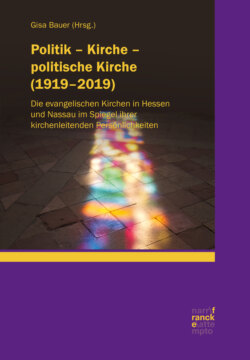Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 17
1. Un pessimisme partagé : entre tragédie et comédie
ОглавлениеLe rapprochement entre les univers poétiques et philosophiques de Leopardi et Lucrèce a été maintes fois abordé. On souligne ainsi chez Lucrèce lʼanticipation subtile du pessimisme dont Leopardi fera son étendard – un pessimisme contenu sous la surface chez Lucrèce, et qui le distingue de son maître Épicure. Cʼest le critique et philologue italien Carlo Giussani qui saisit ainsi la sève toute particulière de ce pessimisme-là, qui se fabrique à partir de la prise de conscience chez Lucrèce que le bonheur tranquille épicurien résulte de la rencontre de forces opposées, cʼest-à-dire que ce bonheur nʼest gagné quʼau prix dʼun déni ou rejet conscient de tendances opposées existantes – et qui ne cesseront pas dʼexister. Dans une formule qui cherche tout dʼabord à identifier la différence de Lucrèce dʼavec Épicure, Giussani observe que « la comédie épicurienne de la nature devient quasiment une tragédie chez Lucrèce », où le poète qui « chante le système philosophique le moins pessimiste de toute lʼAntiquité », non seulement « ne sourit guère, mais, presque toujours sévère, et bien souvent en colère, nous rappelle plutôt le pessimisme de Leopardi1 ».
Cette comédie épicurienne, la comédie du hasard sur fond de chute éternelle et infinie des atomes, a été incarnée dans lʼhistoire de lʼépicurisme – nous ne ferons que le rappeler au passage ici2 – par la figure du philosophe qui rit, qui nʼest autre que le philosophe atomiste, Démocrite. Ce Démocrite rieur, pour citer Sénèque, « ne trouvait rien de sérieux dans ce que tout le monde prenait sérieusement3 ». Dans ce même passage, Sénèque reprend aussi ce que lʼon retiendra dans toute la tradition de transmission de cette figure-là4, notamment lʼopposition au Démocrite rieur de lʼHéraclite pleureur, qui renforce lʼeffet du rire épicurien comme « victoire » de lʼinsouciance, théorisée et rationnelle, sur le constat dʼinsignifiance cosmique de lʼaction humaine5. Cʼest Épicure qui y insiste quand il écrit qu’« il faut rire en même temps que lʼon fait de la philosophie et que lʼon vaque aux affaires de tous les jours6 ». En considérant le rire comme accompagnant ainsi tous les moments de notre vie, Épicure ne conteste pas que lʼon se consacre aux actions quotidiennes mais il met ces actions en perspective, en leur ôtant leur importance. Le rire quʼil préconise nʼest donc pas le rire cynique du « à quoi bon ? », mais bien le rire de la comédie où les sujets, tout en sachant que ce quʼils font est sans grande importance (vu quʼils ne doivent jamais perdre de vue les conclusions de la philosophie), se consacrent tout de même à ces occupations, dans la bonne humeur, voire dans la jouissance – ce que la tradition, dominante depuis lʼAntiquité, de mépris à lʼégard de lʼépicurisme a vite fait dʼinterpréter comme le signe que les Épicuriens ne se consacrent quʼaux seuls plaisirs physiques et immédiats.
Mais entre le rire (sans amertume cynique) et les larmes du sentimental, il y a une brèche qui sʼouvre, peu ou pas approfondie dans lʼAntiquité – si ce nʼest en tant que condition médicale, celle de la mélancolie, traitée dans le corpus des écrits médicaux car elle est essentiellement comprise comme une défaillance physiologique7. Dans cette brèche se développe chez Lucrèce, pour reprendre la fameuse formule de Miguel de Unamuno, un certain « sentiment tragique de la vie8 ». Cʼest là où, tout en restant fidèle à lʼinsouciance épicurienne qui brave le défaitisme cynique, Lucrèce ne peut sʼempêcher de rendre compte de la tristesse du monde des hommes. Unamuno parle bien en effet de Lucrèce comme celui qui « masque, sous lʼapparente sérénité de lʼataraxie épicurienne, tant de désespoir9 ». Ce nʼest pas un pur hasard si, quatre siècles après la mort de Lucrèce, Saint Jérôme rapportera une anecdote (dont on a suffisamment dit quʼelle est inventée de toutes pièces10) selon laquelle Lucrèce serait mort suicidé, dans un excès de folie et malade dʼamour11. Si cette fin, ou du moins ses raisons ne sont ni vérifiables ni plausibles, elles ont été fabriquées à la suite dʼune mythologie dont la source première est bien évidemment le texte même de Lucrèce, où une tendance aux images grandioses et désespérantes (il suffit de penser aux dernières pages du poème qui décrivent de façon visionnaire et apocalyptique la peste dʼAthènes) sʼimmisce dans la présentation de la philosophie tant admirée – aussi parce quʼelle sait consoler et guérir12 – dʼÉpicure.
Cʼest cette tendance, qui va sʼéloignant du bonheur tout en le prônant, que décrit Giussani quand il évoque le renversement de la comédie en tragédie dans le Sur la nature des choses de Lucrèce. Le secret de ce renversement est une des grandes questions des études lucrétiennes : par quel mécanisme une présentation méthodique, fidèle et minutieuse dʼune doctrine philosophique qui a réponse à tous les maux, et recourant, qui plus est, au genre suave et imagé quʼest la poésie en hexamètres dactyliques, finit-elle par nous laisser une image tragique et sans espoir de notre humanité13 ? La nature des choses, telle que nous la montre Lucrèce, cʼest là où les passions amoureuses ne sont que vaines et illusoires ; les rêves, que pures fictions ; où la maladie, la peste, les tremblements de terre et la destruction totale de notre monde sont les événements qui ponctuent notre existence et qui, sʼils ne sont pas encore survenus, surviendront. Le bonheur a beau se trouver dans lʼabsence de trouble – la maxime chérie de lʼépicurisme14 –, à force de détailler ces troubles, cʼest une ataraxie teinte dʼun profond sens tragique de la nature des choses que finit par dépeindre Lucrèce dans son poème.
Cʼest donc un pan de cette alchimie à rebours présente dans le poème lucrétien que nous tentons dʼélucider ici, en proposant, grâce au parallèle avec Leopardi, un autre angle dʼinterprétation, qui interroge la conception du vide que propose Lucrèce. Il sʼagit de voir comment Lucrèce décale le centre dʼintérêt de lʼanalyse du vide par rapport à Épicure : dʼexistant indépendant, chez ce dernier, à existant porteur de qualité négative. En considérant que lʼabsence de qualité est une qualité du vide, une conséquence aussi bien éthique quʼeschatologique sʼensuit : cʼest que la possibilité du bonheur sʼen trouve décalée. Le bonheur nʼest plus dans le monde des humains tel que nous apprenons à le voir par le truchement de lʼanalyse lucrétienne, mais, grâce à la qualité négative du vide, le bonheur promet de se réaliser ailleurs, selon différentes configurations de la matière que le vide tel quʼil est, permettra. Mais il est bien peu probable que ces autres possibles configurations incluent lʼexistence humaine.
Dans le sillage de Giussani, le rapprochement de Lucrèce avec Leopardi peut sʼapprofondir dans le sens de lʼanalyse de la spécificité de leur pessimisme – un pessimisme nourri non pas de fatalisme tragique mais, justement, par la possibilité du bonheur. Tous les ingrédients pour la comédie heureuse y sont réunis. Et pourtant, plus la lucidité ataraxique sʼaffine, plus le poète-philosophe illustre la doctrine et raisonne, plus la possibilité du bonheur est une donnée abstraite et détachée. Il ne sʼagit donc pas de nier la possibilité même du bonheur, mais de se démontrer à soi-même, à travers toute la bonne foi mise au service du raisonnement, que ce bonheur adviendra sûrement, mais seulement pour dʼautres agencements de la matière dont le poète et tout le reste de lʼhumanité sont exclus.
Pour retracer les pas qui portent Lucrèce vers cette vision pessimiste à partir dʼune philosophie essentiellement optimiste, il faut réexaminer la présentation des fondements de la physique épicurienne dans son passage dʼÉpicure à Lucrèce.