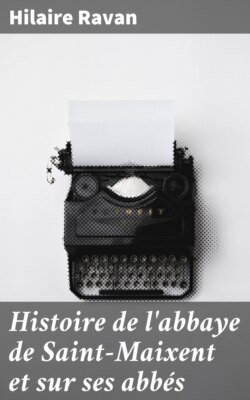Читать книгу Histoire de l'abbaye de Saint-Maixent et sur ses abbés - Hilaire Ravan - Страница 4
ОглавлениеFONDATION DE L’ABBAYE.
Parmi les abbayes qui florissaient au dix-huitième siècle dans le diocèse de Poitiers, l’une des plus remarquables était, sans aucun doute, celle à laquelle un religieux nommé Adjutor, originaire de la ville d’Agde avait, en l’an 500, donné le nom de Saint-Maixent. L’histoire de ce monastère offre un grand intérêt, soit que l’on considère l’antiquité de son origine ou les richesses immenses qu’il posséda, soit que l’on envisage les privilèges dont tant de rois le dotèrent, ou enfin les sièges qu’il soutint, les dévastations et les incendies qui tant de fois menacèrent de l’anéantir.
Je crois à propos de rappeler en quelles circonstances fut fondée l’abbaye de Saint-Maixent, quoique plusieurs écrivains aient déjà traité ce sujet: Un pieux religieux du nom d’Agapit, abbé de Saint-Hilaire de Poitiers, ayant été contraint d’abandonner son monastère qu’Attila, roi des Huns , avait détruit, vint en 459 accompagné de quelques moines, chercher un refuge dans la forêt de Vauclair, située sur la rive droite de la Sèvre-Niortaise, et à 18 kilomètres de la ville de Niort. Là., par leurs soins actifs et éclairés, ces pieux cénobites construisirent des cellules et élevèrent dans ce lieu solitaire un oratoire en l’honneur de Saint-Saturnin, évêque de Toulouse et martyr .
Sous la direction de ce premier abbé, nous devons faire remarquer que cet établissement ne possédait aucun revenu; dès lors pour pourvoir à la subsistance et à l’entretien des religieux, de même qu’aux frais du culte et aux réparations de l’église, on conçoit facilement qu’ils devaient être nécessairement économes, sobres et laborieux. Bien que les terres incultes qui entouraient la forêt où les moines s’étaient établis, fussent défrichées et fertilisées par eux-mêmes, néanmoins le revenu modique qu’ils retiraient des travaux auxquels ils se livraient journellement, suffisait à peine à leurs premiers besoins. Ils ne commencèrent donc à augmenter leurs ressources que lorsque des étrangers en grand nombre, arrivant de toutes les parties de la France, vinrent dans l’intention de se fixer dans ce saint lieu. Ce fut alors que les religieux leur cédèrent certaines parties de quelques-unes des terres qu’ils avaient défrichées, afin d’y construire des logements; mais comme cette cession se fit à un prix inférieur à la valeur des terrains concédés, les acheteurs s’engagèrent à payer à l’établissement, soit en nature, soit en monnaie poitevine, une redevance annuelle.
Les religieux attachés à cette abbaye étaient de l’ordre de Saint-Benoît. On connaît les grands hommes que cette congrégation a produits, on sait également qu’elle a été très-utile à la religion et aux lettres. La règle des bénédictins de cet ordre, œuvre vraiment philosophique et morale, recommandait entre autres choses les exercices de piété, la culture des terres, les travaux littéraires et l’enseignement.
Parmi les bienfaiteurs qui favorisèrent cette institution naissante, nous citerons plusieurs Souverains qui, soit par piété, soit par politique, s’attachèrent dans le principe de la monarchie, à inspirer à leurs peuples les sentiments de religion dont ils étaient animés. Ainsi ils élevèrent des autels, construisirent des temples, fondèrent des monastères qu’ils prirent sous leur protection, créèrent des bénéfices et firent des libéralités.
Or, les princes qui se signalèrent par des actes de bienfaisance, en faveur de l’abbaye, que nous rapporterons en leur lieu, furent Clovis, roi très-chrétien; Pépin-le-Bref; Pépin Ier, roi d’Aquitaine; Charlemagne qui agrandit noblement et gouverna heureusement la France; les empereurs Louis-le-Débonnaire et Lothaire son fils; Charles le Chauve et Pépin II.
Plus tard, des lettres de garde-gardienne ou de protection furent accordées par Philippe-Auguste, Philippe-le-Hardi, Philippe-le-Long, Philippe de Valois et Charles VII.
Indépendamment des avantages exclusifs dont jouirent ces pieux solitaires, ils furent encore protégés par les divers papes qui occupèrent le Saint-Siège du XIe au XVe siècle. Les souverains pontifes Pascal II, Innocent II, Eugène III, Alexandre III, Grégoire XI, etc., leur octroyèrent de hautes prérogatives.
Mais ces libéralités, ces privilèges, ces prérogatives, accordées par la munificence des princes et par la puissance des papes, ne furent encore qu’une faible partie des bienfaits affectés au monastère. Après les rois, les plus grands seigneurs, ainsi que plusieurs fidèles apportèrent aussi leurs offrandes. Les premiers abbés du couvent, ainsi que ceux qui leur succédèrent par la suite, durent employer tous les avantages qui leur furent attribués, à faire des acquisitions propres à augmenter les propriétés qu’ils possédaient déjà.
Aux revenus directs que les abbés retirèrent de leurs nombreux domaines, fruits de libéralités publiques et privées, s’ajoutèrent toutes les redevances qu’ils perçurent: cens, dîmes, droits de péage, de passage, etc.; en outre, par suite de concessions accordées par les rois, les papes, les évêques et les seigneurs, l’abbaye put étendre son patronage sur plusieurs églises, prieurés, chapelles, paroisses, ayant sur les uns le droit de collation directe et sur les autres celui de présentation.
Grâce à ces immenses richesses, à ces nombreux priviléges ecclésiastiques conférés aux abbés, leur puissance temporelle égala, bientôt leur opulence. Dès le moyen-âge ils comptèrent pour vassaux les plus grands seigneurs du Poitou qui leur rendaient foi et hommage. Parmi ceux-ci, on remarquait Hugues Brun, seigneur de Lusignan; un autre Hugues Brun, comte de la Marche et d’Angoulême, seigneur de Couhé ; Aymard, fils de Hugues, comte de la Marche; Hugues l’Archevêque, seigneur de Parthenay et de Vouvant; Arthur, fils du duc de Bretagne, comte de Richemont, seigneur de Parthenay et connétable de France, etc.
En conférant au monastère toutes ces dotations et de si nombreux privilèges, les princes et seigneurs de ce temps étaient sans doute déterminés par le double motif de la piété et de la politique; car il leur importait d’accorder au clergé régulier une utile prépondérance; mais le résultat dépassa leurs prévisions, puisque les religieux placés dans des conditions si brillantes devaient finir par avoir la haute main sur la direction des affaires spirituelles et temporelles. Mais ces hautes prérogatives, ces sages institutions que le moyen-âge protégea pendant bien des siècles, étant devenues plus tard incompatibles avec les idées professées en 1789, elles furent détruites par la Révolution.
Pour donner une idée plus juste et plus étendue des divers événements qui se sont produits du ve au XVIIIe siècle, c’est-à-dire depuis la fondation de l’abbaye jusqu’à sa chûte, en 1791, nous allons diviser notre histoire par époques.