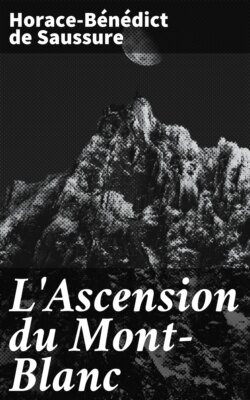Читать книгу L'Ascension du Mont-Blanc - Horace-Bénédict de Saussure - Страница 5
L’ASCENSION DU MONT-BLANC
ОглавлениеDISCOURS PRÉLIMINAIRE
Tous les hommes qui ont considéré avec attention les matériaux dont est construit la terre que nous habitons, ont été forcés de reconnaître que ce globe a essuyé de grandes révolutions, qui n’ont pu s’accomplir que dans une longue suite de siècles. On a même trouvé dans les traditions des anciens peuples, des vestiges de quelques-unes de ces révolutions. Les philosophes de l’antiquité exercèrent leur génie à tracer l’ordre et les causes de ces vicissitudes; mais plus empressés de deviner la nature, que patients à l’étudier, ils s’appuyèrent sur des observations imparfaites, et ils forgèrent des cosmogonies, ou des systèmes sur l’origine du monde, plus faits pour plaire à l’imagination, que pour satisfaire l’esprit par une fidèle interprétation de la nature.
Il s’est écoulé bien du temps avant qu’on ait su reconnaître que cette branche de l’histoire naturelle, de même que toutes les autres, ne doit être cultivée que par le secours de l’observation; et que les systèmes ne doivent jamais être que les résultats ou les conséquences des faits.
La science qui rassemble les faits qui seuls peuvent servir de base à la théorie de la terre, ou à la géologie, c’est la géographie physique, ou la description de notre globe; de ses divisions naturelles, de la nature, de la structure et de la situation de ses différentes parties; des corps qui se montrent à la surface et de ceux qu’il renferme dans toutes les profondeurs où nos moyens nous ont permis de pénétrer.
Mais c’est surtout l’étude des montagnes qui peut accélérer les progrès de la théorie de ce globe. Les plaines sont uniformes; on ne peut y voir la coupe des terres, et leurs différents lits, qu’à la faveur des excavations qui sont l’ouvrage des eaux ou des hommes: or ces moyens sont très insuffisants, parce que ces excavations sont peu fréquentes, peu étendues, et que les plus profondes descendent à peine à deux ou trois cents toises. Les hautes montagnes, au contraire, infiniment variées dans leur matière et dans leur forme, présentent au grand jour des coupes naturelles, d’une très grande étendue, où l’on observe avec la plus grande clarté, et où l’on embrasse d’un coup d’œil, l’ordre, la situation, la direction, l’épaisseur et même la nature des assises dont elles sont composées et des fissures qui les traversent.
En vain pourtant les montagnes donnent-elles la facilité de faire de telles observations, si ceux qui les étudient ne savent pas envisager ces grands objets dans leur ensemble, et sous leurs relations les plus étendues. L’unique but de la plupart des voyageurs qui se disent naturalistes, c’est de recueillir des curiosités; ils marchent, ou plutôt ils rampent, les yeux fixés sur la terre, ramassent çà et là de petits morceaux, sans viser à des observations générales. Ils ressemblent à un antiquaire qui gratterait la terre à Rome, au milieu du Panthéon ou du Colisée, pour y chercher des fragments de verre coloré, sans jeter les yeux sur l’architecture de ces superbes édifices. Ce n’est point que je conseille de négliger les observations de détail; je les regarde, au contraire, comme l’unique base d’une connaissance solide; mais je voudrais qu’en observant ces détails, on ne perdît jamais de vue les grandes masses et les ensembles; et que la connaissance des grands objets et de leurs rapports fût toujours le but que l’on se proposât en étudiant leurs petites parties.
Mais, pour observer ces ensembles, il ne faut pas se contenter de suivre les grands chemins qui serpentent presque toujours dans le fond des vallées, et qui ne traversent les chaînes de montagnes que par les gorges les plus basses; il faut quitter les routes battues, et gravir sur des sommités, d’où l’œil puisse embrasser à la fois une multitude d’objets. Ces excursions sont pénibles, je l’avoue; il faut renoncer aux voitures, aux chevaux même, supporter de grandes fatigues, et s’exposer quelquefois à d’assez grands dangers. Souvent le naturaliste, tout près de parvenir à une sommité qu’il désire vivement atteindre, doute encore si ses forces épuisées lui suffiront pour y arriver, ou s’il pourra franchir les précipices qui lui en défendent l’accès; mais l’air vif et frais qu’il respire, fait couler dans ses veines un baume qui le restaure; et l’espérance du grand spectacle dont il va jouir, et des vérités nouvelles qui en seront les fruits, ranime ces forces et son courage. Il arrive: ses yeux éblouis, et attirés également de tous côtés, ne savent d’abord où se fixer; peu à peu il s’accoutume à cette grande lumière; il fait un choix des objets qui doivent principalement l’occuper; et il détermine l’ordre qu’il doit suivre en les observant. Mais quelles expressions pourraient exciter les tentations et peindre les idées dont ces grands spectacles remplissent l’âme du philosophe! Il semble que dominant au-dessus de ce globe, il découvre les ressorts qui le font mouvoir et qu’il reconnaît au moins les principaux agents qui opèrent ces révolutions.
Du haut de l’Etna, par exemple, il voit les feux souterrains travailler à rendre à la nature, l’eau, l’air, le phlogistique et les sels, emprisonnés dans les entrailles de la terre; il voit tous ces éléments s’élever du fond d’un gouffre immense, sous la forme d’une colonne de fumée blanche, dont le diamètre a plus de huit cents toises ; il voit cette colonne monter droit au ciel, atteindre les couches les plus élevées de l’atmosphère; et là, se diviser en globes énormes qui roulent à de grandes distances, en suivant la concavité de la voute azurée.
Il entend le bruit sourd et profond des explosions que produit le dégagement de ces fluides élastiques; ce bruit circule par de longs roulements dans les vastes cavernes du fond de l’Etna; et la croûte vitrifiée qui le couvre, tremble sous ses pieds. Il compte autour de lui, et voit, jusque dans leur fond, les nombreux cratères des bouches latérales ou des soupiraux de l’Etna, qui vomirent autrefois des torrents de matières embrasées; mais qui, refroidis depuis longtemps, sont en partie couverts de prairies, de forêts et de riches vignobles. Il admire la masse de la grande pyramide que forme l’ensemble de tous ces volcans: elle s’élève de plus de dix mille pieds au-dessus de la mer qui baigne la base; et cette base a plus de soixante lieues de circonférence. Cependant, toute cette pyramide n’est de fond en comble que le caput mortuum, ou le résidu des matières que ces bouches ont vomies depuis un nombre de siècles. Et ce qui augmente encore l’étonnement de l’observateur, c’est que toutes ces explosions n’ont pas suffit pour épuiser dans le voisinage de cette montagne, la matière des feux souterrains; car il voit, presque sous ses pieds, les îles Eoliennes, qui furent autrefois produites par ces feux, et qui en vomissent encore. Mais, considérant de plus près le corps même de l’Etna, le naturaliste observe que, tandis qu’il sort des entrailles de la terre des torrents de minéraux vitrifiés, qui augmentent la masse de la montagne, l’action de l’air et de l’eau ramollit peu à peu sa surface extérieure: les ruisseaux produits par les pluies et par la fonte des neiges, qui entourent, même en été, sa moyenne région, rongent et minent les laves les plus dures, et les entraînent dans la mer. Il reconnait ensuite au couchant de l’Etna, les montagnes de la Sicile, et, à son levant, celles de l’Italie. Ces montagnes, qui sont presque toutes de nature calcaire, furent anciennement formées dans le fond même de la mer qu’elles dominent aujourd’hui; mais elles se dégradent comme les laves de l’Etna, et retournent à pas lents dans le sein de l’élément qui les a produites. Il voit cette mer s’étendre de tous côtés au-delà de l’Italie et de la Sicile, à une distance dont ses yeux ne distinguent pas les bornes: il réfléchit au nombre immense d’animaux visibles et invisibles, dont la main vivifiante du Créateur a rempli toutes ces eaux; il pense qu’ils travaillent tous à associer les éléments de la terre, de l’eau et du feu, et qu’ils concourent à former de nouvelles montagnes, qui peut-être s’élèveront à leur tour au-dessus de la surface des mers.
C’est ainsi que la vue de ces grands objets engage le philosophe à méditer sur les révolutions passées et à venir de notre globe. Mais, si au milieu de ces méditations, l’idée des petits êtres qui rampent à la surface de ce globe, vient s’offrir à son esprit; s’il compare leur durée aux grandes époques de la nature, combien ne s’étonnera-t-il pas, qu’occupant si peu de place, et dans l’espace et dans le temps, ils aient pu croire qu’ils étaient l’unique but de la création de tout l’univers: et lorsque, du sommet de l’Etna, il voit sous ses pieds deux royaumes qui nourrissaient autrefois des millions de guerriers, combien l’ambition ne lui paraît-elle pas puérile? C’est là qu’il faudrait bâtir le temple de la Sagesse, pour dire avec le Chantre de la nature:
«Suave mari magno, etc.»
Les cimes accessibles des Alpes présentent des aspects qui ne sont peut-être pas aussi étendus et aussi brillants, mais qui sont encore plus instructifs pour le géologue. C’est de là qu’il voit à découvert ces hautes et antiques montagnes, les premiers et les plus solides ossements de ce globe qui ont mérité le nom de primitives; parce que, dédaignant tout appui et tout mélange étranger, elles ne reposent jamais que sur des bases semblables à elles et ne renferment dans leur sein que des corps de la même nature. Il étudie leur structure; il démêle, au milieu des ravages du temps, les indices de leur forme première; il observe la liaison de ces anciennes montagnes avec celles d’une formation postérieure; il voit les nouvelles reposer sur les primitives; il distingue leurs couches très inclinées dans le voisinage de ces primitives, mais de plus en plus horizontal es à mesure qu’elles s’en éloignent; il observe les gradations que la nature a suivies en passant de la formation des unes à celle des autres; et la connaissance de ces gradations le conduit à soulever un coin du voile qui couvre le mystère de leur origine.
Le physicien, comme le géologue, trouve sur les hautes montagnes de grands objets d’admiration et d’étude. Ces grandes chaînes, dont les sommets percent dans les régions élevées de l’atmosphère, semblent être le laboratoire de la nature, et le réservoir d’où elle tire les biens et les maux qu’elle épand sur notre terre, les fleuves qui l’arrosent et les torrents qui la ravagent, les pluies qui la fertilisent, et les orages qui la désolent. Tous les phénomènes de la physique générale s’y présentent avec une grandeur et une majesté, dont les habitants des plaines n’ont aucune idée; l’action des vents et celle de l’électricité aérienne s’y exercent avec une rapidité étonnante; les nuages se forment sous les yeux de l’observateur; et souvent il voit naître sous ses pieds les tempêtes qui dévastent les plaines, tandis que les rayons du soleil brillent autour de lui, et qu’au-dessus de sa tête le ciel est pur et serein. De grands spectacles de tout genre varient à chaque instant la scène: ici un torrent se précipite du haut d’un rocher, forme des nappes et des cascades qui se résolvent en pluie, et présentent au spectateur de doubles et triples arcs-en-ciel, qui suivent ses pas et changent de place avec lui. Là des avalanches de neige s’élancent avec une rapidité comparable à celle de la foudre, traversent et sillonnent des forêts, en fauchant les plus grands arbres à fleur de terre, avec un fracas plus terrible que celui du tonnerre. Plus loin de grands espaces hérissés de glaces éternelles donnent l’idée d’une mer subitement congelée, dans l’instant même où les aquilons soulevaient ses flots. Et, à côté de ces glaces, au milieu de ces objets affrayants, des réduits délicieux, des prairies riantes exhalent le parfum de mille fleurs aussi rares que belles et salutaires; présentent la douce image du printemps dans un climat fortuné, et offrent au botaniste les plus riches moissons.
Le moral dans les Alpes n’est pas moins intéressant que le physique. Car, quoique l’homme soit au fond partout le même, partout le jouet des mêmes passions, produites par les mêmes besoins, cependant, si l’on peut espérer trouver quelque part en Europe, des hommes assez civilisés pour n’être pas féroces, et assez naturels pour n’être pas corrompus, c’est dans les Alpes qu’il faut les chercher; dans ces hautes vallées où il n’y a ni seigneurs, ni riches, ni un abord fréquent d’étrangers. Ceux qui n’ont vu le paysan que dans les environs des villes, n’ont aucune idée de l’homme de la nature. Là, connaissant des maîtres, obligé à des respects avilissants, écrasé par le faste, corrompu et méprisé, même par des hommes avilis par la servitude, il devient aussi abject que ceux qui le corrompent. Mais ceux des Alpes, ne voyant que leurs égaux, oublient qu’il existe des hommes plus puissants; leur âme s’ennoblit et s’élève; les services qu’ils rendent, l’hospitalité qu’ils exercent, n’ont rien de servile ni de mercenaire; on voit briller en eux des étincelles de cette noble fierté, compagne et gardienne de toutes les vertus. Combien de fois arrivant à l’entrée de la nuit, dans des hameaux écartés, où il n’y avait point d’hôtellerie, je suis allé heurter à la porte d’une cabane; et là, après quelques questions sur les motifs de mon voyage, j’ai été reçu avec une honnêteté, une cordialité et un désintéressement dont on aurait peine à trouver ailleurs des exemples. Et croirait-on que dans ces sauvages retraites, j’ai trouvé des penseurs, des hommes, qui, par la seule force de leur raison naturelle, se sont élevés fort au-dessus des superstitions, dont s’abreuve avec tant d’avidité le petit peuple des villes?