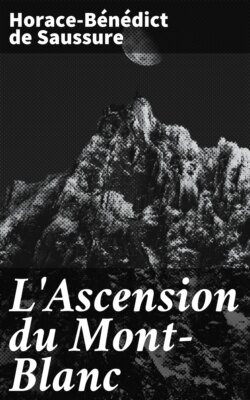Читать книгу L'Ascension du Mont-Blanc - Horace-Bénédict de Saussure - Страница 9
ОглавлениеLa perte du Rhône
Le Rhône, après avoir franchi le passage étroit de l’Ecluse, entre l’extrémité du Mont-Jura et le Vouache, tourne autour du pied de la montagne du Credo. Le pied de cette Montagne est composé de grès, de sable, d’argile et de cailloux roulés. Toutes ces matières, peu cohérentes entr’elles, se laissent creuser par le Rhône, qui, au lieu de s’étendre en largeur, se rétrécit et s’enfonce considérablement. Ce même fleuve qui, auprès de Genève, au-dessous de sa jonction avec l’Arve, a une largeur moyenne de deux cent treize pieds, n’a, sous le pont de Grezin, à deux lieues au-dessous de l’Ecluse, que quinze à seize pieds de large; mais il a en revanche une très grande profondeur.
A une demi lieue au-dessus de ce même pont, le Rhône, coulant toujours dans un lit profondément creusé dans des terres argileuses, rencontre un fond de rochers calcaires, dont les bancs horizontaux s’étendent Par-dessous les argiles.
On croirait que ces rochers, qui paraissent durs sous le marteau, auraient dû mettre un obstacle aux érosions du Rhône, et l’empêcher de s’enfoncer davantage; mais au contraire, il a pénétré dans ces rochers beaucoup plus avant que dans les terres; il les a même creusés au point de se cacher et de disparaître entièrement. C’est là ce qu’on appelle la perte du Rhône.
Il y a peu de voyageurs qui fassent la route de Lyon à Genève, sans mettre pied à terre pour voir cette singularité. Les paysans de Coupy, hameau situé à un quart de lieue au-dessus de la poste de Vanchy et qui domine immédiatement la place où le Rhône se perd, sollicitent les voyageurs d’aller voir cette merveille.
Elle n’est pas également admirable dans toutes les saisons. En été, lorsque les eaux sont grandes, elles ne peuvent pas toutes entrer dans l’excavation du rocher; mais en hiver et au printemps, le Rhône s’engloutit et disparaît en entier, et le spectacle qu’il présente alors est très intéressant.
Le Rhône, avant d’arriver à la perte, coule comme nous venons de le voir, dans un lit profond qu’il s’est creusé dans des terres argileuses. Ce lit redevient cependant plus large; et comme il est très égal et en pente douce, les eaux ne sont point agitées et coulent avec une tranquillité majestueuse. Mais lorsque le Rhône arrive sur le banc de rocher qui passe sous ces argiles, tout à coup le rocher manque sous lui; son lit prend la forme d’un entonnoir, le fleuve entier s’engouffre dans cet entonnoir avec une vitesse et un fracas prodigieux; ses eaux se refoulent mutuellement, s’agitent, se soulèvent et se brisent en écume. Les rochers qui forment cet entonnoir se resserrent même à un tel point, qu’il y a une place où il ne reste Pas deux pieds de distance d’une rive à l’autre; en sorte qu’un homme, même de moyenne taille, pourrait tenir un de ses pieds sur le bord qui appartient à la France, et l’autre sur celui qui dépend de la Savoie , et voir entre ses jambes ce beau fleuve qui semble frémir de colère, et s’efforcer de passer avec toute la vitesse possible dans ce défilé qu’il ne peut pas éviter. Mais cette position serait encore plus périlleuse que brillante; ces pointes de rochers, inclinées et mouillées sans cesse par les eaux qui rejaillissent sur elles, formeraient un piédestal trop glissant au-dessus d’un gouffre aussi terrible.
Un peu au-dessous de ce gouffre, les deux rives sont plus écartées, et l’on voit le Rhône couler assez tranquillement au fond d’un canal qu’il s’est creusé dans le roc. Ce canal est large d’environ trente pieds dans le haut, et il conserve cette largeur jusqu’à la profondeur de trente ou trente-deux pieds; mais là il se ressert considérablement: il s’est trouvé à cette profondeur un banc de rocher plus du r que les autres, et qui ne s’est pas laissé ronger dans toute la largeur du canal. Ce banc n’a qu’un ou deux pieds d’épaisseur; en sorte que le Rhône a creusé par-dessous presque autant que par-dessus. Ce banc plus dur forme donc dans l’intérieur du canal une saillie ou une espèce de corniche, qui, de chaque côté, s’avance de huit ou dix pieds, mais qui est pourtant ouverte dans le milieu, et laisse apercevoir la surface de l’eau qui coule tranquillement dans le fond du canal. Cette corniche divise ainsi le canal en deux parties: l’une supérieure, l’autre inférieure; celle de dessus est un peu plus large que celle de dessous. Le Rhône, renfermé en hiver dans le canal inférieur, paraît couler avec beaucoup de lenteur, sans doute parce qu’il n’a pas une inclinaison bien considérable.
Jusqu’ici donc le Rhône n’est point encore Perdu, puisque l’on voit partout la surface de ses eaux; mais à deux ou trois cents pas au-dessous du gouffre ou de l’entonnoir dont j’ai parlé plus haut, de grandes masses de rochers, qui se sont détachées du haut des parois du canal supérieur, sont tombées dans ce même canal et ont été soutenues par les bords saillants de la corniche qui est au-dessus du canal inférieur. Ces blocs accumulés recouvrent ainsi ce canal, et cachent, pendant l’espace d’environ soixante pas, le fleuve renfermé dans le fond de ce conduit souterrain. C’est donc là que le Rhône est réellement perdu; et c’est cet espace de soixante pas, dans lequel on cesse de le voir, qui se nomme la perte du Rhône.
On peut, en passant par-dessus ces rochers entassés, traverser le Rhône à pied sec; mais ils ne sont pas d’un accès facile. Il faut pour y parvenir aborder sur cette corniche, qui est à trente-un pieds de profondeur dans l’intérieur du grand canal, dont les parois sont taillées à pic. On y descend par une grande échelle, que les paysans de Coupy ont fait faire à dessein; mais cette échelle même est d’un abord difficile, parce que le terrain descend par une pente rapide, jusqu’au bord du canal.
On comprend par là que ce pont, que la nature a placé sur le canal étroit dans lequel coule le Rhône, ne suffit pas pour traverser commodément la rivière. Une échelle de trente pieds, à descendre d’un côté, et à remonter de l’autre, ne fait pas une avenue commode. D’ailleurs le Rhône, lorsqu’il est grand, recouvre tous ces rochers, remplit le grand canal, et s’élève même par-dessus ses bords.
Il a donc fallu que l’art vînt au secours de la nature; on a fait construire un pont en bois, soutenu des deux côtés par un massif en maçonnerie, qui élève le pont à douze pieds au-dessus des bords du canal supérieur. Ce pont se nomme le pont de Lucey.
C’est au-dessous de ce pont, tout près de l’endroit où le Rhône commence à disparaître, que se place l’échelle par laquelle on descend sur la corniche qui règne au-dessus du canal inférieur.
Quand on est descendu sur cette corniche, on peut à son gré examiner de près toutes les particularités de la perte des eaux: on observe la nature des rochers dans lesquels le canal a été creusé ; on voit clairement que le banc qui forme la corniche est d’une pierre plus dure et plus compacte que les autres; on reconnaît que c’est cette corniche saillante qui a été la cause de la disparition du Rhône, puisque, sans elle, les blocs de rocher qui cachent ce fleuve seraient tombés jusqu’au fond du canal, et auraient laissé le Rhône à découvert.
On peut même, en suivant cette corniche, aller observer de près la renaissance du Rhône. On s’attendrait peut-être à le voir ressortir aussi impétueusement qu’il est entré ; mais comme le canal qui le renferme, continue d’être extrêmement profond; comme ce canal n’a vraisemblablement pas beaucoup de pente, ses eaux, à l’endroit où l’on commence à les revoir, paraissent presque stagnantes; on y remarque quelques légers bouillonnements; ce n’est que peu à Peu, et à une certaine distance, que le Rhône reprend la rapidité qui le caractérise.
On dit qu’on a essayé de jeter des corps légers dans le Rhône, pour voir si ces corps ressortiraient avec les eaux, mais que jamais on a pu en revoir aucun. On dit même qu’on y a jeté un cochon vivant, comme un des animaux terrestres les plus habiles à la nage; mais qu’il n’a point reparu.
On devait bien prévoir que ce pauvre animal serait écrasé contre les rochers entre lesquels le Rhône se précipite, et qu’ainsi son habileté à la nage ne pourrait le préserver de la mort, ni le ramener à la surface de l’eau. Quant aux autres corps, que leur légèreté seule devrait ramener à flot, il faut considérer que le Rhône ne reparaît pas tout entier dans une seule place; mais que resserré, comme il l’est dans une fente étroite, ses eaux acquièrent une très grande vitesse, et remontent par des lignes obliques, dont plusieurs s’écartent beaucoup du premier endroit où l’on commence à le revoir. D’ailleurs ces eaux doivent prendre, dans ces gouffres profonds, des mouvements de tournoiement, qui ôtent pendant longtemps aux corps légers le pouvoir de remonter à la surface. Il n’est donc pas étonnant qu’on ne les ait pas vu ressortir auprès de l’endroit où le Rhône commence à renaître.