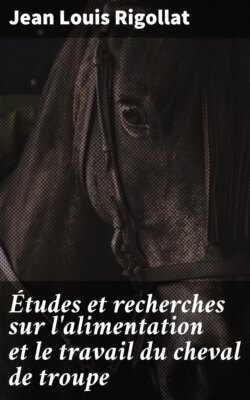Читать книгу Études et recherches sur l'alimentation et le travail du cheval de troupe - Jean Louis Rigollat - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ II. — Phénomènes mécaniques de la digestion.
ОглавлениеTable des matières
Préhension des aliments. — Chez les équidés, la préhension des fourrages, des grains et des aliments plus ou moins pulvérulents se fait par l’intermédiaire des lèvres, des dents incisives et de la langue. La lèvre supérieure, longue, très mobile et extrêmement sensible, fait l’office d’une véritable main qui attire et rassemble les matières alimentaires; les incisives coupent les plantes sur pied et détachent de la botte les brins attirés par les lèvres; la langue, enfin, pousse les aliments sous les dents molaires.
Les expériences de M. Colin ont prouvé que ces trois parties agissent successivement et que le concours de chacune d’elles est indispensable à l’ingestion des substances alimentaires.
Mastication. — Les aliments introduits dans la cavité buccale y sont divisés, écrasés, réduits en pâte pour être attaqués plus facilement par les liquides du tube digestif. Ce phénomène, connu sous le nom de mastication, est dû à l’action des mâchoires munies de leurs dents et mises en mouvement par des muscles spéciaux. Les joues, les lèvres et la langue concourent également à ce but.
Les dents, organes passifs et essentiels de la mastication, ont une forme appropriée à leurs usages. Les incisives n’ont pas, à proprement parler, de surface de mastication; ce sont des lames qui, en se rencontrant à la manière des ciseaux, saisissent et coupent les aliments plutôt qu’elles ne les broient. Les molaires, au contraire, avec leurs large surface de frottement sur laquelle des rubans d’émail dessinent, à tous les âges de la vie, des reliefs plus ou moins irréguliers, sont, comme le disait Cuvier, «des meules qui se repiquent d’elles-mêmes et dont le jeu produit un véritable effet de mouture».
Les mâchoires, sortes de pinces dont les branches sont disposées de manière à s’écarter verticalement et proportionnellement au volume de l’aliment à saisir, sont mises en mouvement, chez les solipèdes, par le crotaphite, le masséter, les deux ptérygoïdiens, le digastrique et le stylo-maxillaire. Ces organes moteurs produisent, comme on le sait, l’écartement, le rapprochement, la prépulsion, la rétropulsion et la diduction.
La langue, par sa motilité est, en quelque sorte, le régulateur de la mastication. C’est elle qui, par ses mouvements les plus variés, attire les aliments dans la cavité buccale, les pousse sous les dents, les y ramène quand ils s’échappent et enfin les rassemble pour les diriger vers le pharynx lors de la déglutition.
Les lèvres servent aussi à la mastication des matières alimentaires en les faisant parvenir dans la bouche et en les retenant dans cette cavité.
Les joues concourent également à l’exécution de cette opération en empêchant les aliments de fuir au dehors des arcades molaires et en les ramenant sous ces dernières à mesure qu’ils échappent à leur action.
Insalivation. — Pendant la mastication, les matières alimentaires s’imprègnent d’un liquide appelé salive, destiné à les ramollir, à faciliter leur déglutition, à rendre leur gustation aussi parfaite que possible et à leur faire subir des modifications préliminaires à celles qu’elles doivent éprouver dans les parties profondes du tube digestif.
Ces modifications préliminaires seront examinées plus loin; nous envisageons seulement ici le rôle mécanique de la salive.
L’appareil salivaire des équidés comprend diverses glandes que Duvernoy a rapportées à deux groupes distincts. L’un, appelé système salivaire postérieur, fournit un liquide clair et limpide, dont le rôle mécanique consiste surtout, en raison de sa fluidité, à délayer, à ramollir les substances alimentaires, pour en rendre la trituration aussi complète et aussi parfaite que possible. L’autre, dit système salivaire antérieur, sécrète une salive épaisse, visqueuse et filante qui englue et entoure le bol alimentaire d’une sorte d’enduit gras qui en facilite la déglutition.
La production du liquide salivaire est constante; elle est, toutefois, plus abondante pendant la mastication. Colin a évalué à plus de 30 kilos ce qu’un cheval peut sécréter de salive par jour.
A mesure que la mastication et que l’insalivation s’opèrent, les aliments forment un magma pâteux appelé bol alimentaire, d’autant mieux préparé pour la digestion que la mastication des matières a été plus parfaite et que leur insalivation est plus complète. Cela donne à l’intégrité et à la solidité de l’appareil dentaire, ainsi qu’au fonctionnement normal des glandes salivaires, un rôle très important dans la fonction digestive.
Déglutition. — Le bol alimentaire, une fois formé et recouvert de salive gluante, est amené, surtout par les mouvements de la langue, sur la face dorsale de cet organe, dont la base forme un plan incliné en arrière pour faciliter le glissement des aliments vers le fond de la bouche. Un mouvement d’abaissement et de retrait de la portion fixe de la langue, déterminé par la contraction des muscles hyoïdiens, leur fait franchir l’isthme du gosier, lubrifié par le fluide des amygdales.
Ils tombent ainsi dans le pharynx, dont les parois musculaires, en se contractant sur eux, les poussent dans l’œsophage. Les contractions péristatiques de celui-ci les saisissent à leur tour et les conduisent jusque dans l’estomac.
La déglutition du bol alimentaire et son transport dans le renflement gastrique sont d’autant plus faciles et plus rapides qu’il a été mieux mâché et mieux insalivé.
Phénomènes mécaniques de la digestion stomacale. — Les diverses parties du tube digestif traversées jusqu’ici par les aliments n’étaient, en quelque sorte, que des lieux de passage. Les substances dégluties font, au contraire, un plus ou moins long séjour dans l’estomac, pour y subir l’action des sucs digestifs. Cet organe, revenu sur lui-même pendant l’état de vacuité, se dilate alors pour les recevoir et pour permettre leur accumulation dans leur intérieur. Il agit, de plus, par ses mouvements, pour faciliter le travail de la digestion, en présentant les diverses parties de la masse alimentaire au contact du suc gastrique.
Les contractions de l’estomac, provoquées par la présence des aliments, par leur température et leurs propriétés plus ou moins stimulantes, jouent un rôle très important. Elles retiennent les matières alimentaires dans le ventricule stomacal; elles stimulent la muqueuse et activent la sécrétion du suc gastrique par l’excitation mécanique qu’elles font éprouver à cette membrane et aux glandes qu’elle renferme; elles favorisent la désagrégation, l’atténuation des aliments; elles brassent, mélangent les différentes parties de la masse et leur impriment une agitation qui leur permet de s’imprégner plus complètement du fluide dissolvant; enfin, elles poussent les matières dans l’intestin à mesure que leur chimification s’effectue.
Phénomènes mécaniques de la digestion intestinale. — Lorsque les phénomènes de la digestion stomacale sont terminés, l’orifice pylorique de l’estomac se dilate pour laisser passer la masse alimentaire. Celle-ci s’introduit par portions fractionnées dans le duodénum, où elle se mélange avec la bile et le suc pancréatique; elle passe ensuite dans le jéjunum, puis dans l’iléon et tombe enfin dans le gros intestin, où nous allons bientôt la retrouver.
Le mouvement de progression de la bouillie alimentaire est déterminé, dans l’intestin grêle, par les contractions des deux sortes de fibres musculaires lisses de cette portion du conduit intestinal. La partie d’intestin dans laquelle vont s’engager les aliments vient, en quelque sorte, au-devant de ceux-ci par la contraction de ses fibres longitudinales, tandis que la section intestinale que cette espèce de bol vient de franchir pousse celui-ci en arrière par la contraction de ses fibres circulaires. Il en est de même pour toutes les fractions de la masse alimentaire.
Les aliments qui n’ont pas été absorbés dans l’intestin grêle et les boissons qui cheminent rapidement dans cet organe passent dans le cœcum, dont la disposition, si remarquable chez les solipèdes, permet de tenir en dépôt les matières délayées et de les empêcher de refluer dans le petit intestin. Les substances que reçoit le réservoir cœcal tombent vers sa partie déclive, s’accumulent, se mélangent dans son intérieur et y éprouvent des élaborations et des transformations analogues à celles qui s’opèrent dans l’intestin grêle. Enfin, lorsque le cœcum est trop plein ou que les parois de ce sac se contractent de la partie déclive vers la plus élevée, la bouillie nutritive remonte contre son propre poids pour passer avec lenteur et en petite quantité dans le côlon replié.
Arrivées dans l’intérieur de ce large canal, où elles se tassent plus ou moins, les matières alimentaires, encore délayées jusqu’au niveau de la courbure pelvienne, prennent de la consistance à mesure qu’elles se rapprochent du côlon flottant. Leur marche est favorisée par les plis appelés improprement valvules conniventes, valvules qui divisent la masse, l’ébranlent portion par portion, par un mécanisme que M. Colin a comparé à celui des palettes d’une roue hydraulique.
Parvenues enfin dans le petit côlon, les substances alimentaires ont cédé aux absorbants une grande partie des liquides qui les imprégnaient. A mesure qu’elles cheminent dans cette dernière section du canal digestif, elles deviennent de plus en plus solides et résistantes. Les valvules conniventes divisent la masse en petites pelotes, qui se tassent progressivement et se recouvrent d’une légère couche de mucus. En passant d’une cellule dans la cellule suivante, chaque pelote conserve sa forme et son volume, sans jamais se réunir avec celles qui l’avoisinent. Elles s’accumulent dans le rectum en quantité plus ou moins considérable, jusqu’ au moment de leur élimination.