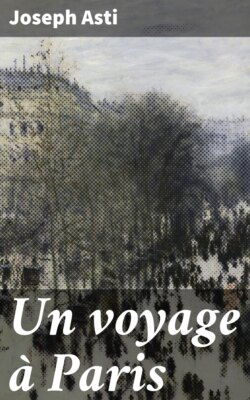Читать книгу Un voyage à Paris - Joseph Asti - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Départ — Voyage — Arrivée à Turin.
ОглавлениеTable des matières
«Pour un jeune-homme qui va faire un voyage d’agrément, il me paraît bien triste, ce pauvre ami». — Si tu as dit cela en me voyant partir, tu ne t’es pas trompé. Je ne saurais pas dire si c’étaient les pensées que je roulais dans mon esprit, ou bien le mauvais état de ma santé ; mais j’étais bien triste alors. Dieu merci, je ne le suis plus, et, quoique je ne sois pas entièrement guéri, je sens que je me porte mieux et que je puis écrire. — Je ne te ferai pas un détail minutieux de mon voyage, mais je dirai peut-être assez et pour dégager ma parole, et pour satisfaire l’envie que tu m’as témoignée de savoir tout ce qui peut intéresser ta curiosité.
Il faut d’abord que tu saches ce que c’est que l’intérieur d’une diligence. Suppose donc cinq ou six individus qui se heurtent, qui se remuent, qui se tournent et retournent pour se mettre à l’aise le mieux possible. Tu en vois un qui décharge ses poches pour remplir les sacoches de la voiture; l’autre qui assure son parapluie et sa canne aux courroies qui se trouvent derrière lui; un troisième qui s’occupe à couvrir son crâne chenu ou pelé, d’une calotte écarlate crasseuse, après avoir appendu quelque part son chapeau; enfin un dernier qui se donne bien de la peine pour se serrer dans son manteau, quoique la saison ne soit pas encore bien avancée, et qui finira par le soupir prolongé de quelqu’un qui se repose après un long travail. — «Y êtes-vous, Messieurs?» crie le conducteur. — Nous y sommes, — répond une voix cassée qui part du dedans. — Mais non, vous n’êtes que cinq. Ah! le voilà. Allons, Mr, en voiture». — Il est censé que tu occupes la première place à gauche en entrant, que ton vis-à-vis est une dame seule, jeune et jolie, bien entendu, et que le dernier venu, gros homme de 50 ans environ, habillé d’une longue rédingote café, portant un grand manteau gris-noir par dessus, ira se placer à l’extrémité opposée. Ce pauvre diable, qui ne s’était que trop aperçu d’être en retard, arrive essouflé, il monte en chancelant, mais à peine a-t-il fourré sa personne toute entière dans la voiture, qu’il se tourne vers la dame et la prie de lui pardonner la peine qu’il lui cause: la diligence fait alors un mouvement et il t’écrase le nez avec son derrière. Tu deviens rouge de colère, tu veux crier, mais un mot d’excuse que balbutie ton homme te désarme. Il reprend son équilibre et marche honnêtement de toute la pesanteur de son corps sur ton pied gauche: tu es tenté de le pousser vivement, mais le respect pour la dame, sur laquelle il irait tomber de l’autre côté, te retient. Il passe enfin et gagne sa place, mais il n’a pu y parvenir qu’en écrasant, qu’en collant ton chapeau là, où tu l’avais attaché. Tu es encore une fois tenté de t’emporter, mais un regard de la dame à qui tu veux montrer de la bonté, déride ton front, tend tes sourcils et change ta colère en un sourire. Alors on te donne un bon coup de pied sur le devant de la jambe, mais ne te fâche pas, c’est l’homme à la calotte crasseuse qui te crie de toute la politesse dont il est capable. «Faites-en autant, M.r; alongez vos jambes». Mais non: j’oubliais que ton vis-à-vis est une dame. Il faut être poli avec les dames, il faut en avoir soin quand elles sont seules: ainsi, la voyant distraite, tu appuies mollement ta main sur un de ses genoux pour attirer son attention, et d’une voix doucereuse tu lui dis: «Madame, mettez-vous à votre aise; passez votre pied entre mes jambes: que la crainte de me gêner ne vous retienne pas». La dame te remercie d’un sourire et ne déploie son genou qu’à demi; mais c’est égal: le voyage est long, il y a du tems pour tout.
L’ordre est enfin établi, et l’ordre amène un silence parfait qui n’est interrompu que par le roulement de la voiture. Alors chacun de tes compagnons se recueille, se concentre et ne paraît plus s’occuper que de ses réflexions. Les uns, tournés à leur droite ou à leur gauche, regardent d’un air distrait les objets en dehors qui semblent s’enfuir derrière eux avec la rapidité de l’éclair, et donnent dans leur apparente distraction un dernier adieu à la patrie, que des affaires pressantes ou l’envie de voir de nouveaux pays, leur fait quitter pour quelque tems; les autres songent à des objets très-chers qu’ils vont embrasser après une absence bien longue peut-être; d’autres enfin, que l’habitude de voyager rend étrangers à ces sentimens, examinent d’un œil scrutateur le voisin que le hasard leur donna, et qui pourra bien être pour une semaine toute entière leur compagnon de voyage.
Le fracas de la lourde voiture continue, on atteint la barrière, on la dépasse, et quelqu’un, naturellement plus bavard que les autres, commence à s’ennuyer d’un silence qui lui paraît trop long. De quoi parlera-t-on? Ne sois pas en peine pour cela: c’est déja convenu, on parlera du tems. C’est une ressource commune, bonne pour l’intérieur d’une diligence comme pour un salon, quand par politesse il faut rompre le silence, ou quand on le veut pour la seule envie de parler. — Dans le dessein où je suis de te rapporter quelqu’une des conversations qui se tinrent dans la voiture où je me trouvais, je te ferai grâce de la conversation sur le tems, parce qu’elle me parait moins digne d’intérêt que les autres. — Il faut avant tout que je te dise qui étaient mes compagnons de voyage. — J’occupais la première place dans l’intérieur, à côté j’avais une Turinaise qui parlait très-bien le français, et que j’avais prise d’abord pour une française. Elle avait 25 à 30 ans, la couleur de sa peau était légèrement tannée, ses traits fort réguliers, ses yeux vifs et sa taille, qui n’était pas des plus riches, était assez bien prise: fort aimable du reste, quoiqu’elle ne parlât que très-peu. L’autre, car nous étions trois dans le fond, était un jeune--homme d’environ 27 ans, compatriote de la dame: ils ne se connaissaient pourtant pas. Il avait été à Milan pour voir la ville, et il la quittait alors pour retourner à Turin. Notre vis-à-vis était. un couple gènevois, couple très-mûr et assez puissant de ses deux personnes pour occuper à lui seul toute la banquette opposée. Le mari avait une face ample, ronde et bourgeonnée, couleur pourpre: il relevait à tout instant ses besicles, et riait à chaque propos d’un rire stupidement complaisant, en approuvant tout ce que l’on disait. Sa compagne lui convenait si bien, que l’on pouvait dire, que les deux faisaient la paire; elle nous épargnait cependant les éclats de rire. — Le jeune-homme entama la conversation, il parla de Milan, et chacun d’y glisser son petit mot. Il trouva cette capitale fertile en belles femmes, mais il remarqua, à son grand regret, qu’elles sont trop sévères: le couple suisse trouva qu’il y a à Milan de bonnes auberges et que l’on y mange très-bien pour peu d’argent; pour la dame turinaise, elle fit en peu de mots un bel éloge à la sincérité du caractère, à la bonne foi et à l’amabilité des Milanais. Moi, qui n’ai pas parlé alors, je.parlerai maintenant et je crierai: «Femmes, aubergistes, citoyens milanais, ne vous enorgueillissez pas! Ils auront peut--être dit la vérité, mais l’éloge d’un étranger qui passe ne vaut rien, ou bien peu!» Un étranger, quand il ne s’arrêterait qu’une heure seule dans une ville, voudrait la juger, et c’est selon. A-t-il rencontré par hasard une laideron aux manières libres? Toutes les femmes sont laides mais faciles. Est-il tombé dans les mains de quelque juif d’hôte, qui l’a mal traité, qui l’a écorché ? Toutes les auberges sont mal servies et diablement chères. Pour les manières, pour les mœurs des citoyens, il leur suffit une personne ou deux à qui ils ont eu affaire pour juger de toute la ville. — Après ces éloges on voulut descendre à quelques détails, et, comme il est naturel. on commença par la Cathédrale. Le jeune-homme avait eu l’avantage de voir sa façade une nuit au clair de la lune, en sortant de l’opéra; il n’en parla que par des monosyllabes. Uhh!.... Ah!.... Oh!.... et il accompagnait ces exclamations de grands gestes, ce qui coûta un peu cher au chapeau de la Turinaise. Ce fut après le tour du Grand-Théâtre. Les Gènevois remarquèrent que les banquettes du parterre sont fort commodes; le jeune-homme trouva les danseuses charmantes. «Pour les danseuses, dit alors la dame de Turin, elles dansent fort bien, mais elles sont un peu indécentes». — «Mais, c’est leur grand mérite, interrompis--je à mon tour; d’ailleurs vous conviendrez, M.me, qu’il faut bien qu’elles plaisent aux habitués du parterre: ce sont eux qui font les réputations théâtrales, et malheur à celui ou à celle qui ne trouvera pas le moyen de leur plaire! » — La dame, prenant cela pour une simple plaisanterie, se mit à rire, et le couple suisse, qui avait approuvé la remarque de Madame, ne fut pas moins complaisant pour moi. Cependant, si je dois l’avouer, je m’étonnais de ce que l’on n’eût pas encore médit de notre bonne ville de Milan, car je ne comptais pas pour de la médisance l’observation de la Turinaise sur les danseuses; nous avons déja vu que, moyennant mon adresse, cette observation avait tourné à l’avantage de ces bonnes filles. Je m’étonnais donc, d’abord parce que je sais que la médisance est l’assaisonnement de toute conversation suivie, un plaisir délicieux, et un plaisir qui ne coûte rien, et puis, parce que j’ai assez bien appris que, pour prouver aux autres que nous avons vu et connu, il faut en dire du mal. Toutefois je ne perdis rien pour avoir attendu. Le jeune-homme, comme s’il eût deviné ma pensée, se déchaîna tout à coup sur notre cher patois et il en dit tant de mal, que, pour une raison contraire, j’en fus étonné une seconde fois. Il poussa la méchanceté jusqu’à le traiter de sale ce pauvre patois, si cher, si expressif. Oh! si notre Porta eût pu soulever la tête hors de son tombeau pour entendre ces blasphèmes! Je suis persuadé qu’il aurait trouvé moyen de nous envoyer de l’autre monde un sonnet, au moins, contre l’ignorance de cet insolent. Pour moi je ne pus me taire: malgré mon rhume, je m’écriai: «Monsieur, vous n’avez passé que quelques jours à Milan, et au peu de termes que vous relevez de son patois, il paraît que vous n’avez eu affaire qu’à des garçons d’hôtel, à des conducteurs et à des porte-faix: vous ne pouvez pas juger du patois milanais. Et puis, vous turinais, vous qui en avez un si désagréable à tous les Italiens, mélange d’italien et de français, vous qui avez toujours recours à ce dernier parce que vous avez presque honte de faire entendre aux étrangers votre jargon, vous osez tourner en ridicule le patois milanais? Oh! je suis bien fâché que mon enrouement ne me permette pas de vous en dire davantage! J’aurais bien pu vous prouver que ce patois est moins sale que vous ne dites». Il demeura court à cette tirade; la dame sa compatriote souriait, et les deux Genevois, qui approuvaient par de grandes inclinations de tête tout ce que je venais de dire, m’avaient l’air de deux cloches: l’une se baissait quand l’autre se levait; ils continuèrent si long tems ce mouvement comique, qu’enfin je ne pus m’empêcher d’éclater de rire à leur nez.
Vers deux heures de l’après-midi nous arrivâmes à la frontière. La frontière est une station à laquelle un voyageur, qui la passe pour la première fois, n’est jamais indifférent. Dès qu’il se voit aux confins, il ouvre de grands yeux, il examine, il cherche la différence qui passe entre les objets qui l’environnent et ceux de son pays; il se croit à cent lieues de chez lui, et veut voir par tout quelque curiosité digne de son attention; les arbres sont plus petits, la campagne moins fertile, les maisons trop pointues et les hommes drôlement habillés. Il interroge ses compagnons sur le voyage qu’il a fait, et est tout étonné d’apprendre qu’il n’a fait que 15 milles. Cependant il voyage sur un sol étranger et cette réflexion suffit pour concentrer toutes ses idées: sa famille, ses amis, ses habitudes se présentent à son esprit, et lui arrachent un profond soupir; il avance la tête hors de la portière et regarde avec tendresse le pays qu’il vient de traverser, comme s’il ne devait plus le revoir. — En attendant la voiture s’arrête: on vous demande vos passeports, on fait descendre vos malles, y-compris celle du novice qui proteste envain à tous les douaniers qu’il n’a aucun objet de contrebande. Cet infortuné, voyant ballotter impitoyablement ses effets, les accompagne de l’œil, place son sac de nuit sur sa malle, son étui-à-chapeau à côté et ne les quitte plus, ces chers objets, ces compagnons indivisibles de son voyage, parce qu’on lui a dit tant de choses avant de partir qu’il craint un fripon, un voleur dans tous ceux qui l’entourent.
L’inspection que l’on nous fit à la frontière dura plus d’une heure et demie, parce que nous avions dans le coupé un chirurgien-dentiste avec sa femme, qui avaient plus de malles et de caisses à eux deux, que nous tous. Les commis des douanes son généralement indulgents, mais ils ne le sont jamais avec un étranger qui a plus de bagage qu’il n’en faut ordinairement à un voyageur. — «Qu’est-ce que c’est que cette grande caisse noire?
— C’est du linge, — répond la femme d’une voix fluette et douce.
— Voyons.
— Elle est clouée.
— Nous ferons sauter les clous.
— Mais je vous assure qu’il n’y a rien d’autre que du linge.
— Je le crois bien».
Alors sur un signe du commis la caisse est ouverte, le linge remué, froissé, renversé. La dame plie sa taille fine, se met à genoux devant sa caisse, et tandis qu’elle ramasse et arrange son linge, le commis continue son inspection.
— «A qui est cette autre caisse blanche?
— Vous voyez, répond encore une fois la dame en haussant la tête; même nom que celle-ci». — Le nom du chirurgien en effet était là écrit en gros caractères; c’est un nom fort répandu à Milan, où ce Monsieur faisait sa demeure.
— «Est-ce encore du linge ça, — continue le commis?
— Ce sont des livres de ma composition, — répond enfin le dentiste d’une voix moitié fière, moitié suppliante. *
— Voyons». — Malgré le grand nom de l’auteur, cette seconde caisse ne fut pas mieux traitée que la première. Tous ces livres, dont il était si fier, et qui étaient son ouvrage, consistaient en un petit volume que j’ai connu par hasard à Milan et qui prouve que.... c’est à dire, qui ne prouve rien, mais c’est égal. Les livres renfermés dans la grande caisse étaient une édition que le dentiste avait faite au profit d’une des pieuses institutions de Milan (action vraiment charitable, qui devait lui attirer la presse), mais voyant apparemment qu’elle ne profitait à personne, le pieux dentiste n’avait pas jugé à propos de se séparer de son ouvrage. Ce qui est à plaindre pourtant, c’est, qu’avec ses grandes caisses, il m’a l’air de nous avoir quittés pour toujours. C’est dommage! Il aurait conservé par le pouvoir de son art la blancheur de nos dents, et pour long tems, à moins qu’elles ne se fussent gâtées: il arrêtait les progrès de quelque carie que ce fût, pourvu que ce ne fût pas des plus obstinées. Et puis, son élixir! Cet élixir qui intéressa tant les commis de la douane et qui nous arrêta si long tems aux frontières, cet élixir, dis-je, nous l’avons perdu! Quel dommage! Mais puisqu’il voulait nous quitter si tôt, à quoi ces affiches qui nous rendaient si tranquilles sur l’avenir de nos dents! A quoi ce grand salon si richement meublé ! A quoi cette éblouissante livrée toute neuve qui se présentait pour recevoir la pratique, et qui nous faisait concevoir une opinion si avantageuse pour le maître! N’était-ce que pour nous avertir qu’il était français? Mais c’est inutile, nous l’avons perdu.
L’inspection finie, on rechargea la voiture, et après avoir récompensé les porte-faix de la peine qu’ils s’étaient donnée de descendre et remonter nos effets, nous partîmes. — Nous arrivâmes jusqu’à quelques milles de Novare sans accident, lorsque, m’apercevant que ma compagne la Turinaise ne disait plus mot, je me tournai pour voir si elle dormait; je la trouvai pâle comme si elle était mourante.
— «Qu’avez-vous, madame? — lui dis-je aussitôt.
— Rien, — répondit-elle, ça passera.
— Comment rien! — continuai-je. — Mais, au risque de paraître impoli, je vous préviens que vous êtes pâle comme la mort. Voulez-vous que je fasse arrêter la voiture?
— Oh non! Je n’y consentirai pas: ce ne sera peut-être qu’un peu de malaise.
— Alors vous consentirez à prendre ma place: vous pourrez ici appuyer votre tête à la paroi de la voiture et vous serez, j’espère, moins mal». — Cela dit, je me levai le mieux que je pus et je la forçai d’accepter. Elle leva alors ses beaux yeux sur moi et me fit, sans parler, un remercîment qui en valait bien un autre. Les choses étaient encore dans cet état, quand nous arrivâmes à Novare. J’aurais bien voulu que cette joufflue de Gènevoise eût pris soin de la malade. Les femmes ont un tact tout particulier pour soigner une personne qui souffre, tandis que nous autres hommes, malgré notre bon cœur, nous sommes en pareilles circonstances bien gauches, mais elle n’y songea nullement. Elle était peut-être affamée, la grosse dame, et renoncer à une bonne table d’hôte toute prête qui nous attendait, ç’aurait été châtier trop cruellement son ventre et ses joues, qui d’ailleurs étaient très-innocens. Poussé donc par un sentiment de compassion qui est naturel en pareil cas, sur-tout quand le patient est une jeune et jolie dame, je fis moi--même ce que j’avais un instant attendu d’autrui. J’aidai ma compagne à monter dans une petite chambre séparée que l’on nous avait indiquée, je lui fis boire un bouillon et, moyennant quelqu’autre petit secours dont elle paraissait avoir besoin, j’eus la consolation de voir au bout d’une demi-heure que mes peines n’avaient pas été perdues. Ses membres recouvrèrent leur force, son teint reprit sa couleur, et, dès qu’elle put parler librement, elle me remercia avec beaucoup de tendresse de tout ce que j’avais fait pour elle, et me pria d’aller dîner. Je lui répondis que, pour les petits services que je lui avais rendus, il ne valait pas la peine d’en parler, et que, pour mon repas, je me serais contenté de prendre quelque chose avec elle, vu qu’il était déja trop tard pour profiter de la table d’hôte. Elle ne répondit rien, mais elle me parut fort charmée de ce que je ne consentais pas à la quitter. Nous mangeâmes donc ensemble quelque mets, chacun suivant son appétit, puis, comme le tems que l’on nous accorda fut long à cause du changement de voiture, nous commençâmes une conversation qui devint peu à peu très-intéressante, pendant laquelle elle fit paraître une bonté de cœur et une amabilité, dont je ne la croyais pas capable. Elle me parlait sans cesse des obligations qu’elle disait avoir envers moi, plus, ne voulant pas demeurer en reste de franchise à l’égard de quelques petites confidences que je lui fis, elle m’apprit qu’elle était veuve, et qu’elle avait été bien malheureuse. En prononçant la parole malheureuse, elle soupira profondément, et fit en même tems un geste qui marqua toute l’horreur qu’elle ressentait en rappelant ses tristes souvenirs. Il n’en fallait pas tant pour m’inspirer la plus vive curiosité d’apprendre ses malheurs. Je lui en témoignai mon envie: elle hésita quelques instans, puis elle me répondit, que l’histoire en était trop longue et que le tems qui nous restait n’aurait pas suffi pour son récit, attendu qu’elle ne consentirait jamais à le continuer dans la voiture. — «Cependant, continua-t-elle, vous avez été trop sincère avec moi, et je vous ai trop d’obligations pour vous refuser ce plaisir. A Turin, puisque vous comptez vous y arrêter quelques jours, je trouverai, j’espère, le moyen de vous satisfaire». — J’allais répliquer, lorsque le conducteur entra pour nous avertir que l’on se disposait à partir. Nous montâmes dans la diligence, et je voulus que ma Turinaise gardât ma place, ce que je ne pus obtenir qu’après quelques difficultés. Nos compagnons de voyages arrivèrent presque en même tems, bien repus et fort satisfaits de leur dîner. Le couple gènevois s’avançait lentement, ne pouvant plus tenir dans sa peau. — La conversation fut d’abord générale, mais peu intéressante, cependant, comme la nuit était tombée, elle languit bientôt et finit par s’éteindre, laissant que chacun se disposât à dormir. Ma dame, après avoir ôté son chapeau, déploya un beau mouchoir blanc et s’en couvrit la tête, en le nouant sous son menton: elle me parut plus jolie. — Ce ne fut pas la nuit la plus délicieuse pour moi: peu accoutumé à un voyage un peu long, j’étais fatigué et presque souffrant; d’ailleurs la chaleur, qui régnait dans cette voiture fermée, m’étouffait. Quand il plut à Dieu, à six heures du matin, nous arrivâmes à Turin. La première question que me fit ma Turinaise en arrivant, ce fut de me demander où j’irais loger.
— «Mais je n’en sais rien, madame, — répondis-je: — il me faudra bien aller au hasard, car je n’ai aucune connaissance de Turin.
— En ce cas, — reprit-elle, — vous risqueriez d’être mal logé.
— Si vous connaissez quelque auberge, — continuai-je, — qui puisse me convenir, vous m’obligerez beaucoup de me l’indiquer». — Les sentimens de reconnaissance qu’elle m’avait témoignés, et l’amitié qu’elle avait déja conçu pour moi en conséquence de tout ce qui s’était passé entre nous, l’avaient peut-être déja disposée à me rendre ce service. Ainsi, sans hésiter, elle me dit qu’à peu de distance de la messagerie il y en avait une, qui me convenait parfaitement et qu’elle connaissait fort bien, attendu que le propriétaire était un vieux parent de feu son mari. Là--dessus elle m’en donna l’adresse et, par des discours qu’elle me tint après, me laissa entrevoir la possibilité de l’entretenir quand elle serait venue voir son parent. Ravi de la disposition favorable dans laquelle je la voyais à mon égard, je la remerciai de sa politesse et nous nous quittâmes. Ainsi à demain.