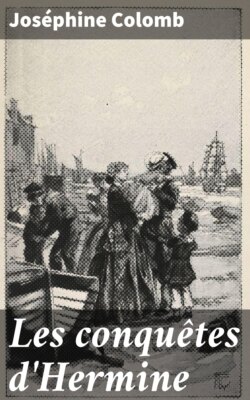Читать книгу Les conquêtes d'Hermine - Josephine Colomb - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sauvés! — Hermine mousse. — Voyage du Passe-Partout. — Histoire de Numa Girague et de sa famille. — Arrivée à Saint-Nazaire.
ОглавлениеLe capitaine Baudoin écarta vivement la couverture et regarda du côté que lui indiquait le petit doigt tendu d’Hermine. C’était bien un grand, un très grand bateau qui s’avançait avec ses voiles blanches toutes gonflées: il était déjà haut sur l’horizon, et se détachait tout entier sur le ciel clair. Il marchait vite, car il grandissait de minute en minute; on distinguait nettement sa voilure, ses trois mâts avec leurs vergues, et son beaupré garni de ses focs. «S’il allait passer sans nous voir! «pensa le capitaine. Il saisit un aviron, attacha la couverture au bout, et l’éleva aussi haut qu’il put en l’agitant. Le soleil donnait sur l’étoffe blanche: pour peu qu’on regardât de ce côté-là, on devait l’apercevoir du trois-mâts.... «Ils approchent... c’est un bateau français..., on s’agite à bord..., ils mettent une embarcation à la mer..., elle vient vers nous! ils nous ont vus, ils viennent nous chercher!»
Et le capitaine, laissant tomber son signal devenu inutile, prit Hermine dans ses bras et se tint debout dans son canot, les yeux fixés sur la chaloupe qui s’approchait.
La petite fille riait et battait des mains. Tout à coup elle étendit les bras vers les sauveteurs et cria: «Kerzoncuff!»
Le capitaine crut qu’elle était trompée par une ressemblance. A bord du Saint-François, Kerzoncuff était son favori. Mais au cri de l’enfant, d’autres voix répondirent de la chaloupe: «Capitaine! capitaine Baudoin! Hourrah! Vive le capitaine Baudoin!»
Un dernier vigoureux effort des rameurs, et la barque arriva dans les eaux du canot. Le capitaine avait repris ses avirons, pour s’en servir cette fois selon leur destination première: il accosta la chaloupe, sauta à bord et tomba dans les bras de Kerzoncuff qui riait, qui pleurait, qui l’embrassait, qui balbutiait: «Capitaine... oh! mon capitaine.... Seigneur Dieu! quel bonheur! Ah! oui, elle l’aura son cierge, Notre-Dame de Bonne-Garde!... Quand je le disais qu’un homme comme vous tient bon tant qu’il est en vie!»
A bord du Passe-Partout, ce fut une autre fête. L’équipage du Saint-François acclama son capitaine, et les hommes des deux navires reçurent la ration des grands jours. Le capitaine Rospinneuc les casa tous: il y avait de la place à bord du trois-mâts. Il put aussi fournir des vêtements de rechange à son confrère; mais personne ne pouvait en prêter à Hermine, vêtue seulement de sa petite chemise, et qui pourtant ne s’arrangeait pas de rester toujours enveloppée dans une couverture. Heureusement, les marins sont ingénieux; l’un d’eux, qui avait jadis fait son apprentissage pour être tailleur, lui confectionna un petit costume de mousse. A l’âge qu’elle avait, cela ne tirait pas à conséquence; et il n’avait pas étudié le métier de couturière.
Comme il n’était pas cordonnier non plus, il ne lui fit point de souliers; mais le pont du bateau était un beau plancher bien uni, qui ne blessait pas ses petits pieds roses. Elle y trottinait toute la journée, suivie et surveillée par Kerzoncuff, qui s’était institué bonne d’enfant et qui se prêtait à ses fantaisies avec une complaisance inépuisable. Il fallait voir ce mousse en miniature essayer de grimper aux cordages et faire l’exercice avec un bâton! Les matelots faisaient cercle pour la regarder; le capitaine Baudoin, qui l’adorait depuis qu’il l’avait sauvée, poussait de gros soupirs à l’idée qu’il serait obligé de la rendre à sa famille; et le capitaine Rospinneuc, qui était resté vieux garçon, déclarait qu’il se serait certainement marié s’il avait su que c’était si gentil que ça, un petit enfant.
Le Passe-Partout continua donc son voyage avec des passagers de plus. Il en avait encore pour quelque temps: il devait toucher au Cap, au Gabon et aux Açores, avant de rentrer à Saint-Nazaire. Là, le capitaine Baudoin serait tout près de chez lui; il pourrait embrasser sa femme et ses enfants avant d’aller à Marseille rendre ses comptes aux armateurs du Saint-François. Le brick était assuré ; mais il tenait quand même à ce qu’il fût établi que le malheur n’était pas arrivé par sa faute. Il avait aussi à remettre Hermine aux mains de son grand-oncle: il y a de dures nécessités dans la vie.... Après tout, pourtant, quand on n’est pas riche et qu’on a quatre enfants à soi, on serait bien fou de songer à s’embarrasser des enfants des autres.
Ainsi raisonnait le capitaine Baudoin, tout en occupant ses loisirs à mettre ses papiers en ordre. Il avait pu sauver son livre de bord; il rapportait de l’argent à ses armateurs, ayant eu la précaution de se faire payer en valeurs de banque qu’il avait pu loger dans sa ceinture; il avait le procès-verbal du sauvetage de ses hommes et du sien: il était en règle. Restaient les affaires de la petite Hermine. De l’argent, elle n’en avait guère; mais il faudrait que son grand-oncle eût un cœur de rocher pour la repousser. Et, pour ne rien oublier, le capitaine se mit à écrire tout ce que son passager, le père d’Hermine, lui avait confié avant de mourir.
A mesure qu’il écrivait cette triste histoire, il sentait la compassion le gagner, lui qui n’était qu’un étranger pour ces gens-là : comment le grand-oncle n’aurait-il pas pitié ! Il n’était pas méchant, ce grand-oncle; son neveu se souvenait de ses tendresses d’autrefois; s’il l’avait maudit dans sa colère, il avait eu le temps de se calmer, depuis bientôt quatre ans... du moins le capitaine Baudoin jugeait impossible de tenir rigueur pendant quatre ans à quelqu’un qu’on avait aimé.
Mais il n’était pas tout à fait aussi débonnaire que le capitaine Baudoin, le grand-oncle de la petite Hermine, le riche armateur marseillais, Numa Girague: et de plus, il faut convenir qu’il avait quelque raison d’être en colère contre son neveu. Numa Girague, tout jeune, s’était trouvé le seul appui de sa mère et d’une sœur au berceau. Il n’avait reculé devant aucune fatigue, il avait accepté tous les métiers; on l’avait vu tour à tour portefaix, déchargeant les cargaisons sur le quai de Rive-Neuve, puis homme de peine au service d’un négociant, garçon de bureau chez un armateur, travaillant le jour et la nuit, toujours prêt, honnête, zélé pour l’intérêt de son patron comme si c’eût été le sien propre, et vivant de croûtes et d’eau claire pour nourrir sa mère et sa sœur. Son patron l’avait distingué et placé dans ses bureaux, où il lui avait bien vite rendu des services, grâce à d’anciennes études, trop tôt interrompues, mais qui lui avaient pourtant laissé l’esprit ouvert et une certaine facilité à apprendre. Un intérêt dans la maison avait été sa récompense: Numa, devenu M. Girague, avait pu louer pour sa mère un joli appartement, et donner à sa petite sœur une maîtresse de piano, signe caractéristique d’une éducation supérieure. Il fallait le voir, le dimanche, donnant le bras à sa mère parée d’une belle robe de soie, promener aux allées de Meilhan la petite Marguerite surmontée d’un chapeau à plumes. Comme il disait, le roi n’était pas son cousin; et de fait, il s’était donné plus de mal pour gagner son bien-être que les rois ne s’en donnent généralement pour gagner leur couronne. A cette époque-là, Numa Girague était parfaitement heureux.
C’était même le temps le plus heureux de sa vie, quoique sa fortune dût grandir longtemps encore. Il venait de fonder une maison pour son compte, lorsque sa mère mourut. S’il n’eût pas eu Marguerite à consoler, il eût été bien capable, dans le premier moment de son chagrin, de monter sur un de ses bateaux et d’aller se faire noyer en pleine mer. Cette pauvre chère femme qui venait de le quitter, c’était pour elle qu’il avait travaillé, c’était à elle qu’il avait, depuis qu’il se connaissait, rapporté toutes ses pensées, tous ses efforts, toutes ses espérances: elle partie, que faisait-il au monde?
Sa petite sœur lui fit comprendre qu’il avait encore une tâche à y remplir. Elle pleurait tant! Il fallait essuyer ses larmes; elle était si seule! il fallait rester avec elle.... Il s’attacha à elle de tout ce qui lui restait de cœur; il l’éleva, il la maria; et quand elle eut un fils, il se crut père de famille, grand-père, plutôt, car son affection pour sa sœur avait déjà quelque chose de paternel. Il ne songea point à se marier lui-même: la famille qu’il avait lui suffisait. Numa Girague était encore un homme heureux.
Mais décidément il y avait toujours une paille dans son bonheur. Une épidémie lui enleva sa sœur et son beau-frère: il se trouva de nouveau seul et chargé d’un orphelin. Cet orphelin, le petit Georges Samarsolles, fut élevé comme un prince; car si du côté des affections Numa Girague était cruellement éprouvé, il n’avait pas à se plaindre du côté de la fortune. Tout lui réussissait. Au moment où son neveu atteignit sa vingt-cinquième année, il était un des premiers armateurs de Marseille, et il venait de fonder aux Indes une maison de commerce qui rapportait déjà de beaux bénéfices. «Ce sera la dot de Georges, en attendant mon héritage» ; et pour voir si Georges était capable de voler de ses propres ailes, il l’envoya diriger la maison de Pondichéry. Il comptait l’y laisser seulement un an ou deux, et le rappeler ensuite pour le marier. En attendant, il s’occupait de lui chercher une femme: quand il aurait trouvé la perfection qu’il rêvait, il ferait revenir son neveu.
Georges n’attendit pas si longtemps. Il n’était pas à Pondichéry depuis six mois, qu’il écrivit à son oncle pour lui demander de consentir à son mariage avec Mlle Aïa Soberyani, une jeune orpheline du pays, très bien élevée à la française. Elle n’avait aucune fortune, mais le cher oncle ne devait pas tenir à cela; et il serait certainement très heureux, quand il la connaîtrait, d’avoir une aussi charmante nièce. Numa Girague répondit par un refus et par l’ordre à son neveu de remettre ses pouvoirs au remplaçant qu’il lui envoyait et de revenir immédiatement en France. Au lieu d’obéir, le jeune homme s’emporta. Après tout, son oncle n’était pas son maître; c’était par déférence, par reconnaissance, par affection qu’il avait sollicité son consentement, mais il pouvait s’en passer. Il le lui fit bien voir.
A l’annonce du mariage de son neveu, Numa Girague répondit par sa malédiction ou quelque chose d’approchant. «Je vous envoie, lui dit-il, la petite dot que j’avais donnée à votre mère; c’est peu de chose, car je n’étais pas encore bien riche lorsque je l’ai mariée, mais c’est tout ce que vous recevrez jamais de moi. Je vous renie et vous défends de jamais reparaître devant mes yeux. Et comme je ne veux pas vieillir dans la solitude, j’ai résolu de me marier moi aussi: de cette façon, je saurai à qui léguer ma fortune.»
Quatre ans s’étaient passés; Georges Samarsolles, chassé de la maison de commerce de son oncle, essaya d’en fonder une avec son petit capital. Il y perdit son argent et ce fut à grand’-peine qu’il trouva une maigre place de commis. L’apprentissage de la pauvreté lui sembla rude, après l’existence dorée qu’il avait due aux bontés de son oncle. Il ne perdait pourtant pas courage; mais sa jeune femme, faible et délicate, languit quelque temps et mourut, lui laissant la petite Hermine, âgée de deux ans et demi.
Georges Samarsolles,désespéré, prit l’Inde en aversion et résolut de revenir en France. Son oncle ne serait pas impitoyable; non, il ne pourrait trouver le courage de chasser un neveu, presque un fils, qu’il avait tant aimé et qui lui revenait si repentant et si malheureux. Mesurant son espérance à l’ardeur de son désir, Georges réalisa à la hâle son petit avoir, et courut au port pour s’informer d’un bateau en partance pour Marseille. Il n’en trouva qu’un, le Saint-François, qui chargeait en ce moment même: il alla trouver le capitaine Baudoin qui consentit à le recevoir, et s’embarqua avec la petite Hermine.
Il était plein d’espoir.
«Mon oncle pardonnera, disait-il au capitaine; s’il refuse d’abord de me voir, je lui enverrai ma fille. Elle ressemble à sa mère, mais plus encore à la mienne; elle a son regard, et un je ne sais quoi dans le sourire, dans le tour du visage.... Il en sera attendri; il croira la revoir, sa petite sœur qu’il aimait tant! il lui ouvrira ses bras, et nous serons tous heureux!... Dans combien de temps pourrons-nous être à Marseille, capitaine?»
Il ne devait jamais y arriver. Il emportait avec lui le germe d’une de ces terribles maladies qui sévissent dans les pays chauds; et peu de jours après son arrivée à bord, le mal se déclara et fit bientôt de tels progrès que le malheureux se sentit perdu. Il voulut alors écrire à son oncle, et il fit promettre au capitaine de remettre lui-même Hermine entre ses mains. «Jurez- le-moi, capitaine, répétait-il; priez-le, suppliez-le, qu’il adopte cette innocente: elle ne lui a rien fait, elle! ne l’abandonnez pas... ne la laissez pas mettre aux Enfants-Trouvés.... Ma pauvre petite Hermine!»
Il était mort en répétant le nom de sa fille et de sa femme; et le capitaine se demandait s’il n’eût pas été heureux pour la petite de quitter ce monde avec lui. Car il n’était pas du tout sûr que l’oncle voulût la prendre. Peut-être bien qu’il la ferait élever, par charité ou par respect humain; mais qui l’aimerait? qui la caresserait? qui la consolerait dans ses petits chagrins? qui l’amuserait, qui jouerait avec elle, qui la ferait rire? car il faut tout cela aux enfants: le capitaine le savait bien, lui qui en avait quatre.
Cependant le Passe-Partout continuait son voyage sans encombre, avec belle mer et bon vent. A sa première escale, le capitaine Baudoin acheta à Hermine une paire de petits souliers qui complétèrent son équipement. L’air de la mer lui convenait, elle devenait fraîche, vive et forte, agile comme un singe et gaie comme un pinson; le capitaine raffolait d’elle, et l’idée qu’on pourrait l’envoyer aux Enfants-Trouvés lui semblait quelque chose de monstrueux. Il faisait et refaisait sans cesse le discours qu’il aurait à adresser au grand-oncle Girague; il n’en avait pas encore trouvé un dont il fût content, lorsque le Passe-Partout fit son entrée dans la Loire aux eaux jaunâtres et vint s’amarrer au quai de Saint-Nazaire.