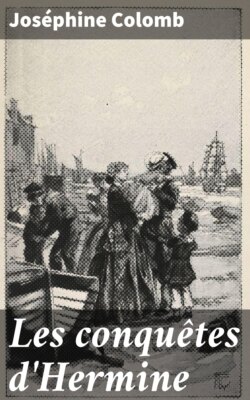Читать книгу Les conquêtes d'Hermine - Josephine Colomb - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Un vieux quartier de Nantes. — Le jeudi des petits Baudoin. — Arrivée inattendue.
ОглавлениеEn ce temps-là, Nantes était encore une vieille ville. Ce n’est pas qu’elle ait rajeuni depuis: mais elle a fait passer de larges voies au milieu de ses vieilles rues, remplacé par de superbes maisons de pierre les antiques bâtisses en pisé de la rue de la Poissonnerie, démoli par-ci, rebâti par-là : elle est devenue une superbe cité moderne que les touristes admirent, mais qu’un vieux Nantais d’il y a quarante ans ne reconnaîtrait plus.
En ce temps-là donc, le quai de la Fosse était un des quartiers les plus originaux et les plus intéressants. Le chemin de fer n’y passait point encore, et pour le parcourir il n’existait d’autre moyen de locomotion que l’omnibus des Dames Blanches, vénérable voiture qui pour quinze centimes vous prenait au pied de l’escalier de la Bourse, et vous conduisait jusqu’au delà de l’Entrepôt général des Salorges et du Sanitat, ancien asile des aliénés, de lugubre mémoire. Les vieillards se souvenaient encore d’avoir vu, dans leur enfance, les malheureux fous cramponnés aux barreaux de leurs fenêtres grillées, tendant la main et implorant de la pitié des passants le morceau de pain dont on les laissait souvent manquer.
Prenons l’omnibus, si vous voulez bien. La lourde voiture s’ébranle, ses roues font résonner le pavé ; les chevaux ne vont pas très vite, et s’arrêtent souvent pour prendre ou laisser des voyageurs: nous aurons tout le temps de bien voir le quai de la Fosse. A droite, une rangée de hautes maisons dont presque toutes les fenêtres ont leur balcon de fer ouvragé ; à gauche, une muraille de verdure; ce sont des ormeaux centenaires plantés tout le long du quai. On dirait des piliers soutenant les arcades d’une galerie sans fin: leur feuillage taillé à la mode du grand siècle ne commence qu’assez haut pour laisser au premier étage des maisons la vue du fleuve. Sur l’eau, c’est une forêt de mâts; bricks et goélettes, gabares et trois-mâts attendent leur tour pour embarquer ou débarquer une cargaison. Dans ceux qui sont au premier rang, amarrés au quai, il règne une grande activité ; sur la double planche qui les relie à la terre, les hommes vont et viennent, pesamment chargés. Ceux-ci plient sous les sacs de sucre brut qu’attendent les camions qui vont les transporter à la raffinerie; ceux-là se passent les uns aux autres les caisses de savon que les matelots de cette gabare vont arrimer à fond de cale; on se hâte pour profiter du vent, du flot qui se fait sentir jusque-là. Les capitaines, les pouces dans les poches de leur pantalon, se promènent d’un pas régulier, comme s’ils faisaient le quart: ils surveillent l’embarquement de leurs marchandises. Les mousses circulent et attrapent une taloche par-ci, par-là ; et des gamins pieds nus, vêtus de plus de trous que d’étoffe, rôdent autour des sacs de cassonade empilés sur le quai pour tâcher d’en éventrer un avec leur couteau. Gare qu’un matelot ou un douanier ne les voie!
L’omnibus avance, et l’aspect du quai se modifie. Les brillants magasins du commencement ont disparu; maintenant les cabarets alternent avec les boutiques d’effets maritimes, ou les chapeaux cirés reluisent au-dessus des gilets rayés en travers, où les suroîts huilés pendent à côté des vareuses de grosse laine et des grands cols de toile bleue. Puis ce sont les ateliers des voiliers, grandes salles de rez-de-chaussée aux larges portes toujours ouvertes, où des femmes cousent péniblement l’énorme toile; les maisons sont moins hautes et l’on ne voit plus guère de balcons. Voici la masse noire des Salorges, vaste construction qui contient l’Entrepôt: là encore, grand va-et-vient de travailleurs affairés; puis le bruit et le mouvement s’arrêtent: la ville finit là.
La course de l’omnibus y finit aussi; mais nous avons encore quelques pas à faire. Prenons la dernière cale, où sont amarrés bon nombre de canots petits et grands, attendant le bon plaisir des gens qui voudraient se rendre à bord de tel ou tel navire, ou traverser la Loire pour se rendre dans quelqu’une de ses jolies îles. Après la cale, plus de quai: toute la rive n’est plus qu’un chantier de construction. Partout se dressent, semblables à des squelettes d’animaux antédiluviens, des ébauches d’embarcations de toute taille, à tous les degrés d’achèvement. Ce sont des canots de plaisance, frêles et élégants comme des joujoux; des côtres qui s’en iront pêcher la sardine et le hareng, des gabares plaies, aux larges flancs, qui ne seront pas pressées d’arriver, mais qui seront solides sur: l’eau; des bricks et des trois-mâts pour le long cours, qui verront des hommes de toutes les couleurs. Les uns n’ont encore que leur étrave posée sur le chantier, d’autres sont déjà une carcasse à jour qui laisse deviner, leur forme et leur grandeur; en voici dont la charpente est complète; on les a couchés sur le flanc: les calfats avec leur marteau travaillent tout près de la quille, et semblent des mirmidons sous cette énorme masse. En voilà un qu’on goudronne: le goudron bout et fume dans la chaudière, et son âcre senteur réjouit les vieux marins. Un peintre, entouré de ses pots de couleur, trace sur la coque, d’une chaloupe de belles raies vertes et blanches; un autre. habille ce canot de noir avec des filets rouges; là, on s’empresse de terminer la toilette de celte goélette qui sera lancée à l’eau demain. C’est partout une activité de ruche en mouvement; coups rythmés de marteaux, grincement de grandes scies, chants d’ouvriers qui veulent se donner du cœur à l’ouvrage, enfin tout le bruit sain et gai que fait le travail humain quand il s’accomplit à ciel découvert. Et partout des enfants; les grands, curieux, en extase devant le rabot qui enlève de grands copeaux ou la scie qui mord le bois de ses dents brillantes; les petits, heureux de jouer à cache-cache, de faire des tas de sciure de bois ou de jeter des pierres dans l’eau. Les enfants du quartier de la Cathédrale vont en grande toilette se promener au Jardin des Plantes; ceux du quartier des Salorges ont pour royaume le rivage de la Loire, et ils ne changeraient pas avec les premiers.
Il faisait un joli temps de septembre, clair et doux, avec juste assez de vent pour rider la surface du fleuve et pour tempérer la chaleur du soleil, lorsqu’une femme, qui pouvait avoir de trente à trente-cinq ans, descendit des rues qui entourent l’église Notre-Dame de Bon-Port et s’achemina vers les chantiers de construction. Elle donnait la main à deux enfants, une petite fille d’environ quatre ans et un petit garçon un peu plus âgé ; et près d’elle marchaient un garçon de dix ans, solidement bâti, et une fillette longue et mince, à qui on ne savait guère quel âge donner, car sa figure enfantine ne concordait point avec sa taille élevée. Elle portait un sac à ouvrage, élégant mais sérieux, et de capacité à contenir tout autre chose qu’une bande de feston ou une dentelle au crochet. Le jeune garçon était chargé lui aussi d’un panier, dont le couvercle à demi soulevé laissait passer le goulot d’une bouteille. Il n’était pas bien difficile de deviner que la mère et les enfants venaient passer leur jeudi au bord de la rivière.
«Laissez-moi vous conduire, dit le jeune garçon; j’ai remarqué un endroit où maman sera très bien. Par ici, s’il vous plaît: c’est le chemin le plus court.
— J’en aimerais mieux un plus long, dit en souriant la mère; celui-ci n’est pas commode pour les petites jambes. «
En effet, le sol était jonché de débris de bois, et il fallait à chaque instant enjamber des poutres, ou des ficelles tendues pour marquer quelque mesure.
«Les petites jambes s’en tireront très bien, tu verras! reprit le jeune garçon en s’arrêtant pour prendre la petite fille, qu’il assit sur son bras. Là ! es-tu bien, ma Denise? Parrain est fort, n’est-ce pas? A présent, Frédéric, donne-moi la main: nous sommes des hommes, nous autres! nous n’avons pas peur de tomber!
— Alors donne-moi le panier, mon bon Philippe, puisque tu te charges des enfants,» et la mère étendit la main pour le prendre. Mais le panier était déjà passé dans les mains de sa fille.
«Catherine! rends-le-moi; je n’aime pas que tu portes des fardeaux à ton âge: ta taille n’aurait qu’à tourner!
— Il n’y a pas de risque, maman; au contraire, les deux font contrepoids, c’est comme les deux paniers de l’âne. Je te le donnerai en revenant, si tu y tiens.
— Oui, quand il sera vide!
— Bien sûr! Quand nous sommes avec toi, tu dois toujours faire comme le quatrième de la chanson:
«L’autre ne portait rien.....
L’autre ne portait rien.....»
Philippe se mit à rire, et répéta le refrain de la chanson de Marlborough, auquel les deux petits mêlèrent leurs voix aiguës. «Bons enfants!» murmura la mère attendrie. Les ouvriers du chantier, les vieux matelots en congé qui venaient flâner dans le chantier et examiner l’ouvrage avec des airs de connaisseurs, la saluaient au passage et souriaient à sa jeune famille: et Philippe redressait sa tête blonde avec fierté, en saisissant des lambeaux de phrases qui lui faisaient battre le cœur: «Le capitaine Baudoin... un bon, celui-là.... C’est un plaisir de naviguer avec lui.... Un plus honnête, il n’y en a pas sous la calotte des cieux.... Les enfants lui ressembleront: tous braves et bons, les Baudoin!
— Là ! est-on bien ici?» demanda Philippe en s’arrêtant, du ton de quelqu’un qui serait bien étonné si on lui répondait non.
L’endroit qu’il avait choisi était tout près de la grève, si plate que les enfants n’y couraient aucun danger. Une belle poutre formait un banc commode, qu’abritait contre l’ardeur du soleil la coque d’un grand côtre à peu près terminé. La Loire coulait avec un bruit rafraîchissant; ses îles verdoyantes se détachaient sur le ciel bleu, et plus loin, sur la rive opposée du fleuve élargi, apparaissaient les maisons basses du village de Trentemoult. De temps en temps quelque bateau descendait ou remontait la Loire, spectacle toujours nouveau pour les enfants, qui accouraient pour le regarder, cherchant à lire son nom, à reconnaître sa nationalité, son chargement, et échangeant leurs observations critiques sur son gréement, ses formes et son allure. Ils s’y connaissaient en bateaux, les enfants du capitaine Baudoin!
Mme Baudoin s’était assise et cousait activement, non sans donner souvent un coup d’œil à sa petite famille. Catherine et Philippe avaient commencé par faire des ricochets sur l’eau avec des pierres plates, à la grande joie des deux petits; puis le jeune garçon avait tiré son couteau de sa poche, et il avait commencé à façonner un débris de charpente en manière de canot. Frédéric et Denise cherchaient une baguette capable de lui servir de mât, et Catherine, après avoir un peu erré aux environs, vint s’asseoir auprès de sa mère en soupirant comme quelqu’un qui vient de prendre une résolution pénible.
«Donne-moi de l’ouvrage, maman, dit-elle en soufflant dans son dé pour le faire tenir à son doigt. Je peux bien travailler aux chemises de papa, je n’ai pas besoin de m’amuser toute la journée.
— Voilà qui est bien beau de ta part! répondit la mère d’un ton de douce raillerie. Je n’abuserai pas de ta bonne volonté, mais je vais en user un peu. Tiens, couds-moi cette manche, cela m’avancera. Je voudrais avoir fini les six chemises neuves quand ton père reviendra. On blanchit si mal aux colonies! il me rapporte toujours du linge en triste état.
— Maman, quand reviendra-t-il?»
Mme Baudoin soupira.
«Je ne sais pas: il devait me l’écrire en arrivant à la Réunion, et j’ai peur qu’il n’en ait pas eu le temps, puisque je ne reçois rien. Il ne manque jamais de me donner de ses nouvelles, toutes les fois qu’il peut; il sait combien je m’inquiète....»
Catherine lâcha son ouvrage et passa son bras autour de la taille de sa mère.
«Chère maman, il ne faut pas te tourmenter. Papa est un si bon marin! si prudent, si habile! tout le monde le dit. Et il ne lui est jamais rien arrivé !...
— Maman! Catherine! un beau bateau! regardez! crièrent les petits. C’est un Hollandais.... De combien de tonneaux, Philippe?»
En temps ordinaire, Philippe n’aurait pas hésité, pour faire montre de ses connaissances maritimes, à attribuer au Hollandais un tonnage de fantaisie. Mais cette fois, dès qu’il eut levé les yeux vers le bateau pour faire son évaluation, il demeura comme frappé de stupeur. Cela ne dura que le temps d’un éclair; il laissa tomber son couteau et son ébauche de bâtiment, et s’élança vers le plus petit des canots amarrés à des pieux plantés sur le rivage. Dénouer le câble, sauter dans le canot, s’emparer d’un aviron fut l’affaire d’un instant; et godillant à force de bras, il navigua vers le Hollandais qui remontait lourdement et lentement le courant avec l’aide du flot.
«C’est défendu, Philippe!» lui crièrent les deux petits, consternés de voir leur grand frère leur donner l’exemple de la désobéissance. A leur voix, Mme Baudoin se leva pour venir voir de quoi il s’agissait, et Catherine la suivit.
Elles virent alors à bord du Hollandais un homme debout contre le bordage, faisant des signaux au petit canot qui s’approchait avec vélocité. Le canot aborda le bateau, où Philippe grimpa avec l’agilité d’un singe.
«Papa! c’est papa!» balbutia Catherine qui n’en croyait pas ses yeux, en voyant son frère dans les bras de l’homme qui lui faisait des signaux tout à l’heure. Et les petits répétèrent en riant, en sautant, en battant des mains: «Papa! Papa! Viens, papa!» Mme Baudoin pleurait de joie, tout en se sentant le cœur serré. Il revenait, il était sauvé, grâce à Dieu; mais par quels dangers, par quelles souffrances avait-il passé ?
Il y eut un court colloque entre les deux capitaines; puis Philippe redescendit dans son canot, et son père donna une poignée de main au Hollandais et se prépara à quitter son bord.
«Oh! vois, maman! cria la petite Denise en joignant les mains d’admiration, papa qui m’apporte une grande poupée!»
La poupée, c’était Hermine que le capitaine passait à Philippe. Celui-ci la reçut avec précaution, comme un objet délicat et fragile, et la déposa sur le banc du canot, où elle s’assit comme une véritable personne.
«C’est un petit garçon!» dirent en même temps Mme Baudoin et Catherine, aussi étonnées l’une que l’autre. Mais le canot approchait rapidement. Bientôt il toucha le bord; et le capitaine Baudoin sauta à terre et tomba dans les bras de sa famille.
Il y eut là un de ces moments bienheureux que connaissent tous ceux qui ont souffert de l’absence d’un être aimé ! Au milieu de ces tendresses, au doux bruit de ces baisers qui pleuvaient comme grêle sur tous les visages, la petite Hermine, un peu oubliée, se sentit toute triste. Sans qu’elle s’en rendît compte, il lui sembla qu’on lui faisait tort de sa part de caresses. Son petit cœur se gonfla peu à peu, pendant que debout, à quelques pas, elle regardait ces heureux qui ne faisaient pas attention à elle. Elle se mit à pleurer, d’abord tout doucement, puis plus fort, en murmurant au milieu de ses sanglots: «Papa capitaine! oh! papa capitaine!»
Philippe fut le premier à l’entendre. Il ne fit qu’un bond jusqu’à la petite fille, qu’il enleva dans ses bras en la caressant, en lui parlant comme il eût fait à Frédéric ou à Denise. «Non, mon bijou, non, mon trésor, il. ne faut pas pleurer, il est là, papa capitaine. Viens voir maman, viens jouer avec les petits enfants.» Hermine le regarda et lui sourit, lui trouvant une bonne figure; puis, pour le remercier de son intervention, elle lui saisit la tête à deux mains et lui posa sur la joue un baiser doux et léger comme la caresse d’une fleur.
Philippe lui rendit son baiser. «Est-il gentil, ce petit! dit il à son père.
Le capitaine Baudoin tomba dans les bras de sa famille.
— C’est un autre petit frère pour moi, n’est-ce pas, papa? demanda Denise.
— C’est une petite sœur, pour quelques jours, ma chérie: le temps de l’habiller en fille, et j’irai la conduire à ses parents. Je vous raconterai son histoire.
— Tout de suite, papa, tout de suite!»
L’histoire entière eût été un peu longue à raconter; le capitaine se borna à dire que le père de l’enfant était mort en mer et l’avait chargé de la remettre à son oncle qui habitait Marseille. Mme Baudoin s’attendrit sur l’orpheline, et Catherine déclara qu’elle se chargeait d’elle pour tout le temps qu’on la garderait. Mais Hermine, qui n’avait point été consultée sur cette adoption, fit bien voir qu’il fallait compter avec sa petite volonté ; elle refusa absolument de se séparer de Philippe, et ce fut à sa main qu’elle foula pour la première fois le pavé nantais. Une fois entrée dans l’appartement de la famille Baudoin, elle se laissa pourtant apprivoiser par les joujoux de Frédéric et de Denise, et elle riait de tout son cœur, passant des soldats de plomb à la poupée négresse, pendant que Mme Baudoin, Philippe et Catherine écoutaient le récit de la dernière campagne du capitaine, depuis son départ de Pondichéry jusqu’à son arrivée à Saint-Nazaire, où il avait quitté le Passe-Partout pour le Jacobus, qui remontait la Loire jusqu’à Nantes.