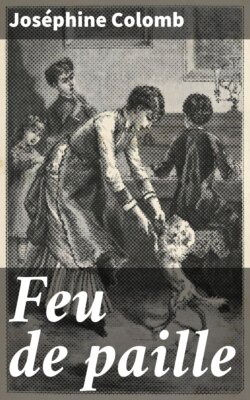Читать книгу Feu de paille - Josephine Colomb - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cousine Lucile.
ОглавлениеLes jours suivants furent des jours de grande agitation dans la maison de Mme Davery. Pacifique, appelée en consultation, avait déclaré qu’il fallait absolument que tous les rideaux de la chambre de «ces demoiselles» fussent du même blanc; et, en conséquence, elle avait plongé dans le même baquet la mousseline neuve et les rideaux déjà existants, malgré les protestations de Valentine. Pacifique s’était engagée sur l’honneur à donnera tout cela «l’apprêt du neuf» ; on pouvait se fier à Pacifique. Mme Davery et Valentine remettaient en bon état les vêtements de deuil, reprisaient les tapis, plaçaient une fleur dans un vase, un écran ici, une gravure là, pour donner bonne mine à la chambre, afin que Lucile la trouvât jolie; et Jacques était à tout moment appelé, avec son échelle, ses clous et son marteau, pour quelque travail d’amélioration. Marcelle, mise en gaieté par tout ce remue-ménage, chantait toute la journée en montant et en descendant l’escalier; et Frédéric daignait faire quelques commissions, de celles qui n’étaient pas salissantes, ni fatigantes, aurait-il ajouté, s’il l’eût osé.
M. Davery, en arrivant à Grenoble, avait écrit une courte lettre. Il y disait que Lucile était une charmante petite fille; qu’il était décidément son tuteur, d’après les dernières volontés de son père; que les formalités seraient très vite terminées, et qu’il reviendrait certainement avec sa pupille à la fin de la semaine. Il fallait donc se hâter de tout préparer pour leur retour; et Dieu sait si, dans le fond de son cœur, Mme Davery maudissait les visites qui venaient à chaque instant l’interrompre dans ses arrangements.
Mme Davery n’avait point de jour; des visites de cérémonie, elle n’en recevait guère, et elle avait trop à faire pour pouvoir, toute une après-midi par semaine, s’asseoir en toilette dans son salon débarrassé de ses housses, et y attendre les indifférents qui viendraient lui dire des banalités. Elle avait quelques amis, quelques vieilles relations, à qui elle ne fermait jamais sa porte; et comme on la savait fort occupée, on ne venait pas la déranger trop souvent. Mais en cette circonstance toute discrétion était mise de côté. On avait appris le départ subit de M. Davery; on en savait vaguement la raison, et l’on grillait de pouvoir répéter aux curieux des détails authentiques, donnés par Mme Davery elle-même. Aussi, à chaque instant, un coup de sonnette forçait Pacifique à quitter son baquet ou ses fers à repasser; et Mme Davery devait descendre du premier étage pour venir subir un interrogatoire.
«Chère madame, j’ai appris le malheur qui vous a frappée! J’en suis désolée, consternée! M. votre beau-frère était jeune encore?.....
«Quel âge a votre jeune nièce? Est-il vrai que ce soit une riche héritière?....
«Pauvre Valentine! vous voilà donc en deuil, ma chère amie! nous comptions que vous feriez votre entrée dans le monde cette année. C’est vraiment dommage; oui, grand dommage, en vérité !»
Cette dernière réflexion, pleine de tact et d’à-propos, était faite trois jours après le départ de M. Davery, par une grosse petite dame de santé florissante, annoncée par Pacifique sous le nom de Mme Briochon. Mme Briochon n’était point méchante; elle n’eût même pas été bête, si elle eût quelquefois pris le temps de réfléchir, mais elle aimait mieux parler, et elle parlait à tort et à travers. Elle excellait à vous raconter l’histoire de gens que vous n’aviez jamais vus; et comme il fallait bien qu’elle renouvelât de temps en temps son magasin d’histoires, elle cherchait à savoir ce qui se passait chez vous pour aller le colporter ailleurs. Valentine et ses frères ne l’aimaient point; la jeunesse ne regarde guère qu’un côté des choses, et ils ne voyaient que les défauts de Mme Briochon, son indiscrétion, sa vanité, son bavardage, et le tour malveillant que prenaient souvent ses jugements. Mme Davery, plus indulgente que ses enfants, lui tenait compte de sa bonté réelle, des services qu’elle était toujours disposée à rendre, sauf à s’en vanter un peu trop, enfin de ses actions, qui étaient généralement meilleures que ses paroles. Pourtant elle ne put s’empêcher d’être blessée de la remarque de Mme Briochon, et ce fut elle qui répondit à la place de Valentine.
«Ma fille ne perd rien en fait de bals, madame, car nous ne comptions pas l’y mener cette année. Elle n’aura pas le temps de songer à la danse, elle n’en aura sans doute pas l’envie non plus, quand elle aura pour compagne de tous les jours une pauvre enfant qui vient de perdre son père, qui se trouve seule au monde et qu’il faudra distraire et consoler.
— Ah!... très bien... repartit Mme Briochon. En effet, pauvre petite! du côté de son père, elle n’a sans doute plus de parents? Il était fils unique, monsieur...?
— Granvier, dit Mme Davery. Oui, il avait perdu ses parents; il restait seul de sa famille.
— Alors, vous êtes bien obligés de vous charger de l’enfant: comme si vous n’en aviez pas déjà assez!
— La fille de ma sœur ne peut pas être une charge pour moi; et, si je ne la plaignais pas d’avoir perdu son père, je serais tout à fait heureuse de la voir venir ici.
— Oui, sans doute,... vous devez penser ainsi... avec le cœur qu’on vous connaît.... Mais cela vous fera trois filles à marier: c’est une grosse préoccupation par le temps qui court... A moins qu’elle n’ait une fortune personnelle, Mlle Granvier?
— Je ne me suis pas occupée de cela, ni mon mari non plus. Son père était fonctionnaire, et il n’avait pas l’âge de la retraite; elle n’a donc droit à aucune pension, et je ne sais pas si la dot de sa mère avait été dépensée.
— Et cette dot, c’était...? dit Mme Briochon en avançant la tête et en tendant l’oreille pour mieux entendre la réponse.
— Je ne m’en souviens pas, répondit froidement Mme Davery; et d’ailleurs cela n’a pas grand intérêt. Valentine, montre à madame le joli couvre-pied que tu as fait pour le lit de ta cousine.»
Valentine alla chercher un grand carré de guipure, taillé dans un rideau de rebut, dont elle avait soigneusement réparé les accrocs, et qu’elle avait doublé de satinette rose et encadré d’une dentelle.
«Ah! charmant! dit Mme Briochon. Vous avez trouvé cela ici?
— Ici, oui, et même dans la maison; cela sort d’un de mes paquets de linge.
— En effet, je crois reconnaître... Et cette guipure, c’est...?
— Un ancien rideau du salon, où Frédéric avait mis le feu avec sa cigarette, sa première cigarette! dit Valentine en riant. Il a été si confus, qu’il n’a plus essayé de fumer; c’est toujours cela de gagné.
— Ah! très bien! adroite comme une fée, cette chère Valentine! elle sait tirer parti de tout. Et cette dentelle, c’est...?
— La dentelle du rideau, tout simplement.
— Eh bien, c’est d’un charmant effet; votre cousine sera bien difficile si elle n’est pas contente. Est-elle plus âgée que Marcelle, mademoiselle...?
— Lucile. Elle a quinze ans juste; vous voyez que c’est une société pour Valentine, plutôt que pour les huit ans de Marcelle.
— Sans doute... pourtant, cela dépend... Il y a des filles de quinze ans qui sont très enfants, tout en ayant des prétentions de grandes personnes. Tenez, Isaure, la fille de Mme Terrail, qui est la nièce de M. Launier, le directeur de l’enregistrement de Rodez, était une petite peste à l’âge de quinze ans. On dit qu’elle s’est corrigée; elle a bien fait, car elle était en train de se faire prendre en grippe par tout le monde. Un jour...»
Pacifique, en ouvrant la porte pour introduire une nouvelle visite, arrêta court l’histoire des méfaits de Mlle Isaure; et Mme Briochon fut seule à en être fâchée.
Cet incident ne fut pas sans laisser quelques traces dans l’esprit de Valentine. Qu’une personne de plus dans la maison pût ajouter aux difficultés de la vie, ce n’était pas un souci pour elle: elle n’était ni égoïste ni intéressée; mais si Lucile allait être «une petite peste», comme la jeune fille dont Mme Briochon n’avait pas eu le temps de conter l’histoire! Valentine ne put se défendre d’une vague inquiétude, et elle mit un peu moins d’ardeur que par le passé à s’occuper de l’arrivée de sa cousine.
Pendant ce temps, que faisait cette Lucile, dont on s’occupait tant à la Rochelle? Transportons-nous à Grenoble, dans un appartement simplement meublé, mais tenu avec un soin, une propreté, un ordre élégants, qui révèlent une ménagère d’esprit délicat et de goûts distingués. Dans une petite salle à manger qu’éclairent les premiers rayons d’un soleil d’hiver, une jeune fille, presque une enfant, est assise sur une petite chaise auprès du feu, et s’occupe à faire griller des tartines. Mais, tout en prenant soin de les présenter au feu des deux côtés pour qu’elles se dorent bien, elle laisse errer tristement ses regards sur tous les objets qui l’entourent, et par moment une larme, qu’elle ne peut retenir, roule sur sa joue et vient tomber sur sa main. Tout à coup elle se redresse: un pas d’homme s’est fait entendre dans le corridor. L’enfant essuie vivement ses yeux, se lève, pose ses tartines sur une assiette et va ouvrir la porte.
«Bonjour, mon oncle, dit-elle avec un doux sourire. Avez-vous passé une bonne nuit?
—Très bonne, ma chère fille, répond M. Davery en la baisant au front. Et toi?»
Il s’interrompt, car il sait bien que la nuit de la pauvre petite n’a pas pu être bonne, et qu’elle a dû pleurer plus qu’elle n’a dormi. Et comme il ne sait que lui dire, il l’entoure de ses bras et la serre contre son cœur, comme il ferait pour sa Valentine, si Valentine avait du chagrin.
Lucile l’a compris; elle lui rend sa muette étreinte; puis, se dégageant de ses bras, elle l’entraîne vers la table.
«Venez, mon oncle, le déjeuner est prêt. Un peu de beurre sur les tartines, n’est-ce pas? Vous trouvez le chocolat bon? Tant mieux, c’est moi qui l’ai fait. Est-il assez chaud?
— Tout est parfaitement bon, ma petite fée; et toi, tu es meilleure que tout le reste!» répond M. Davery; et il contemple avec complaisance la «petite fée» assise en face de lui.
Elle n’est pas bien grande, Lucile Granvier; à la voir, on ne lui donnerait jamais son âge de quinze ans. Elle ne paraît pas faible ni malade; mais elle est délicate, et sa petite figure blanche et mince semble plus blanche et plus mince encore dans ses vêtements de deuil. Elle a de longs cheveux châtains, très fins et très soyeux, qu’elle laisse encore pendre sur son dos, comme des cheveux d’enfant, et qu’elle relève seulement par devant pour découvrir son front. Sa bouche est petite, son nez mince et long, ses sourcils forment deux lignes nettement arquées; mais il n’y a rien de remarquable dans son visage, si ce n’est ses yeux. Oh! ces yeux-là, qui les a regardés une fois ne peut les oublier; on dirait qu’ils éclairent dans les ténèbres. L’âme qui a ces yeux-là pour miroir ne peut recéler aucune fausseté, aucune duplicité, aucune vanité ; elle doit être, elle est nécessairement sincère et loyale, patiente et courageuse, aimante el dévouée; et si Valentine avait rencontré une seule fois le regard de ces doux yeux (j’oubliais de dire qu’ils sont d’un gris bleuâtre à reflets lumineux), il ne lui viendrait pas un instant l’idée que sa cousine pût être «une petite peste».
Elle a l’air d’une enfant, mais elle sert son oncle comme une maîtresse de maison accomplie, lui versant le chocolat, lui beurrant ses tartines, devinant ses désirs, lui souriant et causant avec lui d’un ton gracieux, comme si elle n’avait pas pleuré tout à l’heure et comme si elle ne pleurait pas encore en dedans.
«J’ai fini mes préparatifs, mon cher oncle, lui dit-elle; on pourra déménager dès que la voiture viendra, et quant à ce que nous emportons, je n’ai plus à emballer que les objets dont nous nous servons en ce moment-ci. Vous ne les reconnaissez pas? C’est ma tante qui avait donné à maman ces tasses, ce sucrier et ce pot à lait. La cafetière existe aussi; maman y tenait beaucoup, et elle les lavait elle-même, tant elle avait peur qu’on les cassât. J’ai continué à faire comme elle, et je suis bien aise de les rapporter en bon état à ma tante. Enfin je suis prête, mon oncle; vous pourrez m’emmener ce soir, si vous voulez. Vous devez être pressé de retourner à la Rochelle?
— J’y ai des affaires, c’est vrai; mais je ne voudrais pas t’arracher si vite d’ici, ma pauvre enfant.
— Oh! il ne faut pas penser à cela.... Puisqu’il faut que je parte, autant vaut partir tout de suite. Et puis, n’allez pas croire, mon oncle, que cela me fait beaucoup de chagrin.... Qu’est-ce que je laisse ici, puisque papa est parti avant moi? Je serai très heureuse, là-bas, je vous assure.... Je vous aimerai tant! des frères, des sœurs, à moi qui n’en ai jamais eu.... et ma tante et vous! Partons ce soir, mon oncle, voulez-vous?»
Lucile avait quitté sa place et rapproché sa chaise de celle de son oncle; elle lui avait pris les mains et lui souriait; mais il pensait que les grands artistes ont parfois fait sourire ainsi de jeunes martyres. Il fallait pourtant que le sacrifice s’accomplît; il le sentait; aussi, serrant les mains de l’enfant, il lui répondit:
Lucile sert son oncle.
«Eh bien, oui.... ce soir! Je vais écrire à ma femme pour nous annoncer, et aller chez le notaire pour prendre les papiers qu’il a encore; et puis je reviendrai t’aider.
— Ne prenez pas cette peine, Mme Nourmot m’aidera; il n’y a qu’à charger les meubles sur la voiture. Seulement, quand ce sera fini, vous voudrez bien me mener au cimetière, n’est-ce pas? pour leur dire adieu.»
M. Davery fit un signe de consentement et sortit. Lucile, restée seule, porta elle-même le plateau à la cuisine, lava et essuya ses tasses avec le plus grand soin; puis elle alla les placer dans une caisse encore ouverte, qu’elle ferma ensuite avec l’aide de Rosalie, une grosse fille rougeaude, qui se détournait à chaque instant pour se moucher bruyamment ou pour essuyer ses larmes. A peine la caisse était-elle fermée, que la voiture de déménagement arriva, et avec elle Mme Nourmot, une amie de la famille Granvier, qui possédait une grande maison où il y avait plusieurs chambres vides, et qui avait offert à Lucile de lui garder son mobilier. Lucile avait accepté avec reconnaissance; elle savait bien qu’on ne pouvait pas emmener à la Rochelle des meubles qui n’avaient qu’une valeur de sentiment, et pourtant elle aurait été désolée qu’on les vendît. Chez Mme Nourmot, ils n’étaient pas perdus; elle pourrait les retrouver, elle les reprendrait un jour; cela la consolait un peu dans le déchirement qu’elle éprouvait à l’idée de quitter tout ce qu’elle avait connu et aimé pendant ses quinze ans de vie.
Le sacrifice s’accomplit. Lucile pleura plus d’une fois à la dérobée en voyant se vider ces chambres où tout son passé lui criait: Adieu! adieu! Elle pleura en déposant sur la tombe de sa mère, sur le tertre à peine affaissé où son père reposait depuis si peu de jours, les fleurs, les dernières! qu’elle avait cueillies dans son jardin; mais elle sécha ses larmes, et se montra calme et presque gaie chez Mme Nourmot qui l’avait invitée à dîner avec son oncle. Elle reçut courageusement les adieux de son hôtesse, de la grosse Rosalie, d’un groupe nombreux d’amis qui vinrent jusqu’à la gare pour la revoir encore une fois; et la locomotive l’entraîna bientôt rapidement vers ses nouvelles destinées.