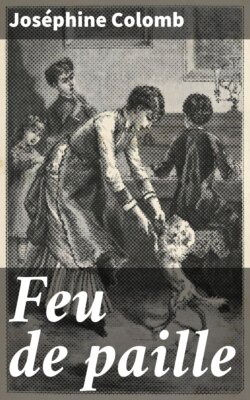Читать книгу Feu de paille - Josephine Colomb - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L’arrivée.
Оглавление«Bonjour, madame, dit en entrant Mme Briochon. Toute la famille va bien, j’espère? Et M. Davery et votre jeune nièce ont-ils fait bon voyage?
— Je l’espère, madame; nous les attendons tout à l’heure.
— Ah! ils ne sont pas arrivés? Je croyais... j’avais demandé hier à Pacifique, que j’ai rencontrée au marché, s’ils revenaient bientôt, et Pacifique m’avait dit qu’on les attendait aujourd’hui. J’avais cru que c’était par le train du matin; il parait que c’est par le train du soir?
— Par le train de cinq heures un quart; ils entrent en gare en ce moment. Jacques et Frédéric sont allés au-devant d’eux.
— Et vous achevez vos préparatifs? Tiens! votre beau linge damassé, vos cristaux des jours de fête, et deux verres à chaque couvert! C’est donc grand gala aujourd’hui?
— C’est fête pour l’arrivée de ma grande cousine, s’écria la petite Marcelle, Pacifique a fait de très bonne cuisine, et moi j’ai écrit le menu sur des cartes, que Frédéric avait taillées pour s’en faire des cartes de visite. Ma cousine verra tout de suite comme je sais bien écrire.
— Et ce menu, c’est?...»
Marcelle prit gravement sous la serviette de Lucile une petite carte blanche, entourée d’un encadrement à l’encre rouge, et lut tout haut:
«Potage au tapioca, bœuf bouilli sur du persil, poulet rôti au cresson, salade de chicorée, macaroni au gratin.»
«N’est-ce pas, madame, que c’est un très bon dîner? Et le dessert! il y a une grande tarte faite par Pacifique, des marrons, des poires, des pommes, des noix, et des petits gâteaux au sucre et à la fleur d’oranger; c’est Valentine qui les a faits. Et pour que la table soit très jolie, on mettra les flambeaux d’argent aux deux bouts et la jardinière au milieu. On boira du vin sucré dans les petits verres, à la santé de Lucile, pour qu’elle se trouve heureuse chez nous.
— Ah! vraiment! c’est très bien tout cela.... Il faut que je vous quitte, voilà l’heure du dîner.... Mes compliments à M. Davery, chère madame!»
Et Mme Briochon sortit lentement, à regret: car la pendule marquait près de six heures; et si les bagages n’avaient pas causé aux voyageurs un trop long retard, ils ne devaient pas être loin de la maison. Elle prit pour retourner chez elle le chemin qui menait vers la gare, en repassant dans sa mémoire le menu du dîner que lui avait lu Marcelle: c’était déjà quelque chose à raconter. Et comme elle allait tourner le coin de la rue, elle aperçut tout à coup, ô bonheur! un groupe facile à reconnaître. Un facteur du chemin de fer, poussant devant lui une voiture à bras chargée de caisses, escortait deux hommes portant des sacs de nuit, des para pluies et des couvertures de voyage, et un jeune garçon les précédait, donnant le bras à une petite créature fluette, enveloppée dans des étoffes noires. Mme Briochon s’arrangea de façon à passer tout près du groupe, juste dans le rayon d’un réverbère, et à y apercevoir à travers un voile de crêpe deux yeux lumineux dans une petite figure pâle. Elle retourna chez elle le cœur léger: elle tenait toutes ses informations.
C’était bien en effet les voyageurs qui arrivaient: M. Davery un peu las, mais joyeux de retrouver son foyer; Lucile, bien lasse aussi, toute tremblante de l’accueil qui l’attendait, se mordant les lèvres pour ne pas pleurer, et s’efforçant de dominer son chagrin, qui se réveillait plus vif à cette heure décisive. Pendant la première partie de la route, elle s’était pelotonnée dans un coin, faisant semblant de dormir, et son oncle, qui voyait bien qu’elle ne dormait pas, avait respecté sa tristesse. La pauvre petite lui faisait pitié quand elle prenait un ton enjoué pour lui répondre; il jugea que toutes les consolations qu’il essayerait de lui donner ne vaudraient pas pour elle le silence, et il prit un livre pour la laisser à ses réflexions.
Lucile pleura quelque temps tout bas; puis, bercée par le mouvement du wagon, engourdie par son chagrin même, elle finit par tomber dans une sorte de torpeur douloureuse, demi-sommeil où elle conservait le sentiment de la réalité présente, pendant qu’elle revoyait tout le passé, auquel elle venait de dire adieu. C’était le doux visage de sa mère qui lui souriait; c’était sa douce voix qui chantait pour l’endormir dans son berceau; c’était son doigt posé sur l’alphabet pour lui montrer les lettres et les syllabes; c’était la vision d’un jour de printemps où elles étaient allées ensemble cueillir des violettes dans un bois, ou d’une fête d’hiver pour laquelle sa mère lui avait brodé une si jolie petite robe rose; c’était une visite dans une mansarde, où Lucile avait pour la première fois appris la charité, et pleuré sur la misère d’enfants qui manquaient de pain. Elle se rappelait ses jeux, le soir, avec son père; le premier morceau de piano qu’elle lui avait joué pour sa fête; elle revoyait les calmes soirées, sous la lampe, quand elle se sentait si heureuse entre eux deux; elle repassait dans son esprit ses longues conversations avec sa mère malade; elle se transportait au jour douloureux où s’était tue cette voix bien-aimée..... Puis ses nouveaux devoirs de maîtresse de maison, si compliqués, si difficiles parfois pour une enfant de treize ans; la bonté de son père qui l’encourageait, qui semblait redoubler de tendresse, pour qu’elle sentît moins la perte de sa mère; leur vie à deux, intime et sérieuse, les études qu’elle faisait avec lui le soir... c’était encore du bonheur! Et à présent?
Le train avançait toujours, entouré de ténèbres; on n’entendait que le bruit monotone de sa marche, et, par moments, les sifflements aigus de la vapeur. Les rêveries de Lucile se confondirent peu à peu, s’effacèrent, et ses traits contractés par la souffrance se détendirent dans le sommeil. Elle dormit longtemps; quand elle rouvrit les yeux, les horizons familiers à ses regards d’enfant étaient bien loin derrière elle. Elle se pencha à la portière; le jour naissait, le temps était beau, le givre brillait aux rameaux comme une poussière de diamants. Ce pays lui était inconnu, mais il lui apparaissait tout souriant, baigné de la lumière rose du matin: l’enfant se sentit réconfortée. Elle se rassit à sa place: en face d’elle, son oncle lui tendait la main.
«Bonjour, fillette, lui dit-il: as-tu bien dormi? n’as-tu pas souffert du froid?» et il l’enveloppait dans sa couverture de voyage, qu’elle avait laissé glisser à ses pieds.
Lucile, à cette voix, à ces paroles amicales, eut honte de son désespoir de la veille. Comme son oncle était bon pour elle! les autres seraient sans doute comme lui. Ce serait bien mal de sa part si elle allait les attrister par ses regrets inutiles; elle aurait du courage, elle tâcherait de ne pas songer au passé, elle serait de la famille, tout de suite; elle les aimerait; elle ferait son possible pour se faire aimer d’eux, pour se rendre utile dans la maison. Elle avait tant désiré une sœur! elle en aurait deux maintenant! elle n’avait qu’à vouloir pour être heureuse. Oui, elle serait heureuse à la Rochelle, très heureuse assurément.
L’idée de ce bonheur-là lui donnait pourtant encore un peu envie de pleurer; mais elle fit un effort sur elle-même et répondit gaiement à son oncle. Elle lui demanda des détails sur le pays qu’ils parcouraient; M. Davery était fort instruit: il put lui citer une foule de particularités historiques ou artistiques sur les villes qu’ils voyaient paraître et disparaître; et il vit, avec un certain étonnement, aux réponses de Lucile, que rien de tout cela ne lui était étranger, et qu’elle pouvait s’intéresser à un château féodal comme à un tableau ou à un poème, à un héros comme à une église gothique. «Elle est bien plus instruite que Valentine, quoiqu’elle soit plus jeune de deux ans, pensa-t-il: quelle charmante compagne elle devait être pour ce pauvre Granvier!» Il la fit causer, il prit plaisir à l’entendre, il admira l’expression intelligente de ses yeux pendant qu’elle écoutait; et le long voyage leur sembla court à tous deux.
Ils étaient donc fort bons amis quand le train s’arrêta en gare de la Rochelle. Là, Lucile se sentit de nouveau le cœur serré : toute frissonnante, elle suivit M. Davery dans la salle des bagages, et regarda autour d’elle, tristement, pendant qu’il réclamait les malles et les faisait charger sur une voiture.
«Je parie que c’est elle!» dit tout à coup une voix presque à son oreille. Elle se retourna: un jeune garçon vêtu de noir, avec une épingle de jais à sa cravate et un crêpe à son chapeau, la montrait à un jeune homme qui semblait chercher quelqu’un dans la foule.
Elle n’avait pas manqué de se faire décrire par M. Davery chacun des membres de la famille; elle devina tout de suite que c’étaient là ses deux cousins. Elle fit un pas vers eux, et Frédéric, n’hésitant plus, s’avança en lui tendant la main.
«Ma cousine Lucile? Vos cousins Davery: voilà Jacques, et moi je suis Frédéric. Papa doit être allé retirer les malles, n’est-ce pas?»
Lucile mit sa petite main dans la main de Frédéric, tout en levant les yeux vers le grand Jacques, qui lui parut bien imposant. Jacques vit sans doute qu’il lui faisait un peu peur: car il se pencha vers elle en lui souriant, ce qui éclaira tout à coup sa figure brune ombragée par tant de cheveux noirs et des sourcils si épais, qu’au repos il avait toujours l’air un peu rébarbatif. Il s’informa, en adoucissant sa voix de basse, de la santé de sa cousine, lui dit que sa mère et ses sœurs l’attendaient avec impatience; puis, voyant qu’elle laissait reposer à terre un sac de cuir trop lourd pour ses faibles bras, il le lui prit, ainsi que son parapluie et sa couverture; et Lucile trouva que décidément il ne fallait pas se fier aux apparences: car si son grand cousin avait l’air sévère, cela ne l’empêchait pas d’être bien bon.
Elle fit, au bras de Frédéric, le trajet de la gare à la maison de son oncle; et Frédéric lui raconta les choses les plus divertissantes qu’il put inventer. Quand on arriva à la maison, Lucile était déjà tout accoutumée à ses cousins; et, si Frédéric ne lui inspirait pas autant de respect que son frère, elle le considérait au moins comme un aimable garçon.
«Drelin! drelin!» la sonnette s’ébranle et retentit: Pacifique se précipite vers la porte, et M. Davery pousse Lucile en avant. La voilà dans le vestibule, dont on a allumé la lanterne ce soir-là : c’est un extra qui ne se fait que les jours de fêtes. La porte de la salle à manger s’ouvre toute grande, laissant voir la table mise, la lampe allumée, le feu brillant. Lucile éblouie, étourdie, se sent enlevée et pressée par deux bras caressants; elle entend une voix tremblante qui lui murmure tout bas: «Mon enfant! ma fille! ma chère petite Lucile!» pendant que des larmes chaudes coulent sur son visage. Puis elle se trouve, sans savoir comment, assise au coin du feu dans un grand fauteuil; Valentine lui enlève son chapeau en lui souriant, et la petite Marcelle, agenouillée devant elle, lui ôte ses gants en lui demandant si elle n’est pas trop fatiguée. Debout, à deux pas d’elle, Mme Davery la regarde d’un air attendri. Lucile sent toutes ses craintes s’envoler, elle est rassurée, elle est heureuse; elle se lève et va se jeter dans les bras de Mme Davery en s’écriant: «Oh! ma tante! comme vous ressemblez à maman!
— C’est toi qui lui ressembles, ma chérie! Je crois la revoir, quand elle avait tes quinze ans. Ma pauvre Thérèse! fallait-il que la maladie l’eût changée, pour qu’elle en fût venue à ressembler à sa sœur aînée!... M ais toi, tu te portes bien, n’est-ce pas? Tu n’es pas trop lasse? Tu dois avoir froid: chauffe-toi bien, et puis nous dînerons; tu dois avoir faim aussi?
— Je ne sais plus... je n’ai besoin de rien, je suis contente... Ma cousine, vous voudrez bien m’aimer un peu, n’est-ce pas?
— Je t’aime de tout mon cœur, Lucile!» répond Valentine, qui a compris tout de suite que Lucile n’avait rien d’une petite peste. Et Marcelle, qui ne veut pas être oubliée, s’attache à la robe de Lucile en répétant: «Et moi aussi, Lucile! et moi aussi!»
Pacifique entre avec la soupière; elle la pose bien vite sur la table, pour pouvoir essuyer ses yeux qui sont troubles: c’est l’émotion de revoir «la fille de Mlle Thérèse». Elle demande la permission d’embrasser Lucile, parce qu’elle l’a vue naître, et qu’elle avait vu naître aussi sa mère et sa tante; et Lucile ne refuse pas la permission.
On dîne gaiement; chacun se met en frais pour l’orpheline; il faut que dès le premier soir elle se trouve chez elle. Et elle s’y trouve si bien, qu’elle se met tout de suite à aider au service, à couper du pain, à passer des assiettes, à desservir la table quand le dîner est fini; on voit qu’elle a l’habitude de penser aux autres. Puis on cause au coin du feu; les garçons ont pris leurs précautions et fait leurs devoirs d’avance pour n’avoir pas à travailler ce soir-là. Mais la causerie ne sera pas longue; Mme Davery, qui pense que Lucile doit avoir besoin de repos, donne bientôt le signal de la retraite; et toute la famille fait escorte à la petite cousine pour la conduire à sa chambre. C’est pour lui faire honneur, d’abord; et puis, il y a peut-être un peu de curiosité là-dedans; on n’est pas fâché de savoir si les grands travaux qu’on y a exécutés auront l’honneur de lui plaire. Les curieux ont lieu d’être contents: Lucile admire tout, trouve tout joli et charmant; elle est touchée, elle est confuse de la peine qu’on a prise; elle remercie, de sa douce voix, avec son gracieux sourire, tous ceux qui ont travaillé pour elle; enfin on la laisse seule avec Valentine, au grand regret de Marcelle, qui voudrait bien avoir un joli lit à rideaux roses dans la chambre des deux grandes demoiselles.
Valentine aimerait à causer avec Lucile, à ébaucher avec elle mille projets d’étude et d’amusements; mais cette pauvre Lucile doit être si fatiguée! il faut la laisser dormir. Elle lui souhaite donc le bonsoir, vient la border dans son lit, l’embrasse... et toutes les deux sont bientôt parties pour le pays des rêves.