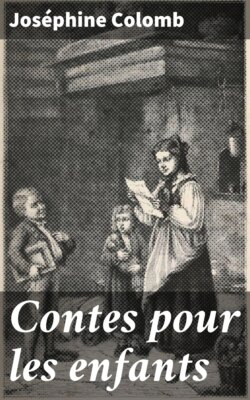Читать книгу Contes pour les enfants - Josephine Colomb - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMARIE AUX FLEURS
Table des matières
LÉGENDE
Quel beau jardin c’était que le jardin de la grande maison blanche, tout là-bas, plus loin que la porte de la ville! Au printemps, les lilas inclinaient pardessus le mur leurs grappes de fleurs parfumées; et à travers la large grille verte, les yeux ravis ne pouvaient se lasser de contempler les pivoines et les giroflées, les iris et les roses. Il n’y avait guère d’heure où l’on ne vît quelque tête d’enfant curieux, appuyée contre les barreaux de la grille, dévorant du regard ce paradis terrestre.
C’est qu’ils habitaient le faubourg voisin, les enfants qui s’arrêtaient ainsi devant le jardin de la maison blanche, que le faubourg était bien triste et bien sombre, et qu’on n’y voyait guère de soleil ni de fleurs. Les maisons, petites et basses, étaient habitées, presque toutes, par des tisserands, dont la main tendait les fils du matin au soir, pendant que leur pied faisait aller le métier. Clic clac, clic clac, voilà ce qu’on entendait, depuis l’aube jusqu’à la nuit, dans toute la longue rue qui formait le faubourg. Les enfants pâlissaient dans les chambres humides où ils aidaient leurs pères à tendre les fils sur le métier; et, le soir venu, ils jouaient sans gaieté dans la rue sombre aux ruisseaux fangeux. Ils n’avaient dans l’année que quelques jours de joie et de soleil, les pauvres-petits! c’étaient les jours où ils allaient, avec leurs mères, étendre Les pièces de toile sur l’herbe des prairies, où la rosée de la nuit devait se charger de les blanchir. Ces jours-là, que de jeux, que d’ébats dans les prés et le long des buissons! On en parlait longtemps d’avance, on y pensait longtemps après. Les prairies au bord de l’eau, et le jardin de la maison blanche, voilà ce qui occupait toutes les petites têtes du faubourg; le jardin sur-out, comme de juste, puisqu’on n’y était jamais entré.
Un jour, un groupe de petits curieux, arrêtés en contemplation devant les fleurs — c’était dans la saison des lilas — vit la grille s’ouvrir, et des visiteurs sortir du beau jardin. Ils étaient deux, un vieillard et une petite fille; et ce qui frappa les enfants, c’est que la petite fille tenait à deux mains un énorme bouquet de lilas.
Les enfants se poussèrent du coude, et leurs yeux suivirent avec admiration — avec envie aussi — la petite fille et son bouquet. — «Est-elle heureuse!» dit l’un d’eux en soupirant; et ils reprirent tristement le chemin du faubourg. La fillette marchait devant eux, légère comme un oiseau, riant et causant avec le vieillard, qu’elle appelait «grand-père». Elle traversa ainsi tout le faubourg, et les enfants la virent s’arrêter à la porte d’une des premières maisons de la ville. Le grand-père frappa, la porte s’ouvrit, la petite fille et son bouquet entrèrent et disparurent.
Le lendemain, on la revit dans la rue sombre. —C’est la petite fille aux fleurs! se disaient entre eux, sur son passage, ses petits envieux de la veille; et ils la suivirent de loin en se demandant: «Est-ce qu’elle y va encore?»
Elle y allait encore, et comme la veille, quand elle ressortit, elle était chargée d’un bouquet de lilas, qui parut aux pauvres enfants encore plus fleuri que le précédent. Même un tout petit garçon, déjà vêtu d’une culotte de drap, quoiqu’un bonnet de fille couvrît encore ses boucles blondes, s’approcha tout près de la grille au moment où elle s’ouvrait, si près que la fillette le toucha en sortant. Elle le regarda et lui sourit; puis, se retournant vers son grand-père: —«Oh! vois le gentil petit enfant! dit-elle. Je voudrais avoir des bonbons à lui donner! Tiens, petit, veux-tu une fleur, puisque je n’ai pas de bonbons?»
L’enfant saisit la fleur qu’elle lui tendait, et, comme s’il eût craint qu’elle se ne ravisât, il rejoignit vivement ses compagnons. Ceux-ci lui firent un cortège triomphal pour rentrer au faubourg, et lui, en bon prince, tendait à l’un, puis à l’autre, sa branche de lilas, pour que chacun à son tour pût en sentir le parfum. Quand il rentra chez lui, ce fut une fête pour son père, sa mère et sa petite sœur. La fleur fut mise soigneusement dans un vieux pot plein d’eau fraîche; et par moments le tisserand arrêtait son métier pour la regarder à son aise.
La première fois que la jeune fille et le vieillard retournèrent à la maison blanche, le petit blondin les guetta à la grille; et se rappelant qu’il avait reçu la branche de lilas sans remercier la donatrice, il dit à demi-voix en avançant la main: «Merci, mademoiselle! » Mademoiselle s’arrêta, le regarda, le reconnut et se mit à rire. «Tu as mis du temps à trouver ces deux mots-là, lui dit-elle; mais enfin tu les as trouvés; c’est bien, cela! Tiens, voilà une autre fleur.»
Un nouveau merci accueillit ce nouveau don, et l’enfant courut en avant pour montrer sa richesse à ses camarades. Quand la jeune fille passa dans la rue, on chuchotait, on se dressait autour du blondin et de sa fleur; et quelques voix timides murmurèrent bien bas: «Un petit bouquet, s’il vous plaît, mademoiselle! » Elle s’arrêta, détacha quelques fleurs de son bouquet et lés mit dans les petites mains qui se tendaient vers elle. — «Qu’as-tu, Marie? lui dit son grand-père en lui voyant les yeux pleins de larmes. — Je ne sais! répondit-elle. Ces pauvres enfants qui demandent des fleurs comme si c’était un sou, ou du pain... cela me donne envie de pleurer.»
Depuis ce soir-là, quand on la voyait passer pour se rendre au grand jardin, on se disait de maison en maison: «Voilà la petite fille aux fleurs!» et comme on avait entendu son grand-père l’appeler Marie, on prit l’habitude de dire: «Voilà Marie aux fleurs!» Tout le long du faubourg, des têtes paraissaient aux fenêtres, tout exprès pour sourire à Marie; et les petits enfants lui envoyaient des baisers. Au retour, elle paraissait au bout de la rue, les bras chargés d’une gerbe de fleurs; quand elle arrivait chez elle, ses mains étaient presque vides; mais chaque pauvre demeure s’égayait d’une rose ou d’un œillet, et les petits enfants, qui avaient entendu parler de bonnes fées, s’endormaient en rêvant d’une belle dame qui ressemblait à Marie, et qui, d’un coup de sa baguette d’or, changeait tout le faubourg en un riant jardin.
Quand Marie était accompagnée de son grand-père, elle distribuait ses fleurs sur sa route sans opposition; le vieillard souriait, tout ému, et la contemplait en murmurant: «Belle et bonne!» Mais quand la gouvernante, la vieille Brigitte, était chargée de conduire Marie à la maison blanche, elle grommelait contre la générosité de la jeune fille, et tâchait d’écarter «ces petits mendiants», comme elle les nommait. Mais Marie les rappelait autour d’elle. «Ils sont si heureux! disait-elle à Brigitte, et cela me fait tant de plaisir de les voir heureux!»
L’été passa, puis l’automne; puis l’hiver vint, et Marie n’eut plus que bien peu de fleurs à distribuer à ses petits amis. Ils attendaient le printemps avec impatience: cette année, ils auraient tous du lilas! Ils oseraient tous lui en demander, maintenant! Les lilas se couvrent de bourgeons, les bourgeons deviennent du feuillage; les boutons rougissent, grossissent et s’entr’ouvrent... voilà les fleurs épanouies! Où donc est Marie, et pourquoi ne la voit-on plus?
Marie est malade. Ses petits amis ont guetté à sa porte, et ils ont vu le médecin entrer et sortir. Il vient bien souvent! et le grand-père, qui le reconduit, a l’air bien triste! et la vieille Brigitte, à qui le blondin a osé demander des nouvelles de Marie, s’est mise à pleurer, au lieu de le rudoyer, comme il s’y attendait. Est-ce qu’elle pourrait mourir? «Les fées ne meurent pas! disent les petits. —Ni les anges non plus!» répond une grande fille qui ne croit plus aux fées. Les mères secouent la tête tristement; elles savent que les anges de la terre sont mortels.
Mai est tout brillant de fleurs, et le soleil inonde les prairies; il glisse même quelques gais rayons dans la vieille rue du faubourg. Mais personne n’est disposé à rire au soleil; on s’aborde en se disant: «Savez-vous? elle est morte!» Les enfants pleurent et les mères sont tristes.
Ils sont tous partis, les enfants, ils sont tous allés du côté des prairies éblouissantes. Où vont-ils donc? Dans la triste maison, un vieillard, aussi pâle que ses cheveux blancs, est assis au pied d’un lit, les yeux fixés sur le doux visage de la jeune morte. Elle semble dormir, et sourire en dormant: ange ou fée, qu’elle est belle ainsi! Le vieillard l’admire encore, celle qu’il aimait tant, sa dernière joie, sa dernière tendresse... Mais pourquoi ce bruit en bas? Des voix, des pas... Brigitte résiste... on monte pourtant... la porte s’ouvre... «Laissez-nous la voir encore une fois! nous ne ferons pas de bruit!» disent des voix enfantines; et tout le petit peuple du faubourg entre en retenant son haleine.
Ils sont tous chargés de fleurs; non des fleurs fastueuses qu’on cultive à grands frais dans les jardins, mais des fleurs que le bon Dieu sème à profusion sur la terre pour l’embellir et pour qu’elles nous fassent penser à lui. Et la chambre se remplit d’un parfum de primevères et de jacinthes sauvages, de muguet et d’aubépine; les enfants couvrent le lit funèbre de pâquerettes et de myosotis, et de toutes les fleurettes qu’ils ont pu moissonner dans la grande herbe; et puis, malgré leur promesse de ne pas faire de bruit, ils n’y peuvent plus tenir, ils fondent en larmes, ils éclatent en sanglots.
«C’est notre cadeau, à nous, des fleurs des champs! disent-ils en pleurant. Nous n’avons pas de belles fleurs comme celles qu’elle nous donnait; mais nous sommes allés cueillir celles-là bien loin dans les prés, pour elle! N’est-ce pas qu’elle ne les refuse pas? N’est-ce pas qu’elle nous entend et qu’elle sait que nous l’aimons?»
Les entend-elle? On le croirait: car une légère teinte rosée a paru sur son visage, et ses lèvres ont fait un mouvement. «Oh! mon Dieu! s’écrie le grand-père. Vite, le médecin!» ‘Et, tout tremblant, il se penche vers ce cher visage qui s’anime, vers ces yeux bien-aimés qui s’entr’ouvrent... «Elle vit! elle vit!» s’écrie-t-il au moment où le médecin, accouru en hâte, entre dans la chambre. Le médecin s’approche, la regarde, touche sa main... «Elle est sauvée! dit-il. Mais que font là ces fleurs, ces enfants...? il y a de quoi tuer la malade... — Non, dit-elle, laissez-les; c’est leur parfum qui m’a ranimée; ce sont leurs voix qui m’ont réveillée...»
Marie aux fleurs est guérie; le médecin dit qu’elle a été en léthargie, mais les enfants du faubourg n’en croient rien, ni leurs mères non plus. Pour eux, elle était bien morte; et le bon Dieu a rouvert les portes de son paradis pour la laisser revenir sur la terre, parce qu’il a écouté les prières des pauvres enfants qui l’aimaient, et qu’il a eu pitié de leur chagrin. Parce que, disent les habitants du vieux faubourg, Dieu aime ceux qui sont bons pour les pauvres gens.