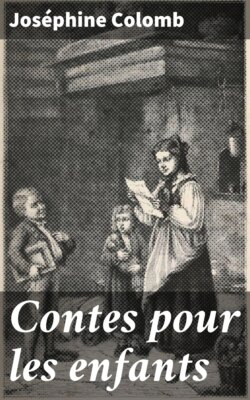Читать книгу Contes pour les enfants - Josephine Colomb - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
UN TRAIT D’UNION
ОглавлениеTable des matières
«La veuve Reffel est-elle à la maison, s’il vous plaît? dit en se présentant sur le seuil de la porte un homme d’une soixantaine d’années, vêtu comme un paysan aisé.
— Non, monsieur, répondit une avenante jeune femme qui savonnait du linge dans un baquet; mais elle rentrera bientôt: donnez-vous la peine d’entrer. Je vais vous servir un pot de bière, et vous vous reposerez en l’attendant.»
Le vieillard entra sans se faire prier, et alla s’asseoir sur un banc, près de l’âtre. La jeune femme, avec un air respectueux et un peu timide, le débarrassa de son bâton de voyage, et lui présenta une chope de bière mousseuse et du feu pour allumer sa pipe; puis, comme la matinée était fraîche, elle ajouta quelques brins de bois clair au feu qui faisait bouillir la marmite. Le voyageur, satisfait, étendit ses mains devant la joyeuse flambée; puis, prenant son verre: «A votre santé et contentement, dit-il: vous méritez d’avoir bonne chance en ce monde, car vous savez ce que la jeunesse doit aux hommes d’âge.»
La jeune ménagère rougit.
«Merci, monsieur, répondit-elle: je suis sûre que vous me porterez bonheur. Avez-vous tout ce qu’il vous faut? Je vous demanderai la permission de continuer mon ouvrage.
— Et moi celle de vous regarder! Je n’aime rien tant que de voir travailler les personnes qui ont du cœur à la besogne.»
Elle se remit à frapper son linge avec le battoir, qui faisait jaillir sur ses bras nus de petites bulles de savon, pareilles à autant de petits arcs-en-ciel. Elle fredonnait une vieille chanson, et le visiteur la regardait à travers la fumée de sa pipe.
«Comme elle a bonne grâce à l’ouvrage! se disait-il. Elle tape, elle frotte, elle tord, elle ne se repose pas une minute: voilà bientôt son linge lavé. C’est une bru comme celle-là qu’il m’aurait fallu, puisque Jean ne voulait pas absolument de la grande Lisbeth. Mais il s’était entiché d’une fille de la ville: une princesse, bièn sûr, qui ne sait pas distinguer un veau d’un âne! jolie bru pour un campagnard!... On est bien ici: je voudrais savoir où la cousine Reffel a trouvé une pareille servante, si alerte et de si bonne humeur. Elle a l’œil à tout: elle a mis du bois au feu pour me réchauffer, et elle a eu soin d’écarter la marmite du foyer pour l’empêcher de bouillir trop fort; elle me remplit mon verre dès que je l’ai vidé.»
«Madame Reffel ne revient point, dit la jeune femme en s’arrêtant devant le vieillard. Cela vous ennuie peut-être d’attendre; j’irais bien la chercher, si j’osais... mais j’ai peur que mon petit Franz ne se réveille.
— Ah! c’est à vous le petit qui est là ? dit-il en regardant un berceau qu’elle lui indiquait du doigt. Eh bien! s’il se réveille, je le bercerai pour le rendormir: ça n’est pas un métier difficile. Vous pouvez être tranquille, j’aurai soin de lui; j’aime beaucoup les petits enfants.
— Vrai? dit la jeune femme, qui parut toute joyeuse. Eh bien, j’y vais.
— Dites-lui que c’est son cousin Bormann.»
Elle partit, laissant le vieillard charge de la garde de l’enfant. Le petit coquin semblait n’attendre que le départ de sa mère pour se réveiller. On l’entendit pousser un léger grognement, se retourner dans son berceau; puis il y eut un silence; et tout à coup une petite main écarta le rideau, et une petite voix appela: «Maman!» avec un frais éclat de rire.
«Eh bien, mon gaillard, il paraît que tu as le réveil gai, dit le vieillard en riant lui-même. J’ai promis de te bercer pour te rendormir, mais je crois que ce sera difficile. Essayons pourtant.»
Il alla près du berceau et se mit à le balancer doucement. Mais le marmot, tout étonné de voir cette figure inconnue, changea subitement de physionomie abaissa les coins de sa bouche et se fourra les poings dans les yeux en gémissant.
«Eh! là ! là ! mon bel enfant! il ne faut pas pleurer... non, non, le mignon, le petit, le joli poupon... Allons, voilà que nous nous calmons: c’est gentil, à la bonne heure!»
Le petit, comprenant très bien que cette bonne vieille figure n’était pas la figure d’un ennemi, avait repris sa sérénité, et tendait ses mains vers la pipe du vieillard.
LE VIEILLARD ASSIT L’ENFANT SUR SES GENOUX.
«Tu veux ma pipe? ne la casse pas au moins: c’est une fameuse pipe... Ah! le scélérat, il me tire les cheveux... Il m’empoigne le nez... C’est gentil, tout de même, de sentir ces petites mains-là sur votre figure... Allons, encore du chagrin!
— Maman! répéta le petit, qui avait regardé tout autour de la chambre.
— Elle va venir, ne pleure pas... Tiens, vois les petits chats... Veux-tu venir avec moi? Je te ferai danser... c’est cela!»
Le petit avait sans façon tendu les bras au bonhomme: il ne voulait plus dormir, il voulait jouer.
Le vieillard, un peu embarrassé de son rôle, alla s’asseoir auprès du feu, assit l’enfant sur ses genoux et commença à le faire danser, en lui chantant de sa voix chevrotante toutes sortes de chansons de l’ancien temps. Le marmot ne comprenait pas les chansons, mais il trouvait très amusant d’être secoué ainsi; il riait aux éclats et agitait ses petits pieds dodus, comme s’il eût dansé pour de bon. Enfin le vieillard s’arrêta essoufflé.
«D’autre!» dit l’enfant. Il ne savait guère que trois ou quatre mots, ce personnage de douze mois tout au plus, mais il faut convenir qu’il avait su choisir précisément ceux qui pouvaient lui être utiles.
«D’autre! comme tu y vas! Laisse-moi me reposer un peu en fumant une pipe. La voilà, la belle pipe!»
La belle pipe fut allumée et changea complètement le cours des idées du petit despote. Il ne songea plus qu’à saisir la jolie fumée blanche qui sortait du fourneau de porcelaine. Le vieillard souriait d’un air attendri.
«Comme cela me rajeunit pensait-il. Il me semble être au temps où mon Jean était tout petit... Celui-ci deviendra peut-être aussi un ingrat en grandissant, et son père se trouvera tout seul dans sa vieillesse... Mon Jean a un petit enfant comme celui-là ; il m’a fait savoir sa naissance, à la Noël de l’année dernière... J’aimerais bien à le voir; mais je ne veux pas recevoir sa mère... non, jamais je n’ouvrirai ma porte à une fille qui a épousé mon fils malgré moi!»
En ce moment la veuve Reffel entra, et leva les mains au ciel d’un air joyeux en voyant ce qui se passait dans sa maison.
«Eh! bonjour, cousin Bormann! dit-elle; soyez le bienvenu chez moi.
— Je suis venu à votre commandement, cousine, répondit Bormann: sur quoi donc vouliez-vous me consulter?
— Sur la valeur de mon bien; parce que, voyez-vous, je voudrais le vendre...
— Le vendre!
— Oui; je suis vieille, je voudrais me retirer quelque part pour me reposer.
— Et où irez-vous? chez votre neveu?
— Non pas! J’y ai passé huit jours à la Saint-Jean d’été, et j’en ai assez: il n’y a plus de paix chez lui depuis qu’il est marié avec la grande Lisbeth; vous savez bien, celle que vous vouliez donner à votre fils. Un vrai diable, capricieuse, exigeante et fière, à cause de l’argent qu’elle a apporté dans la maison. Mais, pour en revenir à mon bien, je veux vous montrer comme il est en bel état, les champs, les vignes, les bêtes, la maison, tout! C’est bien changé depuis deux ans, allez! Après la maladie que j’avais faite, j’étais restée faible et chétive, et je ne pouvais rien surveiller; aussi tout dépérissait que c’était pitié, et je me serais bientôt trouvée ruinée, si je n’avais pas pris à mon service un jeune ménage quia rétabli mes affaires. Vous n’avez jamais rencontré des travailleurs pareils: et honnêtes, et aimables!
— J’ai vu la femme tout à l’heure, interrompit Bormann en soupirant; et je me disais que mon fils aurait bien dû en prendre une pareille, au lieu d’une fille de la ville, qui ne peut rien entendre aux choses de la campagne.
— Oui, oui, reprit la veuve sans relever la remarque de son cousin, Catherine est tout à fait bonne ménagère; et puis, les choses qu’elle ne sait pas, on n’a qu’à les lui montrer, elle comprend tout de suite, et elle s’en tire mieux que les gens qui les ont faites toute leur vie. Elle est adroite, elle est gaie, et instruite! Elle sait une quantité de recettes pour la cuisine, pour le ménage, pour les maladies des personnes et des bêtes. Ce sont ses tisanes qui m’ont remise en bonne santé.
— Son petit garçon sera aussi aimable qu’elle, dit Bormann en embrassant le marmot, Il n’est pas sauvage du tout: nous sommes déjà une paire d’amis.
— C’est que sa mère l’élève bien; elle ne le gâte pas, et elle sait l’aimer comme il faut. Mais parlez-moi donc de vous: je vous trouve changé, depuis deux ans que je ne vous ai vu; êtes-vous malade?
—Malade? non; mais ce n’est pas gai de vivre seul; et puis c’est trop de fatigue, à mon âge, qu’une propriété comme la mienne.
— Si vous n’aviez pas chassé ce pauvre Jean...
— Je ne l’ai pas chassé ; je lui ai dit seulement: Si tu te maries contre mon gré, je ne recevrai jamais ta femme chez moi.
— Et il s’en est allé ; c’est tout simple. Vous avez été un peu entêté là-dedans, mon cousin, soit dit sans vous fâcher.
— Une fille bonne à rien! et qui n’avait pas le sou!
— Pas le sou, c’est vrai; mais il y a des qualités qui valent de l’argent; et pour ce qui est de n’être bonne à rien, qu’en savez-vous, puisque vous n’avez même jamais voulu la voir?»
Bormann secoua la tête sans rien dire, selon la coutume des gens qui manquent de bonnes raisons.
«Papa!» cria joyeusement l’enfant, en essayant de se tourner vers un nouvel arrivant dont il avait reconnu le pas. Bormann leva les yeux.
«Jean! s’écria-t-il d’une voix courroucée... Voilà votre fils, ajouta-t-il avec effort en lui tendant l’enfant comme pour le lui rendre.
— Gardez-le, mon père, dit le jeune homme, qui vint s’agenouiller devant lui; gardez-nous tous deux... tous trois!» et il montrait Catherine, qui s’était arrêtée à la porte, n’osant avancer.
Le vieillard se taisait; un reste de rancune luttait encore contre son émotion. Enfin deux larmes roulèrent sur ses joues ridées, deux larmes que l’innocent, déjà instruit par sa mère à consoler les affligés, essuya d’une caresse de ses petites mains.
«Ma fille! murmura Bormann en regardant Catherine.
— Eh bien! vous ne serez plus seul, cousin! et vous pourrez vous reposer à présent, dit la veuve Reffel quand toute la famille fut réunie autour du dîner servi par Catherine.
— Mais si j’emmène vos ouvriers, il faudra que je vous emmène aussi, cousine. Je connais un acheteur pour votre bien; je vais vous l’envoyer demain, et ensuite vous viendrez vous reposer avec moi, puisque Catherine vous plaît mieux que votre nièce Lisbeth. Cela vous va-t-il?
— C’était justement pour traiter de toutes ces affaires-là que je vous avais fait prier de venir me voir. Vous ne m’en voulez pas?»
Pour toute réponse, l’aïeul embrassa son petit-fils, qu’il avait voulu garder sur ses genoux.