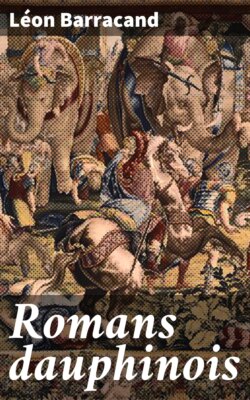Читать книгу Romans dauphinois - Léon Barracand - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеMais je sais la véritable histoire du mariage de Pierrette et du maître d’école, et je veux, avant d’aller plus loin, la raconter fidèlement.
Je dois revenir pour cela sur quelques détails biographiques qui les concernent et qui sont indispensables à la clarté de ce récit.
M. Gagnepain exerçait depuis vingt ans la profession de maître d’école à Saint-Romain-sur-Isère. Il n’avait pas été destiné à cette carrière qu’il n’embrassa qu’à dix-huit ans. Fils d’un paysan des environs, il se serait sans doute livré aux travaux agricoles, sans un accident qui le priva de l’usage d’une de ses jambes et qui le força de choisir une occupation sédentaire.
Il entra à l’école normale primaire, et en sortit, cinq ans après, en sachant plus que n’en savent d’ordinaire ceux qui se destinent à l’humble profession de maître d’école. Il aurait pu trouver une place dans un collège; mais il était sans ambition et préféra venir s’établir dans son village, où l’appelaient d’ailleurs quelques intérêts de fortune, ses parents étant morts dans l’intervalle en lui laissant un petit patrimoine. Il ne conserva qu’un champ sur les bords de l’Isère, vendit le reste et en employa le prix à l’achat de la maison où il devait tenir école.
A partir de ce jour, sa sollicitude se partagea entre les soins donnés à ses élèves et la culture de son champ. Le goût des occupations champêtres avait survécu à l’incapacité qui l’avait frappé, mais qui lui permettait encore de piocher ses vignes, de tailler ses arbres fruitiers, d’arroser ses fleurs, d’embellir enfin de son mieux son petit héritage. Toutes les fois qu’il ne faisait pas la classe, on était sûr de le trouver là.
C’est ainsi que sa vie s’écoula, paisible et monotone, toute de dévouement à ses élèves. Cette existence sans heurts ni accidents, qui glissait comme un ruisseau sur un lit de mousse, dut lui sembler rapide dans sa monotonie même, et il atteignit la cinquantaine sans presque y avoir songé.
Peut-être fit-il alors un retour sur lui-même, et en jetant les yeux en arrière, se demanda-t-il si son bonheur n’aurait pas pu être plus complet; si, maintenant qu’il était arrivé au point culminant de l’existence et qu’il en allait redescendre l’autre pente, plus âpre encore et plus rapide que la montée, il devait se résigner à voir ses jours se succéder toujours les mêmes, sans plus de joie ni de peine. Il s’était sacrifié jusqu’à présent pour cette grande famille d’élèves qui se renouvelaient sans cesse, et qui tous le quittaient un jour, les Uns pour se souvenir de lui, le plus grand nombre pour l’oublier. Mais quelqu’un qui lui fût attaché par le cœur, un être qu’il pût chérir entre tous, auquel il laisserait tout ce qu’il possédait en mourant, il ne le trouvait pas autour de lui.
Son infirmité l’avait toujours empêché de songer au mariage et l’avait rendu timide avec les femmes. Il y avait là pour lui tout un monde plein de mystères, dont il n’approchait qu’en tremblant et avec de secrets battements de cœur; où il sentait que toute sa science et tout ce qu’il avait pu apprendre dans les livres ne devaient lui servir à rien.
Or, comme il arrive de toutes les choses dont l’espoir même nous est défendu, sa principale souffrance était précisément le désir de ce bonheur qui lui était interdit et l’incessante idée en même temps qu’il en serait toujours privé.
Les infirmités sont peut-être considérées à la campagne, où l’homme ne vaut que par la force matérielle qu’il déploie, d’un tout autre œil qu’à la ville, et je doute que M. de Talleyrand, avec tout son esprit et son pied bot, l’eût jamais emporté auprès d’une jeune campagnarde, sur un villageois bien découplé. Ces jeunes et rustiques cervelles gardent encore un culte païen pour la force et pour la beauté, et tout ce qui est dons d’esprit et rares qualités d’intelligence ne les touche guère.
M. Gagnepain le comprenait sans doute, lui qui avait toujours vu dans les yeux des femmes plus de pitié à son endroit que de sympathie, et c’était là pour lui un chagrin plus cruel que la vue de la jeunesse impitoyable de son école, qu’il surprenait parfois contrefaisant sa démarche claudicante.
Tant qu’il restait dans son école et le front penché sur ses livres, ces pensées ne le préoccupaient guère; mais quand il en sortait, quand, il se rendait à son champ, elles venaient l’assiéger en foule, sortant de terre pour ainsi dire à chaque caillou qu’il heurtait, et s’élançant vers lui de chaque côté de la route.
C’est que des deux côtés du chemin, il pouvait voir, à l’aurore, la porte des chaumières s’ouvrir, et apercevoir sur le seuil et dans leur intérieur, le tableau de tout ce dont il était à jamais privé: la ménagère préparant le repas, les enfants s’accrochant à sa jupe, le berceau près du grand lit, le père assemblant ses outils et interrogeant le ciel avant de se rendre à son champ, le feu flambant, la table dressée, toute la joie et l’allégresse d’une jeune famille prospère et d’une belle journée qui commence.
Si le maître d’école ne pouvait se défendre de considérer ce bonheur d’un œil d’envie, son cœur du moins était sans amertume, et loin de fuir le spectacle qui ravivait sa peine, il en rassasiait ses yeux.
Que de fois, parti de chez lui aux premières clartés de l’aube, il s’était attardé ainsi de chaumière en chaumière; puis, quand il arrivait à son champ, voyant qu’il était trop tard pour se mettre à l’ouvrage, il poussait sa promenade jusqu’à la ferme de son vieil ami, Jean Béchard, chez lequel il restait à causer jusqu’à l’heure de retourner au village et de commencer sa classe.
C’est chez lui qu’il avait rencontré pour la première fois une petite fille, que l’hospice avait attachée à la ferme en qualité de domestique. La bonté et la douceur de cette enfant, plus que sa grâce et ses attraits, la faisaient aimer de tout le monde; mais M. Gagnepain surtout, qui tout d’abord s’était pris pour elle d’une tendresse toute paternelle et qui jour par jour avait pu voir ses vertus se développer, l’aimait comme sa propre fille.
C’était lui qui lui avait appris à lire, quand elle venait, de grand matin, garder les brebis près de son champ; qui, plus tard, l’avait aidée de ses conseils, et avait fait d’elle ce qu’elle était devenue, une jeune fille douce et instruite, prudente, avisée et sage. Aussi, bien qu’elle eût grandi d’année en année et qu’elle fût près d’atteindre ses vingt ans, il la voyait toujours avec des yeux de père; il oubliait auprès d’elle le malaise et le trouble qu’il eût ressentis auprès de toute autre femme; il causait familièrement, il plaisantait et riait avec sa jeune élève, comme il eût fait avec n’importe lequel de ses écoliers.
Il faut dire qu’elle s’appelait Apolline des Platanes. Mais que la consonnance aristocratique de ce nom ne fasse rien préjuger: elle avait été baptisée ainsi du saint que l’on fête le jour où elle avait été recueillie, et les arbres de la petite place du village où l’on avait trouvé son berceau, lui avaient valu ce beau nom.
Vous pensez si, pour connaître le secret de sa naissance, la curiosité publique se mit en frais de recherches. Tout fut inutile, et l’on devait toujours ignorer le nom de ses parents.
L’enfant trouvée entra dans un orphelinat, et, dès qu’elle eut atteint sa dixième année, fut placée à la campagne, chez Jean Béchard. C’est là qu’elle fut dépossédée de son beau nom, et qu’on l’appela tout simplement Pierrette, du nom même de la ferme où elle était employée.
Jean Béchard finit, lui aussi, par s’attacher à cette enfant. Quand elle eut grandi, il lui confia la surveillance intérieure de la ferme. Elle s’acquitta à merveille de ses nouvelles fonctions, et l’on vit par ses soins prospérer l’étable et la basse-cour. Béchard, de plus en plus content d’elle, augmenta ses gages, ce qui permit à Pierrette de se montrer, les jours de fête, presque aussi bien parée que toutes les jeunes filles, légitimes héritières des plus gros fermiers des environs.
L’orgueil de ces dernières s’en offensa, d’autant qu’elles virent bien que Pierrette, sans rien faire pour cela, la pauvre enfant! trouvait moyen de détourner à son profit l’attention et les prévenances de tous leurs amoureux. Voilà qui ne pouvait s’expliquer, attendu que par la naissance et par la fortune autant que par la grâce et les beaux habits, elles lui étaient bien supérieures et qu’elles ne se gênaient pas pour le lui faire sentir à l’occasion. Quand elle paraissait à l’église, le vide se faisait autour d’elle; et, après les vêpres, quand parfois on dansait sur la place du village, aucune de ces demoiselles qui se respectaient un peu, ne voulait consentir à lui faire vis-à-vis.
Mais les garçons du village et ceux des environs n’avaient pas de ces scrupules. C’était pour eux une faveur vivement disputée que de danser avec Pierrette. Comme elle était bonne fille, et que, bien que sage, elle aimait à rire et à s’amuser, elle s’efforçait de contenter tout le’ monde et dansait autant qu’on le désirait. Aussi plusieurs ne se gênèrent-ils pas pour lui faire des déclarations; mais l’intelligente Pierrette comprenait très-bien si on voulait se moquer d’elle ou si on lui parlait pour le bon motif. Elle repoussa donc sans cesse, en souriant, toutes les offres et propositions des galants, jusqu’au jour où son mauvais sort lui conseilla d’écouter Cyprien.
Ce n’était pas le premier venu que Cyprien Rivet, apprenti charpentier à Saint-Romain-sur-Isère, et Pierrette pouvait à bon droit être fière des hommages qu’il rendait à sa beauté.,
Bien qu’il travaillât à la journée chez un patron, comme il avait quelque aisance, qu’il savait passablement son état, et qu’il avait d’ailleurs tiré un bon numéro à la conscription, il n’attendait plus que d’être marié pour se mettre à son. propre compte. Il avait vingt-un ans, et l’on pouvait croire que la clientèle ne lui manquerait pas, car c’était un brave cœur et un vaillant garçon. Les dimanches, il était presque mis comme un monsieur, car il portait une redingote; mais, même les jours de la semaine, il n’était pas déplaisant à voir, dans son large pantalon de toile où il y avait de longs goussets pour le compas, la règle et l’équerre, les manches de chemise retroussées jusqu’à l’épaule, et poussant vigoureusement sa varlope, tout en chantant gaillardement..
La première fois qu’elle reçut de lui des propositions de mariage, Pierrette n’en crut pas son bonheur, car la pauvre enfant n’ignorait pas qu’à cause de sa naissance, chacun se croyait en droit de la mépriser. Mais quand elle vit que Cyprien ne pensait pas ainsi, qu’il l’aimait et qu’il: serait fier de l’épouser, elle fut si ravie qu’elle l’aima par reconnaissance.
Dès lors, la timide et modeste Pierrette releva fièrement la tête; elle osa regarder en face les orgueilleuses demoiselles qui l’avaient accablée naguère de leurs dédains. Elle se sentit leur égale. Dès lors aussi, les deux jeunes gens se virent, ils causèrent, échangèrent de bonnes poignées de mains,–quelques baisers, rien de plus,–et ils attendirent pour être heureux que le prêtre eût béni leur union.
Quatre ou cinq jours avant l’époque fixée pour cette cérémonie, un dimanche soir, Cyprien Rivet était assis avec quelques amis au fond d’un cabaret de Saint-Romain-sur-Isère. Il se trouvait dans le nombre un mauvais sujet, à qui l’ivresse avait délié la langue, et qui, jaloux sans doute du bonheur que Cyprien ne pouvait s’empêcher de laisser paraître, s’amusa à le plaisanter.
Celui-ci, patient et indulgent comme le sont d’ordinaire les gens heureux, supporta pendant longtemps ces taquineries sans se plaindre, et en rit comme tous les autres. Cette tranquillité enhardit le mauvais plaisant qui, voulant s’assurer sans doute si rien ne serait capable d’ébranler sa placidité, finit par lui demander si le jour où il aurait un enfant, pour qu’il ne dégénérât pas de ses ancêtres, il l’exposerait sous les platanes de la place du village.
Cyprien releva la tête, pourpre de colère, et voulut par des menaces imposer silence au loustic. Mais ce dernier qui était arrivé à son but, ne se le tint pas pour dit, et il riposta que lorsqu’on était si fier, on n’épousait pas une bâtarde.
Comme c’était la vérité et qu’il n’y avait rien à dire, Cyprien, pour toute réponse, saisit une bouteille, et la brisa sur la tête de l’insulteur, que l’on releva baigné dans son sang.
Ses amis se précipitèrent sur lui pour le contenir, mais en un tour de main il se débarrassa d’eux, sortit du cabaret et courut s’enfermer chez lui.
Il avait bien agi, mais le lendemain le retrouva lâche. Il passa la nuit à réfléchir sur sa situation. La scène qu’il venait d’avoir pouvait se renouveler. Il se vit déjà la fable de tout le village. Enfin le respect humain l’emporta chez lui sur l’amour. Il rougit d’aimer une femme sans nom et dont la naissance était inconnue. Depuis qu’on l’avait insultée devant lui, Pierrette lui semblait moins belle et moins pure, et il en vint, lui aussi, à lui reprocher intérieurement l’irrégularité de sa naissance.
Il n’attendit pas le lever du jour, il fit un paquet de tous ses outils et de quelques hardes, et sans prévenir personne, sans laisser un mot pour Pierrette, il quitta le village dans l’intention de n’y plus revenir.
La nouvelle de sa fuite courut le lendemain de porte en porte, et alla jusqu’à la ferme de Jean Béchard noyer dans les larmes la pauvre Pierrette. Elle arriva aussi chez monsieur Gagnepain qui en fut douloureusement affecté.
Cet excellent homme avait fait son bonheur de celui de Pierrette, et quand celle-ci avait montré quelques scrupules d’accepter les propositions de Cyprien, lui-même les avait levés et avait fait disparaître toute hésitation, en faisant l’éloge du prétendant qu’il connaissait depuis longtemps et qui avait été son élève.
En songeant au mariage prochain des deux jeunes gens, le maître d’école avait vu une perspective nouvelle et enchantée s’ouvrir devant lui. Sa vie allait avoir un but, il aiderait à la prospérité du jeune ménage, il serait là chez lui, il se créerait avec eux une famille, il vivrait de leur vie, et en mourant il leur laisserait son petit héritage. Et voilà que tout ce bonheur, ces espérances brillantes, ce bel édifice construit avec tant de soins s’écroulait tout à coup et les ensevelissait, Pierrette et lui, sous ses ruines. Il fallait donc désespérer de la Providence qui ne voulait rien faire pour eux, et dire adieu pour jamais à toutes les joies que l’on s’était promises.
Monsieur Gagnepain, accablé de tristesse, attendit impatiemment le lendemain pour aller porter ses consolations à Pierrette. Au jour naissant, il se leva et se dirigea vers la ferme.
Il allait lentement et la tête baissée, car la gaîté et l’insouciance de ceux qu’il rencontrait, les cris joyeux des enfants sur le seuil des portes, tout ce qui le charmait naguère, lui faisait mal à voir et lui semblait autant d’outrages faits à sa douleur et à celle de Pierrette. La nature elle-même semblait vouloir se mettre de la partie, car il y avait de l’ironie dans le charmant spectacle qu’elle étalait à ses yeux et dans les splendeurs de cette belle matinée.
C’était un jour de mai, et le printemps, déjà avancé, avait couvert les arbres de feuilles et paré la terre de verdure et de fleurs. Toute cette végétation nouvelle apparaissait éblouissante de perles de rosée, comme si c’était un jour de fête et qu’elle eût voulu s’embellir. Mille insectes bourdonnaient sur la route, dans les rayons de soleil qui faisaient scintiller l’herbe humide. Et les oiseaux qui, à l’approche du maître d’école, s’enfuyaient à tire-d’ailes semblaient lui dire, dans leurs chansons assourdissantes, qu’ils étaient contents de vivre, que sa détresse ne les touchait pas, et qu’ils se hâtaient de construire des nids pour leur jeune famille qui allait naître.
Au milieu de cette allégresse universelle, monsieur Gagnepain s’avançait en comparant dans son cœur avec une amère sollicitude le bonheur de toutes ces créatures de Dieu et le désespoir de sa chère Pierrette qui, elle aussi, à cette époque printanière, s’était crue en droit d’être joyeuse et avait espéré se construire un nid.
Plus il approchait de la ferme, plus son pas se ralentissait, car il ne savait encore comment il allait l’aborder, ni ce qu’il lui dirait pour la consoler. Quand il arriva à son champ, il s’arrêta plein d’anxiété. Puis, après quelques minutes de réflexion, il s’arma de courage et marcha résolûment vers la ferme.
En entrant dans la cour, il aperçut Pierrette, déjà levée à cette heure matinale, qui, un seau à la main, se dirigeait vers l’étable. Au bruit de la crosse de monsieur Gagnepain, la pauvre enfant se retourna, et, l’ayant reconnu, posa brusquement son seau à terre, se laissa tomber sur un banc, et, cachant sa figure dans son tablier, se mit à sangloter. Monsieur Gagnepain franchit rapidement la cour, et alla s’asseoir à côté d’elle. Il lui prit la main et resta-une minute sans parler, les regards tristement attachés sur la pauvre fille qui ne cessait de fondre en larmes. A la fin, il lui dit:
–Pauvre Pierrette! voilà un grand malheur. Je ne m’attendais pas à cela de la part de Cyprien, je pensais le connaître, je le croyais bon. Il n’y a que vous de bonne, Pierrette!
–Et vous. dit-elle à travers ses larmes.
–Il faut oublier ce méchant garçon, qui n’était pas digne de vous, puisqu’il ne vous aimait pas… Allons! ne pleurons plus! Qu’est-ce que cela fait qu’il soit parti? Nous en trouverons bien un autre, et qui vaudra mieux.
–Non, dit-elle en secouant douloureusement la tête, ni lui ni un autre, plus personne.
–Aujourd’hui, sans doute; mais dans un mois, dans deux mois, quand vous serez consolée. Allons! séchons ces larmes. Si vous saviez, ma pauvre Pierrette, comme cela me fait de la peine de vous voir pleurer. Tenez! j’étais bien triste en venant, mais j’espérais vous consoler; et maintenant, je vois que je ne le puis pas, et je le suis bien plus encore.
–Eh bien! dit-elle, pour vous complaire…
Elle passa son tablier sur ses yeux, releva la tête, regarda droit devant elle, mais ses larmes coulaient quand même.
–Ah! il sera plus malheureux que vous, allez! s’il sait jamais ce qu’il a perdu en vous quittant… Il regrettera bien ce qu’il a fait.
–Vous ne l’auriez pas fait, vous, Monsieur Gagnepain?
–Non, sans doute, mais comment aurais-je pu…? Il ne s’agit à présent que de trouver un autre amoureux. Il reste encore de beaux garçons dans le village et de plus braves cœurs…
–De braves cœurs, oui.
–Et les autres jeunes filles ne vous les enlèveront pas tous.
A ces mots, les sanglots de Pierrette éclatèrent encore.
–Comme elles vont se moquer de moi! s’écria-t-elle. C’est une punition du ciel. J’étais devenue aussi fière, aussi orgueilleuse qu’elles. Si vous m’aviez vue, quand je les rencontrais, comme je les regardais fixement, comme j’avais l’air de les narguer… Me voilà bien avancée à présent!
Elle retira brusquement sa main qu’elle avait abandonnée à monsieur Gagnepain, et se cacha de nouveau le visage.
–C’est vrai pourtant, dit le maître d’école, comme se parlant à lui-même, que toutes ces filles vaniteuses vont être contentes de votre malheur. Elles étaient jalouses de vous, Pierrette! elles étaient dépitées de voir que votre fiancé faisait si peu de cas d’elles, et maintenant que vous n’avez plus de prétendant, que personne ne songe plus à vous....
Il s’arrêta, laissa tomber sa tête dans sa main, et réfléchit. Il la releva, regarda Pierrette avec un sourire plein d’hésitation, voulut parler, se tut, et réfléchit encore.
La jeune fille, étonnée de ce silence subit, se tourna à son tour vers le maître d’école.
–A quoi pensez-vous? lui demanda-t-elle.
— Je pensais… Ah! ma foi, non, je ne pourrais pas Tous le dire.
–Si! dites; dites, monsieur Gagnepain.
Et ses larmes s’étaient arrêtées tout à coup.
–Eh bien, reprit-il avec un sourire triste, je pensais. Ce n’est pas sérieux au moins, et vous ne m’en voudrez pas, Pierrette?
–Mais dites donc!
–Eh bien, je pensais, Pierrette, que je pourrais peut-être moi-même… si vous n’étiez pas trop effrayée de mon âge… si vous ne teniez pas trop à la beauté…
–Vous, monsieur Gagnepain! s’écria Pierrette, vous! est-ce bien vrai?
Elle s’était levée, rayonnante, puis, tout à coup, ses pleurs jaillirent de nouveau, et le maître d’école se méprit sur leur cause.
–Allons! dit-il, je suis un vieux fou. N’en parlons plus. j’augmente votre chagrin et vos larmes.
–Mais non, dit-elle, c’est de joie. J’y avais bien déjà pensé, mais. vous m’avez dit que c’était une plaisanterie?
–Eh quoi! Pierrette, serait-il vrai?… Vous ne me repousseriez pas? vous ne seriez pas humiliée d’être ma femme?
–Oh! non, dit-elle, fière au contraire!
—Mais, pauvre enfant, vous n’y songez pas… j’ai trente ans au moins de plus que vous. Je suis vieux, ridé et infirme… vous auriez là un beau mari!
–Ah! ce ne sont pas là des raisons, dit-elle… Vous ne voulez pas de moi.
–Pas de vous, Pierrette? Vous si douce, si belle et si bonne!… Je ne me suis jamais arrêté à cette idée, moi. Est-ce que cela m’était permis? mais maintenant, si je vois que c’est chose possible, et que vous ne me repoussez pas, vous m’allez faire devenir fou!… Savez-vous bien que vous êtes tout ce que j’aime le mieux au monde, que depuis dix ans je ne vis que pour vous, que vous êtes ma première pensée à mon réveil, et que si je viens chaque matin ici, c’est dans l’espoir de vous y voir?… Ah! Pierrette, ne vous moquez pas de moi, ne me dites pas que vous m’épouserez, si vous ne le voulez pas.
–Mais si, dit-elle, je le veux bien.
–Mais alors vous m’aimez donc?
–Si je vous aime!…
Elle s’interrompit un moment, l’émotion l’empêchant de parler; puis, se tournant vers le maître d’école:
–Mais fais-je autre chose, dit-elle, depuis que je vous connais, et n’en suis-je pas à me demander chaque jour comment je pourrai me montrer reconnaissante envers vous à qui je dois tout? Qui donc s’est occupé de moi, quand j’étais petite? Qui m’a consolée dans toutes mes peines? Qui fut pour moi un père, un ami? Qui me tint lieu de famille, à moi qui n’en avais pas?… Que de fois e me suis dit: si j’étais seulement plus grande, et si monsieur Gagnepain pouvait penser à moi!… Mais comment supposer que vous voudriez de moi? Ah! si j’ai cru en aimer un autre, c’est bien votre faute. Vous sembliez heureux de ce mariage, et moi j’ai cru que vous ne vouliez pas m’épouser.
–Mais si, mais si, dit le maître d’école. Pourtant je crains… j’ai peur que vous ne vous repentiez? Ce bonheur me trouble. Il faudra réfléchir.
–C’est tout réfléchi, dit Pierrette.
—Non, à demain… Je sens que ma tête s’en va… Nous en reparlerons demain.
Il se leva, et Pierrette le suivit. Elle avait séché ses larmes, et un sourire de bonheur s’épanouissait sur ses lèvres et transfigurait son visage. Au moment de quitter monsieur Gagnepain, elle lui prit la main.
–Vous, lui dit-elle en souriant, vous ne m’abandonnerez pas?
–Chère enfant! s’écria-t-il, mais je crois rêver. Dieu veuille que ce songe ne se dissipe pas. A demain.
Et il poursuivit rapidement sa route, se retournant de temps à autre pour voir Pierrette qui regagnait la ferme, et qui, elle aussi, se retournait pour lui sourire et pour remuer gentiment la tête en ayant l’air de lui dire: «Oui, à demain; c’est vrai, je vous aime…» jusqu’à ce qu’ils se fussent perdus de vue à un coude du chemin.
Quand il se trouva seul, monsieur Gagnepain jeta des regards autour de lui pour s’assurer que personne ne le voyait. Puis il s’arrêta, s’appuya sur sa béquille, et porta la main à ses yeux qui se trouvèrent pleins de larmes.
Cet homme de cinquante ans, qui n’avait jamais été aimé et qui avait conservé un cœur jeune, pleura comme s’il eût eu vingt ans. Mais il fallait se hâter, car huit heures avaient sonné à l’horloge du village, et ses élèves devaient l’attendre pour la classe.
Il pressa donc le pas. Jamais sa béquille ne s’était trouvée à pareille fête et n’avait fait de telles enjambées; pour un peu il l’eût jetée dans la haie voisine et se fût mis à danser. Jamais aussi il n’avait senti son cœur aussi plein de joie et n’avait promené des regards aussi fiers autour de lui. Il comprit maintenant pourquoi les oiseaux chantaient si gaîment dans la matinée, pourquoi la nature s’était parée et mise en fête sur son passage, et il en remercia Dieu du fond de son cœur.
Quand il arriva à l’école, tous les élèves, montés sur les bancs et sur les pupitres, faisaient un vacarme effroyable et se poursuivaient en se lançant leurs livres. Chose singulière! monsieur Gagnepain ne dit rien, ne fronça même pas le sourcil: au contraire, il leur adressa à tous le plus gracieux sourire et leur demanda pardon du retard.
Il fit réciter les leçons, et au lieu de braquer ses lunettes sur l’écolier, il tenait sa tête dans ses mains et ne s’apercevait pas qu’on lisait impudemment dans le livre tout ouvert. Quand on avait fini, il disait: «Très-bien, mon garçon.» et il marquait une bonne note.
Il ne se donna pas la peine de regarder si tous les devoirs étaient exactement faits. Il en corrigea quelques-uns, y releva des fautes énormes, après quoi il dit encore: «Très bien, très-bien…» Tous les élèves se regardaient et n’en revenaient pas. Il ne distribua pas une seule punition, et au moment où midi sonnait et où tout le monde se levait, il annonça qu’il effaçait tous les pensums; et tous les élèves crièrent ensemble: Vive monsieur Gagnepain!
Mais ils eurent, quelques jours après, l’explication de ces bizarreries, quand ils apprirent que le maître d’école allait épouser Pierrette.
La veille du mariage, ils lui lurent un fort beau compliment et lui offrirent un magnifique bouquet que monsieur Gagnepain s’empressa d’envoyer à la ferme. Il leur donna congé pour le lendemain, parce que ce jour-là, leur dit-il en souriant, il serait trop occupé pour faire la classe. Et tous ses élèves, sans attendre la consécration légale, s’écrièrent d’une seule voix: Vive monsieur et madame Gagnepain!
Et voilà l’histoire du mariage de Pierrette et du maître d’école de Saint-Romain-sur-Isère.