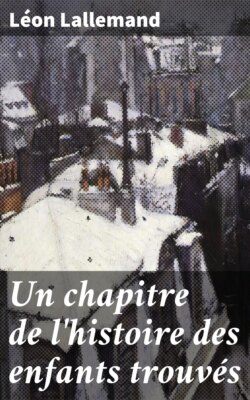Читать книгу Un chapitre de l'histoire des enfants trouvés - Léon Lallemand - Страница 15
Fondations et aumônes.
ОглавлениеJusqu’ici nous n’avons parlé que des concessions de l’autorité royale; il faut examiner les actes dus à la charité privée en faveur des pauvres trouvés.
A l’origine, nous voyons les dames fondatrices de la maison de la Couche fournir généreusement à tous les besoins; l’établissement du faubourg Saint-Antoine est acheté, agrandi avec ces libéralités.
La première bienfaitrice est Mme d’Aligre; «puis S. A. S. Mme la princesse de Condé eut la charité en 1709, M. Rousseau directeur général des monnoyes de France en 1718, et successivement plusieurs autres personnes de piété, de faire construire à leurs dépens les bâtiments qui forment les deux ailes, au moyen de quoi la maison pouvait contenir 6 à 700 enfans..» Plus tard, en 1758, «une personne de considération,» qui ne voulut jamais être nommée, proposa au bureau d’élever deux pavillons nouveaux, l’un pour les garçons, l’autre pour les filles . Cette pieuse personne paya non seulement toutes les dépenses de construction, mais encore celles des lits et des meubles nécessaires.
Voici maintenant quelques libéralités relevées au hasard dans les procès-verbaux et intéressantes par leur importance ou leur origine.
Le 26 janvier 1671, Mme Jolly apporte au bureau vingt louis d’or de «l’Aumosne du Roy».
En 1673, Mme Amyot donne la somme nécessaire pour l’élévation des fonts baptismaux de la chapelle.
Le 10 septembre 1674, Mme de Guisse (sic) envoye«deux louis d’or pour faire prier Dieu pour monsieur d’Alençon lequel est malade».
Le père Edmond Boutonné, de l’Oratoire de Gesù, donne deux mille livres, à condition qu’on lui servira une rente viagère de 153 livres (14 février 1674 ).
Mme Faverolles offre cent louis d’or, valant 1,100 livres, à charge de faire dire une messe pour le repos de l’âme de frère Faverolles, son fils, religieux profès à la Trappe (9 mars 1678).
Mme de Fromon fait envoyer au bureau soixante louis d’or, «provenant de la queste faitte en la cour, à Pasques, par les soins de Mme de Maintenon» (20 may 1693).
Pierre Petit, enfant trouvé, décédé à la Charité, laisse à la maison où il avait été élevé ses habits, linges, hardes et 170 livres 10 sous 23 deniers (18 novembre 1693).
Le 10 avril 1720 on trouve dans un des troncs de l’église Notre-Dame un paquet cacheté contenant cinq billets de banque de mille livres chacun, «et estait escrit sur le papier servant d’enveloppe que l’intention de celuy qui donne ces billets est que messieurs les administrateurs en fassent apprendre des métiers aux enfants, et que l’on fasse dire 50 messes pour demander que le bon Dieu luy fasse miséricorde ».
Le 16 février 1751, M. le marquis de Delassay fait don d’une somme de 100,000 livres. Deux ans plus tard M. Delahaye lègue 50,000 livres, moitié à l’hôpital général, moitié aux enfants trouvés (4 décembre 1753).
Un habitant de Saint-Domingue, paroisse du fort Dauphin, nommé Carcallier, comprend l’hôpital dans son testament pour 30,000 livres (10 juin 1755). En 1760 (1er juillet) on constate qu’après transaction avec les héritiers de M. de Bauve il reste du legs fait par ce bienfaiteur 304,077 liv. 15 sols 7 deniers. Un sieur Martinet, chirurgien en chef de l’hôpital général, donne 12,000 livres (10 juin 1760). Enfin le 1er octobre 1781 on trouve mention de la rentrée d’une souscription relative à la publication de la musique posthume de Rousseau, l’éditeur ayant contracté l’engagement vis-à-vis du public d’appeler les enfants trouvés à profiter du bénéfice qui en résulterait.
Indépendamment de ces dons, les troncs placés dans les églises et les quêtes rapportaient des sommes assez élevées .
Dès l’année 1670 des troncs étaient mis en effet avec l’assentiment de l’archevêque dans les principales églises , et l’on continua pendant tout le XVIIIe siècle à placer dans berceau de la cathédrale, ainsi que nous l’avons vu plus haut, des enfants destinés à solliciter par leur présence la charité des fidèles . La quête ainsi faite le dimanche de la Passion de cette même années 1671 produisit 59 liv. 17 sols . En 1672 les quêtes de toute la semaine sainte fournirent 659 I. 2 s. .
Il est intéressant de noter que, lors de la réunion des justices seigneuriales àla justice royale des Chatelets (1674), les doyen et chapitre de Notre-Dame devaient un reliquat de 4,500 1. sur leur contribution annuelle; il fut décidé par transaction que remise était faite de cette somme à condition qu’ils laisseraient établir «deux troncs nouveaux dans le milieu de la nef de leur église, l’un pour l’hôpital et l’autre pour celui des dits enfants trouvés, outre les cinq qui sont dans la dite église avec la couche» .
La maison des enfants trouvés était aussi chargée de fondations nombreuses avec destination spéciale. Nous trouvons d’abord le legs de M. Belin, trésorier de France, fait en 1697 et consistant en une rente de 550 1. assignée sur la ferme des postes «pour être employée à dotter les filles et les garçons de l’hôpital des enfans trouvez qui se trouveront en état de passer dans le mariage .»
Dès l’année 1720 cette rente se trouvait déjà réduite a 1821. 13 s. .
En 1697 M. Jacques le Beuf, conseiller du roy, receveur général et payeur des rentes sur le clergé, donna par contrat «200 1. de revenu sur la ville, en principal au denier vingt de 40001., à la charge que les arrérages seraient employés annuellement à mettre en métier deux enfans» choisis par lui ou ses héritiers .
Dans le même ordre d’idées on voit des fondations dues à l’abbé Valôt (1709), Jean-Baptiste Buchère écuyer conseiller secrétaire du roy (1717) , Me Delusancy prêtre chanoine de l’Eglise de Paris (1756) .
D’un autre côté M. Etienne Braquet, avocat et directeur de l’hôpital général, avait légué aux enfants trouvés le quart de sa fortune, en obligeant les administrateurs à répartir chaque année 1500 I. «entre dix pauvres étudiants pour les élever daus les études et les rendre capables de servir l’Eglise ».