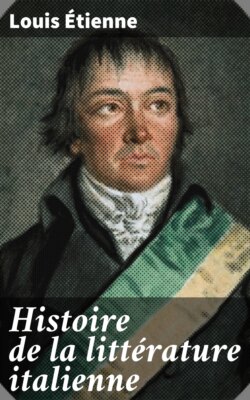Читать книгу Histoire de la littérature italienne - Louis Chastel Étienne - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dino Compagni.–Villani.
ОглавлениеTable des matières
Dino Compagni.
Dino Compagni, trop peu connu en France, est chez les Italiens le véritable père de l’histoire; écrivain d’une fraîcheur qui n’a pas vieilli dans ses narrations aussi éloquentes que rapides, il est juste de reporter sur lui une bonne part de la gloire que nous avons coutume d’attribuer à Villani. Tous deux méritent d’arrêter les historiens de la littérature désireux "de mesurer les étapes du génie national. Se succédant à une distance d’une vingtaine d’années, ils marquent le degré d’avancement de la prose au temps où la poésie avait pris un si grand essor, ils sont proprement les prosateurs de l’époque dantesque.
Les poésies de Dino Compagni sont peu dignes d’attention. Ce sont quelques pièces du genre de celles que les Italiens appellent rime, œuvres lyriques dont le sujet banal est l’amour plus ou moins rempli d’allégories. Quant au poëme de l’ Intelligence écrit en nona rima ou strophes de neuf vers, et publié par Ozanam dans ses Documents inédits pour servir à l’histoire littéraire de l’Italie, il est plus que douteux que l’auteur de la Chronique florentine en soit l’auteur.
Dino Compagni, mort en1323, deux ans après Dante, était noble de naissance, mais non Gibelin. C’était un Guelfe allié du parti des popolani ou démocrates enrichis. Sévère pour les Noirs, parti violent qui se servit de la démocratie pour contenter sa cupidité ou assouvir ses vengeances, froid pour les Blancs, parti faible et malheureux, rejeté par les événements dans les rangs des Gibelins, il paraît avoir fait ses efforts pour maintenir la balance entre les passions ^ extrêmes et gardé fidèlement le drapeau des Guelfes ralliés à ce qu’on appelait il nuovo popolo, le nouveau peuple, gouvernement populaire fondé vers la fin du XIIIe siècle.. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que tout en con damnant ceux qui furent les persécuteurs de Dante et en i maudissant leurs cruautés, il se soit abstenu de louange comme de blâme sur le compte de son illustre contemporain. Il le nomme seulement une fois, et c’est dans la liste des Blancs qui furent exilés en1302, se contentant de cette mention laconique: «Dante Alighieri qui était ambassadeur à Rome.»
Le nom d’histoire était spécialement donné par les anciens aux-ouvrages où l’on trouvait relatés les événements que l’auteur avait pu connaître par lui-même et dans lesquels sa personne avait été engagée soit comme acteur soit comme spectateur du drame: il était un témoin déposant de ce qu’il avait vu ou entendu. Les modernes donnent au moins aussi souvent le même nom aux compositions où l’écrivain fait le récit d’un passé même éloigné, mais avec les lumières de son jugement et les garanties de sa critique: il est alors un juge qui entend les témoins et résume le débat. A l’un comme à l’autre titre, Dino Compagni est un historien. D’une part, il raconte ce qui s’est passé dans sa patrie de1280à1312, sous ses yeux, ce qu’il a su comme citoyen et comme magistrat; il fut prieur deux mois après Dante, et quatre ans après, gonfalonier de justice, c’est-à-dire, commandant une force publique pour la défense de l’ordre et du gouvernement. De l’autre, se séparant de la foule des chroniques ordinaires qui consignent la série des faits sans autre ordre que la succession, son ouvrage offre le tableau d’un temps déterminé, celui des malheurs de la patrie et des vicissitudes des partis florentins, quand les Guelfes jusque-là unis et puissants se divisèrent en Blancs et Noirs. Ces discordes civiles qui remplissent trente-sept années, ont un commencement, un milieu et une fin, et forment la véritable histoire de la démocratie florentine dans la première période de ses erreurs. Celui qui les raconte mérite par l’intérêt qu’il y prend aussi bien que par l’intelligence qu’il a de son sujet, le beau nom d’historien. Comme Polybe, il a hésité avant de mettre la main à la plume, espérant qu’un autre plus capable entreprendrait le récit d’événements non moins importants que douloureux. Cependant les dangers de l’Etat n’ont fait que se multiplier, le spectacle des choses n’est devenu que plus curieux et plus grave; il est impossible de se taire plus longtemps: voilà le début. La fin de l’ouvrage ramène le lecteur vers les mêmes tristesses et l’avertit tout à la fois que l’écrivain a bien achevé son entreprise et que le livre conçu d’ensemble mérite une place parmi les compositions vraiment littéraires.
La vue d’ensemble qui règne sur tout son livre n’empêche pas que Dino Compagni présente tous les caractères de l’historien primitif. Il croit aux prophéties rapportées par la tradition, et lorsque Charles de Valois se détourne de Pistoie qui était sur sa route, il y voit l’accomplissement d’une prédiction’ attribuée à un vieillard du pays de Toscane; Hérodote en use de même avec les oracles. Florence ne lui paraît pas avoir moins de dignité aux yeux de la destinée que la ville de Rome, et des prodiges annoncent les souffrances de sa patrie, qui, suivant ses propres paroles, est une fille de Rome. «Le soir où s’accomplit la trahison de Charles de Valois et des Noirs contre les ennemis de ces derniers, une croix rouge apparut dans le ciel au-dessus du palais des prieurs. Elle était composée de deux bandes d’une palme et demie de large, dont l’une avait vingt brasses de long, et l’autre qui formait les croisillons, un peu moins. Elle dura le temps qu’un cheval mettrait à parcourir deux fois une lice. Aussi les gens qui en furent témoins et moi qui la vis clairement, nous pûmes comprendre combien Dieu était fortement irrité contre la ville.»
Non-seulement Compagni est bien un homme du XIIIe siècle; mais il est rempli du même esprit et animé, quoi que d’un parti différent, des mêmes passions que le poëte son concitoyen. Des critiques modernes se sont appliqués à excuser les colères de Dante; Perticari a fait tout un livre pour prouver que ces emportements n’étaient que justice nécessaire et flamme de charité. En lisant Compagni, on ne se croit pas tout à fait sorti de la présence de ce roi de l’invective. C’est au moins une comparaison à la décharge de Dante que l’on trouve dans certaines pages de l’historien.
«Oméchants citoyens, instruments de la ruine de notre cité, où l’avez-vous conduite? Et toi, Ammanato di Rota, homme déloyal, traîtreusement tu t’adressas aux prieurs, et avec menaces tu voulus te faire livrer les clefs. Voyez où votre malice nous a menés! Et toi, Donato Alberto, qui faisais vivre dans les ennuis tes compatriotes, où sont tes arrogances, malheureux qui te cachas dans une vile cuisine appartenant à Nuto Marignolli? Et toi, Nuto, chef et ancien de ton quartier, qui par tes haines de Guelfe te laissas tromper! Omessire Rosso della Tosa, rassasie ton ambition, toi qui pour arriver au pouvoir prétendis avoir un grand patriotisme et dépouillas tes frères! Omessire Geri Spini, rassasie ta cupidité, et déracine maintenant, si tu peux, les Cerchi, afin de jouir tranquille du fruit de tes félonies! Omessire Lappo Salterelli, toi qui menaçais et battais les magistrats, quand ils ne te servaient pas dans tes querelles, où allas-tu t’armer? Chez les Pulci où était ta cachette. Omessire Berto Frescobaldi, qui te montras si fort ami des Cerchi, et qui te faisais leur agent dans leur procès, pour obtenir d’eux le prêt de douze mille florins, où –as-tu gagné cet argent, où te montras-tu? 0messire Manetto Scali, qui voulais être tenu pour grand et redoutable, croyant toujours que tu demeurerais seigneur et maître, où pris-tu les armes? où est ta suite? où sont tes chevaux et leurs cavaliers? Tu te laissas soumettre à ceux qui auprès de toi étaient tenus pour hommes de rien. 0vous, popolani (démocrates), qui vouliez les charges, qui dérobiez les honneurs, et occupiez les palais des magistrats, où est la défense que vous fîtes? dans les mensonges, prenant le masque ou dissimulant, blâmant vos amis, louant vos ennemis, le tout pour vous sauver vous-mêmes. Pleurez maintenant sur vous et sur la cité!»
A la suite des révolutions, des hommes honnêtes ont toujours lieu de se plaindre des ennemis qui les ont attaqués et d’accuser les amis qui ne les ont pas défendus. Dino Compagni, selon toute apparence, était de ceux-là. Les invectives ne sont pas la seule analogie qui existe entre le poëte et le prosateur florentin. Lorsque Dino invoque le bon roi Louis, si plein de la crainte de Dieu, pour le rendre témoin des forfaits de la maison royale de France, lorsqu’il prend à partie les Florentins qu’il accuse de corruption, de méchanceté et surtout d’avarice, lorsqu’il fait des personnages qu’il a connus, des portraits qui restent dans la mémoire, lorsqu’il rapporte la triste fin et comme le châtiment divin des auteurs de violences et de désordres publics, il offre un commentaire vivant des sentiments du poëte épique, comme sa chronique est celui de la célèbre épopée.
L’école historique italienne a donc commencé d’aussi bonne heure que l’école poétique de ce pays; et Dino Compagni, loin d’être seulement un chroniqueur naïf et sans culture intellectuelle, a mérité d’être appelé par Giordani un Salluste italien. Avec Jean Villani elle prend un développement plus considérable et prélude aux grandes œuvres des historiens du XVIe siècle.
villani.
Tout ce que nous savons de la personne de Jean Villani est extrait de sa Cronica, et il n’a pas jugé bon de nous dire la date de sa naissance. Il fut marchand, fort riche, instruit, capable de raconter l’histoire pour les lettrés, c’est-à-dire en latin, et préférant l’écrire pour les ignorants mais en sorte que les savants pussent tirer quelque fruit de son ouvrage. Cette heureuse pensée lui permit de vivre dans la mémoire de ses compatriotes, et à. ceux-ci, d’avoir une série d’historiens populaires non interrompue dès le i premier siècle de leur littérature. Il était Guelfe pur, ce qui ne l’empêche pas de rendre un très-honorable hommage à l’auteur de la Divine Comédie. Voyageant soit pour son plaisir, soit pour ses intérêts, il connut l’étranger, vit le monde contemporain et rapporta de ses courses, non-seulement l’idée de faire entrer dans son livre les faits principaux qui se passèrent, de son temps, en tout pays, nobili cose dell’ universo mondo, mais le projet même d’écrire son histoire. On sait par lui qu’il visita la Flandre durant les guerres de» notre Philippe le Bel, et qu’il visita le champ de bataille, encore tout couvert de morts, de Mons-en-Puelle; on sait également qu’il se rendit en l’an1300au fameux jubilé de Boniface VIII, où il vit peut-être l’auteur de la Divine Comédie: d’après son propre témoignage, les grands spectacles qu’il lui fut donné de contempler dans l’enceinte de la vieille reine des nations, firent naître en lui la pensée de raconter aux arrière-neveux ce qui, depuis les Romains et de son temps même, s’était fait de grand. Enfin, il ne nous laisse pas ignorer qu’il fut ruiné par la banqueroute d’une maison puissante de Florence, où il perdit plus que sa fortune, sa liberté, au moins durant quelque temps. Trois ans après ce désastre il mourut dans la peste de1348, après avoir été prieur ou chargé de missions importantes comme ambassadeur à différentes époques, et avoir servi son pays les armes à la main, en particulier dans l’expédition malheureuse de Lucques, contre Castruccio Castracane, en1323.
Suivant une parole très-juste de Louis Carrer, Dino Compagni offre, en histoire, le point de départ, celui où il est bon à certains égards de revenir. Mais il n’a pas l’étendue et la compréhension de Villani, tout ensemble chroniqueur et historien, comme il convenait dans la première moitié du xive siècle, reprenant à nouveau les origines plus ou moins fabuleuses de Florence, rapportant avec fidélité les événements qu’il avait vus pu dont il avait entendu parler. Crédule quand il s’agit du passé, curieux quand il raconte le présent, Villani n’a pas de critique et il copie sans défiance comme sans scrupule son devancier Malispini, dont il s’approprie les pages sans avertissement; mais aussi tout l’intéresse dans son époque, et ses informations sont si générales, si variées, que les historiens des autres pays, les économistes, les statisticiens, sont souvent obligés d’avoir recours à ce négociant lettré d’une petite république. Les revenus de Florence, les impôts, les dépenses publiques, les salaires des magistrats ou officiers, le budget des fêtes ou des expéditions, l’approvisionnement des marchés, le prix des denrées, l’accroissement des richesses, rien n’est oublié de tout ce que l’histoire veut connaître aujourd’hui. La chronique, sous la plume de Villani, n’affecte pas les allures féodales d’un Villehardouin ni les goûts chevaleresques Froissart. On sent qu’il est marchand; mais à cet esprit positif qui décrit et observe, une certaine largeur de conception ne manque pas, et sous l’apparence d’un chroniqueur il est déjà bien moderne.
Villani, après les longues apnées d’une retraite silencieuse et recueillie, se met à raconter, à cause de leur importance, les événements dont il a été témoin. Son récit est celui d’un homme qui s’est replié sur lui-même, et les limites étroites où il le renferme, montre que son œuvre n’est pas moins concentrée que sa pensée. Non-seulement la mesure d’expansion de sa chronique est conforme à celle de son caractère et de sa vie, mais il reçoit du dehors l’impression décisive, l’ébranlement d’imagination qui lui fait prendre la plume pour commencer son œuvre.!
«Me trouvant à ce bienheureux pèlerinage dans la sainte): ville de Rome, voyant les grandes et antiques choses qu’elle contient, et lisant les histoires des grandes actions des Romains, écrites par Virgile et par Salluste, par Lucain, Tite-Live, Valérius, Paul Orose et autres maîtres de l’histoire, ^ qui décrivent les petites choses comme les grandes, pour i donner mémoire et exemple aux siècles à venir, je leur ai emprunté le style et la forme, quoique je ne fusse pas un disciple digne de faire œuvre si grande. Mais considérant que notre cité de Florence, fille et créature de Rome, était en train de monter et de s’élever aux grandes choses, de même que Rome était sur son déclin, il me parut à propos; de rapporter dans ce volume et dans cette nouvelle chronique tous les faits et les commencements de la ville, autant que je le pourrais; de rechercher, de découvrir et de suivre le récit des événements passés, présents et futurs. Et ainsi, avec la grâce du Christ, dans l’année1300, revenu de Rome, je commençai à compiler ce livre à la gloire de Dieu et du bienheureux saint Jean, et pour célébrer notre ville de Florence.»
Ces lignes prennent un bien beau sens quand on songe que Villani dut rencontrer à Rome douze Florentins qui, à l’occasion du jubilé, étaient députés par autant de rois, de princes et de républiques. Quelle était donc l’influence de cette ville de marchands? Le pape Boniface VIII, frappé de ce fait, dit qu’aux quatre vieux éléments de la nature, il fallait en ajouter un cinquième: les Florentins.
Une comparaison ingénieuse de Salvini nous fait entrer dans le secret un peu mystérieux pour nous autres étrangers du mérite littéraire de Jean Villani. On sait que d’après l’avis de Cicéron l’époque la plus brillante de la littérature romaine n’était pas l’époque la plus pure de la langue latine. Un intervalle de cent ans séparait l’une de l’autre. De même les Florentins jouirent de la perfection de leur langue avant de parvenir à la perfection de leur goût, et surent bien parler avant de pouvoir bien écrire. C’est en se fondant sur cette distinction assez généralement reconnue que l’auteur des annotations à la Parfaite poésie de Muratori, compare Villani à Sisenna, et Guicciardini à Tacite, les deux premiers étant pour leur nation des modèles de langage, les deux seconds de littérature historique. Ne nous étonnons pas de trouver le style de Villani un peu nu: Tassoni, grand partisan des écrivains modernes et Modénais par surcroît, le compare à un chariot qui cahote çà et là sur une route pierreuse et entrecoupée. Muratori, Modénais également, lui refuse la pureté. Mais un des critiques les plus autorisés en fait de langue italienne, compare la simplicité du style de Villani à la grâce d’un beau visage non fardé. Quant au reproche d’incorrection, quoiqu’il soit repoussé par Salvini, il nous rappelle que la prose italienne n’avait pas atteint plus que les vers ce degré de maturité après lequel la langue n’a plus rien à gagner; même critique et même éloge peuvent être faits des divers prosateurs, primitifs encore, qui ont surnagé dans le grand nombre des écrivains de ce temps.
Parmi les traducteurs d’auteurs latins, soit plus anciens soit contemporains, le plus estimé est un anonyme qui a rendu avec bonheur la grâce et surtout la vie des narrations de Tite-Live. Un autre qu’on pourrait appeler l’économiste du xive siècle, est le Biadajuolo, ou marchand de grains, qui, sans connaissance du latin, mais parlant le dialecte florentin dans toute sa fraîcheur, raconte d’une manière animée les famines dont il a été témoin et, chemin faisant, moralise. Le vrai moraliste de cette époque est Francesco da Barberino, un maître en droit civil et en droit canonique, ambassadeur de la république, mort comme Villani de la peste de1348et enseveli comme tant d’illustres personnages depuis, dans l’église de Santa-Croce. Il fit un traité de l’art de gouverner les femmes, del Reggimento delte donne, et un autre des enseignements de l’amour, Documenti d’amore. Mêlant la prose avec les vers, l’amour avec la politique et’ la religion, il a fait comme un code de la civilité au xive siècle et un Galateo–c’est le nom que les Italiens donnent à ces sortes d’ouvrages –qui a précédé de deux cents ans celui de Della Casa. Selon M. Tommaseo, il est aisé d’y apercevoir le changement des mœurs, l’influence prédominante de l’argent et du pouvoir, le passage de l’ancienne indépendance à uni commencement de servilité.
L’accumulation des richesses et le besoin des plaisirs intellectuels hâtaient le moment heureux de la maturité qui est le couronnement de l’art. Mais les circonstances sociales, l’ostracisme prononcé contre les supériorités, l’extrême division du territoire, l’oubli des patriotiques vertus, la rencontre de deux hommes de génie plus curieux de travailler à leur fortune et à leur gloire que de jouer un rôle politique dont le temps était peut-être passé, tout se réunit pour ouvrir à la langue italienne, au moment de sa perfection suprême, une carrière qui n’était pas celle de l’activité pratique et du progrès national.