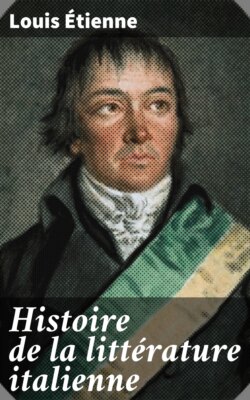Читать книгу Histoire de la littérature italienne - Louis Chastel Étienne - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Poésie toscane.–Premiers essais en prose.
ОглавлениеTable des matières
Poésie toscane.
Les Toscans ont commencé à connaître les jouissances des arts et des lettres au XIIIe siècle. Devenus indépendants ou à peu près avec les premières années du XIIe, et grâce aux luttes des puissances supérieures de l’empire et de l’église, le XIIIe siècle vit s’épanouir leur liberté, leur commerce, leurs richesses et par suite leur poésie. Le témoignage de Dante est sur ce point aussi formel qu’il est curieux. Voici les paroles qu’il se fait dire par son trisaïeul Cacciaguida:
«Florence, enfermée dans l’antique enceinte d’où elle entend encore sonner tierce et none, vivait en paix, sobre et pudique.»
«Elle n’avait point de carcans, point de couronnes, point de femmes parées, point de ceinture plus belle à voir que la personne qui la porte.»
«En nàissant, la fillo ne faisait pas encore peur à son père; car l’heure de la marier et la dot n’avaient pas toutes deux dépassé la mesure.»
«La montagne de Montemalo, (d’où l’on voit Rome) n’était pas encore vaincue par celle de votre Uccellatojo (d’où l’on voit Florence).....»
«J’ai vu Bellincion Berti marchant avec une ceinture de cuir et d’os, et sa femme revenant de son miroir sans être fardée.»
«J’ai vu les Nerli et les Del Vecchio se contenter d’une simple peau, et leurs femmes toutes à leur fuseau et à la quenouille.»
«Ofemmes heureuses! chacune d’elles connaissait. » sépulture à venir, et nulle d’elles, pour la France, n’était seule dans son lit.»
Telle était la simplicité presque rustique des Toscans, quatre ou cinq générations avant Dante. Les nobles passe-temps littéraires ne pouvaient dater de ce temps.
On a pourtant cherché en Toscane un poëte plus ancien que ceux de Sicile, et l’on a trouvé un Folcacchiero, de Sienne, né vers1150, et qui serait l’auteur d’une canzone amoureuse dont le premier vers signifie: «Le monde entier vit sans guerre....» Comme en tournant en tout sens cette époque reculée de l’histoire d’Italie, on ne trouve que l’année1177où la paix ait régné, on a donné cette date à ce vieux poëte de Sienne, et la Toscane en tire l’avantage d’avoir précédé la Sicile de six ou sept ans. Mais la preuve n’est pas bien solide: le caractère plus récent de la pièce, les rimes entrelacées, les paroles mêmes de Dante et de Pétrarque, qui s’accordent à placer en Sicile le berceau de la poésie italienne, suffisaient, ce semble, pour épargner des recherches inutiles et des conflits d’amour-propre local. La transition entre la Sicile et la Toscane est manifeste: l’exemple donné par les princes allemands fut suivi par les villes. La poésie de cour s’éteignit après avoir brillé un instant, ou plutôt se ralluma naturellement et sans interruption là où elle trouvait un peuple actif, une vie surabondante, des loisirs au milieu même des factions et de la guerre, une langue heureusement préparée et singulièrement riche.
Trois poëtes que Dante a jugés fort différemment sont ses devanciers en Toscane: Guittone d’Arezzo, Bonaggiunta de Lucques et Guido Cavalcanti de Florence. Il les avait devant les yeux quand il composait la Vie nouvelle et qu’il écrivait ces lignes: «Ce qui poussa le premier à dire comme poëte vulgaire, ce fut le désir qu’il eut de se faire comprendre à une dame à laquelle il était malaisé d’entendre les vers latins. Et ceci est contre ceux qui riment en matière qui n’est pas amoureuse, attendu que cette façon a été inventée dès le principe pour dire d’amour.» A ce moment il ne tenait pour poëtes italiens ou rimeurs que les poëtes amoureux, et il ne songeait pas lui-même à tenter une autre route.
Guittone, appelé souvent Fra Guittone, parce qu’il appartenait à l’ordre militaire et religieux des Gaudenti, était contemporain de Guinicelli. Plus correct et plus mûr pour le langage, il manque de couleur poétique et de grâce. Bonaggiunta Urbiciani, plus remarquable encore par sa pureté, est prosaïque et imite ingénieusement, mais avec froideur, les Siciliens et les Provençaux. Dante les confond tous deux, avec le notaire Jacopo da Lentino, dans une école qui cherchait à plaire par les accessoires, et dont la plume ne savait pas écrire sous la dictée de l’amour. Ailleurs, il parle de la réputation usurpée de Guittone:
«Laisse dire les sots.... Ils tournent la tête vers le bruit plutôt que vers la vérité, et ils arrêtent leur opinion avant d’écouter l’art ou la raison.»
«Ainsi firent beaucoup d’anciens pour Guittone, en lui donnant, de cris en cris, la première place, jusqu’à ce que, par la bouche du plus grand nombre, la vérité l’ait vaincu.»
Cette école toscane primitive, prosaïque et terre à terre, trahissait une des pentes naturelles de la race et de la contrée. Dante revient à la charge dans son traité de Vulgari eloquio; après avoir nommé quatre poëtes italiens qui ont la phrase noble et poétique, il s’écrie: «Que les sectateurs de l’ignorance cessent donc de vanter Guittone d’Arezzo, et quelques autres qui ne cessent jamais d’imiter la plèbe dans leurs mots et leurs constructions.» Dans un autre passage, il reproche à Guittone, à Bonaggiunta et même à son maître Brunetto Latini, de n’avoir que des façons de dire municipales.
Ces critiques n’aident pas seulement à connaître le trait principal de ces vieux poëtes qui faisaient toute leur gloire de rimer dans leur pur toscan; elles montrent l’essor que le vers italien allait prendre avec le coup d’aile de Dante.
On peut ajouter à Guittone et à Bonaggiunta le nom d’un certain Dante da Majano, né près de Fiesole, dans la banlieue de Florence, prosaïquement ingénieux comme les précédents. Une circonstance curieuse a plus contribué à le faire connaître que ses poésies. Ayant oui dire qu’il y avait en Sicile une certaine Nina, qui avait renom de poëte, la première en date sur la liste nombreuse des Saphos italiennes, il lui adressa des vers pour la requérir d’amour. Monna Nina fit une réponse poétique et courtoise au troubadour des environs de Florence, et témoigna le désir de le voir. Dante da Majano imitait ainsi non-seulement en vers, mais en action, un confrère provençal. Geoffroy Rudel, s’étant épris d’amour pour la comtesse de Tripoli, sans l’avoir jamais vue, chanta ses louanges et fit le voyage de Tripoli. Mais la traversée ne lui fut pas heureuse; il tomba malade et fut débarqué mourant. La comtesse vint au-devant de lui, et recueillit ses derniers soupirs. «Geoffroy Rudel, dit Pétrarque dans les Triomphes, employa les voiles et l’aviron à chercher sa mort.» Dante da Majano fut plus sage et plus heureux. «Sa passion, née des vers, dit Perticari, fut nourrie par des vers.» Quand les deux amants s’envoyaient ainsi des témoignages rimés de leur passion, ils ne se doutaient pas que leurs poétiques flammes, recueillies sous la cendre de six siècles, et rapprochées par des grammairiens, seraient employées à montrer combien le dialecte de Sicile était alors semblable à celui de Toscane. C’est ce que fait Perticari; mais une critique plus délicate que la sienne, en accordant à Monna Nina les grâces de style qu’on ne peut lui refuser, a fait voir les imperfections de langage qui rendent la belle Sicilienne inférieure à son adorateur toscan.
A cette école positive, timide, plébéienne même, suivant l’expression du de Vulgari eloquio, une autre succéda qui reprit la tradition du Bolonais Guinicelli, et mêla beaucoup de métaphysique à l’amour et des accents sublimes à la tendresse. Elle tient presque tout entière dans le sonnet suivant de la jeunesse de Dante:
«Guido, je voudrais que toi, Lappo et moi, nous fussions pris par enchantement, et mis dans un navire, qui, à tous les vents, irait par la mer selon notre désir.»
«En sorte que ni hasard, ni temps contraire ne nous apportât aucun encombre, mais que, le goût de vivre ensemble étant toujours en nous, le désir s’en accrût toujours.»
«Et que le bon enchanteur mît avec nous Monna Vanna (Mme Giovanna), Monna Bice (Mme Beatrice) avec celle qui a le numéro trente.»
«Et là je voudrais toujours raisonner d’amour, et que chacune d’elles fût contente, comme je crois que nous le serions nous-mêmes.»
Dans ce navire idéal qui faisait voile vers l’avenir de la poésie amoureuse italienne, il aurait fallu embarquer Cino de Pistoie que Dante admet au même nombre et comme au même cénacle dans son de Vulgari eloquio; mais il survécut à Dante et nous en parlerons plus tard.
Lappo Gianni, ami et parent de Dante, fut disciple plutôt que maître dans ce que le poëte appelle le doux et nouveau style. Mais Guido Cavalcanti, plus âgé, prit les devants, et le premier sans doute inventa une sorte de mythologie amoureuse, qui personnifiait non-seulement l’amour, appelé Seigneur, mais le cœur, l’âme, les yeux, et jusqu’aux esprits de l’amant. Il y a une canzone de Cavalcanti qui fait des esprits de l’amant des soldats d’Amour mis en fuite durant la bataille et ralliés à la fin par la canzone, dans l’envoi qui termine comme à l’ordinaire ce genre de composition.
A l’époque où le goût public, dans toute l’Europe, se reportait vers la poésie primitive, comme pour se désaltérer de la sécheresse littéraire du xviiie siècle, Cesarotti, qui est, somme toute, un bon critique, a porté un jugement assez curieux sur Cavalcanti. Après avoir cité avec louange une ballade de lui, qui est une fraîche pastorale, il ajoute que le mélange de la religion et de la galanterie gâta la poésie des vieux Italiens. «Ils morcelaient l’âme en mille fractions, âme, pensée, cœur, esprit, comme en autant d’êtres distincts qui se prenaient aux cheveux entre eux, puis s’amalgamaient de nouveau en un seul et même être. De plus, l’esprit engendra plusieurs petits esprits, spiritelli, qui sont les agents principaux de ces poésies; l’un parle, l’autre répond, et ils font entre eux un vrai galimatias.»
Si l’on s’en rapporte à Boccace, Guido Cavalcanti avait hérité quelque chose de la réputation d’athée ou d’épicurien, comme on disait alors, de son père Cavalcante Cavalcanti que l’auteur de la Divine Comédie rencontre dans une tombe de feu, au cercle des incrédules. Un certain messer Betto Brunelleschi, docteur sans doute comme le mot de messer l’indique, plaisante Guido sur ses longues rêveries, lui demandant ce qu’il pourra gagner à découvrir que Dieu n’existe pas. On trouve dans Cavalcanti quelques traces du platonisme chrétien puisé dans les Pères:
«Amour, dit-il, qui nous éprend de ce qui a valeur, naît de la pure vertu de l’âme, laquelle nous rend semblables à Dieu.» Nul écrivain n’était alors plus pratiqué que saint Augustin, qui a dit: «La beauté n’est pas une vertu siégeant sur la figure. Elle réside en la demeure où est la maîtresse de l’Epoux (l’âme). Toute la gloire de la fille du roi est du dedans, et cette gloire n’est pas autre que la beautéé.» Avant Pétrarque aucun poëte n’a pleinement commenté et illustré cette autre belle parole d’Augustin: Disce amare in creatura Creatorem, et in factura Factorem. Mais déjà Cavalcanti aime dans Monna Vanna une intelligence qui vient d’en haut. «De cette dame on ne peut bien parler; elle est ornée de trop de beautés, et i ce n’est pas une âme d’ici-bas qui l’anime, en sorte qu’elle soit visible pour notre intelligence.»
Cependant Cavalcanti est plutôt aristotélicien. La plus célèbre de ses canzoni est celle qui commence par ces mots: Donna mi priega, et qui est une définition de l’amour. C’est une véritable thèse divisée en huit propositions: l’amour est défini un accident; son objet n’est pas concret, puisque cet objet n’est que la forme abstraite qui se dessine en nous, et c’est pourquoi l’amour n’est pas visible. Autrement, l’amour produisant toujours l’amour, la passion visible dans l’amant produirait toujours la passion dans l’objet aimé. Voilà la grande question, et qui animait sans doute ces subtilités. Pourquoi aime-t-on et n’est-on pas aimé? Sans doute elle était résolue suivant que le poëte était heureux ou ne l’était pas. Dante parle comme Cavalcanti dans sa Vie nouvelle, et il explique pourquoi il traite de l’amour comme d’une substance corporelle, quoiqu’il ne soit qu’un accident. Et pour montrer combien le mélange de la théologie et de la poésie amoureuse était intime, saint Augustin avait dit qu’on ne peut voir la charité, c’est à-dire l’amour divin, avec des yeux corporels. Si l’on ajoute que Cavalcanti s’est imposé la gêne du rimalmezzo ou de la rime léonine dans huit vers sur les quatorze qui composent chacune de ses stances, combien de sources d’obscurité! Dame Nature, dans le Tesoretto de Brunetto Latini, dit que «la rime s’oblige à faire accorder les paroles avec une lime, d’où vient que souvent les paroles rimées cachent la pensée et changent le sens.» Avec une canzone métaphysique et des rimes doubles, on peut se faire une idée de la peine que Guido a donnée à ses commentateurs, Egidius Colonna et Paolo del Rosso. Ils sont si peu parvenus à en dissiper les ombres, qu’ils ne peuvent décider s’il s’agit dans cette poésie ténébreuse de l’amour naturel ou de l’amour platonique.
Dante semble mettre le poëte Cavalcanti de niveau avec lui-même quand il se fait dire, dans l’Enfer, par Cavalcanti le père: «Si par cette noire prison il t’est donné de marcher, grâce à ton haut génie, mon fils où est-il, et pourquoi n’est-il pas avec toi?» Mais ailleurs il fait entendre qu’il l’a surpassé, comme Cavalcanti avait surpassé Guinicelli. «Ainsi le second des Guido a enlevé la gloire de la langue au premier, et peut-être est-il né un troisième poëte qui supplantera l’un et l’autre.» Nous autres Français et modernes, à tout le lyrisme scolastique et sévère qui a rendu Cavalcanti si fameux nous préférons, parmi ses œuvres, le gracieux sonnet que Pétrarque a imité plus tard.
«Beauté de femme au cœur plaisant, cavaliers armés nobles à voir, chants d’oiseaux, raisonnements d’amour, beaux navires courant fort sur la mer, sérénité de l’air aux premiers rayons de l’aube, blanche neige tombant sous un souffle de vent, courant d’eau, prairie émaillée de toutes fleurs, or et argent, azur en un émail brillant, tout cela est dépassé par la beauté, par la grâce de ma dame et par son noble cœur; tout cela semble sans prix....»
Cavalcanti était Gibelin, et il épousa la fille de Farinata degli Uberti, le plus illustre, le plus audacieux des Gibelins. Comme cet athée prétendu se rendait en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, il faillit être assassiné par son ennemi Corso Donati, le chef des Guelfes et, entre ceux-ci, le meneur du parti des Noirs. C’est dans ce voyage qu’il connut la belle Toulousaine Mandetta, à laquelle il adresse une jolie ballade chargée d’aller la trouver tout doucement dans l’église de la Daurade, ed entra quetamente alla Dorata.... Dino Compagni raconte un engagement qui eut lieu entre les deux adversaires, après le retour de Cavalcanti; et ce n’est pas un des traits les moins curieux de cette civilisation florentine que de voir le rêveur, le mélancolique poëte sauter ainsi à la gorge de son ennemi. Par suite de cette lutte, il fut relégué à Serezzano dans la maremme de Volterra, d’où il ne revint que pour mourir à Flqrence.
Dante a d’autres devanciers dans l’école toscane. Sienne, Arezzo, Pise, Florence, connurent d’autres poésies que celles des nobles canzoni, des ballades amoureuses et des sonnets sur le ton lyrique. Les chansons, les petits poëmes du genre simple, les dialogues entre Messere et Madonna, les parodies mêmes ne manquent pas, mais rien de neuf ou d’original; de la grâce quelquefois, pas l’ombre de poésie. Il semblait que le cérémonial empêchât rigoureusement les vrais poëtes de chanter pour le vulgaire. Dante a créé, dit-on, la poésie et la langue italiennes; cela est vrai en ce sens qu’il les a rendues populaires: il a opéré l’accord de l’imagination nationale et de l’instrument harmonieux déjà créé. Parmi les noms qu’un art plus modeste peut citer avant lui, Brunetto Latini, maître de Dante, mérite seul d’être tiré de la foule, pour son Tesoretto. On sait qu’il a écrit en français le Trésor, sorte de résumé de la Bible, de Pline le naturaliste, de Solin et de plusieurs autres; on sait aussi qu’il choisit notre langue, «pour chou que la parleure en est plus délitable et plus commune à toutes gens.» Ce que l’on sait moins, c’est qu’il y renvoie, dans son Tesoretlo, et qu’il dit au chant XIVe: «Cherchez dans le Grand Trésor que j’écrirai pour ceux qui ont le cœur plus haut. Là je ferai le grand saut, pour m’étendre plus au long dans la langue française.» Ainsi le vers italien ne semblait pas à ser Brunetto avoir assez d’élan et de souffle; et si l’on en juge par ses vers de sept syllabes rimés deux à deux, il n’a pas tort.
Après avoir fait l’éloge de notre saint Louis à qui il dédie son œuvre, il raconte que cheminant vers la Castille, où il allait en qualité d’ambassadeur de Florence, il apprend dans la vallée de Roncevaux des nouvelles de la défaite de Monte Aperti (1260), de la déconfiture et de l’exil des Guelfes. Rempli de courroux et plongé dans ses réflexions, il fait fausse route. Egaré dans une forêt, il parvient au haut d’une montagne, aperçoit la Nature, qui se montre à lui sous la forme d’une femme, et il entre en conversation avec elle. Cette personnification ressemble à beaucoup d’autres de ce même temps, et qui ont toutes leur origine dans le Traité de la Consolation de Boëce; non-seulement la Nature s’entretient avec Brunetto, comme la Philosophie avec l’auteur latin; mais le Tesoretlo était peut-être, ainsi que l’ouvrage du philosophe, un mélange de vers et de prose, dont les copistes n’auront conservé que les vers.
Ginguené veut que le Tesoretto ait donné l’idée à Dante de son vaste poëme. Une forêt dans laquelle l’auteur s’égare, une vision, un poëte–Ovide–que ser Brunetto rencontre non dès le principe, mais quand il est parvenu dans le domaine de l’amour, tels sont les traits de ressemblance entre le petit écrivain et le grand. Ajoutons que Brunetto a mis dans son ouvrage une profession de foi sur l’enfer, et une énumération des péchés mortels. Si le disciple doit quelque chose à son maître, ce n’est pas le cadre, c’est le germe moral de son œuvre. Disons plutôt que l’image réalisée de la vie future, l’avertissement des peines et des récompenses éternelles, était alors partout. Nous apprenons par Brunetto lui-même qu’elles étaient niées non pas seulement par des hérétiques reconnus, tels que les Cathares ou Albigeois, mais par des esprits plus ou moins sceptiques, «ne croyant pas que vertu ni péché sauve ou condamne un homme, et disant à toute heure qu’un Dieu juste n’aurait pas créé celui-ci pour être damné, celui-là pour être absous.» Voilà la vraie origine de la Divine Comédie; elle n’est pas plus dans Brunetto Latini, que dans la Vision du moine Albéric, ou dans toute autre; elle est dans la foi absolue, avec laquelle le poëte croit un enfer, un purgatoire, un paradis, dans une affirmation de la justice divine qu’il oppose à tous ceux qui n’y croyaient pas, ou qui vivaient comme s’ils n’y croyaient pas.
A lire le Tesoretto, il serait impossible de deviner dans quel cercle de damnés Dante, élève de l’auteur, l’a placé. Surtout il est sévère, il est explicite et circonstancié touchant l’espèce de péché pour lequel il l’a livré au mépris de la postérité. C’est l’éternelle histoire de Salluste et des moralistes dont les paroles valent mieux que les actions. Mais que dire de Dante, qui met en une telle compagnie et sous une pluie de feu un maître dont il porte «gravée dans son cœur la bonne image paternelle, de ce maître qui lui enseignait heure par heure comment l’homme s’éternise? « –Est-ce parce que Brunetto était Guelfe? Il a mis des Guelfes en paradis et des Gibelins en enfer. Dans une ville comme Florence rien ne demeurait caché, la vie était percée à jour, et Dante a fait bien d’autres actes de justice contre des amis et contre des parents.
Brunetto Latini fut dittatore del comune, c’est-à-dire secrétaire de la république; exilé avec les Guelfes, durant la prépondérance du roi Manfred, il vécut en France quelques années, et revint mourir à Florence en1294, où, suivant le témoignage de Jean Villani, il dégrossit les Florentins, leur enseigna l’art de la parole et leur donna des leçons de bonne politique.
Premiers essais en prose.
Si la poésie italienne est à peu près semblable à elle-même par toute la péninsule, et si les vers amoureux des Siciliens, des Bolonais, des Toscans et des Lombards eux-mêmes se prêtent assez au système de la langue commune illustre, partout écrite et parlée nulle part, il n’en est pas ainsi de la prose, c’est-à-dire de la langue réelle, de la langue propre à la pratique de la vie. On peut dire sans exagération que la prose italienne est née en Toscane, qu’elle y a vécu, pour ainsi dire, exclusivement, durant deux siècles, et qu’elle n’a franchi les bornes de l’Apennin, et n’est devenue le patrimoine commun et national qu’au commencement du XVIe. Les besoins nouveaux de la vie intellectuelle et les nécessités de la vie politique firent de la prose un instrument puissant de civilisation. Elle s’étendit de proche en proche à un plus grand nombre de personnes, et se rapprocha de plus en plus des rangs populaires. Bientôt elle fut une image fidèle de l’état politique du pays, et dès le XIIIe siècle, elle servit à des traductions, à des extraits des auteurs anciens, à des chroniques, à des ouvrages d’édification pour ceux qui n’entendaient pas le latin. Encore un peu de temps, et elle fut d’un usage si populaire qu’on ne trouve presque plus de prosateur qui ne soit Guelfe; or, il est bien avéré qu’à mesure que les révolutions rejetaient les riches et les puissants dans le gibelinisme, l’esprit guelfe, ne conservant plus aucune trace-de l’origine de ces dénominations politiques, ne signifiait plus autre chose que l’esprit démocratique. De là cette conséquence singulière que, si tous les poëtes italiens ont été plus ou moins Gibelins, tous les prosateurs à peu près sont Guelfes.
Des chroniqueurs, des traducteurs ou des faiseurs d’extraits, des conteurs ou romanciers, voilà ce que nous trouvons dans le domaine de la prose au XIIIe siècle. Hors de la Toscane, l’histoire, ou ce qui en tient place, s’écrit en latin. En Toscane, au contraire, surtout à Florence, non-seulement on se sert de la langue nationale pour léguer aux arrière-neveux les souvenirs nationaux, mais les familles continuent l’œuvre commencée; les auteurs de chroniques sont chroniqueurs de père en fils. Ce n’est pas tout: les maisons des particuliers ont leurs historiographes; Florence est la ville des annales domestiques, et ces négociants, ces banquiers qui font des affaires dans le monde entier, tiennent leurs registres biographiques non moins exactement que leurs livres de comptes.
Les Diurnali ou journaux de Matteo Spinello, en dialecte du pays de Pouille, sont une exception à ce que nous disons de l’usage exclusif de la prose toscane. Ilsemble que la prose ait dû commencer, comme la poésie, dans le midi de l’Italie, à la faveur d’une cour et de ses splendeurs. Mais l’exemple donné par Matteo Spinello vers1268, sous Manfred, le dernier prince allemand, ne fut pas suivi. A peine une chronique ou deux en dialectes divers parurent dans le siècle suivant, tandis que les récits toscans affluent et s’accumulent. On doit supposer que la comparaison de ceux-ci avec les autres parut tellement à leur avantage, que personne n’osa plus entrer en lice, à moins d’être exercé au maniement de ce dialecte modèle qui tendait à devenir la langue de la nation. Quelles que soient les traces de patois visibles dans Spinello, il eût été malheureux que la littérature italienne perdit ce monument naïf et intéressant des souvenirs d’un magistrat de la province de Bari, d’un soldat de Manfred et peut-être de Charles d’Anjou. Matteo Spinello a raconté les faits et anecdoctes qu’il a recueillis en –son pays de1247à1268.
Les Malispini de Florence descendaient de souche romaine par une aïeule appartenant à l’ancienne famille des Capocci. L’un de ces Malispini, Ricordano, ayant visité ses parents dans la ville des papes, rapporta de leur maison des extraits de chroniques et d’écrits qui lui paraissaient infiniment précieux. En effet, un de ces Capocci, qui s’appelait Marc, avait soi-disant vu poser la première pierre de Florence. Il avait écrit divers ouvrages; un autre, Africo Capocei, du temps de Charlemagne, avait donné une suite aux écrits de Marc, et particulièrement sur Florence et Fiesole. A ces documents qui étaient pour lui paroles d’Évangile, Ricordano ajouta des recherches qu’il fit dans les chroniques et vieilles écritures de Florence, et particulièrement dans la Badia, ou abbaye, encore existante. Tels furent l’origine et le premier fonds de la chronique de Ricordano Malispini. D’après ce qui précède, il est aisé d’apprécier le degré de critique apporté à l’histoire par ce père des logographes italiens. On en peut juger par un morceau: Catilina, à la tête des habitants de Fiesole, a tué en bataille rangée le roi Fioririo de Florence et a pris sa veuve la reine Belisea qu’il aimait éperdument du temps même qu’il vivait à Rome. Un cavalier de Fiesole, que l’histoire ne connaît que sous le nom de Centurion, a pris de son côté la belle Teverina, fille du roi mort et de la reine prisonnière.
«Ledit Centurion n’allait jamais au palais de Catilina; celui-ci, voyant que ledit Centurion ne venait jamais à lui, l’envoya querir plusieurs fois, et chaque fois il répondait qu’il était mal disposé, et il disait: «Je ne veux autre joie «ni autre bien en ce monde que Teverina,» et il prenait ses tresses de cheveux et il les baisait, et se réjouissait en disant: «Celles-ci sont les chaînes qui m’ont enchaîné, et jamais on n’a vu de tresses semblables pour leur beauté;» et il pleurait avec elle, tant il l’aimait d’amour désordonné. Or, étant la reine Belisea, le matin de la Pentecôte, à la messe, en la chanoinerie de Fiesole, elle se ressouvint de Teverina sa fille, et commença à faire une plainte lamentable.... Une matrone qui allait par les palais, veillant à la santé des dames, vendant des accoutrements et faisant ainsi son métier, se mit à l’écouter et s’aperçut des nobles semblants et des beautés infinies de cette reine; elle s’approcha d’elle et lui dit: «Madame, je vous prie de ne pas gâter par vos larmes vos infinies beautés..., etc....»
Voilà pour les époques reculées de l’histoire; Catilina et son expédition composent tout un roman de chevalerie et d’amour. Ce sont là les fables qui s’imposent à tous les chroniqueurs florentins pendant un siècle ou deux; Ricordano ne les a pas inventées, et Villani les répète après lui. Mais aussitôt que le chroniqueur arrive à son temps, il raconte les faits avec toute la sincérité d’un honnête citoyen de Florence; il n’y a plus à craindre en lui que les partialités de la faction politique. ’Voici comment il parle de l’empereur Frédéric II:
«Dans le principe, celui-ci fut l’ami de l’Église, et bien f devait-il l’être, tant il avait reçu d’elle de bienfaits et de grâces, outre le royaume de Sicile et de Pouille qu’il eut par sa mère. Ce Frédéric régna trente ans et se montra fort ingrat envers l’Église. Il était fils d’une religieuse consacrée; il fut hardi, franc, de grande valeur, très-sage par les lettres et le sens naturel, connaissant notre langue latine et notre langue vulgaire, l’allemand, le français, le grec, le sarrasin, abondant en vertus, large et plein de courtoisie. Mais il fut dissolu, et tint près de lui beaucoup de concubines, et des mamelucks à la manière des Sarrasins, et se donna à toutes les délices corporelles, et mena une existence épicurienne, n’estimant pas qu’il y eût une autre vie. Et ce fut la cause principale qui le rendit ennemi des clercs et de sainte Église. Et il voulut encore occuper les biens de sainte Église pour les mal dépenser, et détruisit beaucoup de temples et de monastères dans le royaume de Sicile et de Pouille, et par toute l’Italie il asservit très-fort le clergé. Et ce fut permission de Dieu, parce que les chefs de sainte Église étaient cause qu’il était né d’une religieuse consacrée et qu’on ne se souvint pas assez des persécutions que ses ancêtres avaient fait subir à la chrétienté.»
Suivant la conviction profonde de Malispini, les Gibelins ne peuvent que se perdre, et quand ils réussissent, c’est qu’ils se sont convertis; les Guelfes ne peuvent que réussir, et quand ils échouent, c’est qu’ils ont été infidèles. De là une sorte de fatalisme singulier, qui vient de ce que le chroniqueur ne saurait douter de la part que la Providence prend dans sa cause et dans son parti. Oh peut sans danger croire l’historien pourvu qu’on se défie du Guelfe.
Giacotto Malispini continua la chronique de son oncle, et rédigea la suite, de1282à1286. Tous deux sont si calmes, même dans leurs sévérités, si dépourvus de vivacité dans leurs récits et de vigueur dans leurs pensées, si étrangers à tout mouvement et à toute passion, qu’on se les représente comme deux vieillards qui se sont successivement passé la plume. Une sorte de sénilité respectable de l’écrivain semble s’ajouter à la sénilité ingénue du livre.
L’ouvrage des Merveilles du monde de Marco Polo n’appartient pas seulement à la littérature de la France qui l’a négligé jusqu’à notre siècle: il est bien établi que le texte authentique du célèbre Vénitien fut dicté par lui, en1298, dans une prison de Gênes, à Rusta Pisan, plus connu sous le nom de Rusticien de Pise, qui l’écrivit en français sous les yeux de ses compagnons de captivité. Mais la traduction italienne, au jugement des meilleurs critiques et en particulier de Salviati, est presque jumelle du premier texte de ce livre extraordinaire qui changea toutes les idées des aïeux sur le monde qu’ils habitaient. C’est dans cette traduction, revue et grossie de faits nouveaux par le grand voyageur, qu’un voyageur plus grand encore, Christophe Colomb, entrevit le Nouveau-Monde. Le Génois croyait marcher sur les traces du Vénitien quand il découvrait les premières îles américaines. On sait que le livre de Marco Polo a reçu en Italie le nom d’il Mitione. Il paraît, quoi qu’en disent Sansovino et Zeno, que ce sont les chiffres énormes dont ce livre est rempli qui lui ont fait donner ce nom. Il y a des villes qui ont cent’ milles de circonférence, qui contiennent des lacs de trente milles de tour, douze mille ponts de pierre, douze fois douze mille maisons d’artisans, et en chaque maison de dix à quarante hommes. Moitié admiration, moitié incrédulité, l’auteur et son livre furent appelés Million.
Citons pour mémoire la chronique de Martino Canale, de Trévise, en français. Encore une preuve non-seulement de l’universalité de la langue française au XIIIe siècle, mais encore de la difficulté d’écrire en italien pur pour tous ceux qui n’avaient pas vu le jour dans le bassin étroit et prédestiné formé par l’Apennin et la mer Tyrrhénienne.
«Je te recommande mon Trésor, dans lequel je vis encore, et ne demande rien de plus.» Telles sont les dernières paroles de Brunetto Latini à Dante au XVe chant de l’Enfer. Et en effet c’est par son Trésor qu’il a survécu. Mais il serait malaisé de dire si c’est le texte français du Guelfe exilé, ou la traduction contemporaine de Bono Giamboni qui a. le mieux assuré à son nom la vie et la durée. Cette œuvre est la plus considérable et la plus populaire des œuvres en prose italienne du XIIIe siècle. Elle est une encyclopédie du temps, et un répertoire de la langue nationale. Les deux noms de Bono Giamboni et de Brunetto Latini sont ainsi parvenus de concert jusqu’à la postérité. L’un était juge, l’autre maître de rhétorique; tous deux ont laissé de nombreux ouvrages, extraits ou traductions, pour la plupart, des auteurs latins. C’est de leur enseignement que se sont formés presque tous les écrivains du xive siècle, du siècle classique de Florence.
Un autre juge, Albertano de Brescia, a écrit des ouvrages de morale en langue latine; nous lui devons une place, et parce qu’il fut très-populaire, et parce que ses livres qui datent de1238à1246trouvèrent des traducteurs en Toscane dans les vingt ou trente années qui suivirent. Il est si bien le moraliste du XIIIe siècle, tout nourri et rempli de l’Écriture Sainte, du droit romain, du droit canon, des théologiens et moralistes anciens, qu’il fut adopté, pour ainsi dire, par toute l’Europe. Ce n’est pas seulement en Italie, mais en France, en Allemagne, en Angleterre, en Pologne, que se répandit l’œuvre de ce sage. Il avait souffert lui-même et il tâchait d’apporter aux âmes le baume des bons conseils et de la lecture.
Rien qu’à parcourir les écrits d’Albertano, le lecteur devine où il est, au milieu de quelles passions et de quelles misères. Les traîtres, les vengeances, la soif de domination, l’ardeur et la férocité des intérêts particuliers, voilà les ennemis ordinaires que le moraliste combat; et si sa leçon est surtout bonne aux Italiens du XIIIe siècle, le succès qu’elle eut partout prouve assez qu’elle trouvait sa place ailleurs. Nous ne citerons de ses œuvres que la plus populaire, du Conseil et de la Consolation, traduit en français sous le titre de Livre de Mélibée et de Dame Prudence, et introduite par le poëte anglais Chaucér dans ses Contes de Cantorbèry où ce livre porte le nom de Conte de Melibeus. Soit que Chaucer, qui connaissait l’Italie et sa littérature, ait remonté à la source primitive, soit qu’il ait puisé dans la traduction française, il a fait preuve d’un goût qui est le privilége du génie dans une époque si reculée: il abrége comme toujours quand il traduit, et il conserve la couleur poétique de l’ouvrage quoiqu’il ne sorte pas de la prose. Le sire Mélibée reçoit une grave injure, il veut se venger; les conseillers qu’il assemble, conseillers peu sages et qui voient clairement son désir, le poussent encore à prendre sa revanche. Mais il a une noble épouse qui a nom dame Prudence; elle lui fait voir son erreur, et lui montre la bonne voie à suivre pour corriger ses ennemis et se les attacher. Le sire Mélibée, dame Prudence, les conseillers, les amis, les ennemis, tout le monde parle à tour de rôle. Chacun développe sa pensée en trois, quatre, cinq et six points, mettant en avant la proposition et la faisant suivre d’un bataillon de textes sacrés et profanes. Telle était alors la marche adoptée en toute matière philosophique: les textes servaient d’arguments, et l’on argumentait toujours. Tel est le livre le plus solide, le mieux approprié aux mœurs, sinon le plus éloquent contre la vengeance, contre la cruelle vendetta qui a perpétué la barbarie. Mais «les sages sont-ils crus en ces temps d’emportement?» Combien le livre d’Albertano a-t-il touché de Gibelins ou de Guelfes? Le Conte de Melibeus a-t-il fait épargner une goutte de sang dans la guerre des deux Roses? A côté d’un philosophe qui dit: «Il ne faut pas se venger,» combien y a-t-il dé poëtes qui exaltent l’héroïsme de la vengeance? C’est Dante qui a; écrit dans une de ses canzoni:
Che bell’ onor s’acquista in far vendetta.
Une circonstance bien intéressante de l’ouvrage d’Albertano, c’est qu’il fut écrit dans la prison où l’empereur Frédéric II avait fait jeter l’auteur: son crime était d’avoir trop bien défendu Crémone contre l’empereur. Il y a ainsi bien des livres chers à l’humanité qui sont nés dans un cachot, depuis la Consolation de Boëce jusqu’aux Prisons de Silvio Pellico.
Nous ne pouvons nous arrêter ni à des compilations, telles que celles de ser Ristoro d’Arezzo sur la composition du monde, ou de fra Guidotto de Bologne sur la rhétorique, ni aux lettres en prose de fra Guittone, lettres édifiantes, quelques-unes politiques, comme la quatorzième, adressée aux Florentins, invective assez éloquente par éclairs, mais trop diffuse pour être comptée parmi les monuments vraiment littéraires. Contentons-nous, pour achever cette courte revue de la prose, d’accorder quelque mention aux conteurs populaires.
La nouvelle italienne se compose d’une aventure courte, d’une anecdote historique, d’un bon mot ou d’un bon tour. Ce sont ces deux derniers éléments surtout qui composent la nouvelle florentine; ajoutons les mœurs licencieuses, nullement voilées dans l’expression. Mais à l’époque primitive où nous sommes, il semble que la langue ne soit pas encore sortie de l’âge d’innocence, et que la nouvelle florentine n’ait pas encore pris son pli définitif. Le Novellino ou recueil des Cento Novelle, composé peut-être de récits venus de tous côtés, et rédigé en langue toscane, contient un peu de tout, narrations fictives ou historiques et bons mots: à peine y trouve-t-on une ou deux nouvelles dont l’honnêteté pourrait souffrir. Bien plus pur que nos fabliaux, ce recueil leur ressemble pourtant par la simplicité, par une sorte d’insouciance de bien dire, et c’est pour cela sans doute qu’il a toujours plu et qu’il a mérité d’être appelé il fiore del parlar gentile. Toutes les nouvelles qu’il contient ne sont pas du XIIIe siècle; mais celles qui roulent sur l’histoire de Frédéric II sont des plus anciennes, et il faut sans doute ranger dans ce nombre les deux suivantes:
«On lit du roi Conrad, père de Conradin, que lorsqu’il était garçonnet, il avait en sa compagnie douze garçonnets de son âge. Quand le roi Conrad faisait faute, les maîtres qui l’avaient en leur garde ne battaient pas lui, mais bien quelqu’un de ces garçonnets pour lui. Et il disait: «Pour«quoi battez-vous ceux-ci?–Pour tes fautes,» répondaient les maîtres. Et il disait: «Pourquoi ne me battez-vous pas, moi le coupable?–Parce que tu es notre seigneur, disaient les maîtres; mais nous battons ceux-ci pour toi. Et ce doit être pour toi, si tu as noble cœur, une douleur grande que d’autres portent la peine de tes péchés.» Aussi, dit-on, le roi Conrad se gardait-il fort de pécher, par pitié pour ses compagnons.»
«A un certain roi naquit un fils. Les sages astrologues ordonnèrent qu’il demeurât dix ans sans voir le soleil. Alors le roi le fit nourrir et garder en de ténébreuses cavernes. Après le temps dit, il le fit amener dehors, et devant lui fit mettre maints beaux joyaux et maintes belles damoiselles, nommant tous ces objets par leurs noms, et disant que les damoiselles étaient démons. Et puis on lui demanda lequel de ces objets lui semblait plus plaisant. «Les démons,» répondit-il. Alors le roi s’en émerveilla fort, disant: «Quelle chose c’est que tyrannie et beauté de «femme!»
Au milieu d’une civilisation plus municipale que féodale, l’épopée chevaleresque ne pouvait être qu’un objet de curiosité, une œuvre littéraire à demi comprise ou singulièrement altérée. Elle fut dès le principe remaniée suivant le goût d’une société qui n’avait pas les traditions d’un monde de seigneurs. Ici d’abord, comme dans la poésie lyrique, il y eut une sorte d’invasion de la langue d’outremonts. Des poëtes français firent entendre dans les châteaux et dans les villes le récit des aventures de Charlemagne, de ses paladins, du roi Arthur et des chevaliers de la Table-Ronde. Des Italiens, à leur tour, chantèrent en français les ’mêmes traditions fabuleuses. Il semblait que la langue française fût le seul véhicule possible de la pensée féodale, et que les deux langues d’oc et d’oïl, la dernière surtout, fussent l’idiome naturel de la chevalerie. Venise conserve en ses bibliothèques des monuments de cette poésie italo-française. En est-il qui puissent être attribués avec certitude au XIIIe siècle? Deux faits paraissent hors de doute: le premier, c’est qu’il n’y a pas de poëtes chevaleresques italiens antérieurs au xive siècle; le second, c’est que le roman chevaleresque en prose est antérieur aux poëmes. C’est le contraire de ce qui est arrivé en France; par le roman en prose la littérature chevaleresque semble avoir gagné droit de cité en Italie. «Vers d’amour et prose de romans,» a dit l’auteur de la Divine Comédie. Ce n’est pas tout. Les romans en prose italienne ont été populaires; les poëmes chevaleresques ne sont pas parvenus à la popularité avant Pulci, Bojardo, et même avant Arioste.
D’où vient le succès de ces romans en prose, tels que les Reali di Francia, qui sont encore, bien que fort altérés entre les mains du peuple, de la Tavola Rotonda qui est aussi ancienne que la prose toscane, du Lancillotto que lisait Françoise de Rimini avec son amant et qui les perdit tous deux? Rien ne diffère plus des épopées françaises que ces romans italiens qui en sont tirés. Les cadres, les noms, sont à peu près les mêmes dans les Reali di Francia que dans nos poëmes du cycle de Charlemagne; mais on s’y trouve en pleine Italie. Les aventures, les caractères des personnages, les détails, ne sont plus reconnaissables: c’est un autre monde. Des miracles à chaque pas, tels que la lèpre de Constantin guérie par un prodige, une fournaise qui ne brûle pas sa victime, une épée bien affilée qui ne perce pas même l’épiderme, le tout grâce à une prière faite à propos, des légendes tirées des martyrologes, des coups de couteau, des reconnaissances pareilles à celles de Boccace, des intrigues, de cour, des complots de domestiques, des histoires de gibet, des dévotions particulières à la Vierge, de bons tours joués au prochain et les éclats de rire qui s’ensuivent, voilà des marques assez manifestes du goût italien.
Quand le roman italien prit naissance, la faveur universelle était déjà aux poëmes de la Table-Ronde, où la chevalerie est galante, où la superstition est imaginative, où les enchantements ne semblent inventés que pour créer aux chevaliers un monde nouveau bien au-dessus du monde laissé au vulgaire. De ces conceptions les Italiens prirent les légendes, les ermites, les enchanteurs, les géants, surtout la galanterie. Déjà chez eux le mérite de l’homme se mesurait moins qu’ailleurs sur les grands coups de lance et sur les bons coups d’épée. Leurs poésies amoureuses montrent assez que les femmes étaient réputées les juges les plus compétents du mérite. Leurs romans enseignèrent l’art de plaire par les grâces de la personne et par la délicatesse de l’esprit; la valeur ne venait qu’en second lieu, ou elle était même sous-entendue. Déjà, sauf les barons et châtelains, qui habitaient la campagne, les Italiens désapprenaient le métier des armes. Dès le XIIIe siècle, Florence employait des mercenaires; dès le commencement du XIVe elle traitait avec ses capitaines, non-seulement pour qu’ils eussent des hommes d’armes soudoyés, mais pour que ces hommes d’armes fussent appelés de l’autre côté des Alpes.
Les romans sur Arthur, Tristan et Lancelot plurent davantage dans les classes nobles et cultivées: Dante leur a fait l’honneur de se souvenir d’eux, ainsi que de la déroute de Roncevaux, et de l’expédition de Charlemagne, qu’il appelle di Carlomagno la santa gesta. Mais le roman des Reali di Francia ne lui fournit rien. Il devait dédaigner cette suite de récits fictifs; le titre même de cet ouvrage pouvait lui rappeler d’amers souvenirs. Les Guelfes noirs, ses ennemis, n’appelaient pas autrement leurs protecteurs les princes de France. Lorsqu’ils contraignirent Florence de se mettre à la merci de Charles de Valois, ils donnèrent «le sang royal de France» pour garant de sa parole. Ce roman était-il conçu dans un esprit guelfe? La scène est le plus souvent dans la Romagne, qui est le foyer du guelfisme, et l’ouvrage paraît avoir pour but non-seulement d’amuser le lecteur, mais de l’intéresser aux destinées de la maison de France, et de justifier ses prétentions à une sorte d’empire universel, en la faisant descendre de Constantin. Ces circonstances feraient remonter ce titre populaire à la fin du XIIIe siècle. Quoi qu’il en soit, il est la source la plus ancienne de l’épopée chevaleresque telle que la voulait l’Italie. Arioste a puisé à pleines mains dans ce répertoire varié, divertissant, et qui joint à ces causes de succès une langue naïve et gracieuse.