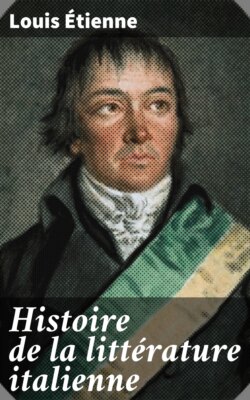Читать книгу Histoire de la littérature italienne - Louis Chastel Étienne - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Critiques dirigées contre la langue italienne.–Formation de la langue italienne; partisans de l’origine barbare; école de Muratori.–Origine locale; partisans du latin rustique; école de Maffei.–Origines de l’italien littéraire; dialectes; primauté de la Toscane.
ОглавлениеTable des matières
Critiques dirigées contre la langue Italienne.
Entre les idiomes nés de la souche latine, la langue française et l’italienne se sont plus d’une fois disputé le premier rang. Aussi semble-t-il nécessaire, quand on parle aux Italiens des lettres françaises, de faire l’apologie de l’idiome qui en est le dépositaire, et, quand on raconte aux Français l’histoire de la littérature italienne, de rappeler les louanges et les critiques dont est souvent l’objet la langue «du beau pays où le si se fait entendre.»
La langue italienne est sans doute la sœur jumelle du français, et probablement la même époque a connu les premiers bégaiements de l’une et de l’autre. Mais la première est demeurée longtemps mineure, et la tutelle du latin qui était plus présent en Italie, ne lui laissant pas de place dans les écrits, l’a retenue dans une plus longue enfance.
Au XIe et au XIIe siècle, le français est non-seulement une langue parlée, écrite, mais encore une langue littéraire. Comme s’il avait attendu l’échéance de l’an mille et le réveil du moyen âge à la vie, pour se livrer au long espoir et aux vastes pensées, il crée des poëmes contemporains de ses cathédrales. Durant ce même temps, dans la péninsule, l’italien se forme sur les lèvres du peuple qui croit parler la langue de ses pères; mais il porte encore le nom de latin, et le latin proprement dit est appelé grammaire. Les règles de l’italien ne sont pas encore soupçonnées; il n’est pas écrit.
Au XIIIe siècle, le français, en avance sur les autres langues, s’impose à l’Italie plus aisément qu’à nul autre pays d’Europe. On le comprend, beaucoup même le parlent et l’écrivent de l’autre côté des Alpes. Cependant l’italien fait entendre des chants; ce sont ses premiers vers. A peine quelques-uns peuvent-ils être reculés jusqu’aux dernières années du siècle précédent. La prose commence, mais ses essais sont timides et rares; et, comme les Français passent pour les maîtres en l’art de bien dire, quiconque veut être lu et ne sait pas faire usage du latin, écrit en français.
Au xive siècle, les rôles changent. La langue italienne prend une revanche éclatante; l’heureuse rencontre de trois hommes de génie et la renaissance de l’antiquité déjà commencée au delà des Alpes, assurent aux Italiens la primauté. Cette conquête dù premier rang s’affermit et s’étend durant le xve siècle. La langue française, qui jusque-là n’a que le dépôt de la civilisation mondaine et de la politesse naissante du moyen âge, s’incline à son tour devant son heureuse rivale, riche, puissante et déjà mûre.
Mais au xvie, la lutte recommence. Si le bon Amyot, très-français par le langage, pratique les Italiens et s’enrichit de leurs tours, on oppose les traductions des anciens par Blaise de Vigenère aux traductions italiennes. Si Ronsard et Marot lui-même imitent Pétrarque, si Du Bellay vante les poëtes italiens en des vers heureux;
Quel siècle esteindra ta mémoire,
OBoccace? et quels durs hyvers
Pourront jamais seicher la gloire,
Pétrarque, de tes lauriers verds?
Qui verra la vostre muette,
Dante, et Bembe à l’esprit hautain?
Qui fera taire la musette
Du pasteur néapolitain?
(Ode IV à Mme Marguerite.)
Henri Estienne prétend démontrer que le français est plus grave, plus harmonieux, plus riche que l’italien. La Précellence du langage françois est presque un réquisitoire en règle contre l’accent italien que l’auteur comprend mal, contre la terminaison de tous les mots en une des cinq voyelles, terminaison qui lui paraît uniforme parce qu’il n’a pas le sentiment de l’accent, enfin contre la physionomie même de l’italien qui ne lui paraît qu’une altération visible et choquante du latin: c’est encore aujourd’hui le préjugé de ceux qui ne connaissent l’italien que de vue.
Le xviie siècle français commença par suivre et imiter les Italiens; plus tard il s’éloigna d’eux, et jugea leur langue avec sévérité sinon avec jalousie. Malherbe n’aimait point les poëtes italiens; et il disait que les sonnets de Pétrarque «étaient à la grecque, comme les épigrammes de Mlle de Gournay,» c’est-à-dire sans pointe. Au resté c’est plutôt de l’abondance des pointes que nos critiques se plaignaient; suivant l’habitude, on jugeait de toute la littérature de ce peuple d’après son goût dans le temps actuel. Pour le seul Ménage qui cultive religieusement et jusqu’à la fin la langue italienne, qui écrit des vers italiens, et fait un dictionnaire des origines de cette langue, nous comptons Saint-Évremond, le P. Rapin, le P. Bouhours, qui répètent les mêmes critiques sur les concetti, sur les pensées fausses, enfin le plus grand critique de ce siècle, Boileau, qui revient sans cesse sur «l’éclatante folie de ces faux brillants», et laisse percer une sorte de haine non moins contre la langue que contre le caractère des Italiens.
.... Je ne puis sans horreur et sans peine
Voir le Tibre à grands flots se mêler à la Seine,
Et traîner dans Paris ses mômes, ses farceurs,
Sa langue, ses poisons, ses crimes et ses mœurs.
(Satire Ire, variante.)
Au xviiie siècle, Regnier-Desmarais fait des vers italiens qui sont étudiés et commentés dans l’Académie de la Crusca; Rousseau aime la langue italienne comme fille du plaisir, et l’oppose à nos langues septentrionales qu’il regarde comme les filles du besoin; il n’est pas loin de la vérité quand il dit que pour rendre justice à l’italien il faut l’entendre, tandis que pour apprécier le français il faut le lire. Mais le public français, tout en corrigeant les jugements littéraires de Boileau sur Tasse, gardait ses préjugés contre la langue de ce poëte, et persistait à la trouver trop badine, trop molle, trop efféminée. Voltaire, qui place les auteurs de la Jérusalem délivrée et du Roland furieux à côté d’Homère et quelquefois au-dessus, refuse à l’italien la vraie harmonie, celle de la variété. C’était en vain que Bettinelli lui faisait, en1758, des leçons de l’accent italien; il. recommençait toujours la faute d’Henri Estienne: il accusait la langue italienne d’avoir des terminaisons monotones et de manquer de syllabes à demi prononcées, comme nos e muets; il prenait les élisions pour des hiatus, et lisait ainsi les premières rimes de Tasse: capitanó, cristó, manó, acquistó
De notre temps, le procès des langues étrangères est partout vidé; la question n’est plus de savoir si les Italiens doivent apprendre le français, ou si les Français doivent apprendre l’italien, mais de connaître les mérites et les défauts respectifs de chacune de ces langues, et nul n’est plus capable de le faire que les critiques nationaux. Les Italiens, en particulier, se sont livrés à des discussions assez nombreuses sur leur langue pour faire une place aux opinions impartiales. Ils se sont chargés eux-mêmes de montrer pourquoi la langue la plus musicale du monde n’est pas devenue une langue universelle. Sans doute la puissance politique a manqué à l’Italie; sans doute aussi la persistance plus longue et le retour de faveur plus marqué de la langue latine ont dérobé à l’italien une part de cette universalité littéraire à laquelle il avait droit. Mais la langue nationale a trouvé en elle-même des obstacles à la conquête d’un empire si étendu. Elle est malaisée même pour les Italiens. Ils s’accordent à reconnaître qu’elle est remplie d’archaïsmes hors de service dans la conversation. Déjà Magalotti, une des meilleures autorités en fait de langage au XVIIe siècle, se plaignait que le dictionnaire de la Crusca s’éloignât de l’usage, au point que les étrangers qui le consultaient se trompaient huit fois sur dix: «La cause en est, dit-il, que toutes les autres nations approuvent l’usage en fait de langue, et n’ont pas d’autre règle. Aussi, dans leurs vocabulaires, on n’est pas sujet à faire erreur. Mais nous tenons pour le bon siècle–de1250à1350–et cependant nous voulons que l’on parle suivant l’usage du temps présent.»
Ce respect de l’archaïsme complique la langue italienne de beaucoup de synonymes et de doubles emplois. Comme elle est une langue écrite encore plus qu’une langue parlée, même pour les Florentins qui en possèdent la pratique à titre d’idiome maternel, elle est toute remplie et encombrée des différents vocables dont les bons écrivains se sont servis pour désigner le même objet. D’ailleurs les augmentatifs, les diminutifs, les terminaisons péjoratives, multiplient à l’excès cette végétation parasite. Le savant Mustoxidi comptait dans le vocabulaire soixante-trois mots pour dire âne et ânesse; le porc et la truie n’ont, pas moins de quarante-deux synonymes.
On devine assez combien il doit être difficile d’avoir le mot propre dans une langue où la pureté est le produit de l’étude ou bien le partage naturel d’un si petit nombre parmi ceux qui la parlent. Plus l’italien correct s’étend hors des limites de la Toscane, grâce à l’éducation, plus il perd en propriété, en brièveté précise et spontanée. De là cette gravité pompeuse, ces termes généraux sous lesquels les prosateurs italiens voilent quelquefois l’absence du mot propre. De même, chez les Grecs, les Asiatiques, voulant être éloquents sans avoir la propriété exquise de l’atticisme, mettaient des périphrases à la place des termes précis dont ils n’étaient pas sûrs.
Point de centre politique puissant, point de grande capitale qui fût le cœur et le siége de la pensée d’un peuple, point d’unité nationale parfaite, même dans le langage, telles sont les causes qui, malgré tant de richesses littéraires, ont empêché les Italiens, nos maîtres dans l’art et dans les lettres, de maintenir leur langue à ce rang de prépondérance et d’universalité qu’elle avait conquis du XIVe au XVIe siècle. Comment cette langue qui a préparé et rendu possible l’unité de la nation, trouvera-t-elle dans cette partie de son œuvre accomplie, le secours et la force nécessaires pour achever et perfectionner sa propre unité, en un mot et pour dire toute notre pensée, par quelles évolutions la langue toscane et la langue italienne seront-elles incorporées l’une à l’autre et identifiées? C’est le secret de l’avenir.
formation de la langue italienne; partisans de l’origine barbare; école de Muratori.
Toutes les questions qui se rapportent à la langue ont trop d’importance en Italie, pour que les lettrés de ce pays ne se soient pas occupés des origines de l’italien, dès que l’Italie eut une littérature. Dante songeait si peu à séparer l’italien du latin qu’il les unissait en quelque sorte et les rendait contemporains en appelant le premier langue vulgaire, et en donnant le nom de grammaire au second. Pétrarque, quoiqu’il fît bien peu d’état de l’italien dans ses œuvres latines, pensait comme Dante en cette matière, et indiquait la Sicile comme le berceau de cette langue qu’il enrichissait tout en la méprisant. Le xve siècle, poussant plus loin le préjugé de Pétrarque, non-seulement se remit à écrire dans la langue de Cicéron, mais il imagina ce paradoxe singulier, que la langue de Dante était celle que parlait la plèbe de Rome. C’est Léonard Bruni, plus connu sous le nom de Léonard Arétin, historien de la république et secrétaire de la Signoria, de Florence, qui le premier mit en avant cette hypothèse plus flatteuse peut-être qu’il ne le pensait. On s’autorisait ainsi de l’exemple des grands écrivains de Rome qui avaient dédaigné, disait-on, de laisser même un monument dans ce patois fait pour les ignorants; on donnait à l’italien dix siècles de plus d’existence pour le mieux accabler sous le poids de son obscure antiquité. Peut-être aussi, comme deux langues étaient en présence, on trouvait naturel qu’il en eût été toujours de même; seulement on pensait qu’à un certain moment, l’empereur romain et sa cour avaient emporté, pour ainsi dire, à Constantinople, l’usage du bon latin mêlé à leur bagage.
Il semblait que les Italiens eussent oublié qu’ils avaient eu des maîtres barbares: aucun critique ne s’avisait de se demander si les races de l’autre côté des Alpes n’avaient pas mêlé quelque chose à la langue nationale. Les guerres des Français, des Allemands, des Suisses, rappelèrent sans doute aux habitants de la péninsule que les bandes des Goths, des Hérules, des Gépides, avaient autrefois sillonné leurs belles contrées; que les Ostrogoths et les Lombards y avaient fondé leur royauté à demi sauvage à la place de l’empire des Césars et des Constantins. Comment l’harmonieuse langue des Italiens n’eût-elle pas conservé quelques traces d’un régime qui dura deux cents ans, au moins quelques locutions grossières, quelques cris barbares des hôtes ou plutôt des maîtres et des tyrans dont un pape du VIIe siècle qui les a vus et combattus parle en ces termes: «Tirés de leurs tanières, ils vinrent comme des glaives sortis de leurs fourreaux, et, s’abattant sur nos têtes, ils s’enivrèrent de notre sang. Les générations humaines qui étaient dans ce pays, aussi nombreuses, aussi serrées que les épis des champs, furent ravagées et détruites, les villes mises à sac, les temples brûlés, les châteaux rasés, et toute cette contrée, veuve de ses habitants, devint un désert, en sorte que les bêtes occupèrent les lieux qui avaient été le séjour des hommes.»
Sperone Speroni, l’un des critiques originaux du XVIe siècle, croit tout simplement que l’italien est en grande partie né du français et particulièrement du provençal. Mieux encore, il déclare que la langue tout entière est en quelque sorte venue des barbares. Il le dit, non sans retrouver le même accent ému que nous venons de voir dans le pape contemporain de la barbarie. Il vaudrait mieux sans doute que Rome eût toujours l’empire et que l’Italie parlât la langue des aïeux latins; mais puisqu’il en est autrement, faut-il mourir de douleur ou rester muet? C’est avec une résignation touchante qu’il console l’esclavage de l’Italie par les lettres. «Il fut un temps où parler le langage vulgaire fut une nécessité violente; mais avec le temps l’italien fit de cette nécessité pénible l’art et l’industrie ingénieuse de sa langue. De même qu’au commencement du monde, les hommes se défendirent des bêtes féroces par la fuite ou en les tuant, tandis qu’aujourd’hui nous en tirons avantage et ornement, et nous nous habillons de leur peau, de. même, dans le principe, et uniquement pour nous faire entendre de nos maîtres, nous parlions la langue vulgaire; mais aujourd’hui c’est par plaisir et par espérance de gloire que nous parlons et que nous écrivons dans cette langue.»
Mais la critique italienne a trop obéi à l’esprit municipal; elle combat bien souvent pour la gloire de la province et pour l’honneur du clocher, au lieu de chercher la vérité même. Aussi la question de l’origine de la langue est-elle sans cesse brouillée par les prétentions locales à la primauté. Muzio, philologue batailleur, qui réunit plusieurs de ses opuscules sous le nom expressif de Battaglie, était né à Padoue, comme Sperone. Il crut avoir démontré victorieusement que la langue n’a pu naître qu’en Lombardie, parce que les barbares y établirent d’abord leur empire. Suivant son raisonnement, les barbares n’étant parvenus à Rome que plus tard, la résidence des papes fut la dernière à connaître la nouvelle langue, et Florence, qui est à moitié chemin, trouva un tempérament entre l’italien lombard et le latin moins corrompu de Rome. C’est suivant lui un juste milieu que l’Italie a fini par adopter; mais la Lombardie n’en a pas moins la gloire de la découverte, d’où il résulte que la langue de Dante a été apportée par le féroce Alboin. Le Florentin Varchi a des raisonnements aussi singuliers pour assurer la priorité à Florence. Dans l’embarras où il est pour trouver des barbares en son pays de Toscane, où ils n’ont pas séjourné, tantôt il fait naître l’italien du provençal, à cause des mots romans qu’il rencontre dans les vieilles poésies toscanes, tantôt il suppose que sa langue maternelle est née du commerce des Florentins avec certains prisonniers suèves qu’ils avaient faits à Fiésole sur Radagaise.
L’origine barbare n’a pas de partisan plus considérable que Muratori, critique estimable, historien profondément érudit et philologue éminent du commencement du XVIIIe siècle. Dépourvu des lumières nouvelles que nous devons à la philologie comparée, mais devenu, à force de labeurs, comme un contemporain des antiquités de l’Italie dont il rédigeait les vastes archives, il ne faut pas s’étonner qu’il ait donné une grande importance au fait de la conquête barbare dans les vicissitudes de la langue. Il voyait partout les Lombards s’établir en tyrans dans le pays, en même temps que les mots barbares faisaient violence à la langue latine. On serait plutôt tenté de s’étonner qu’il ait gardé quelque mesure dans son système. En effet il reconnaît que par la simple action du temps et sans aucune ingérence d’idiomes germaniques le latin se rapprochait des formes des langues modernes. Ainsi certaines inscriptions, surtout celles des catacombes de Rome, nous avertissent que les Latins, surtout parmi le peuple, à une époque très-reculée, prononçaient leur langue de manière qu’une grande quantité de mots étaient déjà de l’italien moderne. Les consonnes finales disparaissent, les terminaisons en us, en um, se changeaient en u et en o; celles en is, em, am, devenaient i, e, a. Auguste affectait sans doute les manières d’écrire populaires, non-seulement quand il multipliait les prépositions devant les régimes indirects des verbes, et par conséquent supprimait le datif et l’ablatif, mais encore quand il s’attachait à écrire les mots suivant leur prononciation. Auguste tendait ainsi vers la forme italienne. Que serait-ce si nous pouvions compter toutes les blessures que faisaient au latin de Cicéron tant d’étrangers admis dans Rome et dont Cicéron se plaint, tant de barbares habitant la capitale du monde avant l’invasion des barbares? Qu’on se figure le latin que devaient parler Arminius et ses Germains enrôlés dans les légions. C’était dans cette langue que le héros germain défiait plus tard au combat les soldats romains, qui la comprenaient fort bien. Ce latin militaire était plutôt populaire que germain, et les barbares apprenaient plus aisément un. idiome plébéien qu’une langue savante enrichie de déclinaisons, de désinences des verbes, d’inversions et de tournures synthétiques. L’historien byzantin Théophane raconte à la date de579que les soldats rappelaient un de leurs compagnons dans un combat, en criant, lorna fratre! est-ce le latin rustique dont parlent les anciens auteurs? n’est-ce pas déjà un commencement d’italien au VIe siècle?
Cependant les causes intérieures et locales ne paraissent pas à Muratori tellement puissantes qu’elles expliquent la dégénérescence extrême du latin et le passage définitif à une langue nouvelle. A ses yeux, ce n’est pas assez des progrès de l’ignorance et de la prépondérance du langage incorrect et du latin rustique, et l’on ne pourrait ainsi rendre compte de la naissance de l’italien: il a fallu pour ouvrir l’écluse à la barbarie et aux révolutions de la langue, le torrent des populations germaines et le naufrage complet de ridiome latin. Certaines formes, telles que l’emploi des verbes auxiliaires dans les conjugaisons, n’ont pu être introduites que par les barbares ou par l’imitation des barbares. De même l’article n’a pu naître simplement de l’oubli des désinences et des cas; mais, par suite de cet oubli, les Italiens ont imité les peuples septentrionaux et ils ont créé l’article de la manière suivante. De l’adjectif ille, devenu illo, par suite d’une altération générale dans toutes les déclinaisons masculines, ils ont formé l’article lo; de illa, ils ont fait la, de illi, li, de illæ, le. C’est ainsi que ille caballus prononcé d’abord illo caballo, illa hasta, illæ feminæ, sont devenus tantôt il cavallo, tantôt lo cavallo, i et li cavalli au pluriel, la asta, le femmine. Le pluriel de l’adjectif possessif est né du génitif pluriel de illorum, loro. De iste, ista sont nés sto, sta qui n’existent que dans les dialectes, et de isthic, isthaec ou hiciste, haecista sont venus questo, questa, etc., formés soit spontanément du latin, soit à l’imitation des démonstratifs en langue germaine. De même Muratori veut que l’article indéfini uno vienne de l’allemand ein.
L’imitation de l’idiome germain, tel est, malgré les con cessions qu’il fait au système opposé, le trait capital de la théorie de Muratori. A l’exception de Maffei qui est un critique original et de Quadrio, tout le XVIIIe siècle s’en tient à cette doctrine. De Brosses, dans son Traité de la formation des langues, adopte, en y mettant plus d’esprit et d’ingéniosité, les vues de ce «bon vieillard qu’il avait vu travaillant au milieu des vieilleries italiennes.» Ce n’est pas Fontanini, malgré tout son savoir, qui pouvait donner à cette théorie un grand surcroît d’autorité. Mais le grave et judicieux Tiraboschi décida par son suffrage celui de tous les critiques. Ginguené lui-même, qui a du goût et une grande sagacité, n’a pas peu contribué à faire pencher la balance en faveur des idées de Muratori. Enfin, le comte Perticari, un de ces critiques polémistes que l’Italie a produits en si grand nombre, penche visiblement vers l’origine barbare, dans une page où il s’élève presque jusqu’à l’éloquence.
«Les mots qui appartiennent à la vie usuelle sont latins; les termes relatifs au commandement et à la guerre nous viennent des barbares. En effet, cette corruption de la langue est soumise à deux conditions: le vaincu apprenait les mots que lui dictait la force, le vainqueur ceux que lui dictait le besoin. Le Goth qui voulait du pain, et qui entendait dire parles plébéiens latins: da mihi illum panem, s’efforçait de les imiter en disant: da... mi... il... pane. Autant de mots latins qu’il mutilait suivant ses habitudes sauvages. Au contraire les nôtres, obéissant à la force, apprenaient des Goths les noms des armes qui les avaient vaincus, et des nouveaux régimes qui s’étaient fon dés. C’est pourquoi ces barons, ces marescals ou maréchaux, qui étaient venus enfermés dans leurs cuirasses, armés de massues et de grandes épées, sans demeures fixes, ces hommes qui tenaient les esprits dans la terreur par des attaques, des combats, des guerres perpétuelles, nous enseignèrent les mots de usbergo, haubert, arnese, armure, spada, épée, strale, trait, ammazzare, tuer, alloggiamenti, étapes, scherma, escrime, scaramuccia, escarmouche, battaglia, guerra, autant de mots nés de nos malheurs.... Ensuite prirent naissance ceux qui sont encore aujourd’hui les témoins de cet antique servage, feudatario, vassallo, barone, maliscalco, bargello, barigel, chef des archers.»
Origine locale; partisans du latin rustique; école de Maffei.
Quelles que soient les apparences qui plaident en faveur de l’origine barbare, la critique abandonne aujourd’hui la voie ouverte par Muratori. Il y a désormais tout lieu de croire que les langues néo-latines sont nées directement du latin tel qu’il était parlé par le peuple, et que le choc des idiomes germains n’a fait que précipiter une révolution qui s’accomplissait déjà d’elle-même. Quelques mots altérés ou ajoutés, suivant l’opinion de ce même Perticari, ne changent pas soudain la nature d’une langue. La diversité des dialectes italiens est encore une objection presque insoluble à tous ceux qui veulent que l’italien soit venu du dehors. Comment deux ou trois siècles après l’invasion barbare auraient-ils suffi, non-seulement à la végétation de cette langue nouvelle pour s’étendre à toute la péninsule, mais à ces vingt langages à la fois semblables et différents, pour jaillir du tronc commun qui avait eu à peine le temps de sortir du sol et de grandir, c’est là un problème que Muratori, avec toutes les ressources de son érudition, n’a pu résoudre. Nous avons voulu faire connaître la doctrine qui fait sortir l’italien du choc des langues barbares, en d’autres termes l’école de Muratori, de ses devanciers et de ses disciples. Nous allons rappeler les noms et les opinions de ceux qui ont défendu la théorie contraire, je pourrais dire, la théorie généralement adoptée de nos jours. Sans doute Léonard Arétin et Poggio Bracciolini, au xve siècle, exagéraient, et peut-être à dessein, l’origine antique de l’italien. Au xvie siècle elle jouissait encore de quelque faveur, puisqu’on la trouve exposée non par Bembo, mais dans un dialogue de Bembo, par Hercule Strozza, grand latiniste, qui s’en fait un argument contre l’emploi de la langue vulgaire; Bembo prend si peu cette opinion à son compte qu’il la fait réfuter par Julien de Médicis. Castelvetro, un de ces critiques dont la règle semble être l’esprit de contradiction, prit parti contre Bembo, et soutint que les Italiens, dans les meilleurs temps de la langue latine, avaient parlé un langage tout à fait semblable à l’italien. Les monuments de cette langue vulgaire antique ont pu périr; mais on en trouve des traces dans Apulée, dans Palladius, etc..
Le plus hardi champion de l’italien contemporain de Térence et de Virgile est Celso Cittadini, de Sienne, professeur de langue toscane à l’Université, et grand déchiffreur d’inscriptions. Non-seulement l’italien est désormais le frère, mais l’aîné du latin; et le vieux romain différait moins de l’italien que du romain de Cicéron; il avait mêmes formes, mêmes terminaisons; entre l’italien et le latin de la colonne rostrale de Duillius il n’y a que la main. Ce qu’il y a de vrai dans les prétentions de ce critique, c’est que le corps des mots en passant des Latins à leurs petits-neveux a peu changé. «Une maison ancienne, dit-il, dont les planchers seraient refaits, le toit rehaussé, les fenêtres changées, les portes redressées, une maison embellie et remise à neuf, serait toujours la même maison, pourvu que les fondations et les vieux murs ne fussent pas touchés.» Les articles et les terminaisons l’embarrassent; il s’en tire grâce aux barbares et aux esclaves qui habitaient Rome. Les Grecs dont se plaint Juvénal, les soldats germains dont parle Tacite, ont apporté, suivant lui, l’article et l’usage des conjugaisons nouvelles. Cittadini ne veut rien devoir aux invasions des barbares. A cet égard, il se rapproche fortuitement de la vérité; c’est que le progrès des formes analytiques du langage avait de bonne heure décomposé la langue sur les lèvres des populations latines. Mais Cittadini est comme Muzio, Varchi et tant d’autres, un critique d’académie locale et de clocher: ses inscriptions, dont il fait sa loi et ses prophètes, lui paraissent se rapprocher davantage du dialecte de Sienne que de tout autre, et, quand il veut que l’italien soit l’aîné du latin, c’est du siennois qu’il s’agit; c’est contre la primauté de Florence qu’il invente Son bizarre Système. Cittadini est du commencement du xviie siècle; on peut rapprocher de sa doctrine celle de Giambullari, qui, vers la fin du XVIe, donnait pour source à l’italien le dialecte de Florence, et à ce dialecte la langue des Araméens qu’il regardait comme les aïeux des Étrusques. Étrusques, Florentins, Italiens, tiraient leur origine de je ne sais quelle province d’Asie: c’était chercher bien loin les titres de la primauté de Florence.
On reproche au comte Scipion Maflei, célèbre critique dû XVIIIe siècle, d’avoir voulu que la langue latine correcte se soit tout simplement corrompue par le mélange avec le latin vulgaire, irrégulier et mal prononcé. Il est vrai que le célèbre poëte et critique obéit à un patriotisme littéraire qui l’a quelquefois trompé en d’autres matières. Il veut que tout soit latin et autochthone dans la langue italienne, comme il veut que tout soit romain dans l’architecture de son pays. «Si nous pouvions ôter, dit-il, les ogives, l’irrégularité des chapiteaux et des colonnes, il ne resterait rien que d’antique dans nos édifices.» Mais avant les recherches des philologues allemands et français, qui ont prouvé que les langues néo-latines se sont formées spontanément, par voie d’altération successive et de mélanges particuliers avec les dialectes locaux, nul critique italien n’a mieux deviné ce qui devait être prouvé plus tard. Sans exagérer l’antiquité du romain rustique, sans prétendre qu’il y eut deux latins existant côte à côte, il a montré que l’italien est né de certains mots, de certaines façons de parler qui n’appartenaient pas au latin littéraire, et dont le nombre, s’accroissant toujours, a fini par déborder et remplacer entièrement la langue de Cicéron et de Virgile. Déjà Plaute employait minaciae pour comminationes, batuere pourpercutere. Lucrèce disait russus pour rubens, Suétone se servait de beccus pour rostrum. Bientôt les impropriétés ou les nouveautés de ce genre se multiplièrent. On dit brodium pour jus (saint Gaudence), camisia pour subucula (saint Jérôme), torta pour placenta (Vulgate), grossus pour crassus (Cassiodore), jucunda mente pour jucunde (Apulée), etc.
La prononciation était la source des plus grands changements; toutes les désinences en us et en um se prononçaient en o; am, em devinrent de bonne heure a, e par la disparition de cette lettre m que Quintilien appelle mugissante. Per hoc se prononça perd; sic devint si en continuant d’exprimer l’affirmation. Quant aux articles, Maffei en expliqua la création de la même manière que Castelvetro; il trouva dans des auteurs latins l’emploi des prépositions pour remplacer les cas, comme caput de aquila et genera de ulmo dans Pline. Plaute et Apulée, Cicéron lui-même, lui offrirent des exemples de verbes auxiliaires, comme dans dictum habeo.
Il serait inutile aujourd’hui de revenir sur la célèbre hypothèse de M. Raynouard qui consistait à faire naître dans tous les pays néo-latins et surtout en Provence, où il aurait acquis sa perfection, un romain vulgaire, sorti du latin rustique et appelé roman. Cette langue intermédiaire se serait répandue dans tous les pays d’obéissance romaine, grâce à l’unité politique établie par Charlemagne. En vertu de cette théorie adoptée par le comte Perticari, l’italien eût été d’abord une sorte de provençal introduit à la cour de Charlemagne, apporté par lui de l’autre côté des Alpes, et remanié par les populations latines. Cette hypothèse n’a servi qu’à montrer plus clairement l’étroite parenté qui lie ensemble les langues néo-latines et qui les sépare d’autant des idiomes tudesques. Elles sont nées directement du latin au lieu d’avoir passé par un langage intermédiaire.
Après les savantes études de M. Fauriel, il semble permis d’affirmer que les langues germaniques ne sont presque pour rien, dans la formation de l’italien, et que celui-ci est le dernier degré d’une transformation lente et graduelle du latin vulgaire. Ouvrez Dante à côté de Virgile, et Boccace à côté de Cicéron: voilà ce que le peuple, obéissant instinctivement aux tendances analytiques des races indo-européennes, a fait d’une langue si riche en ses flexions et si savante en ses tours; voilà aussi comment le Siennois Celso Cittadini, malgré les exagérations et l’esprit de provincialisme, ne se trompait pas entièrement. Tandis que les Français conservaient les consonnes finales, les Italiens les remplacèrent par des voyelles; les uns et les autres défigurèrent le latin en deux sens contraires: l’accent seul était conservé des deux côtés des Alpes, et maintenait la physionomie du mot.
De là des conséquences considérables. Les Français se plaisant aux consonnes finales, gardèrent des restes de flexions latines à travers le naufrage du latin correct. Les Italiens ne souffrant que des voyelles finales, passèrent le niveau sur leurs terminaisons, qu’ils rendirent uniformes. Les premiers durent peut-être à ces vestiges de grammaire latine une priorité, une sorte de correction apparente, que seconda certainement la civilisation du pays et la puissance de la nation, mais qui retarda la formation définitive de leur langue et la maturité de leur littérature. Les seconds, restés plus latins, par l’intervention plus active de l’Église, par les conciles, par la théologie, par le droit romain, n’écrivirent pas l’italien dans une époque intermédiaire, ils ne furent pas précoces; mais leur langue devint plus vite une langue moderne.
Origines de l’italien littéraire; dialectes; primauté de la Toscane.
Le problème de la formation de la langue semble résolu; mais où a-t-elle pris naissance? Plus de vingt dialectes sont parlés et même écrits en Italie. Parmi ceux-ci, le sicilien, le vénitien, le milanais, ont toute une littérature. Ils sont nés dans des communes détachées les unes des autres, et cette absence d’un centre suffit peut-être à expliquer le retard de l’italien sur le français. Doit-on penser que la langue correcte, que l’italien littéraire, s’est formé par un choix, par un triage, en un mot, est né partout un peu, et nulle part entièrement? Doit-on croire qu’il existe dans les livres et dans l’usage des classes instruites, mais qu’en dehors de ces classes il n’est parlé réellement par aucune des populations qui vivent du pas de Suze au cap de Spartivento?
Ici se présentent encore deux écoles rivales, celle des Toscans et autres qui croient que la langue des écrivains est exactement l’idiome parlé dans l’heureuse vallée de l’Arno, et celle des critiques jaloux de ce privilége d’une population de un à deux millions d’hommes sur vingt-deux millions. La première de ces écoles croit que la Toscane a été pour l’Italie ce que la Castille a été pour l’Espagne, et l’Ile-de-France pour notre pays, le centre et le foyer de la langue pure et correcte. La seconde soutient que la langue italienne a son centre par toute la péninsule, et son foyer dans les écrits des classiques’; elle prétend que tous les dialectes qui se parlent en Italie ont fourni leur contingent à une langue commune qui est la langue écrite, comme il est arrivé pour les dialectes grecs dans l’antiquité. L’autre appose à cette prétention que les Attiques ont à peu près seuls créé la langue commune de la prose chez les Grecs, et que d’ailleurs les dialectes grecs ont chacun quelque domaine à part, et une grande littérature aussi pure que riche: qui pourrait en dire autant des patois de l’Italie?
Cette querelle qui occupe tant de place dans l’histoire de la littérature italienne commença dès qu’il y eut des chefs-d’œuvre et une vie littéraire hors des limites de la Toscane, à savoir, dès les premières années du xvie siècle. Jusque-là tous s’accordaient à dire que la langue littéraire avait commencé de paraître en Sicile, comme une étoile un peu pâle encore, que l’astre avait grandi en passant sur la savante Bologne, mais qu’il avait bientôt traversé l’Apennin et choisi sa place dans le ciel pur de la Toscane, que là enfin il s’était posé au-dessus de Florence, où il était devenu un soleil dont les rayons éclairaient la péninsule entière. Le livre de Vulgari eloquio ou de l’Éloquence vulgaire de Dante, fait seul exception à cette unanimité de trois siècles. Il ôte aux Florentins la primauté qu’il donnerait plutôt à Bologne, et veut que la langue illustre, la langue de cour, cortigiana, se soit formée de tous les dialectes, comme si une langue littéraire ne commençait pas toujours par être une langue parlée et vivante! Ce livre curieux est un pendant du de Monarchia; c’est le gibelinisme en littérature.
Aujourd’hui les droits de la Sicile à se dire le berceau de l’italien littéraire ne sont pris au sérieux que par les Siciliens. La patrie de Théocrite n’était plus au moyen âge que la province de Verrès, des Arabes, des Normands et de tous les aventuriers. L’italien de la poésie y était né en quelque sorte par hasard, à la suite de la cour d’un empereur italien. Bologne ne fonde ses prétentions que sur deux ou trois écrivains qui ont vécu en Toscane, qui y ont trouvé peut-être des leçons, et sur un texte paradoxal, contestable, du de Vulgari eloquio. Au contraire trois grands noms, les plus grands de la littérature italienne, deux siècles et demi de gloire littéraire, et des chefs-d’œuvre dans tous les genres, avaient fondé avant le xvie siècle et confirmé l’empire de Florence sur la langue.
Cependant une fois le xvie siècle inauguré, toute l’Italie prend part au banquet littéraire, et des voix hardies, ingrates peut-être, s’élèvent contre la Toscane, «semblables, suivant le mot de la Bruyère, à ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé, qui battent leur nourrice.» Castiglione, l’auteur du Courtisan, l’arbitre des élégances italiennes, fait usage du toscan le plus parfait et prétend au début de son livre qu’il écrit en dialecte lombard. Sperone, dont la pureté n’est pas moins exquise, feint de croire qu’il écrit dans le langage padouan; mais sa patavinité n’est pas moins imperceptible que celle dont un critique raffiné accusait Tite-Live. Muzio, qui n’est pas un médiocre écrivain et qui se prend sans façon pour un modèle, compose, s’il faut l’en croire, sa langue avec tous les dialectes. «Je choisis, dit-il, ce qu’il y a de plus pur ici, là et ailleurs, et je compose comme une salade d’herbes diverses et de diverses fleurs. On ne peut l’appeler ni persil, ni menthe, ni estragon, ni fleur de bourrache, ni buglose, ni romarin, étant composée de toutes ces choses; il faut dire que c’est un mélange. De même la langue commune à toutes les contrées d’Italie doit recevoir son nom de l’Italie entière, non d’une de ses parties.» Castelvetro, le Varron de l’Italie, suivant Gravina, venait à son tour à la rescousse contre l’usurpation prétendue de Florence, et Trissino fournissait un aliment aux disputes en publiant le de Vulgari eloquio qui paraissait pour la première fois après deux siècles d’oubli, sous la forme d’une traduction italienne.
Tous ces écrivains lombards tombaient dans cette erreur qu’une langue littéraire peut naître d’un choix artificiel et d’une convention. Ils avaient aussi un mépris extrême de la langue parlée, autre préjugé bien naturel à des hommes nés au milieu de patois qui n’avaient que des titres douteux à être appelés dialectes. Un seul fait suffisait pour les avertir de leur erreur. Tous les premiers grammairiens furent étrangers à la Toscane. Bembo, le plus illustre de tous, était de Venise. On ne devait sentir la nécessité des préceptes que là où l’on sentait la difficulté de les connaître, et la plupart des Italiens devaient faire cet aveu que Bembo met dans la bouche d’un Vénitien: «Les Florentins, sans fatigue, ont appris au berceau et dans leurs langes cette langue que nous autres apprenons péniblement des auteurs, quand nos os sont déjà durcis.»
De leur côté, les Florentins n’obéissaient pas moins que les Lombards aux préjugés de l’esprit municipal. Restreignant le privilége du bien dire dans les limites de leurs remparts, ou dans un rayon qui se prolongeait tout au plus jusqu’à Pistoie, ils soutenaient des principes qui, entendus à la rigueur, faisaient tomber la plume des mains de tous ceux qui écrivaient hors de ce cercle de Popilius où ils enfermaient la bonne langue. Ils ne voulaient pas que l’on dît langue italienne, pas même toscane, mais langue florentine. A la fin de ce siècle, ils étaient devenus exclusifs à ce point qu’ils déshonoraient de leurs chicanes une des gloires les plus brillantes de l’Italie, la Jérusalem délivrée.
Rien d’original et de nouveau dans le siècle suivant, si ce n’est la tentative de Celso Cittadini qui relève le drapeau de Sienne déjà illustré par Tolomei: ces Siennois ne veulent pas que l’on dise langue florentine ni langue italienne, mais langue toscane. Le jurisconsulte romain Gravina reprend la thèse de la langue commune ou langue illustre et littéraire de toute l’Italie. Mais les conclusions de sa Ragione poetica sont plus raisonnables, et il semble s’être combattu lui-même dans un dialogue latin demeuré inédit jusqu’à nos jours.
Muratori dans sa Perfetta poesia recommence le procès des Lombards contre l’empire absolu de Florence. A cette époque l’idée de l’unité morale de la nation commence à pénétrer de nouveau dans les écrits. L’illustre érudit de Modène veut que la langue italienne n’ait acquis sa perfection suprême qu’au xvie siècle, quand toute l’Italie a pris part au mouvement littéraire. Il y a du patriotisme dans sa doctrine, et il désire que l’Italie puisse réunir toutes ses forces pour lutter contre1ascendant de la France et de l’Angleterre. Mais il n’y en a pas moins dans la belle page où lui répondait le Florentin Salvini:
«Ne disputez pas sur le nom de la langue, d’un bien dont la possession fait notre gloire. Elle est toscane, mais sans cesser d’être italienne. Toscane, elle l’est par sa grammaire, par ses premiers et ses plus fameux écrivains, par son terroir, par son ciel, qui l’a mieux favorisée. Italienne, elle l’est par vous qui en avez les premiers écrit les règles et les préceptes, et qui continuez par vos nombreux et admirables ouvrages à la cultiver et à l’embellir. Vos dialectes natifs vous font citoyens de vos villes seulement; le dialecte toscan, appris, reçu, embrassé par vous, vous fait citoyens d’Italie. De particulier il devient, grâce à votre étude, la langue commune. L’Italie, de pays divisé qu’elle était en climats très-différents et en langues diverses et étranges, devient un pays non plus partagé en plusieurs cités et plusieurs maîtres, mais ne formant qu’une cité et ne parlant qu’une langue. Ce n’est pas peu pour arriver à être d’un seul esprit et d’un seul cœur et reprendre cette antique valeur qui dans les cœurs italiens n’est pas encore morte. Qui peut dire combien la communauté du langage établit d’affection réciproque, combien elle est un symbole et un gage d’amitié, de fraternité! Rendre cette unité de la langue, qui prépare l’unité des esprits, nécessaire au bien-être des hommes, des familles et des États, c’est votre affaire, lettrés et savants dont il a été, dont il est, dont il sera toujours si fécond ce pays, que l’Apennin partage, que la mer et les Alpes environnent.»
Les dernières discussions sur l’Académie de la Crusca, et sur la langue commune de l’Italie, sont un épisode important de la littérature italienne de notre siècle: nous y reviendrons. L’intérêt de la patrie aurait dû mettre obstacle à des divisions nouvelles entre Toscans et Lombards; mais comme il arrive d’ordinaire, la diversité d’opinions sur la meilleure manière de la servir produisit les différends. Le comte Perticari voulait «que l’Italie tout entière fût considérée comme la vraie patrie et comme la dépositaire de la langue parlée par tous les Italiens.» Mais quelle que fût l’excellence de ses intentions, son entreprise et celle du poëte Monti rallumèrent les vieilles discordes. Depuis deux siècles et demi, l’on ne se battait plus avec le fer, mais avec la plume. Tant il était malaisé d’entretenir l’étincelle sacrée de cette unité latente qui nous semble le secret de toute l’histoire de l’Italie et de sa littérature! «Effacez,» dit à ce propos l’un de ses plus éloquents critiques et de ses plus nobles citoyens, «effacez de votre cœur, non de votre mémoire, ces souvenirs dont la honte est salutaire! que l’expérience du passé vous rende sages dans l’avenir! sachez vous retenir vous-mêmes, quand le démon de la discorde vous empoigne par les cheveux, afin de vous jeter à la fin par terre épuisés, écumants! «