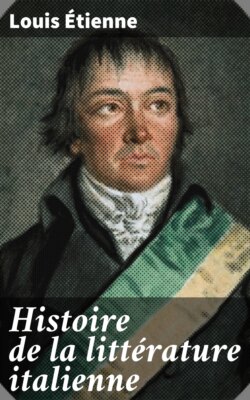Читать книгу Histoire de la littérature italienne - Louis Chastel Étienne - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Commencements de la poésie italienne; école sicilienne.–École bolonaise.–École ombrienne.–École toscane.
ОглавлениеTable des matières
Commencements de la poésie italienne; école sicilienne.
Toutes les littératures modernes ont commencé par où ont fini les littératures anciennes, par les chants d’amour et par les romans. On serait peut-être porté à croire que les premiers poëtes italiens, essayant de renouer la chaîne des temps, devaient revenir à Tibulle et à Properce, les classiques de l’amour chez leurs aïeux: il n’en est rien. La poésie italienne primitive est aussi éloignée de la poésie latine que l’italien l’est du latin littéraire. C’est ailleurs qu’il faut chercher la source des premiers vers qui ont jailli de l’idiome national.
Peut-être la réforme opérée par Grégoire VII, le pontife impérieux et sévère que les critiques protestants ont comparé à leur Martin Luther, avait-elle eu des résultats plus sérieux et plus prompts en Italie qu’en France et surtout que dans la Provence et dans le Languedoc; peut-être aussi la lutte entre les papes et les empereurs, entre les cités et les barons impériaux, avait-elle laissé trop peu de loisir pour amasser les richesses que suppose le goût des arts, et pour créer le besoin des jouissances de la paix. Toujours est-il que les Italiens se trouvaient fort en arrière des Provençaux. Ceux-ci, placés à égale distance du mouvement monarchique et religieux de la France du Nord et du chaos des communes italiennes, virent les premiers naître parmi eux une littérature profane dans une langue assez parfaite, la poésie épique et chevaleresque préférée dans les pays du nord, et la poésie lyrique, individuelle et libre, dont ces contrées plus féodales ne sentaient pas également le besoin. C’est le second de ces deux éléments que les Italiens se sont approprié. Les romans et la chevalerie traversèrent aussi les Alpes; mais dans ce pays, plus municipal que féodal, ils demeurent au second plan jusqu’à Arioste. La poésie lyrique, surtout amoureuse, voilà ce que les Italiens doivent aux Provençaux. Ils ne pouvaient demander aux poëtes élégiaques de Rome ni l’exemple de cet amour dégagé de la sensualité, ni cette exaltation de la femme qui purifie la passion et range parmi les genres littéraires les plus élevés les compositions où elle est célébrée. La France du Midi a l’honneur de l’initiative: elle a laissé aux Italiens celui de réaliser entièrement l’amour platonique dans les vers, de faire de cette apothéose de la femme un vrai culte, une sorte de religion, de porter enfin les chants amoureux au degré d’une grande et belle poésie. Il n’est pas nécessaire d’arriver jusqu’à Pétrarque pour vérifier ce jugement, et le perfectionnement dont nous parlons est déjà sensible chez les poëtes qui sont nommés dans ce chapitre.
La poésie provençale parut dans la péninsule à la suite des empereurs, qui, en vertu de leur vieux titre de rois d’Arles, conservaient sur la Provence une sorte de suzeraineté flottante et d’autorité périodique, semblable à celle qu’ils exerçaient en Italie. Frédéric Ier Barberousse fut suivi dans ce pays par plus d’un troubadour. Des troubadours furent accueillis dans les maisons des seigneurs, surtout du pays Lombard. Les marquis de Montferrat, les marquis d’Esté, les Malaspina, seigneurs de la Lunigiane, au nord de la Toscane, protégeaient et encourageaient ces poëtes qui payaient leurs largesses en éloges. A Vérone, à Trévise, non-seulement on se plaisait à entendre les beaux esprits provençaux, mais la langue française elle-même, au XIIIe siècle, était parlée de préférence par les châtelains de la Lombardie. Après les guerres de destruction connues sous le nom de croisades contre les Albigeois, la poésie provençale s’exila de la France méridionale, et les poëtes du gai savoir émigrèrent en Italie. Enfin des Italiens mêmes, laissant de côté leur langue qu’ils croyaient sans doute trop populaire pour être digne de se faire entendre dans les cours et dans les châteaux, se firent troubadours, hommes de cour, comme on disait alors, c’est-à-dire rimeurs et chevaliers tout ensemble, et apprirent à versifier en langue provençale, première condition requise de tous ceux qui voulaient ainsi vivre de leur talent, de leur esprit, et mener, sans patrimoine, la vie de chevalier et de seigneur. Sordello de Mantoue, l’un des personnages les plus remarquables de la Divine Comédie, est le plus illustre de ces Italiens qui se firent provençaux par la langue et le talent, comme par le genre de vie. Le poëte le représente altier, dédaigneux, «regardant à la manière d’un lion qui se repose.» A la rencontre de celui-ci avec Virgile, les deux Mantouans s’embrassent; c’est pour Dante un héros et un autre maître. On peut lire dans Fauriel le sirvente du cœur de Blacas, la plus originale de ses œuvres. Fier, mordant, satirique, Sordello eût été peut-être le plus digne devancier de l’auteur de la Divine Comédie, s’il ne s’était pas attaché à une langue, à une poésie, dont la dernière heure avait sonné.
Avec un certain fond d’amour raffiné sinon platonique, les Italiens empruntèrent aux Provençaux les formes mêmes de la poésie. Ne parlons pas de la rime; avec la perte de la prosodie, la rime devait naître nécessairement. Elle naquit en effet dans les hymnes de l’Église, par toute l’Europe à la fois, et il est inutile d’en aller chercher l’origine chez les Arabes, comme on le faisait au siècle dernier et au commencement du nôtre. L’imitation introduisit plutôt une image qu’une reproduction fidèle des chansons, des sonnets, des coblas, en italien cobbote, des ballades des Provençaux. L’oreille des Italiens, demeurée fidèle non-seulement au fait particulier de l’accent dans chaque mot latin, mais à la loi de l’accentuation latine, rejetait le port de voix sur la seconde et sur la troisième syllabe, à partir de la fin du mot, et, par suite, imposait aux vers d’autres lois. La sestina, espèce de ballade courte et très-compliquée, est à peu près la seule mesure qui de nom et de fait passe des troubadours aux poëtes italiens.
La Sicile a entendu les premiers vers italiens proprement dits. Ne croyons pas cependant que la langue poétique y soit née comme un fruit du terroir. Ce qui est vraiment sicilien, ce ne sont pas les vers italiens; ce n’est pas la poésie de cour, ni la langue illustre: c’est la chanson dialoguée de Ciullo d’Alcamo, qui remonte peut-être aux vingt dernières années du XIIe siècle. Ici la poésie est populaire et spontanée; le dialecte est tel ou à peu près qu’on le retrouve à six siècles de distance dans les écrits de Meli. Qu’on se rappelle l’Oaristys de Théocrite, qu’André Chénier a traduit en beaux vers antiques: voilà le sujet de cette idylle vénérable en ses grâces encore grossières. Madonna –madame, dans les poëtes italiens–Madonna qui n’est pas innocente de toute coquetterie, résiste aux prières, aux menaces de l’amant qui veut devenir son époux: celui-ci se plaint de son amoureux supplice, il parle de mourir. Il a d’ailleurs l’audace et les exigences des amours illégitimes: il ne craint pas les frères de sa maîtresse. Enfin la promesse du mariage et un bon serment sur l’Evangile mettent fin à la dispute. Le petit drame n’est pas mené, bien s’en faut, avec le talent spirituel de Théocrite; mais les strophes alternatives de l’amant et de l’amante forment un dialogue piquant.
La chanson de Ciullo appartient à un dialecte et elle est populaire; quoiqu’il y ait des dialogues de ce genre dans la poésie provençale, elle a sa marque particulière et son originalité. On peut compter encore parmi les poésies de cette classe, mais en langue italienne pure, une canzone par Odo delle Colonne, qui fleurit vers1245. C’est la plainte d’une amante abandonnée. Son dépit en se rappelant le doux parler, les ardentes promesses, l’image de beauté dont son cœur est trop rempli, est éloquent; les malédictions qu’elle prononce sur celle qui est peut-être la cause de cet abandon, ne le sont pas moins. Mais le fond et le cadre de cette petite pièce ne valent pas ceux de la chanson de Ciullo.
La vraie poésie italienne du XIIIe siècle est noblement galante, amoureuse, mais avec des formes conventionnelles, et dans un langage auquel le sentiment et la nature étaient parfaitement incapables d’initier. Les premiers éléments de cet amour raffiné furent empruntés des Provençaux avec les cadres mêmes des poésies; les Italiens en firent bientôt une science subtile et un art.
En effet, c’est en Provence et en Languedoc que l’on trouve pour la première fois ces effusions poétiques sur l’amour considéré comme principe de tout bien (Pierre Vidal), comme source du courage et de toute valeur. A ce foyer s’allument des feux que rien ne peut éteindre: «ni le vin ni l’eau ne les peut étouffer,» dit Arnaud de Mareuil. Toutes les souffrances sont pour Guillaume de Cabestaing, une joie, un plaisir, «parce qu’il sait que c’est Amour qui les envoie.» Qui a le premier enfermé dans des rimes sonores les antithèses de l’amour, de cet amour défini une pénitence sans faute, un don gracieux et un refus, une colère et une bienveillance, une douleur et une joie parfaite, une douceur et une amertume, etc.? Tout cela est dans le Roman de la Rose, dans les poëtes italiens, dans les troubadours, partout; mais quels sont les coryphées de ce chœur interminable, sinon les Provençaux? N’ont-ils pas dit avant les autres que la vue de leur dame est le seul adoucissement à leur éternel martyre? Qui enseigna aux rimeurs à comparer leur belle avec Biblis, avec Blanchefleur, avec Sémiramis, avec Thisbé, à frémir, comme la feuille agitée par le vent, en présence de l’idole, à trembler comme l’enfant devant la verge du maître? Et les protestations, et les vœux, et les clefs du cœur, et la guerre des yeux, et le procès fait aux miroirs, et tant de jolies subtilités, que dire de tout cela, si ce n’est que les troubadours en ont légué l’héritage aux Italiens et que ceux-ci ont agrandi et changé ce fond assez mince, le seul presque qui fût à l’usage de leurs devanciers, et l’ont rendu tellement italien, qu’ils s’y sont tenus plus qu’à tout autre genre de poésie?
Bien que l’amour soit, comme le printemps, un recommencement éternel, pour fournir à tant de redites il fallait cependant quelque nouveauté. Ce rajeunissement ils l’ont demandé à la philosophie, ce qui ne doit pas trop surprendre en Italie. Les troubadours ne sont pas ignorants; ils ont lu; ils ne manquent ni de courtoisie, ni de délicatesse; ils mêlent aussi quelquefois le sacré et le profane. Mais ils sont des hommes de cour et de chevalerie plutôt que de magistrature et d’université; ils sont hardis, sensuels dans leur langage; ils ne sanctifient pas leur chimère, et leurs accents n’ont rien d’éthéré. Les poëtes italiens sont des docteurs, des juges, des hommes d’État considérables dans leurs petites républiques, des dignitaires de l’Église. Ils connaissent Aristote; ils professent un platonisme chrétien; ils prétendent par l’amour de la créature s’élever jusqu’au Créateur; ils poursuivent l’idéal d’une passion mondaine épurée par les scrupules de la religion.
La poésie amoureuse en langue poétique et illustre commença à la cour d’un prince qui en fit lui-même; Frédéric II est comme le parrain de la langue italienne et il a dit, à ce qu’on assure, que l’italien était propre à l’expression de l’amour et pas à autre chose. Une autre remarque à faire c’est qu’il savait toutes les langues de son temps, et qu’il ne connaissait pas moins les Arabes, les Grecs et les Français que les Italiens et les Allemands. La poésie italienne proprement dite est née sous un prince polyglotte. Son mot sur la langue est loin d’être juste, mais il a porté malheur à la poésie de ce pays. Frédéric était né à Iesi dans la marche d’Ancône, au centre de la péninsule, d’une mère italienne; il fut pupille et filleul d’un pape, lui qui devait être l’ennemi le plus irréconciliable des papes; il vécut longtemps à Palerme et à Naples, et fit des vers dans les intervalles de ses guerres contre ses sujets révoltés. Telle était la destinée de la poésie italienne, au milieu des réalités sanglantes, de chanter un amour idéal qui est à peine de ce monde.
Il suffit à la gloire de Frédéric II d’avoir réuni autour de lui les premiers poëtes qu’ait possédés l’Italie, et de leur avoir donné l’exemple: peu importe que ses vers soient parmi les plus médiocres de cette époque primitive. Son secrétaire et ministre, Pier delle Vigne, et son fils Enzo, roi de Sardaigne, firent mieux. Le ministre doit sa célébrité moins à la perfection relative de sa langue et à la noblesse de quelques détails qu’aux mélancoliques paroles que Dante fait sortir de l’arbre où il emprisonne son âme au cercle des suicides.
«Je suis celui qui tint les deux clefs du cœur de Frédéric, et qui les tourna si douces et pour fermer et pour ouvrir.»
«Que j’écartai presque tout autre de sa confiance; et„ j’apportai tant de foi à ce glorieux office, que j’en perdis le sommeil et la vie.»
«La courtisane qui n’a jamais détourné du palais de César ses yeux effrontés, peste commune et vice des cours (l’Envie),»
«Enflamma contre moi tous les esprits, et ils enflammèrent tellement à leur tour Auguste, que mes joyeux honneurs se changèrent en triste deuil.»
«Mon âme, dans un désir emporté, croyant par la mort fuir l’emportement, me rendit injuste contre moi-même qui étais si juste.»
«Par les racines récentes de ce bois, je vous jure que • jamais je ne manquai de foi à mon maître, qui fut si digne d’être honoré.»
«Et si l’un de vous retourne au monde, relevez ma mémoire, qui gît encore sous le coup que l’Envie lui a porté.»
S’il est vrai, comme on le rapporte, qu’il fut accusé de trahison envers son maître par l’époux de la belle Florimonde qu’il avait célébrée dans ses remarquables canzoni, l’amour idéal des poëtes fut l’objet du soupçon dès l’origine de cette poésie. Si au contraire cette histoire est une fiction, elle serait le premier des nombreux romans qui ont pris naissance dans les vers amoureux de l’Italie.
Le fils de Frédéric II a mérité, comme son ministre, les éloges et les critiques. Pier delle Vigne avait étudié dans l’Université de Bologne; Enzo vécut de longues années captif dans la même ville, et y mourut. Aussi brave capitaine qu’il était bon poëte, après avoir soumis la Sardaigne à son père et fait une guerre ardente au souverain pontife, il fut battu et pris à Fossalta par les Bolonais, qui, en leur qualité de Guelfes, tenaient pour le pape. Ce fut un grand spectacle pour ces républicains qui avaient pour devise le nom de libertas, que le défilé de tous les seigneurs faits prisonniers dans ce combat, et surtout de ce roi de vingt-cinq ans, jusque-là vainqueur, «qui l’emportait, disent les historiens, par sa beauté et la noblesse de son maintien, sur tous les hommes de son temps.» L’orgueil bolonais, exalté par cette victoire, rappelle encore aujourd’hui dans l’église de San Domenico, où ce prince fut enseveli, que ni les promesses, ni les menaces de l’empereur ne purent fléchir les citoyens vainqueurs, et qu’il mourut dans sa prison au bout de vingt et un ans, neuf mois et vingt jours (1272).
On est ému en lisant les vers suivants d’Enzo; mais sont-ils éclos dans la prison? et leur tristesse est-elle la tristesse du captif ou celle de l’amoureux?
«Telle est la peine douloureuse qui m’abonde dans le cœur, et se répand par mes membres, en sorte que chacun en a trop grande part. Je n’ai pas un jour de repos, comme la vague dans la mer. Mon cœur, pourquoi ne t’arraches-tu pas? Sors de peine et te sépare ’de mon corps; car de beaucoup il vaut mieux mourir une heure que toujours souffrir.»
Enzo ne ressemble pas seulement à Charles d’Orléans par sa destinée; comme le captif de Londres, celui de Bologne ne songe qu’à son amour et ne parle que de sa dame. S’il n’a pas la même grâce dans sa mélancolie, et la même variété dans son thème invariable, il faut songer que ses canzoni un peu lourdes, plus vieilles de deux cents ans, sont au début même de la langue et de la poésie italiennes.
La recherche commence de bonne heure chez ces poëtes; ils l’ont imitée des troubadours avec le reste. Dans Inghilfredi, l’amant est dans le feu comme la salamandre, il oublie son mal à la vue de sa dame, comme la tigresse oublie ses petits dans le miroir que le chasseur qui fuit a jeté sur son chemin. Guido delle Colonne s’estime heureux de mourir au service de la sienne, comme l’assassin brave les supplices pour accomplir les ordres du Vieux de la Montagne, et il la compare, en dix-neuf vers galants et pédantesques, au vase qui contient l’eau sur le feu. La pierre d’aimant, la licorne, le basilic, le parfum prétendu de la panthère, les sirènes, les pierreries, jouent un grand rôle dans ces préciosités où les Siciliens rivalisent avec les Provençaux. Dante, en nous disant comment il a entendu la poésie d’amour, a condamné cette seconde époque de l’école sicilienne, et particulièrement Jacopo da Lentino, qu’on appelait le Notaire, le plus habile, le plus connu et aussi le plus raffiné de tous. Il se fait dire par Bonaggiunta, un autre poëte que nous allons rencontrer:
«Ofrère, je vois maintenant le nœud qui nous a arrêtés, le Notaire, Guittone et moi, loin de ce doux et nouveau style qui m’est révélé.
«Je vois comme vos plumes suivent fidèlement celui qui dicte si bien (l’Amour); certes, il n’en fut pas ainsi des nôtres.»
«Et celui qui, pour plaire davantage, sort de ce style, ne voit plus combien il s’en écarte.»
Toute la science et tout l’esprit de Jacopo le Notaire n’aboutissaient qu’à faire tomber la poésie dans le prosaïsme; voilà ce que veut dire le grand poëte. Aussi croyait-il que l’amour noble et relevé était la source des vers sublimes. C’est un idéal auquel les Siciliens ne sont pas parvenus. C’est pourquoi il en est d’eux comme des Provençaux: ils se ressemblent tous; aucun nom ne s’élève beaucoup au-dessus des autres. C’est une poésie qui aurait pu rester anonyme. Joignons à la strophe que nous avons traduite du roi Enzo, un autre échantillon poétique d’un ton presque populaire, un extrait d’une jolie canzone de Rinaldo d’Aquino, personnage fort indéterminé, qui fut ou simplement un poëte, ou un évêque de Martorano (1255), ou un vice-roi d’Otrante et de Bari (1257). Il fait parler la maîtresse d’un croisé: est-ce une imitation directe ou éloignée de la chanson énergique et vraiment brûlante de la dame de Fayeel?
«Dieu saint, trois fois saint, qui naquis de la Vierge, sauve et garde mon amour, puisque tu l’as séparé de moi. 0souveraine puissance crainte et redoutée, que mon doux amour te soit recommandé!»
«La croix sauve les hommes, et me perd. La croix fait ma douleur, et il ne me sert de prier. Hélas! croix précieuse, pourquoi m’as-tu anéantie? Hélas! pauvre et misérable que je suis, et quel feu me consume entière!»
«L’empereur maintient le monde dans la paix, et il me fait la guerre en m’ôtant toute mon espérance. 0souveraine puissance, crainte et redoutée, que mon doux amour te soit recommandé!»
Il est resté aux Siciliens l’honneur d’avoir pris l’initiative et donné leur nom à la langue poétique naissante. Quoiqu’ils n’aient pas écrit dans le dialecte populaire dont s’est servi le vieux Ciullo d’Alcamo, ils ont quelques mots siciliens, surtout des terminaisons siciliennes, comme dans la pièce qui précède: amoruso pour amoroso. De plus, leur veine s’est vite tarie, et Pétrarque a pu dire dans ses Triomphes: «Les Siciliens, qui furent les premiers, et qui maintenant étaient les derniers.»
École bolonaise.
On peut trouver de jolis vers dans les précédents, par exemple celui-ci, de Rinaldo d’Aquino: «Les oiseaux, qui font si douces leurs chansons.» L’école bolonaise a produit les premiers beaux vers de la langue italienne, et cette école se compose, pour ainsi dire, d’un nom, Guido Guinicelli. Il semble que les vers gracieux, pittoresques ou touchants, puissent naître partout où il y a des cœurs humains et une imagination créatrice; mais que les vers vraiment beaux soient comme ces fruits auxquels il faut des conditions nombreuses de sol, de climat et de température pour mûrir.
Bologne, suivant une description très-intéressante de Pétrarque, était, de toutes les cités italiennes, la plus libre et la plus heureuse Il n’y avait pas d’université qui pût s’enorgueillir d’un tel peuple d’étudiants, d’un si bel ordre dans ses études, d’une telle majesté dans son corps enseignant. Le jeune Pétrarque s’imaginait y voir les vieux jurisconsultes romains revenus à la vie pour enseigner le droit. Ces professeurs étaient des poëtes aussi; tel était cet Onesto Bolognese, dont nous avons, entre autres œuvres, trois sonnets sur l’ambition, sur la justice et sur l’immortalité de l’âme. C’était encore l’âge d’or ou à peu près de ces petites républiques italiennes toujours en guerre, toujours se déchirant elles-mêmes. Pétrarque raconte que dans ses parties de plaisir avec ses compagnons, il revenait souvent à la nuit et trouvait les portes de la ville toutes grandes ouvertes. Et si, par hasard, elles étaient fermées, la ville n’en était pas mieux close: une mauvaise palissade de bois qui tombait de vétusté était un rempart aisément franchi par des étudiants attardés. Elle prouvait, sinon la rigueur de la discipline universitaire, du moins la paix profonde dont jouissait la vénérable cité des vieux Boïens. «Ce n’était pas une porte que nous trouvions, dit Pétrarque, c’étaient cent portes.» Et l’amant de Laure, faisant un triste retour sur le temps présent, sur les plaies saignantes de la discorde, de la tyrannie, des déchirements perpétuels, s’écrie qu’il n’en peut croire ses yeux. «Depuis bien des années, la paix a fait place à la guerre, la liberté à la servitude, la richesse à la misère; au lieu de la joie nous voyons le deuil; au lieu des chants, les pleurs; au lieu des danses des jeunes filles, les bandes de brigands.»
Ce sont ces chants, ces danses de jeunes filles qui marquent l’époque poétique de Bologne. L’heureuse saison des vers n’a pas duré dans la ville universitaire; quelques noms seulement ont surnagé. Un seul nom est parvenu entouré de quelques rayons de gloire; il est le plus brillant de cette époque.
Guido Guinicelli doit une part de sa renommée à Dante, qui dit, au chant XXVIe du Purgatoire: «Guido mon père, et supérieur à tous les autres de mon paysqui ont écrit des rimes d’amour douces et gracieuses;» et bientôt après, en réponse à l’âme du poëte: «Vos douces rimes, tant que durera le langage moderne, rendront bien chers vos écrits.» Malheureusement, les copistes, en défigurant les vers de Guinicelli, ont presque empêché ce présage de s’accomplir. Tout au plus est-il possible d’y reconnaître la main du grand artiste dans de belles strophes, comme dans quelque marbre brisé de Phidias.
Voici trois stances amoureuses où l’on trouve ces grandes images, ces nobles sentiments auxquels ni les Siciliens, ni les troubadours ne nous ont accoutumés:
«L’amour s’abrite toujours en noble cœur, comme l’oiseau bocager dans le feuillage. La nature ne créa point l’amour avant noble cœur, ni noble cœur avant l’amour. Dès que le soleil fut, la lumière éclatante fut aussi, et elle ne fut pas avant le soleil. Amour prend naissance dans noblesse, absolument comme la chaleur dans la clarté du feu.»
«Flamme d’amour s’éprend en noble cœur, comme dans la pierre précieuse sa vertu particulière; car cette vertu ne descend pas de l’étoile avant que le soleil n’ait purifié la pierre. C’est quand le soleil en a retiré ce qu’elle avait encore de vil, que l’étoile donne à la pierre sa valeur. Ainsi du cœur, qui de sa nature est simple, noble et pur: la dame, comme une étoile, lui communique l’amour.»
«Dame, que prétends-tu? dira Dieu à mon âmee, quand elle sera devant lui. Tu traverses les cieux, tu viens jusqu’à moi; et cependant ton vain amour m’a échangé contre une créature faite à mon image. C’est à moi qu’appartient la louange, et à la Reine de cet empire où cesse toute fraude. Je lui pourrai répondre: Elle avait l’apparence d’un ange qui venait de ton royaume. Que je ne sois pas estimé coupable pour avoir mis mon amour en elle!»
Ce ne sont pas là des idées provençales, suivant l’expression de Fauriel; ce n’est pas de l’amour chevaleresque, à proprement parler. L’Université de Bologne n’enseignait certainement pas une métaphysique plus savante que les vers de Guinicelli; c’est la doctrine qui florissait alors, fortement imprégnée de théologie et de souvenirs des Pères de l’Église. Guinicelli est le premier des poëtes qui ont littéralement divinisé la femme. Comme Dieu est le soleil des âmes dans tous les Pères, la dame de Guinicelli est un soleil qui anime, qui réjouit tout autour d’elle. Comme saint Augustin fait descendre la beauté ineffable de Dieu sur les objets terrestres pour les embellir, la beauté chantée par Guinicelli ennoblit les pensées de ceux qui la voient.
La théorie de la grâce est transportée tout entière en cette matière profane. L’amant ne peut grandir, être noble et vertueux, que par l’influence supérieure de l’amante; ce ne sont pas ses mérites, ni ses œuvres qui ont attiré sur lui le divin rayon, mais une secrète disposition de son âme que la divine idole a su découvrir. Celui pour qui il n’est point de secret, reconnaît «une perle dans la fange, et choisissant l’homme qui a la noblesse de la volonté, lui accorde sa grâce et le joint à ses élus.» Ainsi s’exprime saint Jean Chrysostome. Amour fait son séjour d’un noble cœur qu’il distingue comme du diamant dans le minerai de fer. Le soleil frappe la fange toute la journée, mais elle demeure vile; l’homme altier dit: Je suis noble par ma race; il ressemble à la fange, et la noblesse au soleil. Ainsi s’exprime Guinicelli, et Dante qui est de son école a développé ce texte dans une belle canzone.
Guinicelli n’est pas seulement métaphysicien et théologien en vers; il est savant et varié; il est élevé, plein d’expressions vigoureuses, suivant Laurent de Médicis, qui vivait un siècle après Dante. Guinicelli fut le premier sous la main duquel la langue italienne prit un coloris poétique, fù dolcemente colorita. Mais il était obscur même pour ses contemporains. Un poëte de ce pays sensé et positif de Toscane, Bonaggiunta Urbiciani de Lucques, le lui faisait bien comprendre, dans le sonnet suivant:
«Ovous qui, pour éclipser tous les autres troubadours, avez changé la première manière, l’ancienne forme des plaisants dires d’amour.»
«Vous avez fait comme la lumière qui dissipe l’obscurité à distance, mais qui ne se laisse point regarder elle-même.»
«Vous surpassez tout le monde en subtilité et en savoir, mais votre langage est si obscur, qu’à peine se trouve-t-il quelqu’un qui le comprenne.»
On ne sait rien de la vie de Guinicelli, si ce n’est qu’il était de la famille très-noble des Principi de Bologne, qu’il suivit le parti des Gibelins de son pays, et qu’il fut exilé deux ans avant sa mort (1274). Soit que le platonisme raffiné des poëtes italiens ait éveillé la curiosité publique sur leur vie privée, soit qu’ils fussent des modèles prédestinés de l’inconséquence humaine, leur vie ressembla peu à leurs vers: Guinicelli, le premier de tous, expie dans le Purgatoire de Dante le péché de sensualité.
École ombrienne.
Si les rimesd’amour profane étaient remplies de théologie et de métaphysique, combien il était plus naturel que l’Italie mêlât des hymnes religieux à la poésie lyrique, et les effusions de l’amour divin à celles de la passion humaine? Car il est remarquable que dans cette Italie du moyen âge toute remplie de haines et de vengeances, on ne parle pour ainsi dire que d’amour. Il n’est que trop vrai que la poésie est bien souvent une trêve, un repos, un passe-temps, plutôt qu’un champ pour les passions. Il l’est également qu’un seul aspect de l’état social d’un peuple, fût-il l’aspect le plus saillant et le plus général, ne fait pas connaître la vraie physionomie de sa littérature. D’ailleurs l’Italie d’alors était pleine de contrastes, et l’on trouvait, au milieu de guerres perpétuelles et de dangers toujours renaissants, toute l’activité des arts de la paix, un commerce qui s’étendait à toute l’Europe, une richesse qui paraît quelquefois inépuisable.
L’Italie ne chantait donc que l’amour, et l’amour divin eut aussi ses interprètes. On ne sera pas surpris qu’ils soient nés dans des populations agrestes et pleines de foi, dans ces vallées de l’Apennin, préservées par la pauvreté, par le travail, autant que par les montagnes. Tandis que les dominicains se réservaient la science et pratiquaient les langues savantes, les franciscains, époux de la pauvreté, comme leur fondateur, se mêlaient au peuple, parlaient son langage sans prétention et même sans choix, et contribuaient par leur prédication populaire à généraliser par toute la péninsule l’usage de la langue nationale.
Saint François fut-il poëte? Son Cantique au soleil n’est pas rimé; il n’est pas même versifié, comme le voudrait Crescimbeni qui a tant ajouté et tant effacé dans le texte, sous ombre de correction, que, suivant l’expression d’un autre critique, avec cette méthode, les discours de Démosthène se transformeraient en odes d’Anacréon. Ce ne sont pas même des vers saturniens, les vers grossiers dont parle Horace, mais des versets à l’imitation des psaumes avec des assonances. L’assonance qui est une rime imparfaite devait plaire et suffire à des oreilles dont toute l’éducation se bornait aux chants de l’Eglise. Le Cantique au soleil ressemblait à un chant de Moïse, d’Habacuc ou de Débora.
«Très-haut, très-puissant, bon Seigneur ; à toi les louanges, la gloire, l’honneur et toute bénédiction.
A toi seul tout cela convient; à nul homme n’appartient de te nommer.
Loué sois-tu, ô Dieu du ciel et de la terre, pour toutes les créatures, pour messire le Soleil notre frère,
Qui nous apporte le jour et nous éclaire; il est beau et rayonnant de splendeur, et de toi, Seigneur, il est le signe et l’image.
Loué sois-tu, ô mon Seigneur, pour notre sœur la Lune, pour les étoiles et leur clarté; c’est toi qui les créant dans le ciel leur as donné la beauté.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour nos frères le vent, l’air, les nuées, le serein et toute température; par eux tu entretiens les créatures....»
On pense bien que «ce frère le Soleil» et «cette sœur la Lune» paraissaient dès ce temps-là (1184-1226) être fort au-dessous de la noblesse poétique et du cérémonial amoureux. C’était la poésie naïve des montagnes de l’Ombrie: elle n’était pas née dans la mollesse et la douceur de la vie des villes et des cours; mais elle avait senti la bise pénétrante et le soleil ardent qui règnent tour à tour dans cette contrée, et dont l’auteur de la Divine Comédie s’est souvenu.
On peut s’assurer par l’Hymne de la pauvreté, que saint François ne chantait pas son amour pour cette vertu qu’il appelait sa dame, avec moins de passion que les poëtes n’en mettaient dans leurs poésies amoureuses. Entre ses œuvres plus ou moins retouchées et arrangées en mesure et en rimes, il n’en est pas de plus ardente que le Cantique de l’amour de Jésus. «L’amour m’a mis dans la fournaise..., etc..»
Est-il temps, comme l’a dit Ozanam, de rendre à un autre religieux, à Jacopone da Todi, sa place au berceau de la poésie italienne? Est-il le poëte théologique, le poëte satirique, devancier de Dante, qui a ouvert sa voie à l’auteur de la Divine Comédie? La théologie et la satire devaient donner à l’Italie un grand écrivain, mais aucun avant Dante. Jacopone, devenu moine franciscain après avoir été avocat, embrassa la sublime folie du renoncement et de la pauvreté. Il voulut souffrir, il voulut aimer jusqu’à paraître avoir perdu le sens. Les enfants le poursuivaient dans les rues; ses confrères en religion le traitèrent en insensé. Des pages surprenantes, écrites par lui ou sous sa dictée, respirent encore l’enthousiaste ferveur avec laquelle il demandait à Dieu, non la mort paisible et chrétienne, mais les supplices et les douleurs de l’enfer, pour satisfaire à la justice divine et payer la rançon des crimes des hommes. Analogie bien imprévue, Jacopone da Todi invoque la colère divine, comme le stoïcien Caton dans la Pharsale appelle sur sa tête tout le fardeau de l’expiation et demande aux dieux ou plutôt à la fatalité, d’épuiser sur lui les supplices, afin de racheter Rome. Un même rayon de beauté morale brille sur les vers du poëte et sur les pages du moine; mais quelle disproportion dans la langue et dans le talent! Plusieurs des canzoni du franciscain contiennent des invectives contre le pape Boniface VIII et la description de la prison où il fut jeté. On rapporte que le pape, en passant devant son cachot, lui cria: «Quand en sortiras-tu?» et que le moine lui répondit: «Quand tu y entreras?» En effet Boniface VIII fut quelque temps captif. Il est douteux que Dante ait eu, comme on l’a dit, une entrevue avec le roi de France, Philippe le Bel, et par conséquent qu’il ait pu lui parler de ce moine persécuté qui avait un renom de sainteté dans l’Ombrie agricole et industrieuse.
Mais si Jacopone da Todi n’est pas un devancier de Dante, ni un théologien ou un satirique vraiment poëte, il ne faut pas tomber dans l’excès de sévérité du trop académique Perticari, qui en fait presque un bouffon, un Zanni portant la robe de saint François. Ses canzoni sont parsemées de traits charmants, comme celui-ci à la Vierge:
«Une pensée me naît dans l’esprit, et c’est de savoir comment ton cœur n’éclata pas de plaisir, quand toi, la simple fille, tu entendis le Dieu éternel, quand toi, l’humble servante, tu entendis le souverain Maître t’appeler tendrement du nom de mère. Car à cette pensée seulement, le cœur manque à celui qui a quelque douce étincelle de l’amour qui me consume.» Voilà, pour ainsi dire, la vraie poésie ombrienne, celle qui a précédé et nourri l’imagination d’un Pérugin, non pas seulement le Pérugin des saints décharnés d’une Thébaïde, mais celui qui a précédé Raphaël et l’idéal grec, celui dont le pinceau n’a connu que la nature dans. ses réalités pures, extatiques et plus souvent souriantes. Jacopone da Todi mourut en1306.