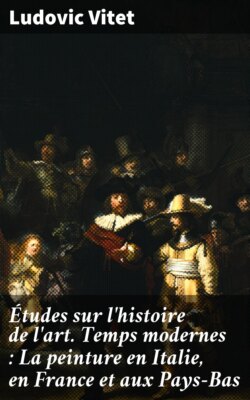Читать книгу Études sur l'histoire de l'art. Temps modernes : La peinture en Italie, en France et aux Pays-Bas - Ludovic Vitet - Страница 10
IV
ОглавлениеPour être clair, il faudrait remonter bien haut; mais ce n’est ici ni le lieu ni le moment d’aborder les origines de la peinture italienne et d’entrer dans le récit de ses longues vicissitudes. Qu’il nous suffise d’indiquer comment se forma, comment grandit, et à quelle mission était destinée l’école qui avait déjà le Pérugin pour chef, lorsque Raphaël vit le jour.
Cet usage de diviser et d’enregistrer par écoles la peinture italienne a été, comme on sait, pris au grand sérieux par les uns et traité par d’autres de classification arbitraire. C’est surtout l’existence d’une école romaine qu’on a le pins souvent et le plus vivement contestée, soit parce qu’aucun des peintres réunis dans cette école, sauf Jules Romain peut-être, n’est, à proprement parler, né à Rome, soit parce que ni le style, ni la couleur, ni aucun autre caractère, ne les distinguent suffisamment des autres peintres d’Italie et même de leurs plus proches voisins, les Florentins.
Nous n’attachons, pour notre part, qu’une médiocre importance à ces divisions géographiques, souvent vides de sens; mais si nous sommes tenté de faire une exception, c’est, quoi qu’on en puisse dire à Florence, pour soutenir qu’une école romaine a réellement existé. Expliquons-nous pourtant. Nous ne désignons pas par là, comme on le fait communément, ce groupe de peintres sortis de l’atelier de Raphaël, famille indisciplinée qui se disperse et s’évanouit aussitôt. Si c’est là ce qu’on entend par l’école romaine, nous nous réunissons à ceux qui ne veulent pas la reconnaître. Pour nous, il n’y a point d’école sans discipline et sans foi. Mais qu’avant Raphaël il se fût dès longtemps formé, sinon dans les murs de Rome, du moins dans son voisinage et sur le territoire du saint-siége, une agrégation de peintres procédant avec une évidente conformité de méthode et de but, et se distinguant, d’une manière profonde et tranchée, de tout ce qui les entourait, notamment des Florentins, c’est là pour nous une vérité hors de doute, et les recherches de la critique moderne nous en auraient, au besoin, démontré l’évidence. Seulement, pour éviter toute équivoque, cette école romaine ainsi comprise a dû être débaptisée; et comme les peintres qui en ont fait partie habitaient pour la plupart Assise, Fabriano, Pérouse, Foligno, Urbin et autres villes situées sur les confins ou au sein même de la petite province et du groupe de montagnes qu’on appelle l’Ombrie, l’usage a prévalu de désigner ces peintres sous le nom d’école ombrienne.
Peut-on déterminer l’époque où cette aggrégation prit naissance? Dès le treizième siècle, au temps de Cimabuë, il y avait à Pérouse des peintres en renom, et Dante parle d’Oderigi, né à Agobbio, petit bourg voisin de Pérouse, presque comme s’il parlait de Giotto lui-même:
..... Non se’ tu Oderigi
L’onor d’Agobbio e l’onor di quell’ arte.....
On pourrait donc attribuer à cette école une longue généalogie, mais à quoi bon? Elle n’a vraiment commencé que le jour où elle s’est frayé une route à part, c’est-à-dire un peu avant la moitié du quinzième siècle. Jusque-là, la peinture étant partout exclusivement religieuse et mystique, il n’existait réellement dans toute l’Italie qu’une seule école, et les peintres ombriens s’y confondaient comme tous les autres. Quelques hommes supérieurs pouvaient bien, même alors, imprimer à leurs œuvres un cachet d’individualité ; mais la peinture proprement dite ne consistait qu’en un procédé presque uniforme, destiné à reproduire des types consacrés.
Du moment où parut Masaccio, tout fut changé. De cette chapelle de l’église des Carmes où s’était manifesté son génie allait sortir une véritable révolution. Non-seulement Masaccio avait regardé la nature, non-seulement il l’avait rendue du premier coup avec une fidélité et un bonheur dont les plus grands artistes, près d’un siècle plus tard, sont venus, dans cette chapelle, étudier le secret, mais il l’avait regardée d’un œil purement humain, et, en la traduisant sans idéal, il avait sécularisé la peinture. De ce jour, l’art italien fut coupé en deux: deux tendances, deux doctrines, deux écoles véritablement opposées se disputèrent son domaine, et l’admiration des hommes se partagea entre la pureté angélique de Jean de Fiesole et la vérité humaine de Masaccio.
Si nous ne voulions pas être bref avant tout, si nous pouvions ne rien omettre, il nous faudrait chercher près d’un siècle auparavant les premiers germes de cette révolution. Giotto, ce grand novateur, ne s’était pas contenté, comme son maître, de peindre des madones et des crucifix. En se lançant avec prédilection dans les légendes, en se hasardant même à faire des portraits, il avait ouvert et frayé lui-même la voie qui se détourne de l’idéal; mais comme dans cette route on ne le suivit qu’en tâtonnant, comme le mouvement de son siècle resta malgré son influence, purement religieux et mystique, il nous est bien permis de ne constater le mouvement nouveau que lorsqu’il se produit et se manifeste au grand jour, lorsqu’il est compris de tous, lorsque sur les traces de Masaccio s’élance la foule des imitateurs.
On venait donc d’apprendre à Florence qu’en s’inspirant de la seule nature, sans ravir les âmes au ciel, sans sainteté, sans extase, par la seule représentation fidèle et animée des choses de ce monde, et surtout de la vie et de la pensée humaine, la peinture avait la puissance de charmer les hommes et d’exciter leur enthousiasme. Cette découverte une fois connue, il était impossible d’en modérer l’usage: l’abus devait s’ensuivre; il ne se fit pas attendre.
Masaccio avait traduit la nature en artiste, c’est-à-dire en se l’assimilant plutôt qu’en la copiant, en saisissant ses beaux aspects plutôt que ses trivialités et ses misères. C’était un laïque et un prosateur, mais un laïque croyant en Dieu, un prosateur croyant à la poésie. Lorsqu’en 1443 la mort vint le frapper à la fleur de l’âge et du génie, par qui fut-il remplacé ? qui devint l’héritier, sinon de sa gloire, au moins de son école et presque de sa renommée? Un moine perdu de mœurs, vrai mécréant, enlevant et débauchant les nonnes pour s’en faire des modèles, homme d’énergie et peintre habile, mais trivial et maniéré. Ainsi, née de la veille, l’école de la réalité tombait déjà dans les mains de Lippi, de la hauteur où l’avait placée Masaccio. Mais, tel était le penchant des esprits vers cette nouveauté, que, tout en dégénérant, elle n’en voyait pas moins croître sa vogue et sa fortune. On a peine à comprendre comment ce public de Florence, qui venait d’accueillir avec transport et comme une révélation du génie, le style à la fois noble et vrai de la chapelle des Carmes se mit à battre des mains presque aussi chaudement aux types vulgaires de Lippi; comment il put souffrir que, pendant près d’un demi-siècle, on n’offrît à son admiration que ces femmes aux formes matérielles, aux nez arrondis, aux joues pesantes, ces chérubins espiègles, frisés et grimaçants, qui n’ont des anges que quelques bouts de plume aux épaules. Certes, il y a chez Lippi, comme chez son fils Filippino, et même chez Boticcelli et tant d’autres qui ont adopté et outré sa manière, de grandes qualités de peintres, un éclat de couleur souvent digne de la Flandre et de Venise, des fonds de paysages pleins de charme, des draperies vigoureusement rendues, quoique brisées et tourmentées à l’excès; mais cette soi-disant reproduction de la nature n’en est à vrai dire, qu’une injurieuse contrefaçon.
Telle fut pourtant la peinture que Masaccio, en sortant des voies battues, légua, sans s’en douter, à sa patrie. Jusqu’à la fin du quinzième siècle, jusqu’à la première apparition des merveilles de Léonard, toute la vivacité de l’esprit florentin, toute la munificence des Médicis furent dépensées à faire fleurir cette décadence anticipée. Un seul, parmi ces réalistes, Dominique Ghirlandaïo, fit de vaillants efforts pour se rattacher à Masaccio, et eut parfois la gloire de retrouver la tradition perdue; mais presque tous les autres, abaissant l’art devant le métier, n’hésitèrent pas à prendre pour modèles les triviales productions de Martin Schœn et tous ces prosaïques chefs-d’œuvre d’outre-Meuse et d’outre-Rhin, qui, depuis l’invention récente de la gravure envahissaient l’Italie. A voir le caprice du goût, l’oubli du style, l’abaissement des types, on eût dit qu’une colonie flamande était venue camper sur l’Arno, et avait pris dans la ville de Giotto et de Masaccio le monopole de l’art de peindre.
Qu’était devenue pendant ce temps cette ancienne peinture italienne, qui, les regards tournés au ciel, sachant à peine ce qui se passait sur terre, semblait n’être en ce monde que pour parler aux hommes des choses divines, pour faire comprendre et entrevoir, même à ceux qui ne savaient pas lire, la gloire de Dieu, le bonheur des séraphins, les joies de l’infini? Elle s’était réfugiée dans les cloîtres. Son plus éloquent, son incomparable interprète, fra Beato-Angelico, après avoir acquis, du vivant de Masaccio, plus de gloire qu’il n’en voulait; après avoir, malgré lui et par obéissance, soutenu contre ce digne émule l’honneur de son école, continuait en silence son œuvre sainte au fond de cette cellule où bientôt il allait mourir. A son exemple, mais bien inférieurs à lui, d’autres pieux cénobites, dispersés çà et là, à Subiacco, à Assise et dans d’autres solitudes, entretenaient le culte de la beauté purement religieuse; mais que pouvaient leurs efforts isolés? A peine connaissait-on leurs œuvres: ensevelies dans les couvents, elles n’avaient pour admirateurs que la foule obscure des pèlerins. Ce n’était pas là qu’il eût fallu lutter: c’était dans Florence même, devant ce capricieux public, dans ces turbulents ateliers, et jusque dans ce Palazzo Vecchio où Laurent le Magnifique prodiguait ses largesses aux profanes nouveautés. Profanes est bien le mot, car il ne s’agissait pas seulement de l’imitation de la nature, mais d’une autre sorte d’imitation plus séduisante encore et plus incompatible avec l’art religieux. L’antiquité, le paganisme, après dix siècles de léthargie, s’étaient réveillés tout à coup. Les merveilleux modèles qu’on exhumait chaque jour étaient reproduits avec idolâtrie, et tous les esprits d’élite à force de lire les anciens, à force d’habiter l’Olympe avec leurs dieux, n’avaient plus que dédain pour les saints du paradis. Les Médicis, moitié par goût, moitié par politique, secondaient à Florence ce mouvement érudit et mythologique; aucun artiste n’ignorait que la fable était chez eux plus en faveur que l’Évangile, et qu’on avait meilleur chance de leur plaire en leur montrant Hercule aux pieds d’Omphale que les lois mages aux pieds de Jésus.
Contre cette double influence de l’art antique et de la nature vivante que pouvait l’ombre de fra Angelico? que pouvaient, sous leurs frocs, ses timides successeurs? Son disciple chéri lui-même, Benozzo Gozzoli, bien que libre, laïque, et grand peintre s’il en fut, opposa-t-il une héroïque résistance? Non; sans jamais trahir son maître, il n’osa jamais non plus marcher résolument sur sa trace, évita les sujets mystiques, et remplaça, dans ses admirables légendes, l’idéal de la pensée chrétienne par une gracieuse et touchante bonhomie.
Mais, comme il était dans la destinée de la peinture italienne de ne tomber en véritable décadence qu’après s’être élevée à de nouvelles hauteurs et avoir fait connaître au monde la plus parfaite expression de la beauté moderne, il fallait que l’élément suprême de cette beauté, l’élément spiritualiste ne disparût pas si tôt. Aussi, pendant que Florence presque toute entière sacrifiait aux faux dieux, on vit, dans la contrée des saints pèlerinages, aux alentours du tombeau de Saint-François d’Assise, et comme suscitée par sa vertu miraculeuse, se former, en dehors des cloîtres, une milice volontaire, marchant comme à la croisade, pour sauver l’idéal et défendre la tradition. C’était cette école ombrienne qui jusque-là ne s’était point révélée; c’étaient Gentile de Fabriano, élève de fra Angelico lui-même, Benedetto Buonfiglio de Pérouse, Florenzo de Lorenzo, Nicolo de Fuligno, et bien d’autres encore, instruits, pour la plupart, chez les maîtres miniaturistes de Pérouse et d’Assise, à ne chercher leurs inspirations que dans le cercle restreint des sujets exclusivement chrétiens. Quelques-uns, comme Gentile, par exemple, ne se contentèrent pas de répandre dans leurs montagnes les produits de ces inspirations, ils les colportèrent dans toute l’Italie, a Venise, à Naples, à Milan. Malheureusement, parmi ces missionnaires pleins de foi et même de talent, comme Vasari est obligé d’en convenir, il n’en était aucun qui pût agir sur les masses par l’ascendant d’une véritable supériorité. Ils étaient suffisants pour empêcher le feu sacré de s’éteindre, mais ne parvenaient pas à le ranimer. Cet honneur était réservé à Pierre Vanucci, à celui que la postérité a surnommé le Pérugin.
Tout le monde connaît ce grand artiste. Ses tableaux conservent encore un tel charme aujourd’hui, que ses contemporains, même les plus endurcis, ne pouvaient y rester insensibles. Il osa descendre à Florence, et ses gracieuses créations, moins pures, moins élevées, moins célestes que celles de fra Angelico, mais aussi chastes, aussi attachantes et plus vigoureusement peintes, réveillèrent dans bien des cœurs l’amour mal éteint des choses saintes. Les novateurs se sentirent atteints; on le voit aux calomnies et aux sarcasmes qu’ils lancèrent au nouveau venu, et dont Vasari, plus d’un demi-siècle après, se faisait encore l’écho brutal et acharné. Le Pérugin soutint le choc avec constance, et remporta même à Florence, les plus éclatantes victoires. Conduit à Rome par sa renommée, il y fut comblé de biens et d’honneurs, mais n’en voulut pas moins retourner dans ses montagnes pour fonder et consolider celle école qui devenait sienne, et qui poussait déjà de nombreux et vigoureux rameaux. Soutenu par des élèves tels que Gerino de Pistoïa, Luidgi d’Assise, Paris Alfani, Pinturricchio, le Pérugin, tant qu’il fut dans la force de l’âge, c’est-à-dire jusqu’à la fin du siècle environ, vit grandir et s’étendre son influence, non seulement autour de lui, mais dans presque toute l’Italie, à Bologne surtout, où dominait Francia, son glorieux auxiliaire. Le moment approchait pourtant où ses forces allaient faiblir; il ne s’en rendit pas compte et commit la faute de retourner à Florence. Ses adversaires, pendant qu’il vieillissait, avaient reçu de puissants renforts: ils comptaient dans leurs rangs cet impétueux génie, cet irrésistible champion des idées nouvelles, Michel-Ange. Lejeune homme fut impitoyable, et le vieillard assez mal avisé pour se plaindre en justice. Les tribunaux ne pouvaient lui rendre ni ses succès ni sa jeunesse; ils ne vengèrent même pas son injure. Courageux jusqu’au bout, cet échec ne lui fit point quitter Florence; mais il essaya vainement d’y rétablir sa fortune et celle de son. école. De dédaigneux sourires, d’injurieux sonnets accueillaient ses incessantes tentatives, et chaque jour voyait s’éclaircir les rangs de ses anciens admirateurs. C’en était fait de cette noble cause, si quelque main providentielle ne venait la soutenir.
Heureusement, peu d’années auparavant, un habitant d’Urbin, fervent disciple de l’école ombrienne et peintre de talent. quoiqu’on en ait pu dire, avait cru reconnaître chez son fils encore enfant, les signes manifestes du génie. Il l’avait conduit à Pérouse, dans l’atelier de son ami, de son chef, Pierre Vanucci, et l’enfant déjà formé aux leçons paternelles, s’était, approprié sur-le-champ le savoir et le style de son nouveau maître. Bientôt on ne distingua plus leurs œuvres, si ce n’est que, dans les tableaux de l’élève, se révélait déjà plus de pensée et une certaine aspiration à des types plus parfaits.
Lorsque, vers l’an 1500, le maître entreprit son malencontreux voyage à Florence, ce fut à ce jeune Sanzio, à peine âgé de dix-sept ans, qu’il confia la direction et l’achèvement de tous les travaux dont il était chargé, notamment à Citta di Castello. Qui eût osé, parmi ses disciples, s’élever contre ce choix? Les jalousies d’atelier se taisent devant de telles supériorités. Pinturrichio lui-même, de tous le plus habile, n’eut pas plus tôt reçu la mission de décorer la bibliothèque de la cathédrale de Sienne, que bien vite il appela Raphaël à son aide. L’école entière s’inclinait devant ce maître imberbe, et ce n’était pas seulement le Pérugin et sa famille d’artistes ombriens qui l’entouraient de leurs sympathiques espérances; la même sollicitude, dégagée de tout sentiment d’envie, se manifestait dans tout le reste de l’Italie chez tous les peintres demeurés fidèles aux traditions de fra Angelico. En apprenant à Venise l’apparition de cet astre naissant, les Bellini témoignaient la joie la plus sincère, et le vieux Francia écrivait de Bologne une touchante lettre où il demande au jeune artiste son amitié et son portrait.
Par un échange bien naturel, celui qu’on accueillait ainsi devait se dévouer tout entier aux hommes qui lui tendaient la main et aux idées qui étaient pour ainsi dire confiées à sa garde. Enclin par nature au culte de ces idées, l’éducation les lui avait gravées dans le cœur. La mort récente de son père et le souvenir de ses leçons, un respect presque filial pour son maître, sa suprématie incontestée dans l’atelier, la déférence de ses condisciples, tout l’attachait, l’enchaînait à sou école; mais il portait en lui bien des germes inquiétants pour sa future orthodoxie. Jamais homme n’était né avec un tel besoin de voir, d’apprendre, de connaître, avec une telle facilité de reproduire tout ce qu’il voyait, tout ce qu’il sentait, tout ce qu’il imaginait. Ce n’était pas cette aptitude universelle qui consiste à tout faire passablement, mais un don merveilleux d’exceller également dans les directions les plus diverses et les plus opposées. Quand on peut ainsi tout bien faire, on est tenté de tout essayer. Il fallait donc, pour s’enfermer dans un système, qu’il fit violence à sa nature. Son cœur, aussi bien que son esprit, conspirait à l’en faire sortir, car ce cœur ardent et passionné livrait de continuels combats aux chastes instincts de sa raison. Le ciel lui avait donné plus généreusement qu’à aucun autre homme le sentiment de la beauté parfaite et surhumaine, ce sentiment que l’ideal seul a le pouvoir de satisfaire; mais il ne l’avait pas moins richement pourvu de cette autre manière, moins platonique, de sentir le beau, qui se complaît aux perfections réelles et vivantes. Il y avait donc gros à parier qu’un jour viendrait où cet espoir d’Israël, ce Joas élevé saintement dans le temple, passerait aux Philistins, et des yeux clairvoyants pouvaient dès-lors apercevoir dans la main dévotement occupée aux peintures de Citta di Castello le pinceau qui devait nous donner le Parnasse et la Galathée.
Mais ni lui ni personne ne s’en doutait alors, et c’est avec la foi d’un néophite qu’il descendit dans l’arène où combattait son vieux maître. Laissant Pinturrichio terminer à Sienne les fresques dont il avait en partie composé les cartons, il s’en vint à Florence pour voir et pour s’instruire, mais avec la conscience de sa force et le désir de lutter. Les biographes s’étonnent qu’à son arrivée il ne soit point allé comme tous les jeunes gens de son âge, s’inscrire chez Léonard, chez Verocchio ou chez tel autre des grands maîtres qui tenaient alors école à Florence; ils oublient que son maître à lui était là, et qu’il avait à cœur de lui rester fidèle. Ce n’est pas qu’il se fît un scrupule de butiner parfois chez les autres. D’un regard jeté à la dérobée, il s’emparait de leurs secrets. C’est ainsi que, sans prendre directement les conseils de Léonard, il s’instruisit à son exemple et se rendit familières les plus exquises délicatesses de sa façon de peindre. Cependant ces sortes d’emprunts, il ne se les permettait que pour les procédés d’exécution, et n’en restait pas moins observateur rigoureux des lois de son école par le choix exclusivement religieux de ses sujets et par l’ordonnance à demi symétrique de ses compositions.
Dès ses premiers pas à Florence, il s’était posé en ombrien fervent, et n’avait recherché et pris pour compagnons que les artistes qui avaient soutenu le Pérugin dans sa disgrâce, qui se permettaient d’admirer les vieux maîtres et respectaient les traditions. C’était ce Baccio della Porta, destiné à rendre immortel le nom de fra Bartolomeo, esprit austère et fougueux, entré tout récemment dans la vie monastique et hésitant encore à reprendre ses pinceaux; c’étaient le fils du grand Ghirlandaïo, le pieux et tendre Rodolpho, Crouaca l’architecte, Baldini, le graveur, et ce peintre suave et mélanco lique, Lorenzo di Credi, formé comme Léonard aux leçons de Verocchio, mais entraîné par sa nature vers les mystiques inspirations.
Cette phalange d’artistes, au milieu de laquelle Raphael, malgré sa jeunesse, s’était placé dès l’abord au premier rang, n’avait alors ni crédit ni faveur; c’était un parti vaincu. Presque tous avaient aimé, suivi et défendu cet apôtre réformateur, ce Luther catholique, l’impétueux Savonarola, qui, durant dix années, avait tenu Florence sous sa loi et en avait chassé les Médicis. Précipité de sa haute fortune, Savonarola était mort dans les flammes, et les partisans des Médicis, bien que trop faibles encore pour tenter une restauration, avaient sourdement rétabli leur influence et reconquis le pouvoir. Ils l’exerçaient, sans qu’il y parut, par les mains du gonfalonier Soderini. C’était le même esprit que sous Laurent-le-Magnifique; on chantait le même air, comme on dirait aujourd’hui, seulement on le chantait plus mal. Tous les amis de Savonarola, tous les mystiques, tous les fervents qui, comme fra Bartolomeo et Lorenzo di Credi, avaient, au commandement du saint homme, jeté sur le bûcher leurs études d’après le nu, tous ceux qui avaient tenté, le dernier jour, de l’arracher à la fureur des tièdes, étaient tombés en complète disgrâce. Raphaël, quoique nouveau venu, devait par point d’honneur, épouser leur querelle et partager leur fortune. Il n’y avait donc rien à espérer pour lui sous les lambris du Palazzo Vecchio.
Il s’y présenta pourtant une lettre à la main, lettre charmante dont le texte est venu jusqu’à nous et que la duchesse de la Rovère lui avait donnée à son départ d’Urbin. Le gonfalonier lut la lettre, et l’artiste n’obtint rien. Sa noble protectrice avait oublié que recommander dans cette maison un faiseur de madones, c’était perdre sa peine. Autant aurait valu, il y a cent ans, introduire un séminariste dans le salon de madame Du Deffant.
Sans appui de ce côté, Raphaël se rejeta sur de plus modestes patronages. Il y avait encore par la ville quelques rares amateurs qui ne s’effarouchaient pas de la peinture sacrée, et qui accueillirent avec sympathie ce nouveau et brillant Pérugin. Ainsi Tadeo Tadei non-seulement lui ouvrit sa bourse, mais lui offrit sa table et sa maison; Lorenzo Nazi lui demanda plusieurs tableaux, et le plus riche de tous, mais aussi le plus avare, Angolo Doni, fit l’effort de lui commander son portrait et celui de sa femme Madelena Strozzi. Ce furent autant de chefs-d’œuvre. Les coteries eurent beau faire, le public se sentit ému, l’enthousiasme survint, et le jeune artiste reçut plus de commandes qu’il n’en pouvait exécuter. Mais ce n’étaient que des tableaux de dimension moyenne, des tableaux de chevalet; on lui demandait ce qu’il excellait à faire, tandis que lui, dévoré de cette activité qui va toujours en avant, aspirait à un champ plus vaste. Il lui fallait des murailles à couvrir de ses pensées. Quand il vit exposer aux regards du public florentin les immenses cartons de Léonard et de Michel-Ange, il fut pris d’une invincible ardeur d’entrer en lice avec ces deux géants. Une salle restait à décorer dans le palais. Mais comment l’obtenir? comment aborder cet intraitable gonfalonier? Quelque fut sa répugnance à mendier une faveur, la passion l’emporta, et il écrivit à son oncle maternel, Simone Ciarla, qui habitait Urbin. Il le priait de mettre tout en campagne pour lui procurer une nouvelle lettre de recommandation auprès du gonfalonnier . La lettre n’arriva pas; mais il en vint une autre qui lui ouvrait des perspectives toutes nouvelles et décidait du reste de sa vie. Barmante lui écrivait de Rome qu’il se hâtât d’accourir: le pape l’appelait et lui donnait à peindre les murs du Vatican.
Il partit pour la grande cité, encore ferme et bien aguerri contre les séductions qui l’attendaient. Ce séjour de Florence, cette vie de contrainte et d’opposition avait été pour lui une admirable école. Ses facultés avaient pris un développement prodigieux, tout en restant soumises à une forte discipline. Il savait dans son art tout ce qu’un homme peut savoir; il était aussi grand peintre qu’il devait jamais l’être, sans que son pinceau eût encore cédé à une fantaisie, ou subi un mauvais exemple. Il n’employait sa puissance qu’à suivre, comme un enfant docile, les voies naturelles de son génie, revêtant d’une forme toujours plus parfaite les saintes pensées dont son âme était pleine. La jeunesse un peu fanatique, mais croyante, au milieu de laquelle il passait sa vie, ne l’avait pas laissé dévier, et ce fra Bartolomeo, dont la cellule était un des lieux favoris de ses récréations, lui avait communiqué quelque chose de sa foi. Telle fut sa déférence aux conseils du cénobite, que, pendant ces quatres années, il ne mit presque jamais les pieds dans le jardin des Médicis, où tant d’autres venaient, un crayon à la main, s’inspirer devant les statues antiques dont il était peuplé ; telle fut sa constante soumission aux prescriptions de son école, que, parmi plus de soixante ouvrages produits par lui depuis son arrivée à Florence jusqu’à son départ pour Rome, on n’en peut citer qu’un seul, à peine grand comme la main, dont le sujet ne soit pas chrétien, et encore où en avait-il pris l’idée? Dans une cathédrale, devant ce groupe antique des trois Grâces qui décore la sainte librairie de Sienne.
Une fois à Rome, il sembla résolu à continuer sa vaillante gageure, et c’est l’esprit encore tout plein de ses convictions florentines, qu’il entreprit et conduisit à fin ce grand drame théologique, ce magnifique dialogue entre le ciel et la terre qu’on appelle la Dispute du saint sacrement. Jamais les traditions ombriennes ne s’étaient montrées au monde sous un plus splendide aspect; c’était le comble de l’art: la vie intérieure, la vie de l’âme, coulait à pleins bords d’un bout à l’autre du tableau, sans troubler le calme et la simplicité d’une composition majestueusement symétrique. Pour indiquer hautement combien il restait fidèle à ses croyances et à ses amitiés, pour lancer un défi bien clair à ses illustres rivaux, le peintre avait pris soin d’introduire dans son tableau non-seulement le Pérugin, son maître, mais ce Savonarola qui venait d’être brûlé-vif à Florence. Comment passa-t-il brusquement de cette page sublime, qui résumait et complétait l’œuvre de toute sa vie, à un autre chef-d’œuvre non moins inimitable, mais conçu dans un esprit et dans un but tout différents? Il avait changé d’atmosphère; il se trouvait aux prises avec des séductions toutes nouvelles, une entre autres, qu’il ne connaissait pas: la faveur. Quand un pape vous dit: Faites-moi des dieux, des muses, des Athéniens, des philosophes, il est assez difficile de lui répondre: Je ne fais que des vierges et vous êtes un païen. Il fallait donc, bon gré mal gré, qu’il désobéît à son école, ne fût-ce que pour le choix des sujets. Ce premier pas franchi, comment n’en pas faire un autre? comment se refuser le plaisir, si longtemps différé, de vaincre ses adversaires sur leur propre terrain, de dire à tous ces prôneurs du style savant et pittoresque: Il vous faut des combinaisons, des calculs, des lignes accidentées; vous voulez que la vie, l’expression, ne soient plus concentrés seulement sur la figure de l’homme, mais répandues sur tout son corps; vous voulez que le système musculaire joue, comme l’âme, un premier rôle; vous appelez l’intérêt sur la surface des choses, et vous glorifiez la matière aux dépens de l’esprit: eh bien, je m’en vais vous montrer que je connais tous ces secrets, et que j’y suis passé maître!
Il aura cru ne s’engager à rien, faire un essai; mais, une fois dans ce chemin, il n’en devait plus sortir. Il s’y maintint il est vrai, avec toute sa force, toute sa retenue, sans jamais être entraîné plus loin qu’il ne voulait, sans jamais abandonner l’usage de ses qualités propres, des dons innés de sa nature, et compensant, s’il est possible, les inconvénients de cette sorte d’éclectisme par la merveilleuse universalité de son génie. C’est ainsi que se passèrent ses dix dernières années, et ce fut certes encore un admirable spectacle; mais un progrès, quoiqu’en puissent dire certains esprits, nous avons peine à l’admettre.
Il peut convenir à Vasari de nous le montrer grandissant à mesure qu’il s’éloigne des traces de son maître, s’élevant de jour en jour et peu à peu jusqu’à l’intelligence du grand goût florentin, et parvenant enfin à élargir son style après qu’on lui a indiscrètement fait voir, comme à travers le trou d’une serrure, quelques figures de Michel-Ange. Tissu d’erreurs ou de mensonges que tout cela. Ce n’est pas après deux ans de séjour à Rome que Raphaël a reçu la révélation de Michel-Ange: ne l’avait-il pas vu d’assez près à Florence? n’avait-il pas vécu à ses côtés, en face de ses œuvres? N’avait-il pas vu, revu et étudié la plus célèbre de toutes, le carton du Palazzo Vecchio? S’il eût voulu dès lors faire au système de ce puissant génie le plus léger emprunt, qui pouvait l’en empêcher? Il en avait le savoir, et sa main s’y fut façonnée aussitôt; mais ç’eût été une abjuration, une désertion dont il n’aurait pu alors supporter la pensée.
Aussi la plus belle phase de sa vie sera toujours, pour nous, le temps écoulé à Florence et les premiers moments passés à Rome, parce qu’au milieu de séductions déjà bien entraînantes, et malgré les tendances si variées de son esprit, il fut, durant cette période, résolument fidèle à sa règle et à son but, parce que, après avoir apprécié la méthode de ses émules, il persista volontairement dans la sienne, obéissant à sa vocation plutôt qu’à la mode, et s’obstinant à faire ce que Dieu avait voulu qu’il fit mieux qu’aucun homme en ce monde.
Que n’a-t-il persévéré ? Mais franchement ce n’était pas possible. Non, pour rester jusqu’au bout dans cette voie de pureté et de candeur, il eût fallu qu’il renonçât au siècle, qu’il se fit moine comme son ami Baccio, comme son aïeul en génie fra Agelico; mais, au milieu du monde, vivant à une cour, favori d’un Jules II, d’un Léon X, toute résistance était vaine; il fallait qu’il succombât, qu’il se pliât au goût du siècle, qu’il s’en fit comprendre et admirer, qu’il se mît au niveau de ses applaudissements.
Nous ne sommes donc pas de ceux qui, sans pitié, frappent d’anathème ces dix dernières années; encore moins voulons-nous les exalter, les mettre au-dessus des autres, prétendre que cette vie d’artiste n’a été qu’une marche toujours ascendante, un progrès incessant sans solution de continuité, sans changement de foi ni de doctrine. Les preuves sont trop claires pour ne pas le reconnaître: il y a deux hommes, deux peintres en Raphaël. Le premier a toutes nos préférences mais Dieu nous garde de ne pas admirer le second! Loin de nous surtout ce sacrilége vœu qui a fait souhaiter à quelques-uns que sa vie se fût terminée plus tôt! Les chefs-d’œuvre que nous supprimerions ainsi, quoique de moins sainte origine peut-être n’en sont pas moins, comme leurs frères, l’honneur éternel de l’esprit humain. Il faut même le reconnaître, si, durant ces dix années, les œuvres ont plutôt grandi en savoir et en puissance qu’en sentiment et en poétique beauté, l’homme, l’artiste n’en a pas moins continué à s’élever sans cesse au-dessus de lui-même, et la preuve, c’est qu’il lui est arrivé quelquefois, durant cet intervalle, de se replacer pour un moment à son ancien point de vue, de traiter des sujets purement mystiques dans des conditions de simplicité naïve et symétrique qu’eût acceptées un fidèle ombrien, et il l’a fait avec une supériorité dont son jeune âge ne nous montre pas d’exemple. C’est ainsi qu’il a créé la Vision d’Ézéchiel, c’est ainsi qu’a pris naissance cette Vierge de Dresde, le plus sublime tableau qui soit peut-être au monde, la plus claire révélation de l’infini que les arts aient produite sur la terre.