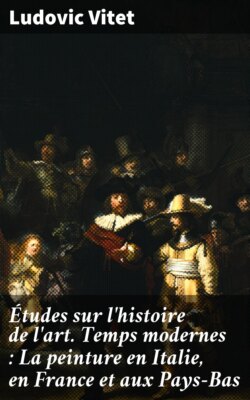Читать книгу Études sur l'histoire de l'art. Temps modernes : La peinture en Italie, en France et aux Pays-Bas - Ludovic Vitet - Страница 9
IV
ОглавлениеLe sujet en est trop connu pour qu’il soit besoin de le décrire: c’est le moment où Jésus fait entendre à ses disciples ces terribles paroles: Un de vous me trahira. L’étonnement, la douleur, se peignent sur leurs visages; leurs mouvements et leurs gestes en sont comme suspendus; ils ne peuvent parler et s’interrogent du regard. Ceux-là seuls qui, plus voisins du Maître, n’ont pu se méprendre sur ses paroles, commencent à laisser voir la violence de leur émotion; les autres, plus éloignés, se contraignent encore et semblent vouloir douter d’avoir bien entendu. Du reste, pas le moindre effet théâtral, pas l’ombre de mise en scène: personne n’est là pour poser et ne paraît même se douter qu’il y ait un spectateur. Ce sont des hommes sérieux, sobres et calmes, réunis dans un dessein solennel et pieux; aucun d’eux ne s’agite ni ne gesticule, aucun d’eux ne se lève de son siége sous prétexte de chercher à mieux entendre, mais en réalité pour fournir à l’artiste l’occasion de briser la ligne supérieure de sa composition et d’y introduire des ondulations heureuses.
Ces secrets du métier, cet art des contrastes conventionnels, l’auteur de cette fresque les a-t-il ignorés ou dédaignés? Dès le premier coup d’œil, on a le sentiment, je dirais la certitude, que c’est par choix et non par inexpérience qu’il s’est maintenu dans cette rigoureuse observation du vrai. Voyez comme ces figures sont drapées, quelle justesse de mouvement, quelle science du nu sous ces étoffes! quelle ampleur et quelle mesure dans ces plis! Le modelé de toutes ces carnations n’est-il pas à la fois précis et moelleux? Le dessin de ces pieds nus sous la table et de ces mains si diversement posées pourrait-il être plus pur et plus irréprochable? Et jusqu’à cette façon d’indiquer les cheveux n’est-elle pas également exempte de sécheresse et de lourdeur? L’habileté technique ne saurait aller plus loin, et celui qui a pu se jouer de ces difficultés avec tant d’aisance était à coup sûr en état de recourir aux artifices de composition dont à Florence même on admirait dès lors de séduisants exemples. S’il ne l’a point fait, c’est qu’il ne l’a point voulu, soit par fidélité à des traditions d’école, soit par un invincible amour du simple et du naturel.
Voilà donc dans ce tableau un étrange et curieux contraste. Si vous le regardez à distance, si d’un coup d’oeil vous en saisissez l’ensemble, cette suite d’hommes assis, quelques variées que soient leurs attitudes, a je ne sais quoi d’uniforme et de symétrique qui vous rappelle les productions les plus ingénues de l’art à son enfance; si vous vous approchez, si vos regards pénètrent dant chacune de ces figures, vous les voyez vivre et penser, vous découvrez l’infinie variété de leurs affections, de leurs caractères, vous apercevez les liens qui les unissent, qui les groupent moralement pour ainsi dire; en un mot, c’est l’art à son apogée, avec toute sa magie, toute sa puissance, et, sauf sur les murs du Vatican peut-être, vous n’en trouveriez nulle part de plus merveilleux effets.
Cette sorte de disparate entre la naïveté des conditions extérieures de la composition et la supériorité de la pensée créatrice et de la mise en œuvre n’est pas le seul trait caractéristique que nous ayons à signaler. Il en est un plus saillant encore, nous voulons parler de la manière toute traditionnelle dont sont représentés deux des principaux personnages, le saint Jean et le Judas.
Ainsi qu’on l’a vu plus haut, la date de cette fresque n’est pas douteuse. C’est en 1505 qu’elle a été peinte. Lors même qu’on ne lirait pas ce chiffre sur le vêtement d’un des apôtres, on aurait une preuve équivalente: évidemment la fresque n’est pas antérieure à 1500, puisqu’avant cette époque le réfectoire n’était pas bâti. Or, eu 1505, il y avait déjà plus de dix ans que Léonard de Vinci avait peint dans le couvent de Santa-Maria delle Grazie, à Milan, cette autre Sainte Cène que toute l’Europe connaît et admire. Bien que les communications ne fussent alors ni fréquentes ni faciles, nous ne saurions supposer que cette grande création, cette découverte d’un génie précurseur, qui en un jour venait de faire l’œuvre d’un siècle, fût inconnue dans sa patrie. Les deux pays possédaient alors assez bon nombre de dessinateurs, peintres, et même graveurs; Léonard avait conservé à Florence as ez d’amis soigneux de sa gloire pour que son chef-d’œuvre dût y être reproduit au moins par le crayon. Lui-même, à la rigueur, eût pu prendre ce soin, puisque dans l’intervalle il avait repassé l’Apennin et revu ses foyers. Nous tenons donc pour certain que l’artiste qui fut chargé, vers 1504 ou 1505, de peindre dans ce réfectoire de S. Onofrio le dernier repas de Jésus et de ses disciples connaissait la façon toute nouvelle dont Léonard venait de concevoir ce sujet.
Qu’il n’ait rien emprunté de ces combinaisons savantes, de ces lignes étudiées, de ces balancements pittoresques dont plus tard on devait tant abuser, mais qui, dans ce premier jet, brillait d’un éclat inconnu, et n’avait pas encore perdu l’accent de la vérité ; qu’il se soit volontairement refusé à donner à ses personnages ce feu, cette action, cette vivacité de gestes qui lui semblaient peut-être appartenir à des hommes s’échauffant de politique ou de controverse plutôt qu’à des esprits simples et croyants recevant de leur divin maître une suprême et douloureuse confidence, il n’y a rien là qui nous étonne. Les deux artistes évidemment n’obéissaient pas aux mêmes lois, ne tendaient pas au même but, et devaient différer dans les moyens; mais, à quelque système qu’on s’attache, quelque fidèle qu’on soit aux vieux usages, il est certaines innovations si bien justifiées, qu’il faut, bon gré mal gré, les adopter une fois qu’elles se sont produites. De ce nombre était assurément le parti pris par Léonard de réintégrer Judas à une place que tous les peintres lui avaient refusée depuis quelques centaines d’années, et de modifier la pose qu’ils avaient tous attribuée à saint Jean.
En effet, la tradition voulait que le disciple bien-aimé, conformément au texte de saint Matthieu, reposât sur la poitrine de Jésus, et quant à Judas, bien qu’aucun évangéliste ne lui eût assigné une place à part, on n’admettait pas qu’il pût être assis à côté de ses condisciples; aussi, pendant que le Seigneur et les apôtres occupaient un côté de la table, Judas seul, posé sur un escabeau, devait figurer de l’autre côté.
Cette tradition n’avait pas toujours existé. On n’en voit aucune trace dans les monuments de la primitive Église, et notamment dans cette fresque tirée des catacombes de Saint-Calixte et conservée au Vatican, représentation de la Sainte Cène la plus ancienne peut-être qui soit venue jusqu’à nous. Ce sera probablement vers le douzième ou le treizième siècle qu’aura commencé cet usage . L’esprit du moyen âge ne badinait pas en ces matières, et se souciait fort peu de la vraisemblance, quand ses croyances étaient en jeu. Tout le monde aurait jeté la pierre au malheureux peintre qui se fût permis de faire asseoir Judas entre deux apôtres; on eût crié à la profanation. Il fallait qu’on vît Judas seul, délaissé, comme la brebis pestiférée qu’on sépare du troupeau, afin que personne ne pût s’y méprendre, que les enfants eux-mêmes le montrassent au doigt, et qu’il reçût, même en peinture, une sorte de châtiment. Quant à saint Jean, qui eût osé le faire asseoir comme tous les autres? Les spectateurs se seraient révoltés; ils l’auraient cru tombé en disgrâce et déchu dans le cœur de son maître, s’il n’eût pas été couché littéralement sur sa poitrine.
Est-il besoin de dire que cette manière d’entendre l’Évangile se prêtait assez mal aux combinaisons pittoresques? Comment ajuster cet homme sur sa sellette, seul en face de tous les autres? Quoi de plus gauche que ce personnage à demi couché au milieu de figures assises sur leur séant? Quel vide désagréable à l’œil et impossible à déguiser! Il n’en fallait pas moins que l’artiste, sans sourciller, se pliât à ces exigences, et le Léonard du quatorzième siècle, Giotto, s’y était soumis tout le premier. Lui aussi nous a laissé sa Sainte Cène: elle occupe mi des compartiments de cette immense fresque qu’on voit encore à Florence dans les anciennes dépendances de Santa-Croce. Là, nous trouvons un saint Jean dont la pose est absolument horizontale, et un Judas le dos tourné au spectateur, assis comme un accusé vis-à-vis de ces onze apôtres, qui le foudroient de leurs regards, comme si tous ils connaissaient déjà son crime.
Léonard n’était pas homme à perpétuer ces naïvetés séculaires. Donner à son Judas une expression qui laissât voir bien clairement la noirceur de son âme, lui mettre une bourse à la main, lui faire poser le coude sur la table, lui faire renverser la salière, voilà tout ce qu’il pouvait concéder; du reste, n’écoutant que sa raison et la vraisemblance, il fit asseoir le disciple maudit côte à côte avec les fidèles, n’oubliant pas qu’un quart d’heure auparavant Jésus lui avait lavé les pieds comme aux autres. A l’égard de saint Jean, il prit même liberté ; au lieu de le coucher sur son maître, il l’en écarta à respectueuse distance, et lui fit détourner la tête, comme pour dire à son voisin: Si quelqu’un doit trahir ici, je sais bien que ce n’est pas moi.
A coup sûr Léonard avait raison, et comme le temps où il vivait tournait au relâchement et presqu’à la tolérance, il n’y eut point de cris de haro. L’innovation parut même si généralement bonne et si parfaitement fondée, que, depuis cette époque, personne, aussi bien dans un cloître qu’en un lieu séculier, ne s’est plus avisé de recourir à la vieille tradition.
Nous nous trompons: plus de dix ans après, un peintre fut chargé de faire une Sainte Cène dans cette ville de Florence où les esprits assurément étaient tout aussi libres et aussi hardis qu’à Milan, où du soir au matin les anciennes traditions étaient battues en brèche, et ce peintre eut le courage, ou, si l’on veut, l’entêtement, de placer son Judas, de poser son saint Jean, conformément au vieil usage. Il a mis, il est vrai, une adresse infinie à déguiser le côté disgracieux du parti qu’il osait prendre, mais il n’en a pas moins exactement suivi toutes les données de la tradition.
Quel était donc ce peintre? Était-ce quelque vieillard, quelque artiste du siècle passé, attaché à sa marotte et hors d’état de se rajeunir? Mais cette exécution si franche, si souple, si dégagée, ne nous répond-elle pas qu’il n’y avait chez cet homme ni caducité ni routine? Le pinceau qui a tracé ces contours n’était-il pas dressé aux pratiques les plus nouvelles, aux secrets les plus raffinés de l’art en Italie, et n’observait-il pas avec une exactitude encore à peine connue, si ce n’est de Léonard lui-même, ces lois de la perspective et ces règles théoriques que la science, à cette époque, commençait depuis si peu de temps à enseigner aux peintres? Eh bien, c’est cette main évidemment jeune et libre, obéissant à un esprit lucide et cultivé, qui non-seulement a consenti à tracer au bas de ce tableau les noms de chaque personnage, comme dans les œuvres des vieux maîtres, à ceindre d’un cercle d’or, en signe de sainteté, la tête de chacun de ces apôtres, mais qui, s’attachant avec passion à une sévérité de style presque archaïque, fuyant comme le péché toutes les licences alors accueillies par la mode, en est venu jusqu’à préférer, pour la représentation du bien-aimé saint Jean et du traître Judas, la version de Giotto à celle de Léonard.
Nous citera-t-on beaucoup d’artistes à qui s’applique ce portrait? en trouvera-t-on beaucoup qui, en 1505, aient osé tenir si haut le drapeau des anciennes écoles? Qu’on nous les nomme, ceux qui possédaient alors un tel génie, un tel savoir, et qui en ont fait un tel usage? Pour nous, nous n’en connaissons qu’un, un seul, et nous défions qu’on en découvre un autre.
Voilà ce qui vaut mieux, selon nous, que toutes les signatures, que tous les récits de biographes; voilà ce qui, mieux que tout le reste, nous persuade que MM. della Porta et Zotti n’ont pas fait une vaine conjecture, que MM. Jesi, Cornelius, Minardi, Selvatico et tant d’autres, ont rendu un clairvoyant témoignage. Ce n’est pas que nous n’attachions une très-sérieuse estime aux preuves d’un autre genre que nous avons déjà citées, et à d’autres, non moins concluantes, que nous aurions à signaler encore. Ainsi nous pourrions faire remarquer que ces noms d’apôtres, tracés en lettres d’or dans le bas du tableau, sont écrits en dialecte, ou, si l’on veut, en palois d’Urbin, comme certaines lettres adressées alors par Raphaël à sa famille, et qui sont venues jusqu’à nous; que c’est aussi d’Urbin, ou, ce qui revient au même, de l’atelier de Bramante, que sont évidemment sortis les motifs d’architecture sur lesquels se détachent Jésus et ses disciples. Il n’y a rien là qui rappelle les vigoureux effets du goût florentin: c’est une délicatesse de profils, une élégance de proportions qui appartenait alors en propre au parent et compatriote de Sanzio, et dont le secret s’était transmis à celui-ci, témoin le constant usage qu’il en a fait dans ses tableaux. Nous pourrions dire encore qu’à travers ces arcades à jour on voit un paysage conçu dans le même goût et traité exactement de la même manière que ceux qui servent de fond soit à la Vierge au Chardonneret, soit à d’autres chefs-d’œuvre exécutés par la même main et vers la même époque à Florence; que les petites figures groupées dans ce paysage, savoir, Jésus en prières et ses trois disciples endormis (car le peintre, à la façon des anciens maîtres, a voulu indiquer dans cette perspective ce qui allait se passer quelques instants après sur le mont des Oliviers), rappellent à s’y méprendre, par le style et par la finesse de la louche, les petites compositions dans le genre du Saint George de notre musée de Paris, et doivent être probablement une reproduction de ce Jésus au jardin des Oliviers, peint en 1504 pour le duc d’Urbin, tableau d’un fini si précieux et que Vasari prise si fort. Enfin il est une dernière preuve dont nous pourrions faire usage, et que nous avons tenue en réserve jusqu’ici, la plus frappante peut-être de toutes ces preuves de détail, celle qui vous saisit dès l’abord quand on lève les yeux sur cette fresque, c’est qu’un de ces apôtres, le saint Jacques mineur, placé à l’extrémité de la table, au côté gauche du spectateur, est la vivante image de Raphaël lui-même. Ici pas la moindre hypothèse. Cette gracieuse et intelligente figure nous est aussi connue que si elle existait de nos jours, que si nous l’avions vue de nos yeux. On sait combien Sanzio s’est souvent pris lui-même pour modèle. Non-seulement il a fait plusieurs fois son portrait; mais Vasari et d’autres contemporains nous apprennent qu’au Vatican, dans quatre fresques différentes, il s’est représenté quatre fois, tantôt à côté du Pérugin, son maître, tantôt en compagnie de ses principaux élèves. Or, la physionomie de ce saint Jacques mineur est exactement celle que nous retrouvons et dans le portrait de là galerie de Florence et dans les fresques du Vatican, aussi bien dans la Dispute et l’École d’Athènes que dans le Parnasse et l’Attila. Ce sont les mêmes traits, la même expression rêveuse, la même grâce répandue dans toute la personne, et jusque dans ces deux mains si naturellement posées l’une sur l’autre. S’il existe une différence, c’est qu’ici la figure est peut-être étudiée avec encore plus de soin et de recherche, qu’elle a plus d’individualité, et surtout un plus grand charme de jeunesse, ce qu’explique suffisamment la date de ce nouveau portrait.
Voilà certes un argument qui, s’ajoutant à tous les autres, doit triompher des résistances les plus tenaces et les plus incrédules. Nous en proclamons volontiers l’incontestable puissance; mais, qu’on nous permette de le répéter, il est pour nous une démonstration plus victorieuse encore: c’est celle que nous tirons non de tel ou tel détail, mais des caractères généraux de l’œuvre. S’il y a dans cette fresque de tels contrastes, de telles anomalies, qu’elle ne puisse avoir été conçue et exécutée que par un artiste placé dans des conditions dont l’histoire de l’art à cette époque ne présente qu’un seul et unique exemple; si ces conditions exceptionnelles sont exactement celles où s’est trouvé, pendant quatre années de sa vie, l’immortel élève du Pérugin, n’aurons-nous pas le droit de dire que la question est sérieusement résolue? et, en la posant ainsi, n’aurons-nous pas écarté d’avance toutes Jes arguties qu’on serait peut-être tenté d’opposer à nos autres preuves prises isolément?
C’est donc l’histoire de Raphaël à Florence qui doit nous dire s’il est réellement l’auteur de la fresque de S. Onofrio. Retraçons en peu de mots les traits principaux de cette histoire.