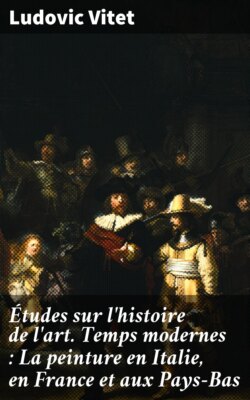Читать книгу Études sur l'histoire de l'art. Temps modernes : La peinture en Italie, en France et aux Pays-Bas - Ludovic Vitet - Страница 7
II
ОглавлениеMalgré ces preuves répétées, malgré ces autorités souveraines, une partie du public demeurait en suspens. Comment croire, disait-on, qu’une œuvre de Raphaël et une œuvre de cette importance, ait pu rester inconnue à Florence pendant trois cent quarante ans? Comment ni Vasari, ni Bocchi, ni Comolli, ni aucun de ceux qui, à diverses époques, ont fouillé et décrit les trésors de la peinture toscane, comment Richa, qui, dans son histoire des églises florentines, parle si longuement du couvent de S. Onofrio, auraient-ils ignoré ou négligé de nous apprendre que cette muraille portait l’empreinte de ce divin pinceau?
Assurément cela est étrange; mais ce qui ne l’est guère moins, c’est que ni Vasari, ni Richa, ni personne n’ait parlé de ce tableau, quand même Raphaël n’en serait pas l’auteur. Celui qui l’a créé, n’eût-il jamais fait autre chose, valait certes bien la peine qu’on nous apprît son nom. Ainsi, quelque parti qu’on prenne, le problème reste à peu près le même. Il s’agit d’expliquer comment, pendant trois siècles, un chef-d’œuvre a pu exister dans Florence sans qu’aucun écrivain en eût dit un seul mot.
Mais d’abord les oublis de ce genre sont-ils donc aussi rares qu’on paraît se l’imaginer? Pour ne parler que de Vasari, croit-on qu’il ait dressé l’inventaire authentique et complet de toutes les œuvres de Raphaël? Dit-il la moindre chose, par exemple, de la Madonna della Seggiola? parle-t-il de la Madonna del Gran Duca? Et personne a-t-il jamais argumenté de son silence contre la légitimité de ces deux merveilles? Vasari est un guide excellent et presque toujours sûr; sans lui, cette longue histoire de la peinture italienne ne serait que ténèbres, car tous ceux qui sont venus à sa suite semblent n’avoir rien vu par eux-mêmes et ne jurent que sur sa parole; mais à l’époque où Vasari prit la plume, près de trente ans s’étaient écoulés depuis la mort de Sanzio. Il écrivait de souvenir, d’après des notes incomplètes: de là bien des erreurs et d’inévitables oublis. Non-seulement il passe sous silence des tableaux de premier ordre, mais il affirme quelquefois, à propos de ceux dont il parle, des circonstances matériellement inexactes. Ainsi la Sainte Famille du palais Rinuccini, qui, par son style, appartient évidemment aux dernières années du maître, serait, au dire de Vasari, antérieure à 1508. Or, en nettoyant ce tableau, il y a soixante ou quatre-vingts ans, on a découvert sa véritable date, la date conforme à son style, c’est-à-dire 1516. Pour constater d’autres erreurs encore plus étranges, il ne faut qu’entrer au Vatican, notamment dans la salle della Segnatura. N’est-on pas tenté de croire, à la manière dont Vasari décrit les fresques qui la décorent, que jamais il ne les a vues? D’abord il confond à tout propos la Dispute du saint sacrement avec l’École d’Athènes, nous montre Platon assis au milieu des anges, et, ce qui est plus grave, ce qui bouleverserait toute chronologie de l’art, suppose que, de ces deux fresques, c’est l’École d’Athènes qui a été exécutée la première.
Il faut donc n’attacher un respect superstitieux ni aux paroles ni au silence de Vasari. Un tableau peut être de Raphaël sans que l’auteur de la Vie des Peintres en ait fait mention. Parmi tant de madones et de saintes familles, diversifiées sans doute par le génie, mais au fond toutes semblables, comment le plus scrupuleux biographe n’en eût-il pas oublié quelques-unes?
Dira-t-on que des tableaux peints sur toile ou sur bois, des tableaux qui changent de place, qui passent de main en main, souvent même de ville en ville, ont pu lui échapper, mais qu’il n’en est point ainsi des fresques? que si parfois il se méprend à les décrire, jamais on ne le surprend à les oublier? que le moindre pan de mur où Raphaël a porté la main nous est signalé par lui avec un soin religieux? que dès lors on ne saurait comprendre comment il eût passé sous silence cette œuvre capitale, exécutée dans sa propre patrie, et qui ne pouvait pas plus s’effacer de son souvenir que se détacher de l’édifice où elle était fixée?
Nous en tombons d’accord: il n’est pas une fresque de Raphaël que Vasari ait vue sans s’être fait un devoir d’en dire au moins quelques mots; mais avait-il vu la fresque de S. Onofrio? C’est là qu’est la question.
Or, il est bon qu’on le sache, les nobles comtesses de Fuligno observaient la clôture rigoureuse, et aucun homme, à aucun jour de l’année, n’avait accès dans le couvent. Nous sommes donc tout au moins en droit de supposer que Vasari n’avait point vu leur fresque.
Mais pouvait-il ignorer qu’elle existât? D’autres religieuses, dont la règle n’était guère moins sévère, les sœurs de Sainte-Marie-Madeleine dei Pazzi, cachaient aussi à tous les yeux profanes une peinture dont le Pérugin avait orné leur chapelle, et cependant personne dans la ville n’ignorait que ce trésor fût en leur possession. Pourquoi les dames de Fuligno auraient-elles été plus discrètes? Nous ne prétendons pas leur attribuer plus de vertu qu’à leurs sœurs; mais ne peut-on supposer qu’elles ont gardé ce modeste silence, faute d’être assez bons juges en peinture pour se douter que l’œuvre d’un simple étudiant pût faire la gloire de leur maison?
Ce n’était, en effet, pour toute une partie du public italien, qu’un étudiant et presque un inconnu, celui qui, en 1505, à Florence, portait ce grand nom de Raphaël. Il semble aujourd’hui que, dès le premier jour, son front dût rayonner de gloire; on ne pense qu’au peintre du Vatican, comblé d’honneurs, traînant après soi le cortége de ses disciples idolâtres, et on oublie le modeste jeune homme descendu de sa petite ville d’Urbin dans la cité des Médicis, sans argent, sans amis, presque sans protecteurs. Nous le suivrons tout à l’heure de plus près dans cette phase de sa vie, la moins connue, bien que, selon nous, la plus attachante; et s’il nous est prouvé que ses œuvres encore naïves ne pouvaient être alors sainement appréciées que dans un cercle restreint et choisi, si l’état des esprits et du goût à Florence ne lui permettait d’aspirer ni aux applaudissements incontestés de la foule, ni même aux encouragements et aux faveurs prodigués dans certains palais, on ne sera pas surpris qu’au fond d’un cloître, loin du monde et des arts, de saintes femmes n’aient pas su deviner qu’elles confiaient au plus grand des peintres la décoration de leur réfectoire.
Plus tard, lorsque sa renommée devint universelle, le bruit en pénétra sans doute jusque dans leur asile, et le prix inestimable de cette peinture ne put leur rester inconnu. De nombreux crochets de fer plantés régulièrement dans le haut de la muraille indiquent qu’un voile ou une tapisserie la couvrait habituellement comme un objet de haute vénération, et l’étonnante conservation de l’enduit et des couleurs confirmerait au besoin cette conjecture. Ajoutons qu’il existe encore à Florence quelques femmes qui, avant 1800, fréquentaient ce monastère; elles disent toutes qu’aux jours de fête seulement on découvrait la Sainte Cène du réfectoire, que de toutes les peintures du couvent, celle-là était tenue en la plus haute estime, mais sans qu’on parût connaître quel en était l’auteur.
Comment et depuis quand le souvenir s’en est-il perdu? Était-ce d’abord par prudence, pour ne pas éveiller une importune curiosité, qu’on s’était abstenu de divulguer un nom d’artiste devenu trop célèbre? Était-ce seulement par sainte indifférence pour les choses de ce monde? On peut à ce sujet se perdre en hypothèses. Ce qu’il y a de certain, c’est que les dernières religieuses ignoraient de qui était le tableau, et, à défaut du public, ce n’était pas quelques dévotes assistant à leurs offices qui pouvaient le leur apprendre.
Aussi, jusqu’en 1800, tant qu’a duré la communauté, il est tout simple que le mystère et le silence se soient perpétués, et qu’un secret si bien gardé depuis trois siècles n’ait pas été violé ; mais le jour où, par ordre du sénat de Florence, les religieuses de S. Onofrio furent réunies aux religieuses de S. Ambrogio, le jour où les bâtiments conventuels furent mis en vente, et où chacun fut libre de pénétrer dans ce réfectoire, comment ne se trouva-t-il personne, pas un commissaire des républiques française ou cisalpine, pas un Anglais voyageur, pas un amateur de la ville, personne enfin qui signalât les beautés supérieures de cette fresque, personne qui en révélât seulement l’existence? La suie ne la couvrait pas alors. Comment a-t-il fallu quarante-trois ans et un heureux hasard pour en faire la découverte? Voilà quelque chose de bien autrement étrange que l’ignorance de nos religieuses, quelque chose qui paraît incroyable, et dont pourtant on ne peut douter.
Il est vrai que, sans sortir de Florence, nous citerions d’autres découvertes de ce genre plus extraordinaires encore. Ici du moins personne n’était averti; on ignorait que, sur ces murs de S. Onofrio, il y eût quelque chose à chercher, et le badigeon pouvait ensevelir à jamais ce chef-d’œuvre sans que personne eût un reproche à se faire. Mais qu’un tableau des plus exquis, un tableau que tout Florence avait admiré pendant deux siècles dans un des riches palais de la rive gauche de l’Arno, en ait disparu un beau jour, qu’il ait été pendant soixante ou quatre-vingts ans non-seulement perdu, mais oublié de la famille et du public, jusqu’à ce que, par fortune, un étranger l’ait retrouvé dans ce même palais, cela n’a-t-il pas l’air d’un conte fait à plaisir? et pourtant c’est l’histoire parfaitement véridique de la Vierge du palais Tempi. Une femme de chambre tomba malade, et le médecin de la maison, qui, par bonheur, aimait les arts, monta la visiter sous les combles; là, dans le fond d’une alcôve, à travers une couche de poussière et de fumée, il aperçut l’image de cette jeune mère au souriant visage, prête à donner un baiser à l’enfant qui joue dans ses bras, mais hésitant comme arrêtée par le majestueux regard de son divin fils. C’était du temps du feu marquis Tempi que ce chef-d’œuvre revoyait le jour. Il y a des gens à Florence qui ont assisté à cette résurrection; malheureusement, leur joie devait être de courte durée. Quelques années plus tard, le tableau abandonnait cette demeure où il était entré de la main même de Raphaël, d’où jamais il n’était sorti: il s’en allait à Munich. Un opulent héritier avait eu le triste courage de préférer au joyau de sa famille les florins du roi de Bavière.
Plus récemment encore, il y a seulement quelques années, l’ancien palais du podestat n’a-t-il pas été témoin d’une autre résurrection plus imprévue et non moins merveilleuse? D’après une ancienne tradition, fondée sur des témoignages contemporains, sur des autorités incontestables, on savait que Giotto avait peint à fresque une salle de ce palais et qu’il avait fait dans un de ses tableaux le portrait du Dante, alors dans la force de l’âge. On connaissait la salle, et souvent on avait essayé, en détachant l’enduit rougeâtre qui en recouvre les parois, de retrouver ce précieux portrait. Jamais on n’avait réussi, et tout le monde était convaincu que les peintures de Giotto avaient été complétement détruites. C’est au moment où personne n’y pensait plus qu’un homme enfermé dans cette salle, et ne sachant qu’y faire, s’amusa, sans le moindre soupçon, sans le moindre instinct d’archéologue, à gratter la muraille avec son couteau et tomba juste sur cette tête du Dante, admirable profil qui reproduit ces traits si connus avec un accent tout nouveau de jeunesse, de force et d’inspiration.
Nous pourrions parler encore d’une certaine fresque de Paolo Ucello, qu’on voit aujourd’hui dans l’ancien monastère de Santa-Apollonia (in via San-Gallo), et qui ne s’est révélée pour ainsi dire que le jour où l’élargissement de la rue voisine a fait pénétrer un peu de lumière dans cette partie de l’édifice; nous pourrions rappeler enfin que, dans la maison même de Michel-Ange, on vient de retrouver, il y a quatre ou cinq ans, le modèle en cire de sa statue de David, ébauche sublime déposée depuis trois siècles dans une armoire dont le double fond n’avait jamais été aperçu. Ces exemples ne font-ils pas justice de tous les arguments négatifs opposés à la découverte de MM. della Porta et Zotti? ne prouvent-ils pas aux plus sceptiques que s’enfermer dans un système d’incrédulité à l’apparition de tout chef-d’œuvre inconnu, c’est s’exposer presque à coup sur aux plus lourdes méprises? Mettons donc de côté et le silence des biographes et toutes les autres fins de non-recevoir: c’est, en définitive, au tableau seul à nous apprendre de quelle main il est sorti; c’est lui qui doit nous dire s’il peut légitimement prétendre à l’honneur qu’on lui fait. Toutefois, avant de l’interroger, il faut encore que nous nous arrêtions un instant devant une objection préjudicielle. Qu’on nous permette ce mot, car c’est d’une vraie procédure qu’il s’agit. Nous l’abrégerons autant que possible; puis, l’incident une fois vidé, nous entrerons au fond de notre sujet, ou pour mieux dire, nous décrirons et nous essayerons d’apprécier cette grande et touchante composition.