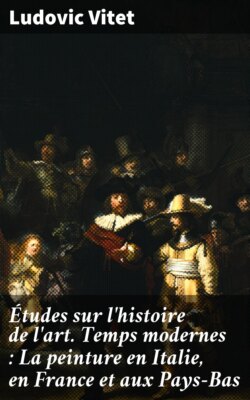Читать книгу Études sur l'histoire de l'art. Temps modernes : La peinture en Italie, en France et aux Pays-Bas - Ludovic Vitet - Страница 6
I
ОглавлениеVers la fin de juillet 1843, un vernisseur de voitures, nommé Masi, prit à loyer, dans la rue Faenza, à Florence, une vaste salle à rez-de-chaussée, dont la voûte en berceau et les épaisses murailles n’avaient guère moins de trois ou quatre siècles: c’était le réfectoire d’une ancienne communauté connue sous le nom de maison de S. Onofrio ou des Dames de Fuligno. Supprimé en 1800, ce couvent de nobles religieuses s’était, quelques années plus tard, transformé en filature de soie, et les chaudières à cocons avaient vomi sous ces voûtes de tels flots de fumée et de vapeur, qu’une couche épaisse de matières charbonneuses tapissait chaque pierre comme l’âtre d’une cheminée.
Le nouveau locataire, pour égayer ce noir séjour, le mit aux mains des badigeonneurs. Déjà la grande salle était à moitié blanchie, lorsque, à l’une des extrémités, on crut apercevoir sous la suie quelques traces de couleurs. Quoique vernisseur de son métier, M. Masi aimait la peinture. Il arrêta le badigeon, défendit de toucher à cette muraille, et se mit à en laver lui-même quelques parties. Le peu qu’il découvrit lui sembla fait de main de maître. Il courut en donner avis aux propriétaires de la maison; mais ceux-ci n’en furent pas autrement émus. Il y a tant de fresques à Florence! il y en a dans les rues, dans les greniers, dans les corridors! où n’y en a-t-il pas? Une de plus n’était pas merveille. Quelques voisins, quelques amis vinrent jeter un coup d’œil sur la découverte de M. Masi, puis il n’en fut plus question. On se mit à vernir des voitures, et deux ans se passèrent sans que personne eût l’idée de nettoyer un peu mieux cette muraille et de la regarder de plus près.
Un jour pourtant un artiste distingué, M. Zotti, passant par là pour surveiller je ne sais quel tilbury, vint à jeter les yeux sur ce grand mur dont les teintes enfumées contrastaient. avec la blancheur des voûtes et du reste de la salle. Il s’approcha. Les parties qui avaient été lavées, quoique encore bien noires, lui laissèrent deviner l’ensemble de la composition: c’était une Sainte Cène. L’ordonnance en paraissait grande et simple; les figures semblaient expressives, bien posées, bien drapées. Il demanda la permission de revenir et de procéder à un lavage complet. Un de ses compagnons d’atelier que bien vite il avait appelé, M. le comte della Porta, fut frappé comme lui des beautés de premier ordre qui perçaient sous ce noir de fumée. Ils se mirent en besogne. Ce n’était pas petite affaire. Cette peinture était large à sa base de quatorze brasses (environ vingt-six à vingt-sept pieds), et elle couvrait tout le demi-cercle circonscrit par l’arc de la voûte. C’était ce vaste champ qu’il fallait lessiver, nettoyer peu à peu, avec des soins et des précautions infinies, sous peine d’attaquer l’épiderme des couleurs.
Le succès fut complet. A mesure que les dernières pellicules de la suie se détachaient, la fresque apparaissait dans sa fraîcheur virginale. Merveilleux privilége de cette façon de peindre! L’enduit n’avait subi que des dégradations très-légères, facilement réparables, et, dans les parties accessoires du tableau; toutes les figures étaient intactes, et les têtes et les mains admirablement conservées. Combien de fresques, et des plus belles, et des plus constamment admirées depuis trois siècles, n’ont pas le même bonheur! L’oubli pour les œuvres de l’art est bien souvent une sauvegarde.
Nos deux artistes, pendant qu’ils poursuivaient leur patiente entreprise, s’étaient, maintes fois demandé : Quel est l’auteur de cette grande page? Ni l’un ni l’autre n’avaient osé répondre, et plus ils avançaient, plus leur embarras redoublait. Dans les premiers instants, lorsqu’ils ne pouvaient encore saisir que le caractère général de la composition comme à travers une sorte de brouillard, ils trouvaient dans son extrême simplicité, dans sa symétrie tant soit peu primitive, de fortes raisons d’en faire honneur à quelque maître de l’école ombrienne, et peut-être à son chef, au Pérugin lui-même; mais lorsque, nettoyant chaque figure, ils eurent découvert certains détails du modelé, reconnu la précision du trait, la fermeté des contours, l’accent individuel et varié des physionomies, il leur fallut changer de conjecture, et pendant quelques instants ils supposèrent qu’une main florentine avait dû passer par là. Parmi les Florentins, un seul, l’auteur des grandes décorations du chœur de Santa-Maria-Novella, avait, dans sa manière de traiter la fresque, d’assez notables analogies avec l’auteur inconnu du cénacle de S. Onofrio; mais si Ghirlandaïo pouvait avoir produit quelques-unes des beautés naïves répandues dans cette composition, était-il raisonnable de lui attribuer cette profondeur et cette justesse de sentiment, cette ordonnance harmonieuse, et surtout cette grandeur, cette poésie de style? Non certes, et nos deux amis y étaient d’autant moins disposés, que, plus ils pénétraient dans leur découverte, plus ils étaient frappés d’une souplesse de dessin et d’une absence complète de parti-pris dont aucun Florentin, y compris les plus illustres, ne pouvait leur donner l’exemple.
Quand ils eurent ainsi bien cherché, et successivement éliminé toutes les hypothèses d’abord conçues par eux, ils commencèrent à n’avoir plus dans la pensée qu’un seul nom, mais un nom qu’ils hésitaient à prononcer, parce qu’il était trop grand. Cependant M. della Porta, se hasardant le premier, dit un jour à son compagnon: «Je pars demain pour Pérouse; je veux revoir la fresque de San-Severo.»
Ceux qui ont une fois admiré cette œuvre des plus jeunes années de Raphaël ne peuvent perdre le souvenir de sa majestueuse disposition. On conserve à tout jamais devant les yeux ce Christ dans sa gloire, ces anges qui l’entourent, et dans le bas du tableau ces six figures de saints posées trois d’un côté, trois de l’autre, ordonnance qui contient en germe l’idée première de la Dispute du saint sacrement. Aussi n’était-ce pas pour se remettre en mémoire l’ensemble de cette composition que M. della Porta allait à Pérouse, c’était pour en étudier les détails et particulièrement les procédés d’exécution.
Il revint convaincu que les deux fresques ne pouvaient avoir été tracées que par la même main et vers la même époque. Celle de San-Severo est datée de 1505: or, Raphaël avait passé à Florence la plus grande partie de cette même année; il y avait fait d’assez longs séjours dans l’année précédente, et enfin, à partir de 1505 jusqu’au moment de son départ pour Rome, c’est-à-dire jusqu’en 1508, il y fut presque constamment établi. Rien n’empêchait donc de supposer que, vers cette époque, il eût fait pour les religieuses de S. Onofrio, aussi bien que pour les camaldules de San-Severo, un grand essai de travail à fresque; mais ce n’était là, pour M. della Porta, qu’une raison secondaire à l’appui de sa conjecture. Avant, tout il s’en rapportait au témoignage de ses yeux: toutes les particularités observées par lui à Florence sur cette fresque, dont les moindres touches lui étaient devenues familières, il les avait retrouvées à Pérouse, et ainsi s’était fortifiée en lui la conviction qu’avait fait naître, dès le premier regard, l’extrême ressemblance, pour ne pas dire l’identité, entre les deux figures du Christ dans les deux compositions.
Il était à peine de retour, que son opinion, dont il commençait à ne plus faire mystère, reçut une éclatante confirmation. Quelques parties de la fresque, entre autres la tunique de saint Thomas, n’avaient encore été qu’imparfaitement lessivées: lorsqu’on vint à nettoyer cette tunique avec plus de soin, on reconnut, sur un galon bleu et or qui la borde, vers le haut de la poitrine, des lettres très-légèrement tracées et entremêlées de quelques arabesques. La dorure qui les avait jadis recouvertes était à moitié détruite, mais les parties qui n’étaient plus dorées se distinguaient encore par une certaine saillie, un certain empâtement de la couleur. On aperçoit d’abord un R suivi d’un A et d’un P entrelacé avec la partie inférieure d’un L. Ces trois lettres, les plus endommagées de toutes, étaient suivies de trois autres beaucoup plus visibles: savoir un V, un R et un S, les deux dernières entrelacées ensemble. Venaient ensuite un A et un D en partie effacés, puis enfin le millésime MDV. Ces abréviations pouvaient se traduire ainsi: Raphael Urbinas, anno Domini 1505.
La découverte fit du bruit dans Florence: on commençait à parler de la fresque et des conjectures de ses deux restaurateurs; mais la foule, peu confiante dans une œuvre anonyme, ne se hâtait guère d’accourir; des qu’il fut question d’une signature, on arriva de tous côtés. Chacun examina, contrôla, mais personne, il est bon de le dire, n’eut seulement la pensée de soupçonner une supercherie. Le caractère bien connu de MM. della Porta et Zotti en excluait l’idée, et les yeux les moins exercés reconnaissaient tout d’abord qu’il n’existait sur cette partie de la fresque aucune retouche, aucun travail fait après coup. Seulement quelques sceptiques se demandèrent si c’était bien là des lettres: la forme leur en semblait indécise. N’était-ce pas un caprice involontaire du pinceau qui avait produit ces caractères parmi tous les méandres tracés sur ce galon? D’autres, faisant moins belle part au hasard, ou armés de meilleurs yeux, admettaient bien les lettres, mais ils étaient érudits et soutenaient que Raphaël, à aucune époque, n’avait signé ses œuvres par de simples initiales ou par des abréviations entremêlées ainsi de méandres et d’ornements. Il leur fut aussitôt répondu que, sur la petite Sainte Famille de Fermo, une des productions les plus authentiques de la jeunesse de Raphaël, on trouve les lettres suivantes: R. S. V. P. P. E. S. 17. A. 1500, c’est-à-dire Raphael Sanctius Urbinas pinxit Perusiæ ætatis suæ 17 anno 1500. En outre, on leur cita la célèbre madone conservée chez les Niccolini, passée depuis en Angleterre, et gravée par Perfetti; sur le galon qui borde le corsage de la madone ne voit-on pas les chiffres de l’année où le tableau fut peint, puis de légers ornements, puis immédiatement après ces deux lettres R. V. Raphael Urbinas ou (Raffaello Urbinate, selon qu’on traduit les initiales en latin ou en italien)? D’autres exemples, non moins concluants, furent encore signalés, et l’objection demeura sans valeur.
Pendant que s’agitaient ces discussions microscopiques sur le galon de la tunique de saint Thomas, une circonstance plus décisive vint trancher le débat, et mit pour un moment les plaideurs hors de cour.
La famille Michelozzi, de Florence, possédait par héritage, depuis environ deux cents ans, une précieuse collection de dessins originaux. Parmi ces dessins, on remarquait avant tout plusieurs feuilles de croquis et d’études qu’une tradition non interrompue attribuait à Raphaël. Un artiste florentin, M. Piatti, ayant acquis cette collection, en céda la moitié, il y a quelques années, à M. Santarelli, sculpteur habile, et déjà possesseur d’un riche cabinet. Les dessins de Raphaël furent partagés entre eux. Ces dessins se composaient de têtes, de mains, de pieds étudiés avec grand soin, et de quelques figures d’hommes qu’on pouvait supposer assis derrière une table, car une ligne tracée au crayon les coupait à mi-corps, et au-dessous de cette ligne on ne voyait plus ni vêtements ni draperies, mais seulement des cuisses et des jambes nues et à peine indiquées par un simple trait. Ces croquis avaient évidemment servi de préparation à quelque tableau; mais à quel tableau? On avait beau chercher, les œuvres connues du grand maître n’offraient rien qui se rapportât à ces études, et on en concluait que, selon toute apparence, le tableau n’avait jamais été exécuté. Certaines figures dans la Dispute du saint sacrement, et particulièrement celle de David, rappelaient, il est vrai, quelques-unes des têtes esquissées sur ces feuilles de papier; mais elles les rappelaient seulement par analogie, par un certain air de famille, et sans qu’on pût établir aucune relation entre les dessins de la collection Michelozzi et la fresque du Vatican.
Il n’en devait pas être ainsi de la fresque de S. Onofrio. Lorsque M. Santarelli entra pour la première fois dans l’atelier de la rue Faenza, il se trouva dès l’abord en lieu de connaissance. Ces têtes d’apôtres, il les avait admirées cent fois: elles n’étaient, pour la plupart, que la reproduction fidèle de ses dessins et de ceux de M. Piatti; le saint Pierre surtout, esquisse étudiée avec plus de précision que les autres, et terminée même dans sa partie inférieure, avait été reproduit trait pour trait sur le mur. C’était un des dessins de M. Piatti. M. Santarelli en possédait une variante, moins achevée et évidemment antérieure. D’autres figures, le saint André, le saint Jacques majeur, se retrouvaient également dans cette collection Michelozzi. Les dessins furent apportés devant la fresque: on les confronta; l’identité n’en parut contestable à personne. Pour ceux qui les connaissaient déjà, et qui, familiers avec le faire et le sentiment des dessins de Raphaël, ne pouvaient mettre en doute qu’ils fussent de sa main, la preuve était sans réplique. Ce fut l’avis de tous les artistes spécialement versés dans l’étude des maîtres. Ainsi M. Jesi, dont la pointe souple et vigoureuse a si merveilleusement traduit le portrait de Léon X, M. Jesi, le religieux interprète des moindres finesses du pinceau de Raphaël, déclara sans hésiter qu’à ce pinceau seul pouvait être due la fresque de S. Onofrio, et telle fut son admiration pour ce nouveau chef-d’œuvre, qu’immédiatement il en entreprit la gravure. Tous les vrais connaisseurs florentins confirmèrent son jugement. Un homme d’autant d’esprit que de savoir, M. Selvatico de Padoue, écrivit à ce sujet quelques pages d’excellente critique. Plusieurs artistes italiens ou étrangers prirent la plume à son exemple: ainsi M. de Cornelius, le célèbre peintre de Munich, M. Bezzuoli de Florence, M. Minardi de Rome , se firent un devoir d’adresser à MM. della Porta et Zotti, non-seulement un témoignage public de reconnaissance au nom des amis de l’art, mais un exposé des nombreuses raisons qui les forçaient à voir dans cette fresque l’œuvre du peintre d’Urbin.