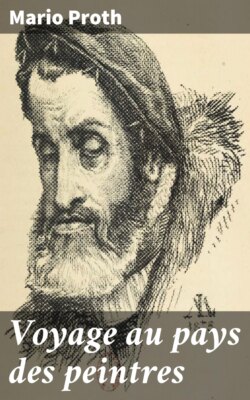Читать книгу Voyage au pays des peintres - Mario Proth - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE IV
ОглавлениеTable des matières
SOMMAIRE: M. Lucien Mélingue et la Levée du siège de Metz. — La tête aux grands, les pieds aux petits. — Karl n’est point fringant. — Un tas de grands d’Espagne. — Hier, Metz la Pucelle, aujourd’hui, Metz, la Violée. — M. Le Blant et la Mort du général d’Elbée. — Un médiocre, donc un impitoyable. M. Magnan et Saint Louis. — Après les papes glorieux, les saints royaux. — Marie-t-on les saints avec les saintes? — La Sainte Élisabeth de M. Ronot. — Marmitan vous semble-t-il risqué ? — Tout ce monde-là ne veut point avoir d’idées. — M. Monchablon et son Titan déchu. — La Jeanne de M. Jacquet en conversation avec Sabaoth. — Bonnes nouvelles de M. Aublet. — M. Bridgman et son divertissement. — Lions ou toutous. — Les Leloir. — M. Hector Leroux et ses élégies romaines. — MM. Motte et Adrien Moreau. — M. Béraud et sa Soirée. — Monseigneur Saint-Progrès, notre patron! — M. Jules Garnier s’en contentera-t-il? — Parole vole, écrit reste.
L’auteur du Matin du 9 thermidor, M. Lucien Mélingue, a pris l’an dernier, par un coup de maître, la tête de la jeune école historique. Par un coup de maître, la Levée du siège de Metz en 1553, il la garde, et tout porte à croire qu’on ne l’en délogera de longtemps. Le choix viril et tout patriotique de ses sujets, leur exécution nette et sobre, solide, hardie, savante et vivante, montrent en lui un fier talent de penseur et de voyant, tout marqué pour les nobles tâches de l’histoire.
En 1552, cette «moitié de Dieu», l’empereur Charles-Quint, était singulièrement ramollie. L’autre moitié, le pape, n’étant plus qu’une ombre, valait mieux et ne gênait personne. Charles-Quint, comme tous les despotes, avait fatigué sa chance, brûlé son étoile. A la profusion des succès l’avalanche des revers avait succédé. Souvent battu et jamais content, il se vengeait de ses disgrâces sur l’humanité, faisant couper la tête aux grands, les pieds aux petits.
De la résolution il tombait dans l’emportement, et non pas encore en enfance, mais en cruauté déjà. Il n’avait, lui-même le dit, plus d’hommes et surtout plus de grands hommes. Or, l’on sait que pour les monarques une telle disette est le commencement du néant, car les trois quarts de leur génie sont fabriqués de génies ambiants. Il ne lui restait guère qu’une sorte de bandit italien, un marquis de Marignan, et le duc d’Albe, une manière de fauve, féroce et médiocre. C’est à celui-ci qu’il confia la direction du siège de Metz, vers la fin de 1552. Le duc de Guise commandait en cette ville, alors comme aujourd’hui si propre à la défense. C’était un homme, et les hommes ne lui manquèrent. Autour de lui, le meilleur de la noblesse française, si ardente au combat, qu’on la dut maintes fois tenir sous clef. Autour de la noblesse, une garnison nombreuse, et les habitants, alors comme aujourd’hui fort décidés. Et puis, l’hiver s’en mêla, très-rude aux assiégeants. Et aussi la maladie, qui les faucha dru... Tant vaillante fut la défense et de si bonne stratégie, et les éléments la secondèrent si bien, que sur soixante mille hommes le césar en perdit trente. Et, après cinquante-six jours de vains efforts, il leva le siège, le Ier janvier 1553, pour les étrennes de nos bons ancêtres messins.
Ainsi les historiens, en quelques pages, exposent cette aventure mémorable; ainsi M. Lucien Mélingue nous la résume en une peinture d’un ordre admirable et d’un saisissant effet. Au premier plan, voici le vieux Karl qui vient de quitter son impériale tente, surmontée de l’aigle à deux têtes. Un respectueux majordome soutient sa pénible démarche. Il a un pied déjà dans la litière, que vont enlever ces deux solides hommes d’armes, bien choisis, pour transporter à quelque carrosse de voyage la fuyante Majesté. Karl n’est point fringant, et nul panache ne se dresse sur la toque râpée qu’il porte basse, comme l’oreille. La Toison d’Or elle-même, seul insigne apparent sur cette vieille robe de velours noir, a des airs désolés. On dirait toutefois qu’il hésite encore. Sa grosse figure ridée et courroucée, son louche regard, tout chargé d’ire et de ruse, sa barbe rouge grisonnante, qui se confond presque avec la fauve fourrure de l’habit, lui donnent quelque aspect d’un tigre lâchant à regret sa proie. Mais, derrière lui, un tas de grands d’Espagne, la tête couverte, selon l’usage, impassibles et raides, vêtus pour le départ et non pour la bataille, surveillent leur maître. «Allons, grogne-t-il, la fortune est comme toutes les femmes, elle ne sourit qu’aux jeunes et se rit des vieux.»
Et, dans quelques instants, l’impérial cortège aura disparu, et les rares soldats valides que l’on aperçoit, errant à travers ce vaste camp à moitié enfoncé sous la neige, se précipiteront pêle-mêle sur les routes. Et tandis que Charles-Quint, sous bonne escorte, et avec ses fourgons pleins, se hâtera vers son plus proche palais, ces mourants et ces morts que l’on porte sur des civières, les jambes ballantes, seront abandonnes dans les glaces et sur les boues à la générosité proverbiale des Français, qui ne leur fera point défaut. Mais ceci est la règle de tous les pays et de tous les temps. Aux chefs la fuite commode, aux soldats la déroute mortelle. De même, après deux siècles et demi, l’apprenti césar Bonaparte lâchera son armée d’Egypte. De même le césar parvenu Bonaparte lâchera son armée de Moscou. De même encore, après trois siècles, le Bonaparte troisième...
Quant à cette ville qui se dresse dans le lointain, blanche sous le ciel noir, groupée autour de sa cathédrale superbe, toute enserrée dans ses remparts comme en une formidable ceinture de chasteté, vomissant ses derniers boulets sur les reîtres germains, nous la reconnaissons, chère ville de notre enfance!... Depuis ce Ier janvier 1553 on l’appelait Metz la Pucelle. On l’appelle aujourd’hui Metz la Violée. Grâces en soient rendues à ce Bonaparte troisième, et à son digne lieutenant, le Bazaine immonde, que François de Guise eût fait pendre haut et court!
Vraiment, ce tableau de M. Lucien Mélingue est une œuvre hors prix, dont l’acquisition honore deux fois l’Etat. Dans le musée qui l’attend, elle sera pour les générations nouvelles un double enseignement. Son exécution est puissante, pour ne pas dire magistrale. Sa composition est plus qu’heureuse, son Charles-Quint est trouvé. Chaque détail y a sa valeur juste, à la place requise, dans une perspective exacte. Œuvre sincère et vigoureuse, harmonieuse et solide, elle ne déclame point. Elle évoque, elle montre, elle prouve. Il y a du Tacite là-dedans et du Michelet. Et Charles-Quint levant le siège de Metz aura pour lui non-seulement l’admiration raisonnée des artistes, mais encore la reconnaissance intelligente des patriotes.
Les qualités essentielles de M. Mélingue, la couleur, le sentiment dramatique, la composition, nous les retrouvons, moins hautes et moins amples, mais très-nettes et très-vives, dans le tableau de M. Le Blant: la Mort du général d’Elbée. Ce que fut ce personnage, on le sait. Bon gentilhomme, courageux soldat et médiocre capitaine. La royauté n’en avait pas voulu faire un lieutenant. L’insurrection vendéenne en fit un général, et après la mort de Cathelineau un généralissime. Ses rares succès furent compensés par de nombreuses défaites. Frappé de quatorze blessures, le 17 septembre 1793, à l’attaque de Chollet, où il prodigua sa personne, il fut à grand’ peine transporté par ses partisans dans l’île de Noirmoutier. Là, il traîna deux longs mois une déplorable existence, ne voulant soigner ses blessures et maudissant l’incurable division des chefs vendéens.
Le 3 janvier 1794, le général Turreau prit Noirmoutier. Arrêté aussitôt, d’Elbée fut porté au conseil de guerre. Son interrogatoire eut ceci de remarquable et de touchant, que le généralissime vaincu et désillusionné offrit de consacrer «sous telle surveillance que ce fût» le reste de ses forces à la pacification de la Vendée. D’un tel homme de cœur, si dédaigneux de la vie, une pareille offre méritait considération. Un Hoche, un Marceau l’eût acceptée. Turreau, un médiocre, donc un impitoyable, la repoussa. Du conseil de guerre on porta d’Elbée sur son fauteuil jusqu’au lieu du supplice, la place de l’Ile de la montagne. Les guerres civiles étant expéditives, on fit d’un peloton cinq coups. Avec d’Elbée, on fusilla ses parents, d’Hauterive, Boisy, Duhoux, un chef vendéen, dont l’oncle, le général républicain Duhoux, avait été fusillé déjà pour s’être laissé battre par son neveu, et Wicland, un républicain qui avait rendu Noirmoutier à Charette. Puis, selon l’usage, devant leur travail, les troupes défilèrent.
M. Le Blant nous montre cette parade lugubre. Au milieu de la grande place où l’herbe pousse, à quelques pas d’une calme rivière où se balancent de petits bateaux, un cadavre tout botté, tout éperonné, ceint de la ceinture blanche, est assis dans un fauteuil. Sa tête tombe, ses bras tombent. Son équilibre est fort instable. Ce cadavre, c’est d’Elbée. Tout à l’entour de lui, quatre cadavres gisent à terre, en des attitudes diverses, dans des flaques de sang. Ce sont des militaires aussi. A droite, le long d’un mur, des compagnies de grenadiers s’éloignent, au pas de circonstance. A gauche, d’autres compagnies attendent, l’arme au pied, leur tour de parade. Face au spectateur, un cavalier, la main sur la hanche, raide sous un manteau noir, coiffé d’un tricorne, empanaché d’un triple panache tricolore, regarde, farouche, les cadavres. C’est, je pense, le général Turreau.
Encore une fois, la Mort du général d’Elbée a tous les caractères d’un drame bien fait, d’une action bien serrée. Vous y chercheriez vainement un détail oiseux, un personnage inutile. Simple est la donnée, forte et sincère l’exécution. Le style, c’est-à-dire la couleur, est mâle, impérieux, sévère, en harmonie parfaite avec l’action. Nous avons sous les yeux une œuvre convaincue, émue. L’émotion de l’artiste nous gagne. Elle est immédiate, poignante et durable. Cette œuvre nous poursuit et nous hante. Elle évoque en nous de graves réflexions et de terribles souvenirs. Elle ravive, et ce n’est pas là son moindre honneur, la haine implacable qu’a dès longtemps vouée notre génération à ces deux monstres: la peine de mort et la guerre civile.
Tandis que monte le talent de M. Mélingue, celui de M. Maignan aspire à descendre. C’est un chrétien fidèle. Parfois il se peut oublier à nous conter en un style assez terne quelque sentimentale historiette, comme celle de l’Amiral Zeno, un vieux brave aveugle qui s’en va, sous la conduite de sa fille, toucher du doigt et des lèvres les trophées de ses lointaines victoires. Mais l’Église, vigilante personne, rattrape son lévite. Après la série des papes glorieux, le voici qui nous entame celle des saints royaux. Ce personnage insignifiant qui s’approche de ce personnage dégoûtant, c’est le sempiternel saint Louis s’apprêtant à guérir les écrouelles du lépreux obligatoire. En vérité, on a bien raison de demander à quoi pensent messieurs les peintres, et dans quelle tradition surannée ils s’obstinent à vivre. On ne conçoit pas une telle ignorance du monde moderne et du dédain tardif, mais profond, où s’effondrent les vieilles légendes. Si encore il y avait là-dedans une inspiration, un souffle d’art! On n’y voit rien que du métier, et un métier mal compris. Le roi et sa suite ne sont que des modèles habillés de costumes plus ou moins exacts. Le lépreux lui-même n’est qu’un lépreux de mélodrame, point convaincu et tout habillé de lèpre déclamatoire. La Faculté ne la contresignerait point, cette lèpre, la Cour des Miracles lui refuserait, le Talrich de Paris, les Curtius de Londres ne lui octroieraient point le fief d’une vitrine.
Marie-t-on les saints avec les saintes en paradis? Pourqu’ils fassent souche, cela n’est point douteux. Alors, Anges du ciel, Dominations et Séraphins, fanfarez sur l’heure aux quatre coins du système solaire les bans du roi Saint-Louis, de M. Maignan, avec la reine Sainte-Elisabeth de Hongrie, de M. Ronot. Aussi édifiants, aussi banals tous deux. Celui-là trompait l’ennui du voyage par le guérissement des écrouelles. Celle-ci, bonne reine de ménage, distribue de la soupe aux marmiteux de son pays. Si «marmiteux» semble risqué, prenez-vous en à cette marmite colossale, principal personnage du tableau. Les mendiants sont d’un réalisme vulgaire. La reine Elisabeth est une dame de romance quelconque. De tels sujets allaient bien au mysticisme des primitifs. Les païens de la Renaissance, virtuoses malins et prestigieux, brodaient, sur ces thèmes ennuyeux des variations éclatantes d’étoffes et de cortèges, d’architectures et de couleurs. Ici, plus de mysticisme et plus de variations, reste l’ennui. Et les facultés de l’artiste s’usent rapidement à cette besogne froide et machinale, industrielle et commerciale. Peut-être attendions-nous mieux de M. Ronot?
Mais encore une fois, que voulez-vous? Tout ce monde artiste est stupéfiant d’immobilisme. Chacun se cantonne, qui dans son coin de paysage, qui dans sa boutique de bric-à-brac, qui dans son chapitre de catéchisme. Tout ce monde-là n’a point, ne peut point et ne veut point avoir d’idées. Ainsi M. Monchablon croit encore à la légende napoléonienne. Pour ce peintre, le sinistre malfaisant qui, parlant de lui-même, s’écriait: «quand je n’y serai plus, le monde dira: Ouf!», le récidiviste des Cent-Jours à qui l’Europe indulgente accorda le bénéfice des circonstances atténuantes est toujours: un Titan déchu! Et il nous l’exhibe, drapé de noir sur son rocher, roulant des éclairs dans ses yeux, tonitruant du front tandis que la mer gronde et qu’une rouge tempête illumine la nue. Tout tonne et tout détonne dans cette œuvre malheureuse, qui prête à sourire. O croyants ultimes, on a vendu tout dernièrement le tricorne de votre Titan, à la salle Drouot, et le vendeur n’a point couvert ses frais. M. Monchablon, vous valez mieux que cela! Laissez ce bonhomme, et retournez à vos Panneaux décoratifs. Ils sont charmants.
Un immobile entre tous, c’est M. Jacquet. Et, s’il continue, il deviendra, comme M. Jules Lefebvre «un phénomène de stérilité ». Chez le premier, on voit depuis de longues années la même femme nue en des poses et sous des noms divers. Chez le second, la belle dame habillée ne varie guère. Elle s’appelle aujourd’hui Jeanne d’Arc priant pour la France. Elle est jolie, bien jolie, brune, bien brune. Elle a une robe de velours et l’on sait s’il est beau, le velours Jacquet. Elle a une cuirasse, une belle cuirasse à faire loucher Desgoffe. Elle est à genoux sur un coussin magnifique. Elle a les mains jointes, les yeux en l’air; elle invite Sabaoth à se prononcer galamment contre l’Anglais. Et puis c’est tout. Ce n’est rien.
J’ai de M. Aublet, j’ai de meilleures nouvelles. Désabusé de la peinture à grand orchestre où l’avaient un temps égaré de décevants exemples, il nous revient avec une petite toile fort intéressante: le Duc de Guise à Blois (23 décembre 1588). Après tant d’autres, il a su tirer parti de cette tragique histoire où Delaroche a puisé sa meilleure, pour ne point dire son unique inspiration. Il a saisi cette minute du récit de Miron où, s’acheminant vers le cabinet royal, la victime désignée du lâche Henri III «se prend la barbe et se tourne le visage et le corps pour regarder ceux qui le suivent». Le mouvement de Guise est très-naturel; sa figure, bien en lumière, est très-historique et très-vivante, les conjurés sont bien campés, bien groupés. La scène est d’un dramatique effet, juste en couleur, et en tradition précise, comme la Chronique du Bourgeois de Paris. Cette œuvre nous semble décisive pour M. Aublet, car elle le marque au premier rang parmi les anecdotiers de l’histoire.
Bataillon utile, chaque jour plus érudit et plus nombreux, où il rejoindra M. Bridgman, l’auteur de cet Enterrement d’une momie, qui nous fit l’an dernier si grande impression. Moins heureux, cette fois, est M. Bridgman. Excellent motif certes, et d’un archaïsme bien tentant que ce Divertissement d’un roi assyrien, mais les lions que ce potentat excentrique s’amuse à tirer à coups de flèches, en présence de sa cour, ne sont que des lions à ressorts, de gros toutous savants. Et le roi et la reine, et les courtisans et les courtisanes, et les gardes et les prêtres, ont l’air de figures à découper pour un jeu de salon.
Au bataillon des anecdotiers, M. Aublet retrouvera les Leloir. A Louis Leloir les siècles d’apparat, le seizième siècle, le dix-septième. Sa page des Fiançailles sous Louis XIII est un quasi-chef-d’œuvre. Sous la vaste tonnelle, à deux pas du manoir aux sveltes tourelles, autour d’une longue table chargée de hanaps ciselés, de rutilantes faïences, surchargée de victuailles plantureuses, tout une seigneuriale compagnie fête l’accord d’une très-belle damoiselle avec un délicieux jouvenceau. Les parents s’attendrissent, les barons aux larges feutres risquent des toasts, les jeunes dames s’épanouissent dans leurs fraises énormes, les musiciens, tout de pourpre habillés, râclent et soufflent à cœur joie. Les costumes sont exacts et splendides, les gens sont vivants, la nature est radieuse, tout rit, tout chante, et les tourelles aussi! Vigny, dans Cinq-Mars, Théo, dans le Capitaine Fracasse, ont-ils été plus historiens et plus poètes? Avec Gérard de Nerval nous fûmes à telle fête dans une de nos existences antérieures. Nous nous en souvenons, et nous en rêvons. On appelle cela une restitution.
A Maurice Leloir le dix-huitième siècle, c’est-à-dire Voltaire, en son triomphe. Admirable et touchante et profonde histoire que celle du Dernier Voyage de Voltaire à Paris. «L’enthousiasme, nous dit Condorcet avait passé jusque dans le peuple... La voiture, forcée d’aller au pas, était entourée d’une foule nombreuse.» Fécond enthousiasme, préface des grands jours, il avait si bien passé dans le peuple, qu’il y resta, et nous nous estimons aujourd’hui trop heureux de le voir remonter à son monde originel, la bourgeoisie, si longtemps dévoyée.
Comme tout artiste supérieur, M. Leloir n’a point eu besoin d’étaler sur une toile immense de longs cortèges avec des allégories confuses. En un seul de ses mille épisodes, il nous retrace tout entier l’unique et merveilleux triomphe. Je vois bien là un de ces carrefours, une de ces grandes belles maisons si caractéristiques du Paris d’alors qu’on nous démolit chaque jour si brutalement, si stupidement. Il y a entre tous ces personnages de toute classe et de tout habit, ceux du balcon et ceux de la rue, communauté de ferveur. Tous les cœurs, tous les regards, tous les pas, tous les applaudissements vont bien à la même personne. Le vieux philosophe, ému et comme répétant: «Mais vous m’allez faire mourir de joie.» est bien le centre de la scène, le Deus, ecce Deus! Là aussi nous y étions et nous nous en souvenons. Cela aussi est une restitution, et, par-dessus le marché, une actualité vraie. Le petit tableau de Leloir aura sa place et une bonne place dans l’histoire du premier Centenaire de Voltàire. Et il survivra bien autrement à la terrible injure des années que la transcendantale Apothéose de M. Thiers, par l’actualiste Vibert.
LUCIEN MÉLINGUE
La Levée du siège de Metz en 1553.
Tête de Charles-Quint.
Anecdotiers de l’histoire:
M. Hector Leroux. Ses élégies romaines ont toujours la pâle couleur, et, quand même, l’on ne se peut défendre de leur charme pénétrant.
M. Motte, le paléontologue infatigable des civilisations antechrétiennes. Son Passage du Rhône par les troupes d’Annibal est une œuvre des plus louables. Devant ses éléphants armés en guerre, transportés sur des radeaux que meuvent à grand’peine d’éléphantesques machines servies par d’innombrables esclaves, le public se presse, et les savants s’exclament. Encore une fois, nous souhaiterions à M. Motte une facture plus ample, un style plus coloré. Tous les écrivains ne sont pas érudits, soit. Mais parmi les érudits combien peu sont écrivains! M. Adrien Moreau, dont le Menuet au seizième siècle nous rappelle, quoique d’un peu loin, tant de pages brillantes, M. Bakalowiez, auteur d’une si vivante et pétulante Fête à la cour d’Henri III; M. Brozik, dont la grande toile, l’Ambassade du roi de Bohême et de Hongrie à la cour de Charles VII, mérite assurément d’être signalée pour sa belle ordonnance.
M. Jules Béraud, que nous aurions pu citer déjà parmi les portraitistes, car son Portrait de Coquelin cadet dans le rôle de Matamore est une des pochades les plus éclatantes, les plus endiablées du Salon. M. Jules Béraud, très-coloriste, possède à un rare degré cette faculté précieuse, connue généralement sous le nom mal défini de vis comica. Aussi bien que personne, il nous traduit, en ses multiples détails, ce Paris cher à Mols et dont M. Herpin s’empare aujourd’hui par une si magistrale vue d’ensemble: Du haut des Saints-Pères, le soir. Du Paris de la rue, Jules Béraud nous mène cette fois au Paris des salons; où sa verve impitoyable se donne libre carrière. Une soirée n’est point, qu’on le sache, œuvre caricaturale. il lui suffit, comme à la délicieuse Soirée de Gavarni, d’être une œuvre observée. Nos fouilleurs de l’avenir, d’un avenir qui sera plus laid peut-être et moins artiste encore que notre présent, y pourront relever tout à leur aise notre luxe richard, nos mobiliers disparates et criants, nos femmes, poupées à traînes et à ressorts, nos hommes, ombres chinoises uniformément tachetées de blanc, nos gandins automatiques, notre société sans cohésion, nos assemblées sans plaisir, notre ennui, ce lourd ennui, dont Monseigneur Saint-Progrès, notre patron, nous garde!...
A M. Jules Garnier, enfin, que nous qualifiions il y a deux ans l’un des maîtres du genre, nous devons une mention toute particulière. Il a cette année abordé un fort grave sujet. Ce n’était point petite affaire, à notre gré, que de pourtraicturer cette séance à jamais célèbre du 17 juin 1877, où, provoquées par les impertinentes hâbleries de l’ordre moral, les trois gauches saluèrent, d’un applaudissement unanime en M. Thiers le puissant, l’unique initiateur de la libération du territoire. Un mouvement extraordinaire souleva la salle, de l’hémicycle aux tribunes. Il y eut là un moment indescriptible et prodigieux, la véritable apothéose de M. Thiers. Un tel moment appelle la grande peinture d’histoire. Mais celle-là, nous l’avons dit, ne s’exécute point sur l’heure et veut, pour une impression plus juste, des horizons plus lointains.
Le brillant anecdotier du Droit du seigneur, du Roi s’amuse, du Supplice de la truie, a-t-il prétendu à si haute gloire? Non, sans doute. Mais il nous a voulu donner et il nous a donné un croquis sur le vif et dans son cadre moyen une impression moyenne du mémorable événement. Toute une partie de l’œuvre, témoignant d’un sérieux travail, est bien venue. L’impassible et magistrale figure de M. le président Grévy domine bien la scène. Sous lui, l’horrifique et mirifique M. Fourtou, debout à la tribune, coupé dans sa rhétorique par l’explosion soudaine, vous a des airs pincés tout à fait réjouissants. Au pied de la tribune, quelques figures principales sont bien groupées et largement traitées. Mais le geste célèbre de Gambetta, l’émotion de M. Thiers, ne sont point assez indiqués. Il y a du fouillis et de l’entassement sur les bancs de la gauche. Les attitudes des représentants ne sont point assez variées, et le public demeure figé dans une inexplicable réserve. N’importe, cette petite toile, fort animée quand même, remplie d’heureux et véridiques détails, a conquis de suite une très-suffisante popularité. M. Jules Garnier s’en contentera-t-il? Homme de talent, qu’il remette courageusement sur le métier son œuvre hâtive, et, par de faciles amendements, la parole qui vole deviendra l’écrit qui reste.