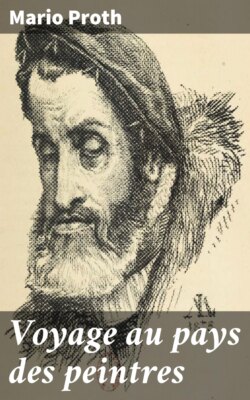Читать книгу Voyage au pays des peintres - Mario Proth - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER
ОглавлениеTable des matières
SOMMAIRE: Donc M. Vibert, un beau matin.... — L’ange de l’Institut. — Et M. Vibert comprit. — Anch’io! — Un homme venait de mourir. — Ange et farceur. — On dit monsieur Thiers. — Le Père-Lachaise est l’antichambre de l’olympe. — Quatre municipaux et trois fantassins. — La Commune? non, mais une femme commune. — Le pavé de l’ours à la tête d’un dieu. — L’historiographie n’est point l’histoire. — O cette Maria! — Sous votre arbre, bons pères. — Tout autre que Carolus Duran. — La direction des postes olympiennes. — La Renaissance est là ! — Carolus et Tiepolo. — Un plafond plafonnant de plafonnerie. — M. Ranvier et son Aurore parisienne. — Que diable rêvait cette Nuit? — Une modestie réglementaire. — M. Roll et les augures. — Jules Simon ou Jules Janus? — On a ses jours et aussi ses années. — Et M. de Chateaubriand? — Le Jules Simon de 1878. — Encore un Bonaparte en Égypte! — Une photochromie économique et mirifique. — M. Detaille, laissez l’Afrique à M. Benjamin Constant. — Ils sont effroyables, ces misérable. — Hélas! je n’ai pas vu l’Orient. — MM. Paul Colin et Destrem. — Le manitou aux vaches. — M. Escalier et son panneau. — Tous caquettent et tous coquettent.
Donc M. Vibert, un beau matin, se réveilla tout rempli d’une joie pétulante et pure. Un ange lui était apparu pendant la douceur d’une profonde nuit, l’ange de l’Institut, reconnaissable à ceci, qu’il a pour vêtement une épée de salon, et pour ailes lui battant aux épaules deux pans d’habit à la françaisé, brodés de palmes vertes. Et l’ange lui avait dit: «Relève enfin ton front superbe. Dédaigneux des clameurs d’une critique envieuse et basse, cours où ta destinée t’appelle. Toi aussi, je te l’assure en vérité, tu seras un grand peintre d’histoire. Rien ne te sera plus facile, crois-moi, que ce genre inférieur; avec une toile hors mesure et ton chic suprême, l’on s’en tire. Brosse-nous une belle affaire, et les peuples applaudiront. Et sur le seuil du Temple auguste, Cabanel te lancera par une trompette d’airain le ps’t, pss’t des jours solennels.» Et M. Vibert comprit. Cet ange de l’Institut a la parole si claire. «Anch’io! s’écria-t-il. Attends un peu, critique basse et envieuse, tu vas voir ma noble vengeance! Anch’io! je secouerai la poussière de mes sandales, désormais académiques, sur le seuil de l’Antichambre de Monseigneur. Tu ne me reverras plus, Boutique du nouveau commis. Anch’io!» Et il releva son front définitivement superbe. Et il chercha. Et il trouva.
Justement, un homme de quelque célébrité venait de mourir, M. Thiers, pour ne vous rien céler. Quelles funérailles! il vous en souvient. Hector le Troyen, Alexandre le Macédonien, Washington l’Américain, en eurent-ils jamais de pareilles? Le doute est permis. «O l’actualité magnifique! pensa M. Vibert. Ma belle affaire, je la tiens.» Et, séances tenantes, il brossa de M. Thiers l’apothéose que voilà.
Et les peuples n’applaudissent point. Leur en vouloir est au-dessus de nos forces. O trop confiant M. Vibert! vous n’écouterez plus, je gage, les plaisanteries de cet angélique farceur. Il vous a mal conseillé, et vous avez mal choisi, et plus mal encore vous avez peint. Votre talent, si léger, s’est égaré dans une grosse aventure qu’eût soigneusement évitée le génie d’un Delacroix. Une actualité, si énorme qu’elle soit, appartient au Journal Illustré. Entre elle et la légende il y a ce long espace, l’histoire. Et d’ailleurs on divinise, après des siècles de gloire, un poète quelquefois, un homme politique jamais, alors surtout qu’il compte six mois à peine de postérité. Le héros de M. Vibert sera-t-il quelque jour divinisé ? Je ne sais, car toujours on l’appellera M. Thiers.
Un dieu, d’ordinaire, n’est ni couché, ni mort, et le Père-Lachaise n’est que l’antichambre de l’olympe. Un dieu plane, ou il agit. Il juge, il guerroie, il foudroie, ou il se promène dans quelque campagne élyséenne. On ne se l’imagine pas étendu sur un catafalque, même en carton pâte, et flanqué de coqs gaulois. La meilleure figure de votre tableau est celle de cette belle dame en deuil, la France, n’est-ce pas? Mais pourquoi recouvre-t-elle le défunt tout justement de la partie rouge du drapeau tricolore? Et s’explique-t-on comment, si ce geste est spontané, l’étoffe ne recouvre point aussi toute cette batterie de cuisine de la gloire, cette quincaillerie officielle? On dirait un vieux magistrat ou quelque professeur de Faculté, enseveli par testament dans sa robe écarlate, avec toutes ses décorations. Gros effet, et bien théâtral, et bien vulgaire. Votre mort est ressemblant à peine, jaune, mal embaumé, renfrogné, guère imposant. Où donc est le million d’hommes qui escorta jusqu’à sa. tombe le Président? De cette apothéose immense et authentique, la seule qui vous eût dû inspirer, vous nous avez conservé un corbillard de première classe, quatre municipaux, trois fantassins, et une hotte de couronnes d’immortelles. C’est peu, c’est triste, c’est banal, c’est laid. Dans les nues, ces ombres de grognards qui défilent, avec des gestes héroïques, sans doute elles nous évoquent l’Histoire du Consulat et de l’Empire. Mais ces rééditions, ces dilutions, ou, pour parler franc, ces «resucées» de la rengaine Raffet et Cie, n’ont vraiment plus de quoi nous toucher...
Il est dans cette œuvre toute une part considérable sur laquelle volontiers nous aurions gardé le silence. Abattue et rebattue, gisante sur son rouge étendard, essayant, en un dernier effort, d’allumer à sa torche l’écusson de Paris, cette mégère échevelée? non, mal peignée seulement, cette Euménide de barrière, c’est la pétroleuse poncive, invention des gazetiers de l’an 1871. D’aucuns y voient la Commune. Je n’y vois qu’une femme commune. A l’horizon, ces batteries en travail, ces monuments en feu, nous connaissons cela. Il fut un temps où cela se vendait fort bien, mais les marchands de photographies n’en veulent plus. Pourquoi, ô artiste, oubliant le libérateur du territoire, avoir à cette apothéose infligé ce souvenir sombre? Pourquoi avoir, maladroit fidèle, jeté à la tête de ce dieu endormi le pavé de l’ours de la guerre civile? Croyez-vous donc que M. Thiers tut si heureux d’avoir Paris à conquérir? Quand l’histoire se fera de ces journées lugubres, bien des choses étranges seront démontrées. Jusque-là, comme en un vaudeville célèbre, la consigne est de ronfler. Tandis que les plus apeurés se rassurent, et que les plus implacables fléchissent, alors que par-devant l’Europe accourue Victor Hugo proclame cette amnistie que tous réclament, votre pétroleuse, ô peintre, arrive un peu tard!... N’insistons pas. M. Vibert, homme d’esprit libéral et galant homme, saura bien prendre sa revanche. Il y a dans son œuvre des qualités incontestables; de l’habileté surtout, et du mouvement qu’il faudra ordonner. Ni critique, ni pédant, nous ne le condamnerons point à l’historiette forcée. Qu’il reste dans l’histoire désormais, c’est son droit et presque son devoir. Il y a, dans son effort même, toute une volonté de favorable augure. Mais cette Muse-là, qu’il ne l’oublie point, sévère entre toutes, n’accorde ses restreintes faveurs qu’aux réfléchis, aux patients, aux sincères.
Et maintenant retournez-vous, et de toute votre attention, avec tous vos souvenirs et toute votre justice, contemplez ce plafond de Carolus Duran. Quel titre et quel sujet! Ce n’est point l’histoire, cette fille légitime et si jeune encore de l’esprit moderne, c’est l’historiographie, cette impudente bâtarde, cette vieille courtisane, qui les a dictés. Aussi bien
Le latin dans les mots bravant l’honnêteté,
nous lisons au livret cette audacieuse légende qui n’a de pudeur qu’en sa brièveté : Gloria Mariœ Medicis. Certes, notre siècle songeait peu à cette apothéose. Une gloire en 1878, une gloire encore à cette bête et odieuse femme, si funeste à notre pays, à cette créature des jésuites et complice de Ravaillac! Une gloire à cette épaisse tonton qui, sans Richelieu, eût perdu la France, et qui lui amena tant de malheurs, et aussi tant d’aventuriers qui firent souche! A cette gloire extraordinairement posthume, et indéfiniment attardée, il n’était qu’un refuge à peu près explicable, le palais du Luxembourg, que cette Maria fit bâtir, que Rubens lui décora, et qui attend le plafond de Carolus Duran. O commande officielle, voilà de tes coups! Au Panthéon le catéchisme, au Luxembourg la turlutaine monarchique. Le système est complet vraiment, d’un mécanisme ingénieux et subtil, faisant tout honneur à l’esprit d’intrigue de nos révérends administrateurs. Pour que l’arbre, par leurs soins planté, l’arbre de l’ignorance du bien et du mal, porte les fruits rêvés, il ne manque plus que deux conditions, fort aisées d’ailleurs à obtenir: un retour bienveillant du siècle en arrière, et la complicité de la nation française. Sous votre arbre, bons pères, espérez, cela viendra.
Tout autre que le talent robuste et nerveux de Carolus Duran eût été fatalement inférieur à sa lourde tâche, et il ne fallait rien moins que son prestigieux pinceau pour écrire sur ce thème plus que menteur une belle page de rhétorique décorative. Notre brillant coloriste a soutenu, jusqu’au bout, cette gageure avec un rare bonheur, justifié par une habileté surprenante. Le temps, disons-le une fois pour toutes, nous pressera trop cette année pour qu’il nous soit loisible d’entrer en un récit détaillé de chaque composition, et de l’œuvre présente nous ne tracerons qu’une esquisse rapide avec plus rapide commentaire.
Dans un imperturbable azur, au seuil d’un temple de gloire, circulaire, aux sveltes colonnes, gracieux et léger, trône une reine tout de blanc habillée. Une douce et jolie blonde, reine de Perrault qui ne garde, s’entend, de l’historique Maria que la plus idéaliste des ressemblances. Une Religion, une Charité, chastes et sévères, une Vérité, toute nue, belle et hardie comme le Mensonge, une Renommée, point paresseuse, assistent et célèbrent la divinité du jour, et de gentes nymphes donnent la volée aux pigeons voyageurs que chargea la direction des postes olympiennes de distribuer aux mortels «la bonne nouvelle».
Très-bonne assurément, si l’on en juge par l’allégresse bruyante et l’entrain sans pareil des spectateurs d’en bas. O la pittoresque vision et le tohu-bohu charmant que voilà ! C’est un rêve, mieux encore, c’est une évocation. La Renaissance, l’incomparable Renaissance est là qui tressaille, s’exalte et défile sous nos yeux, avec ses balcons aux riches draperies où s’accoudent les élégantes beautés, ses coursiers empanachés, ses cavaliers superbes, souples dans l’armure, fiers sous le casque, ses patriciennes de noble allure et ses paysannes sculpturales, ses costumes chatoyants et ses nudités radieuses, ses pages endiablés, ses varlets bigarrés, ses Maures en vrai bronze et ses nègres plastiques, ses mannes de fruits, ses corbeilles de fleurs, ses guirlandes de femmes, ses feux et ses sourires, sa luxuriante jeunesse et son Messidor éternel, sa cour du Décaméron et son peuple d’opéra. Que de groupes variés, que d’attitudes heureuses et de personnages bien campés! Cette foule se meut, ce mouvement est sonore, ces bouches crient, ces mains applaudissent, ces regards se cherchent, ces gestes s’appellent, cette peinture éclate et chante. Cette couleur, ce bruit, ce brio, c’est bien une fête, c’est la Fête! Et sans contredit la meilleure et la plus vivante part de l’œuvre, celle où s’affirme le plus librement ce talent de Carolus Duran, avant tout épris des réalités magnifiques, visiblement rebelle aux errements des académiques mythologies.
La Gloire de Marie de Médicis a éveillé chez nombre de personnes, chez nous particulièrement, qui fréquentâmes beaucoup ce maître à Venise, le souvenir de Tiepolo. Il y a, certes, entre les deux manières, entre les deux verves, de très-frappantes analogies. Par sa couleur, du reste, comme par son entente de la composition, Carolus Duran est parmi nous le représentant le plus accrédité de l’école vénitienne. Il l’a longuement et fructueusement étudiée. Très-personnel, fort indiscipliné, il ne la copie point. Il la rappelle, et il en continue librement la très-libérale et scientifique tradition. Sa filiation directe est au seizième siècle; son tempérament, sa volonté, son idéal sont au dix-neuvième. Les défauts même et les imperfections de son œuvre trahissent cet amour impérieux de la vie, cet irrésistible sentiment de la réalité, caractères distinctifs de notre époque. Poncif et convaincu, il eût installé sa divinité au sixième étage de l’empyrée, au lieu de l’asseoir en quelque sorte parmi ses terrestres fidèles. Il eût donné moins de carrière au peuple et plus d’importance aux allégories. Il eût été plus respectueux, plus calme, plus ordonné, moins touffu, moins tumultuaire, moins bruyant. Un mot encore. Les ignorants, les savantissimes et les amis ont amèrement critiqué l’équilibre instable, la perspective singulière des dispositions architecturales, et tout de suite ils ont péremptoirement décidé que ce plafond ne plafonne pas. Quoique très-ignorant, nous ne trancherons point cette grave question. Quand aura paru ce livre, la Gloire sera en place, et alors seulement, avec tout le monde, nous jugerons si ce plafond est, comme dirait Rabelais, un plafond plafonnant de plafonnerie. Ce que dès maintenant avec tout le monde nous savons et jugeons, c’est que l’on chercherait inutilement parmi les Nestors de l’Institut, et que l’on trouverait difficilement parmi les peintres de l’âge de Carolus Duran, un gaillard capable de mener à meilleure fin une telle entreprise. Et nous ne doutons pas que, prochainement délivrée des influences rétrogades et cléricales, la République française ne propose à M. Carolus Duran quelque autre Gloire humaine, moderne, historique et sensée, véritablement digne de son éloquent et magistral talent.
Et celui-là, plafonnera-t-il, au palais de la Légion d’honneur, le plafond de M. Ranvier? J’en accepte l’augure. En tout cas, il se présente fort bien sur la cymaise du salon carré. L’Aurore! simple et éternel sujet, jamais rebattu, jamais menteur. Nul apparemment ne pouvait mieux inspirer ce peintre aimable que ses défauts ont cette fois servi peut-être autant que ses qualités. Aurore jolie et blonde, qui laisse aller son rose voile aux mains d’un génie impatient. Élégante et fugitive souveraine de ce ciel doux et tendre comme un ciel de boudoir, elle séduira sans effort les quelques vertueux qui se hasarderont à la contempler. Aurore discrète, elle ne troublera point de ses rayons bien appris le sommeil savant du paresseux, ni le repos à peine commençant du veilleur attardé, ni le long baiser, si court, de Romeo et Juliette. C’est une aurore parisienne. Et cette joueuse de cymbales assise sur la nue, et son coq rutilant, aux ailes éployées, au bec largement ouvert, et ces génies qui collent leurs petites bouches à leurs grands clairons, ils attendent, je gage, un geste de leur patronne pour frapper, chanter, sonner la vie nouvelle, car ils n’ont point réveillé encore cette Nuit que vous voyez là, si belle et si bellement accoudée, poursuivant quelque divin songe où pourrait bien jouer son rôle un camarade fort connu de ce gamin céleste qui la regarde malignement, en soufflant sa lampe. Tout est esprit, tout est nuances, rêve, crépuscule, dans cette œuvre si bien comprise et si bien venue, le chef-d’œuvre de son auteur. Tout, sauf les carnations éblouissantes des divinités athéniennes qui emplissent de leurs radieuses personnes cet adorable firmament. Mais encore, la gaze et la brume les enveloppent. Elles flirtent avec un quartier de lune, elles coquettent avec l’étoile du matin; elles sont séduisantes et chastes. Elles glissent, immortelles, et n’appuient pas. Qu’on se rassure en haut lieu, les intéressantes pupilles de la Légion pourront arrêter sur ce plafond un candide regard, sans que leur modestie réglementaire en demeure le moindrement effarouchée.
Il n’est point au Salon carré que cette imposante trinité d’allégories.
Tout à côté de M. Thiers canonisé, voici, par une piquante coïncidence, la très-fidèle et très-véridique effigie de son plus intime et plus apprécié collaborateur, Jules Simon, œuvre nouvelle et non la moins durable de Roll. Participant au destin de l’original, ce portrait a subi mainte attaque. Contre cette toile la critique a fait houle, comme si souvent contre l’homme d’État la vague des partis. Et jamais plus qu’en cette occurrence elle n’a justifié le vieux Boileau. Jamais peut-être la critique ne fut plus aisée, plus banalement facile, jamais l’art ne fut plus difficile.
M. Roll, ont dit les augures, M. Roll s’est trompé. Il n’a été que vigoureux, le très-vigoureux auteur de la Chasseresse et de l’Inondation. Vigueur inutile et intempestive! Il a prodigué la force là où il fallait quasiment exagérer la finesse. Il nous devait un Jules Simon complet, c’est-à-dire complexe, que dis-je, un Jules Janus, mi-parti causeur et mi-parti orateur, souriant beaucoup à droite et à gauche, tonitruant un peu, malin surtout et ironique, et onctueux et épiscopal. L’un d’eux même, et un admirateur plus ou moins adroit du philosophe, s’est écrié : «Il peint M. Simon à la suie, quand l’eau de rose bénite n’eût pas été de trop.» Si ce coloriste de l’avenir nous a récréé, vous le devinez sans peine.
Eh là ! là ! bonnes gens, augurales personnes, la réflexion vous est-elle donc interdite? M. Jules Simon, nature très-complexe, en effet, nature d’artiste s’il en fut, n’a point la physionomie stéréotypée, faussement légendaire, le masque de commande qu’il vous plaît de lui attribuer. Il a ses jours, comme tout le monde. Il a aussi ses mois, voire ses années, comme tout artiste. Le brutal Seize-Mai l’a cruellement frappé dans sa plus plus haute ambition, dans son plus légitime orgueil. Une coupe débordante lui a été versée, coupe d’amertume, de fiel, d’ingratitude et d’outrages, qu’il a dû vider jusqu’à l’extrême lie. Que le goût lui en remonte incessamment aux lèvres et gêne un peu le sourire demandé, qu’il oublie rarement et même qu’il se souvienne toujours, cela vous étonne-t-il, observateurs légers? Quand M. de Chateaubriand, autre artiste, fut jeté sans phrases, en cinq minutes, à la porte du ministère par son doux Roy, cet épais Louis XVIII qui conserve encore parmi les imbéciles quelque renom d’esprit, croyez-vous qu’il offrit de longtemps à ses contemporains un visage rasséréné ? Sa colère fut si grande, qu’il la fit immortelle. Aux angoisses morales ajoutez une maladie qui fut longue et dangereuse, et vous comprendrez pourquoi, à peine convalescent de sa double torture, le modèle de M. Roll n’a point l’air de monter au Capitole, ni même d’entr’ouvrir l’inépuisable trésor de ses anecdotes à quelque visiteur privilégié.
M. Roll, qui voit bien, a peint dans la manière énergique et vibrante qui est sienne, il a écrit pour ses contemporains et pour l’histoire le Jules Simon de 1878, grave, réservé, soucieux, récapitulant les fautes commises et calculant les revanches possibles, préparant, qui sait? le triomphe académique de M. Henri Martin, ou la prochaine campagne des élections sénatoriales. Il l’a bien assis, bien posé, dans un intime et méditatif abandon. La main droite, nerveuse et potelée, eût enlevé le scientifique enthousiasme du capitaine d’Arpentigny, et si la gauche, dans l’ombre, est trop noire, une facile retouche la blanchira. Il a vivement, habilement éclairé cette face typique, et ce n’est pas nous qui lui reprocherons de l’avoir projetée sur un sombre rideau. Autour d’une telle personne, les accessoires sont gênants et ridicules, les mobiliers inutiles. Bien au contraire, dans çe portrait de Madame ***, si chaud, si harmonieux, M. Roll a donné à l’intérieur familial toute son opportune valeur. Autour de la vénérable douairière bourgeoise, doucement souriante et coquettement épanouie dans son vaste fauteuil Louis XIII, il a sobrement groupé le confort artistique de notre époque. Ici et là, il a bien compris son modèle. En somme, et pour en finir avec le portrait de M. Jules Simon, les critiques du jour passeront, otiosa verba, et il restera pour nos Vasari et nos Michelet futurs le fier témoignage de l’un des rares vaillants de la jeune école moderne.
Une mesure fort explicable et bien accueillie de tout esprit sérieux ayant écarté, pour cette année, du Champ-de-Mars et des Champs-Élysées tout épisode militaire contemporain, M. Détaillé, en homme pratique, a pénétré dans le Salon carré par un Bonaparte en Égypte. Ce vieux sujet poussif n’éveillera pas, j’en réponds, la moindre susceptibilité internationale, et il n’ajoutera pas le moindre succès au répertoire de M. Détaille. Pour restituer un peu, si peu, cette tant vieille légende usée jusqu’à la dernière de ses dernières ficelles, il faudrait une imagination prodigieuse, armée d’une palette jusqu’à nous inconnue. Il faudrait un menteur de génie. Tel n’est point le cas de M. Detaille; ses qualités comme ses insuffisances lui interdisent le rôle de magicien.
L’actualité va bien mieux que l’évocation, et bien mieux aussi notre ciel commode que l’exigeant soleil d’Orient à son talent correct, d’une exactitude un peu froide. Tous ses personnages, général, état-major, mamelucks, grenadiers, prisonniers, Arabes, Français, y compris les chevaux et les dromadaires, ont l’air empaillés. Ce petit tableau pourra servir de modèle à quelque montreur de cires, et l’on en tirera volontiers une gravure bon marché ou une photochromie économique et mirifique à l’usage des derniers gobe-mouches, s’il en reste, qu’attendrit encore le souvenir des quarante siècles perchés sur les Pyramides.
Que M. Detaille revienne donc à ses régiments sur le boulevard ou à ses escarmouches dans la banlieue parisienne, et qu’il abandonne résolument l’Afrique à ce jeune maître, M. Benjamin Constant, dont voici tout près, au même mur et sur la même cymaise, une page splendide: La Soif — prisonniers marocains. L’auteur de Mahomet Il à Constantinople a-t-il été jamais mieux inspiré ? Je ne le crois pas. Sous un ciel implacablement lourd, où s’amasse et roule une noire colonne de simoun, une chaîne de quatre prisonniers marocains a rencontré un filet d’eau sale, imperceptible dans le sable immense. Un oubli, une ironie. Par faveur spéciale, ils se sont précipités, couchés, vautrés dessus. Ils le boivent, ils l’aspirent, ils le hument, et le sable avec. Ils le dessèchent. L’un d’eux, un ambitieux, y a puisé la moitié d’une gourde. Ils sont effroyables, ces misérables. Torquemada passant par là les amnistierait. A leur tête, sur un coursier magnifique, aux naseaux haletants, un grand janissaire noir dans un burnous blanc, le regard sévère et dédaigneux, déjà impatient. Au-dessus d’eux, une espèce de garde-chiourme, accroupi comme un orangoutang, laissant aller sur ses maigres genoux ses longs et maigres bras pendants jusqu’à terre, profile sur l’horizon sa face bestialement, férocement indifférente. A son côté, un énorme yatagan de boucher. Droit entre ses jambes, un fusil dont l’interminable canon s’en ira tout à l’heure percer la nue. Au loin, tout au loin, des collines d’un bleu sombre. Cela est simple, cela est poignant. Cette petite toile, d’un dessin si ferme, d’une facture si énergique, est une ébauche. Cette ébauche est une oeuvre.
Et nous la préférons à ce Harem marocain, si attrayant à la masse des visiteurs. M. Benjamin Constant sait son Orient, il nous l’a souvent prouvé. Il nous le prouve encore. Mais cette fois, ne s’est-il pas laissé, comme on dit très-vulgairement, emballer par son Pégase oriental? Son Harem est très-vivant, très-pétulant, et, s’il nous le représente ainsi, c’est, sans nul doute, qu’il l’a vu tel. Mais la mise en scène, cependant, n’est-elle pas ici un peu trop évidente, et ce rayon de soleil, droit et guindé, ne semble-t-il pas une lumière électrique à feux tournants? Sous toutes réserves, car, hélas! je n’ai point vu l’Orient et suis très-disposé à l’entrevoir, jusqu’à nouvel ordre, à travers le prisme aimable de M. Benjamin Constant.
Deux toiles encore nous intéressent au salon carré, deux bons paysages. L’un est de M. Paul Colin; il a pour titre: La Maison du charron à Yport (Seine-Inférieure). Beaucoup moins éclatante et décorative que le Clair de lune de l’an passé, un peu trop sage même et un peu triste, la Maison du charron nous fait suffisamment apprécier le constant effort, ou mieux le constant progrès de M. Paul Colin. Sa manière se précise; elle devient chaque année plus scientifique, dans la meilleure acception du terme, et accentue d’autant les qualités natives de cet aimable talent: l’honnêteté, l’intimité, la sincérité.
L’autre paysage a pour auteur M. Casimir Destrem et pour sujet: La Saint-Roch: bénédiction des animaux dans la campagne du Languedoc. Il est fort remarqué, non sans motif, dans le monde artiste. C’est que M. Destrem, lui aussi, est un sincère. C’est par la sincérité seule qu’il a pu vaincre la très-grosse difficulté de son sujet: le ridicule. Rien n’est plus burlesque assurément que cette cérémonie de la bénédiction des bestiaux, visible encore en Bretagne et dans certains départements du Midi. M. Destrem, néanmoins, nous a rendu presque touchante et explicable l’émotion religieuse de ces braves terriens qui voient, avec la foi robuste de l’intérêt, descendre, aux appels de leur curé, la protection de quelque complaisant manitou sur une bien chère, quelquefois la plus chère partie de leur famille. Il a franchement abordé les monotonies d’une telle scène, et, par cette franchise même, il s’en est dextrement tiré. Ses hommes sont bien bâtis, ses animaux bien construits; l’ordonnance de sa cérémonie est un peu gauche, ses paysans sont un peu rangés comme des capucins de cartes. Le curé, personnage principal, s’efface trop dans le lointain des derniers plans, et, pour tout dire, le paysage pèche trop par la perspective.
Mais ce sont là des défauts que l’avenir corrigera aisément. Quand on a, comme M. Destrem, les facultés innées, vitement l’on arrive, et sûrement, à cet inévitable résultat du travail, la science.
J. BASTIEN-LEPAGE
Les Foins
Midi!... Les prés fauchés sont baignés de lumière.
Sur un tas d’herbe fraîche ayant fait sa litière,
Le faucheur, étendu, dort en serrant les poings.
Assise auprès de lui, la faneuse hâlée
Rêve, les yeux ouverts, alanguie et grisée
Par l’amoureuse odeur qui s’exhale des foins.
André THEURIET.
Ces deux grands travaux décoratifs, la Gloire de Marie de Médicis et l’Aurore, ont, au Salon, quelque chose comme un petit frère qu’il convient de citer tout à leur suite: le Panneau décoratif pour un vestibule, de M. Escalier. Pour le vestibule de quelque féerique demeure, assurément, un temple du plaisir, un hôtel de la richesse ou un palais de l’art! C’est la préface d’une fête des Mille et une Nuits, le frontispice d’un éternel Décaméron. Sur un balcon aux légers balustres, sous une luxuriante tonnelle, des dames en gaieté, des pages en liesse, des seigneurs en folie, des fous en exercice, mènent un carnaval intime. Ceux-ci agacent un magnifique ara qui braille à se décrocher le bec; ceux-là lutinent un sapajou qui grince, et siffle, et se tord à rompre sa chaîne. Cet autre, à cheval sur la balustrade, accompagne des tendres accents de sa mandoline la cacophonie épouvantable. Tous coquetent et tous caquettent. La scène est d’une joyeuseté sans pareille, brossée avec un brio extraordinaire, éclatante et harmonieuse.
Et ceci se passait au seizième siècle, en quelque palazzo florentin, ou bien à la libre cour de François, père des lettres, ou peut-être bien en quelque asile du lugubre Escurial, entre courtisans échappés pour une heure à la surveillance du maniaque Philippe II.