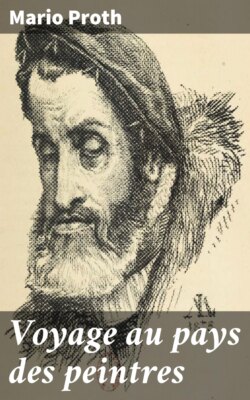Читать книгу Voyage au pays des peintres - Mario Proth - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE V
ОглавлениеTable des matières
SOMMAIRE: Le plus d’idéal dans le plus de réel. — Français, Harpignies, Hanoteau. — Aimez-vous mieux la mélancolie? — M. Pelouse et son Passage. — Madame la Chambre, je vous les recommande. — Connaissez-vous Landerneau? — MM. Lansyer, Lhermitte, Dameron. — La Normandie a ses peintres servants. — MM. Guillemet, Flahaut. — Autour du chalet d’Alexandre Dumas. — MM. Vuillefroy, Van Marcke et Émile Vernier. — Il ne vous en faut plus qu’une, M. Butin. — A genoux devant Coco. — M. Beyle, n’écoutez pas les gens sérieux, s’il en reste! — M. d’Alheim et sa Brûlée. — Vous revoilà, pays de l’Astrée! — Récompense ou impertinence? — M. Rapin, Hégésippe Moreau et la Femme de la Bible. — Du Doubs aux Vosges il n’est pas loin. — Mlle Frisler et les Hêtres de Retournemer. — Où M. Zuber a vu la forêt du Dante. — M. Feyen-Perrin, et sa Mort d’Orphée. — M. Dagnan-Bouveret, et la Mort de Manon Lescaut. — Les petits bas bleus de la pauvre morte! — M. Poilpot et sa Proie. — Il se méfie encore, le gourmand. — Moins ambitieux et plus gai, M. Baudouin. — M. Léonce Petit. — O jury! ô gendarmerie! — M. Palizzi, nous les avons déjà vu jouer. — M P. Éraire, époux de la Marne. — M. Méry, la cire, et M. Cros. — Sic vos non vobis. — Impressionnisme et opposition constitutionnelle. — On en rira longtemps.
Le paysage, c’est toujours bien convenu, est la meilleure gloire, la plus abondante et la plus solide de la moderne école française. C’est là, jusqu’à nouvel ordre, que l’on rencontre le plus d’idéal dans le plus de réel, c’est-à-dire le plus d’art. C’est que là aussi le talent est plus accessible aux intelligences ou aux éducations moyennes. Tant mieux pour le paysagiste et pour nous, s’il pense, mais son plus facile génie consiste surtout à bien sentir.
Bastien-Lepage pense. Il nous l’a prouvé, et nous l’avons montré. Dès lors, quel tapage autour du nouveau-venu! Sauf cet incident de quelque importance, tout le paysage est demeuré calme. Il ne nous a causé ni surprise, ni déception. Pas un chef-d’œuvre, quelques belles œuvres, beaucoup d’excellent métier. Ce genre ne monte, ni ne descend. Il paraît se maintenir en attendant, comme toutes choses aujourd’hui, son imminente révolution, dont l’auteur des Foins nous semble être le vaillant précurseur.
Saluons, tout en courant, ces trois maîtres que notre mémoire unit souvent: Français, Hanoteau, Harpignies.
Français a voyagé cette année. Il s’en est allé loin, je vous prie, au bout du monde, jusqu’en Italie. Au pays bleu, il a trouvé une de ses plus fraîches inspirations, le Lac de Némi. Et, revenant par la Suisse, il a rencontré un spectacle merveilleux dont voici l’adorable souvenir: Mont Cenis; soleil couchant. Sur des monts entassés par je ne sais quel Encelade, le vieux pic, raide et pointu, se dresse. Le voilà qui sourit gauchement, et il est rose, et ses neiges sont bleues aux rayons de ce soleil couchant qui descend là-bas si superbe, et si glorieux. Au pied du pic il y a un haut plateau, bien vaste et bien solitaire, et tout au milieu un lac bien froid et bien clair. Et dans ce lac on voit se refléter la pyramide rose, et les rayons d’or. Et tout autour, quelles ombres étranges! Ces hauteurs-là ne rient jamais. Leur sourire, c’est la mélancolie. Au grand jour, elles sont sévères. La nuit, elles sont terribles. Arrivé là, on s’intimide et on recule, comme si l’on surprenait quelque effrayant mystère. Ce soleil et ce mont, dans ce silence, ce sont des Dieux. Ils se disent des choses formidables à voix basse. Quiconque a vu du haut des Alpes le soleil se coucher nous comprendra. Et avec nous il admirera Français.
Harpignies a été, lui aussi, en Italie, et il nous en rapporte le Colisée à Rome. C’est exact et curieux, mais un peu froid. Harpignies n’est tout à son aise qu’en pleine nature, et ce Vieux noyer, dont les rameaux énormes, issues d’un tronc géant, figurent une manière de portique triomphal au seuil de cette campagne vaste et profonde, comptera parmi les études les plus marquantes de ce maître tenace et consciencieux.
Hanoteau, je veux dire le paysage d’Hanoteau, continue à se bien porter, et le nouveau bulletin de sa santé s’appelle la Tournée du meunier. Les anémiques, encore une fois, et les rêvasseurs, et les élégiaques doivent être rares dans cette nature toujours plantureuse et toujours riante. Il doit y avoir un solide meunier, quelque belle fille gaillarde dans ce moulin cossu, et l’on doit boire du bon vin sous ces arbres bons vivants.
Aimez-vous mieux la mélancolie? Pourquoi pas? Chacun son goût, et le meilleur est de tout aimer. Adressons-nous donc à Pelouse. Il nous va servir à souhait. Nous éprouverons même quelque pittoresque terreur à le suivre dans son Passage de Lonriec à Concarneau. Le soir, aux vagues rayons de cette lune inquiète, sous ce ciel tourmenté, cette campagne bretonne est tragiquement noire. Tant bien que mal, dirigez-vous vers ces grosses taches rouges. Ce ne sont point des feux follets, mais les foyers flambants de ces basses chaumines. Elles émergent d’une boue épaisse, et vous donnent la perception nette d’une cité lacustre. Autour de ces foyers-là, vous trouverez de bien braves gens, mais bien misérables, à qui leurs curés n’enseignent point le français. Monsieur le ministre des travaux publics, et vous, Madame la Chambre, j’ose vous les recommander. A-t-on assez démoli, que diable! a-t-on assez enlaidi ce malheureux Paris? Et n’y a-t-il donc rien à faire là-bas pour vos architectes sans vergogne et vos Limousins sans ouvrage?
Mais elle n’a point que ces aspects-là, cette Bretagne, si justement aimée de tous les artistes vaillants et sincères. Connaissez-vous l’épique Landerneau? O l’amusante petite ville avec ses ponts habités, et ses vieux pignons, et sa vieille lune, et les chers souvenirs que les Haussmann du pays respectent encore! Il ne s’y fait point de bruit, quoi qu’on en dise, mais il s’y tient sur une petite place un fourmillant marché où des gas bien bâtis et d’avenantes paysannes, couleur locale, débitent de beaux fruits, bien éclatants. Le voilà, ce gentil marché, vu et bien vu par le coloriste Lhermitte, un des fidèles de la Celtique.
Connaissez-vous la plage de Douarnenez? C’est une des plus grandioses qui soient au monde. Il la faut contempler du haut de ces Landes fleuries, avec son féal amant, M. Lansyer. Quel nom attrayant et singulier: landes fleuries! Et puis de la Bretagne l’on a dit encore et bien souvent: des fleurs sur du granit. Cette Bretagne des poètes, elle est là, sous vos yeux. De la mer au ciel montent roches sur roches, énormes et blanches, et des roches les arbres jaillissent, et sur les roches les fleurs poussent, insolentes. Quand vous aurez, par cet escalier superbe, atteint la terrasse extrême de ces jardins de Babylone, cette plage sans fin que vous voyez là, sur votre droite, étincelante au soleil, c’est la côte de Douarnenez. Devant vous, l’Océan!... Et vous bénirez votre guide puissant, votre irrésistible tentateur, le maître de céans, M. Lansyer.
Mais j’y songe, de Douarnenez à Pont-Aven il n’y a qu’un pas, il n’y a qu’un jour. Et Pont-Aven, chacun sait cela, c’est quelque chose comme une petite Suisse d’étagère, coquettement épanouie dans un vallon perdu de la Bretagne. L’an dernier, nous y suivîmes Le Marié des Landelles. Aujourd’hui, c’est Dameron qui nous mène. Il y a bien des promesses dans son paysage, Au Bord de l’Aven, un des plus aimables et des plus frais du Salon: des promesses et des progrès. M. Dameron est tout jeune, et nous avons épié son début. Hier il était élève, bon élève. Encore un coup, et il sera élève maître.
La Normandie a ses peintres servants, tout comme la Bretagne. Le Calvados surtout les attire, et dans le Calvados la Plage de Villers, celle-là même dont Guillemet nous fixe les rudes aspects en cette toile magistrale. La nature normande est plus riche, mais beaucoup moins étrange que la nature bretonne. Ses lignes sont plus arrêtées, ses masses sont plus lourdes, plus étroit est son horizon. Même aux approches de l’orage, la mer normande est plus lente, plus épaisse. Dans cette nature plus plantureuse et plus calme, l’habitation humaine est plus haute, plus vaste et de plus confortable aspect. Ne vous fait-il pas plaisir à voir, comme un solide refuge et un asile de bien-être, ce gros mastoc de village normand, si agréablement posté dans la baie, étalant ses bonnes grosses rouges tuiles aux rayons d’une rapide éclaircie? Tout ce qui est de poésie sous ce ciel, et dans ce lieu, ne pouvait avoir de plus sûr interprète que le talent, de plus en plus large et fort, de M. Guillemet.
Les analogies sont nombreuses entre la manière de M. Guillemet et celle de M. de Flahaut. Très-large aussi est la touche de ce dernier. Il comptera bientôt, s’il ne compte déjà, parmi les rares maîtres de ce genre si difficile, la marine, sur lequel cette révélation, la Vague de Courbet, vue et revue au Champ-de-Mars, nous rend désormais si pointilleux. Cette Marée montante est d’une belle impression. Je la reconnais. On la contemple à Puys, du seuil même de ces ateliers si pittoresquement groupés autour du chalet d’Alexandre Dumas.
Non loin de ces falaises de Dieppe où un Mauvais temps inquiète et pourchasse les mugissants modèles de M. Vuillefroy. Un excellent éleveur toujours que ce peintre-là, mais son bétail, cette année, quoique fort bien portant, ne mérite qu’un second prix.
Quant à celui de M. Van Marcke, il a vingt fois épuisé toutes les primes d’encouragement, et on ne lui connaît plus de rivaux sur le marché. Est-il dans la meilleure école flamande beaucoup de pages plus remarquables que ce Gué de Mouthiers? Avertis par l’orage, les bouviers et garçons de ferme ont sonné la retraite. Aux abords du gué, chevaux, bœufs et vaches se pressent dans le beau désordre que rêvait Boileau. La campagne aux perspectives profondes est d’un admirable effet. Il n’est guère aujourd’hui, nous le redisons volontiers, de paysagiste plus sincère et plus puissant que l’auteur du Gué de Mouthiers.
Moins sincère, plus rude et moins puissante est la manière de M. Vernier, un autre fidèle de Normandie. Elle s’améliore d’ailleurs incessamment. Il y a dans cette toile Avant le grain, Grand-Camp, Calvados, une ampleur, une facilité inaccoutumées. M. Vernier, à qui le livret n’assigne aucun professeur, a débuté par la lithographie où il est resté maître. Il a reproduit avec une rare intelligence les oeuvres les plus célèbres de Courbet. Et il s’en souvient, et l’on s’en souvient à l’examen de sa robuste et consciencieuse peinture.
Son autre toile, la Cour de ferme à Attainville (Seine-et-Oise), est d’une jolie coloration, intense et gaie. Aux travailleurs le progrès appartient, en propriété exclusive et garantie. M. Vernier est un travailleur.
En Normandie encore, à Villerville (Calvados), cet Enterrement d’un marin, l’un des plus légitimes et des plus brillants succès du Salon, chichement consacré par le jury. Sur une place du montueux village, des marins en grosse veste de bure, des vieilles femmes tout encapuchonnées dans leurs mantes noires, tenant droits de longs cierges allumés, attendent pour l’escorter à l’église le cercueil que l’on entrevoit à travers la porte ouverte de cette humble maison. Sur le seuil, un homme agenouillé prie et sanglotte. Sous le vert contrevent fermé en signe de deuil, une petite table couverte d’un napperon blanc, autel improvisé, porte un crucifix entre deux bougies allumées. Des enfants regardent le sinistre appareil avec cet ahurissement si naturel que cause toujours au jeune âge ce mystère stupide: la mort. Dans cette rue escarpée, si pittoresque, des voisins s’apprêtent à grossir le cortège. Dans le ciel, de gros nuages courent, chassés par un vent de tempête. A ce ciel seul, on devine la mer, invisible et prochaine. Peinture solide et franche, simplement composée, d’un effet austère et poignant; voilà ce qu’on appelle du bon «plein air». Avec ou sans médaille, il ne vous en faut plus qu’une, M. Butin, pour avoir gagné votre maîtrise.
Et par je ne sais quelle filiation sentimentale, l’Enterrement d’un marin nous rappelle à temps la Dernière Etape de Coco, une ravissante page de M. Beyle que la gravure rendrasans doute vitement populaire. Comme ils s’en allaient, trottinant menu par la campagne lugubrement blanche, contre le rude vent d’hiver, le pauvre vieil âne de ces marchands-forains est mort. Il git là, sur le chemin, dans la neige, devant sa lourde voiture. L’homme, un vieux routier grisonnant, regarde Coco avec une douleur muette, vraiment touchante. Sa vieille, à genoux, les mains jointes devant Coco, semble le supplier de ressusciter. Le chien flaire tristement son compagnon. L’enfant est tout hébété. Le bourg est bien loin, le temps est bien mauvais, la route est bien déserte. Ils sont bien malheureux. Sujet de romance, tant qu’il vous plaira, et que les gens sérieux, fort au-dessus de l’art populaire, confondront dans un égal dédain avec le cèlèbre Convoi du pauvre. M. Beyle qui tient une bonne veine, et qui a un bien autre talent que l’auteur du Convoi, fera bien de n’écouter pas les gens sérieux, s’il en reste.
La Normandie n’irait point, je pense, au sévère talent de M. d’Alheim. Mais comme il s’est trouvé tout à son aise dans la grandiose et solennelle nature du département de la Loire! Entre ces hautes murailles de quartz, jets énormes d’une antique éruption que rejoint l’une à l’autre cette passerelle, tout en l’air perchée, ce vallon houiller, rigide et sombre, c’est la Brûlée. Bien nommé, ce vallon. Il n’est point émaillé de fleurs, on n’y voit point courir de ruisseaux argentés où baignent les buissons de myosotis, chers aux demoiselles en promenade. Le sol est une alluvion de noires scories, craquant sous les roues des lourds chariots. A gauche, sur la hauteur, une de ces vastes roues d’extraction comme il y en a près Paris, aux carrières de Montrouge, projette sur le ciel son profil bizarre et grossier. Uu peu plus loin, par le toit d’un hangar, un four en activité vomit sa flamme. Un peu plus loin encore, à l’arrière-plan, un mont dénudé domine la scène, cône géant qui fait songer aux Pyramides, et s’empourpre aux rayons du soleil. Sur le tout un azur implacable darde ses lueurs d’acier. A quelques lieues de là serpente le clair Lignon, le célèbre Lignon, dont les gentilles naïades, des truites superbes, entendirent aux siècles lointains le beau Céladon, fils des Druides, soupirer ses platoniques amours. Région étrange, riche et sauvage, industrielle et romanesque. L’homme préhistorique y laissa d’authentiques souvenirs, et la lente histoire y a marqué dans une empreinte ineffaçable chacun de ses pas. On y trouve à tout instant des ruines splendides et l’on y rencontre des sorciers. Les châteaux y poussent, les usines y fourmillent. On y fabrique des rubans et des locomotives, on y forge des canons et des légendes. C’est le pays des cours d’amour et des cours de mécanique. C’est le pays de la houille, et c’est le pays de l’Astrée.
Ainsi la Brûlée de M. d’Alheim éveille en nous les plus vives impressions, les plus magiques souvenirs. C’est que cette toile, de très-haute valeur, n’est pas seulement la reproduction d’un accident quelconque de la nature, le portrait d’un de ces paysages aimables et indifférents comme il s’en trouve à peu près partout. C’est mieux qu’un paysage, c’est un pays tout entier, saisi dans son type, œuvre de poète non-seulement, mais au premier chef, œuvre de savant, car je défie qui que ce soit, dans l’école française, de nous mieux traduire la roche que M. d’Alheim. Dans tout autre pays que la France, la Brûlée eût été vivement acquise par quelque établissement scientifique. Mais la compensation, une enivrante compensation, n’a point manqué à M. d’Alheim. Cet artiste, studieux et sincère, qui compte autant d’œuvres remarquables que de Salons, a fini par recevoir du Jury pour prix et témoignage de ses progrès constants... une mention honorable. Quelle impertinence!
Las de Cernay où quelque temps il tint ses poétiques assises, M. Rapin nous emmène au Valbois, dans l’âpre et forte campagne du Doubs. On traverse là-bas des bois superbes auxquels la magicienne automne prête un charme inénarrable et une singulière grandeur. Et l’on y rencontre çà et là, comme en toute forêt, cette pauvre besoigneuse à qui MM. les princes d’Orléans réclament des dommages-intérêts, et que chanta le grand poète, mort à l’hôpital, Hégésippe Moreau, en ces beaux vers aimés de M. Rapin:
La femme de la Bible, erre, pâle et courbée,
Glanant le long des bois quelque branche tombée.
Or, jugez si ces merveilleux aspects entraînent le fin talent du franc-comtois Rapin, et avec nous sans réserve admirez la touchante élégie que voilà.
Du Doubs aux Vosges, il n’est pas loin, et les vieilles forêts d’Alsace sont les plus belles du monde. A leur ombre s’est écoulée la meilleure part de notre enfance, et tous les voyages possibles n’ont pu nous les faire oublier. Aussi est-ce avec une émotion profonde que nous avons surpris au Salon ce délicieux sous-bois: les Hêtres de Retournemer. Surpris est le mot, car les placeurs de l’administration, peu esthétiques d’ordinaire et point galants, l’ont relégué au quatrième étage, alors qu’il eût mérité sans discussion préalable les honneurs de la cymaise. Songez-y donc! Qu’est-ce que cela? Mlle Eugénie Frisler? quelque modeste débutante. Et, va-t-on point pour une débutante, qui n’a eu, s’il en faut croire le livret, d’autre professeur que la nature, troubler la bonne digestion de MM. les Jurés, ou déranger par une intrusion révolutionnaire les situations péniblement acquises d’un tas d’honorables médiocrités? Un avenir prochain vengera Mlle Frisler, car son vaillant début est gros de promesses. D’autres que nous l’ont surpris, d’autres, plus autorisés vous en ont dit et rediront les brillantes qualités. Dans cet asile touffu, sous ce dôme impénétrable aux rayons du soleil, on respire à pleine âme la divine horreur des grands bois sourds. Et, comme M. d’Alheim traduit les roches, Mlle Frisler traduit les arbres avec cette intuition de leur individualité propre, avec cette science patiente dont Harpignies demeure jusqu’à nos jours le maître unique et incontesté.
Un peu moins haut que les Hêtres de Retournemer, on avait placé le Panier de pommes de Mlle Frisler, et l’oeil y pouvait sans trop de fatigue cueillir toute une assiette de fruits appétissants. Qui sait si bien comprendre les arbres saura bien peindre aussi les fleurs et les fruits, et quelque jour, les dessertes ou les bouquets de Mlle Frisler s’inscriront dans la faveur publique, parmi les natures mortes des Bergeret, des Attendu, des Kreyder, des Muraton, des Muller, des Jeannin et autres que nous mentionnons au galop, sans nous y pouvoir arrêter.
En Alsace aussi, sans nul doute, l’alsacien M. Zuber a vu l’étonnante et terrible forêt qu’il donne pour théâtre à son paysage historique: Dante et Virgile, œuvre hors ligne, d’un tel souffle qu’elle range d’un coup son auteur parmi les maîtres de demain. Un mot suffira pour préciser notre pensée. Ainsi Dante a décrit sa forêt, ainsi, et d’un style égal, l’a peinte M. Zuber.
En Thrace assurément, il nous faut reporter cet autre paysage historique où M. Feyen-Perrin nous montre la Mort d’Orphée. Cette fois encore, il a pris pour texte de son inspiration quelques vers de son ami Armand Silvestre:
Sous le thyrse qui vole et le cuivre qui tonne
Orphée est étendu: les Ménades en chœur,
Comme une grappe mûre échappée à la tonne
Foulent en bondissant, sous leurs pieds nus, son cœur.
Et son chef que brandit leur caprice vainqueur
Semble un astre sanglant sur l’or d’un ciel d’automne.
Lire cette strophe si mouvementée, si imagée, c’est voir le tableau de M. Feyen-Perrin. Le peintre a presque littéralement traduit le poète. Leurs styles sont si semblables d’ailleurs, qu’à vrai dire leurs poèmes s’équivalent. Moins belles, j’imagine, devaient être les antiques Ménades, mais elles n’étaient ni plus ivres, ni plus furieuses, et la beauté même que leur prête l’élégant pinceau de Feyen Perrin souligne d’autant leur tragique folie. Rien n’égale ni le vertige horrible du chœur, ni la splendeur éblouissante du ciel d’automne, sur lequel se détache «comme un astre sanglant » le chef d’Orphée. Une réserve toutefois: on ne s’explique guère le voile et la lyre prudemment jetés sur la place où fut ce chef. Les Ménades n’étaient point dames à s’épargner la vue complète de leur crime, et l’on serait tenté de croire que sous ce voile trop ingénieux, M. Feyen-Perrin nous a voulu céler une difficulté invaincue.
HENRI FANTIN-LATOUR
La Famille D...
C’est un paysage historique aussi, cette Mort de Manon Lescaut qui a valu à M. Dagnan-Bouveret, avec une troisième médaille, un bien plus honorable succès d’entraînement: oui bien, un paysage historique. Car enfin, de tels types sont des personnes autrement historiques et réelles que tant d’éphémères pieusement enregistrés dans les classiques in-folios. Et nous avons toujours rêvé qu’un Dictionnaire des héros de roman serait pour le moins aussi utile, et en tout cas plus divertissant, que le meilleur dictionnaire de Bouilhet ou de Vapereau.
Aussi l’on faisait queue devant le tableau de M. Bouveret. N’est-elle point dans toutes les mémoires, la fin si émouvante et si vraie de l’incomparable Manon? Et pouvait-on la rendre avec une plus scrupuleuse et plus poignante fidélité ? Devant la pauvre morte, gisante, en son mignon costume de grisette parisienne, avec sa robe à fleurs, et sa jupe courte à ramages, et son pimpant bonnet, et ses petits bas bleus, et ses petits, tout petits souliers à boucles, Desgrieux, poudré, à genoux, chapeau et habit bas, en chemise à manchettes, Desgrieux, sombre et halluciné, grattant de ses mains effilées le sable pour y enfouir la plus adorable des amantes qui fut jamais! En face de lui, ce cadavre. Autour de lui, si loin que porte le regard, la solitude, et pis que la solitude, le désert. Autour de lui, sur lui, le silence. En lui le désespoir. Dans les cieux, le soleil, indifférent et radieux. Et ceci n’est point une vignette. M. Bouveret n’est pas un illustrateur. C’est un coloriste, c’est un poète. Qui donc ne s’attendrirait?
Au fond de quelque défilé kabyle, dans un ravin, sur un lit de roches, la mort a précipité une Proie, le cadavre d’un jeune arabe, tout armé encore, et naguère frappé dans un combat. Sur le cadavre, les ailes tendues, les griffes serrées en rond, un vautour plane. C’est un oiseau superbe, il a une gorge bleu de ciel. Il roule dans son œil sinistre, avec des appétits fauves, des inquiétudes vagues; il regarde de côté son rare festin. Par où l’attaquera-t-il? La tête le tente, un si bon morceau. Mais il se méfie encore, le gourmand. Ceci non plus n’est pas une vignette. La Proie est œuvre de coloriste, et dénote chez son auteur, M. Poilpot, une vive intelligence de la composition dramatique.
Moins ambitieux et plus gai, M. Baudouin nous mène à la Récolte des amandes dans le Haut-Languedoc, à la Bastide Saint-Raphaël. Jolie scène, bien ordonnée, dans une gamme claire et harmonieuse, en évident progrès sur la Récolte des olives de l’an passé, mais trop sèche encore. On voudrait dans ce gentil paysage des figures plus vivantes, moins automatiques. Cela viendra.
Quant au paysage de M. Léonce Petit, mettez-le où il vous plaira, dans la campagne picarde, ou dans la banlieue parisienne. Peu importe, il est de partout, puisque son auteur l’intitule: Un Troupeau d’oies. Ce pittoresque volatile tient, on le sait, une maîtresse place dans l’œuvre de notre caricaturiste, que peut-être un jour, l’on nommera le Maître aux oies. Elles sont si plaisantes bêtes, n’est-ce pas? et dans la vie rustique si importantes personnes. Voyez-les s’avancer lentement, majestueusement, processionnellement, sous la conduite d’un gas. Moins qu’elles, le corps de pompiers remplit la grand’rue du village, aux jours de revue. Cependant, sur les portes les commères devisent, et cahin-caha, comme les oies marchent, s’accomplit, ici et là, tout le petit train-train de la vie quotidienne. Robuste et saine peinture, où s’épanouit cette malice franche, et bonhomme, qui perpétue au Journal amusant le succès hebdomadaire de Nos bons Villageois. On la peut désormais goûter librement et regarder sans effort au Salon, la peinture de M. Léonce Petit. On ne le refuse plus, et même on le descend jusque sur la cimaise, depuis qu’il n’expose plus de gendarmes. O France! ô ma patrie! O jury! O Institut et surintendance! O gendarmerie! Et c’est un gendarme, je vous prie, et un gendarme sous l’Empire, de qui nous entendîmes cette parole immense: «La conciliation, Monsieur, est la base de la civilisation.»
Les bons villageois, de Léonce Petit, je les préfère par un côté à ceux de M. Palizzi. Les premiers, ce sont, comme l’on dit, ceux du bon Dieu. Les autres, ceux de M. Sardou. Cette femme entre ces deux hommes, tous les trois à cheval sur des ânes, se gaussant et fumant des pipes, sous leurs parapluies de campagne, par une averse de hallebardes, sont très-amusants, soit, mais un peu cabotins. Nous les avons déjà vu jouer.
La Marne et M. Peraire sont en train de convoler. Tous deux, je les félicite de cette union. Il aura la plus séduisante et la plus gaie des rivières. Elle aura un peintre solide et brillant.
Dès longtemps nous remarquions le paysage de M. Peraire, mais il s’est vraiment, aujourd’hui, surpassé. Quel Parisien ne connaît les gentilles petites Sources de Nogent-sur-Marne, dont l’eau fraîche calme, dit-on, les yeux malades, et qui sortent de terre comme en tapinois, au pied des côteaux de Champigny-la-Bataille, vers le val de Beauté, dans ce sîte joyeux et splendide où villégiaturait à son heure très-blonde et très-honneste dame, Agnès Sorel? Les voilà. Et M. Peraire, que vous en semble, n’a-t-il point bien rendu les grands aspects d’alentour? Il a toutes les qualités de la jeune école, son entrain vers l’observation sincère, son goût des tonalités claires et des valeurs accusées. Encore une fois, la Marne est bien heureuse.
Et finissons nos paysages par cette autre gaieté : l’Intervention, d’un peintre de très-aimable et très-vif talent, M. Méry. Des poussins picoraient des raisins. Entre ces gamins précoces et leur rapine un escadron de guêpes intervient. Vous devinez la scène, et jugez tout le parti qu’en a pu tirer la main leste de M. Méry. Mais l’Intervention a pour nous un autre intérêt. Elle est peinte à la cire. Ce nouvel essai, fort heureux, nous enchante doublement. L’antique peinture à la cire, susceptible d’ailleurs de maint perfectionnement, nous sera d’un inestimable secours pour la décoration des édifices privés ou publics. En outre, l’essai de M. Méry venant après celui de M. Gustave Moreau, qui employa l’an dernier la cire pour sa magnifique aquarelle: la Danse d’Hérodiade, légitime la patiente et courageuse initiative de M. Henri Cros.
C’est lui, nous le rappellerons sans cesse, qui le premier, dans ces derniers temps, exposa des toiles peintes à la cire. C’est lui qui, par de laborieuses et savantes recherches dont le Voyage au pays des Peintres a raconté l’histoire, nous restitua dans toute son intégrité la méthode des anciens (Ciris igne resolutis). Cette initiative, il ne la faut point oublier sous peine de justifier à la lettre, cette fois, le célèbre proverbe: Sic vos, non vobis mellificatis, apes.
Et maintenant, si intéressants que soient les oubliés non pas, mais les négligés, si grand que soit leur nombre, il nous faut descendre au jardin, parmi les statues.
Un mot toutefois, en tenant la rampe, un dernier. MM. les impressionnistes n’ont pas, cette année, convoqué le public à une exposition spéciale. Pour deux raisons, suffisantes chacune. La première, c’est que le public ne répond point à ces convocations par un enthousiasme délirant. La seconde, c’est que leur prétexte disparaît devant l’admission de la nouvelle école au Salon officiel.
Le jury, par extraordinaire, a compris l’un des plus sûrs et des plus réjouissants bénéfices de la liberté. Par cette admission qui n’est, au demeurant, que la consécration tardive d’un droit formel, il ramène nos intransigeants martyrs au rôle plus modeste et plus difficile d’opposants constitutionnels. Comme ils s’en tireront, nous le verrons bien.
Leur premier début ne nous semble pas des plus brillants. Laissant de côté quelques faux et timides intransigeants dont les noms nous échappent, et qui déserteront un de ces quatre matins, ne citons qu’un pur, ou mieux encore, une pure. Que dis-je? une prophétesse, la Jeanne d’Arc même de l’impressionnisme, Mlle Eve Gonzalès, élève de MM. Chaplin et Manet. Son chef-d’œuvre de combat, Miss et Bébé, occupait sur la cimaise la place d’une peinture vraisemblable, les Hêtres de Mlle Frisler, par exemple. Trois mois durant, quelques cent mille visiteurs cosmopolites ont savouré Miss et Bébé. Eh bien! ils en riront longtemps.