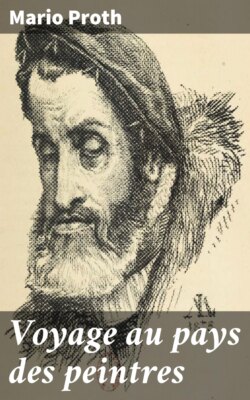Читать книгу Voyage au pays des peintres - Mario Proth - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II
ОглавлениеTable des matières
SOMMAIRE: Longue fut notre halte. — Le dessus de la corbeille immense. — Bastien-Lepage et les Foins. — Elle est bien grisée. — Belles dames, belles poupées. — Le bonheur d’une défaite. — M. Comerre et sa Jézabel, point belle. — M. Besnard et Saint Benoît. — Le denier de la France et le denier de saint Pierre. — M. Ferrier et Sainte Agnès. — Prospectus pour un inventeur philocome. — M. Sylvestre et son Vitellius. — Midi et aurore. — Et l’on charcuta l’impérial porc. — Un sac-à-vin fort embêté. — MM. Bastien-Lepage et André Theuriet. — M. Louis Collin. — Ils habitent le même idéal. — Fantin Latour et la Famille D... — Rassurez-vous, nullités convenables!
Longue fut notre halte au Salon carré. Ainsi font tous les voyageurs à leur première station, et cela s’appelle d’ordinaire (non cette fois, assurément,) s’arrêter aux bagatelles de la porte.
En route maintenant, et que le génie des arts nous veuille bien accorder une petite, toute petite place à son côté, sur l’aile impatiente du Pégase de Mercié. Très-rapide sera notre course à travers le Salon de 1878, où les œuvres retentissantes sont clair-semées. Au Champ-de-Mars, les écoles étrangères nous réclament. L’art nous déborde, en cette année prodigieuse, et il impose à nos forces limitées un labeur tout exceptionnel. Si bien que, pour conserver à notre Voyage, tout de polémique et de combat, l’allégement et la clarté nécessaires, nous devrons exceptionnellement restreindre le nombre des œuvres citées. Aux encyclopédistes, compilateurs et critiques de profession à réparer nos lacunes énormes. Pour une fois, cette fois seulement, oublieux malgré nous de la masse humble et modeste des petits travailleurs si méritants, nous ne glanerons, fleurs du bien ou fleurs du mal, que le dessus de la corbeille immense.
Parmi les premières, il en est une, tout d’abord, qui fixe notre regard, ou, pour parler net, notre admiration. Forte est sa poussée, âpre est son parfum, et, pour le plus prochain avenir, elle nous promet une ample récolte de fruits superbes. Elle a pour titre: Les Foins, pour auteur Bastien-Lepage.
Sur la campagne, ardente et blanche, règne en joyeux despote le soleil implacable et béni de Messidor. Il marque midi, l’heure formidable. Pas un bruit, pas une ombre, pas un souffle. Nulle feuille ne bouge. Tout chauffe, tout brille, tout se tait. Dans cette campagne-là, comme dirait l’autre,
On ne voit que le jour, n’entend que le silence.
Tandis que dans le lointain de rares tacherons, quelques faneuses au léger costume, leur repas fini, reprennent mollement l’attaque des blés jaunes et hauts, un moissonneur dort, au second plan. Paresseux ou las, il dort à plein sommeil, tout de son long étendu, les poings fermés, son chapeau de paille sur les yeux. C’est un gars solide et bien charpenté, un homme rude et fort, et, pour son honneur, nous voulons croire qu’il a bien travaillé.
Assise auprès de lui,
le poète André Theuriet,
Assise auprès de lui, la faneuse hâlée,
Rêve, les yeux ouverts, alanguie et grisée
Par l’amoureuse odeur qui s’exhale des foins.
Cette figure au premier plan, la dominante du tableau, est d’un effet puissant, d’une exécution magistrale. Bien modelée, bien potelée en son corsage entr’ouvert, la faneuse laisse aller distraitement ses bras nus sur son court jupon de bure. Elle n’est ni belle, ni laide. Ce n’est point une paysanne d’opéra-comique, c’est une brune travailleuse, une laborieuse des champs, un peu plus vieille que son âge, un peu lourde, un peu dure, un peu taillée à coups de serpette. Elle est bien alanguie, bien grisée. Ses narines dilatées respirent vraiment l’amoureuse odeur des foins. Rien ne saurait rendre l’intense, l’extraordinaire fixité de son regard presque halluciné. Où va-t-il, si loin? A moitié endormie encore, quel songe continue-t-elle? A qui, ou plutôt à quoi rêve-t-elle? La surprenons-nous poursuivant l’hystérique vision d’une faunesse, ou assistons-nous à je ne sais quel réveil douloureux d’une femme de peine, brusquement ramenée du bienfaisant pays de l’oubli? On peut tout voir, on peut tout lire sur ce visage étonnant, et une telle indécision, si puissamment traduite, est le triomphe même de l’artiste, net et précis entre tous.
Devant la faneuse de Bastien-Lepage, toutes les belles dames du Salon ne sont que poupées. Elle vous attire, vous retient et s’empare de votre souvenir. N’y eût-il en cette exposition que cette œuvre, elles se justifieraient l’une l’autre. Le jeune artiste, dont notre Voyage note chaque année la grandissante fortune, est cette fois résolûment et définitivement passé maître, et la preuve en est qu’il déroute et irrite la vieille critique. C’est un audacieux, un révolutionnaire, s’il vous plaît, et un révolutionnaire avisé, qui se gare aussi bien des intransigeances ridicules que des traditions pédantes. Vous réclamiez, à cor et à cri, du plein air. En voilà, ou Apollon me damne! et de quoi satisfaire les plus difficiles. En M. Bastien-Lepage, nous avons l’artiste qui pense et qui veut, l’artiste deux fois libre et deux fois indépendant qu’appellent les temps nouveaux.
Alors que son Achille, si hardiment conçu, lui enleva le prix de Rome, il y a deux ans, notre joie fut sans pareille. Qui donc revint jamais sain et sauf, indemne et entier, de ce cachot formidable: la Villa-Medici ?Il comprit le bonheur de sa défaite, et, comme un aiglon, battit des ailes. Les antiques instituteurs de son enfance, fort alarmés, ont essayé de le rattraper cette année. Il n’avait, nous dit-on, qu’à tendre vers le Prix du Salon une main repentante, obéissante et reconnaissante. Mais il s’en est soucié, le monstre, comme de sa première layette. Il a ri, et la Doctrine pleure. Lugete, Bouguereau Cabanelque. Et vous, monstre, courage! Vous avez ouvert une voie, dicté un exemple. En vous la France, notre chère France nou velle, comptera bientôt pour sa gloire un artiste et pour sa liberté un combattant de plus!
Ce qu’ils en font, de leurs victimes, cette école de Rome et ce Prix du Salon, jugez-en plutôt. J’ai l’honneur de vous présenter M. Comerre, et sa grosse Jézabel, point belle. Cette nudité épaisse et vaste qui se vautre dans un carrefour ne relève point de l’art, mais du bureau des mœurs. Ces chiens peu dévorants, qui ne se la disputent guère entre eux, sont des chiens savants, peut-être des gardiens dressés de la pudeur publique. Ils aboient aux mollets de cette dame, et cela se conçoit: ils ont une consigne et de l’esthétique.
Je vous présente M. Besnard et son Saint Benoît qui ressuscite un enfant. Où vîtes-vous jamais composition plus académique, plus froide, plus bêtasse? En vérité, on se demande si ces messieurs de Roma n’ont point de gré ou de force abjuré le siècle et ses pompes, et si leur bibliothèque renferme d’autres livres que la Mythologie de Détouche, la Bible ou les Vies des Saints? Est-ce donc décidément une école de missionnaires, que cette école de peintres? Cet emploi du denier de la France à prêcher le denier de saint Pierre, cet élevage de nos artistes en montreurs de la thaumaturgie cléricale est un défi.
Voici encore M. Ferrier, un des meilleurs et des plus vaillants, qui à son Ganymède et à sa Bethsabée donne pour suite un Martyre de sainte Agnès. Cette jeune personne, qui a eu l’honneur de transmettre son vocable à toutes les demoiselles réservées, fut (le saviez-vous? jusqu’aujourd’hui je l’ignorais profondément) jetée nue en quelque lupanar par un puissant dont elle avait éconduit le fils. Ses cheveux tout aussitôt entrèrent en une frondaison miraculeuse, à ce point qu’ils la couvraient comme d’une tunique à traîne, et vers elle un ange de la garde céleste fut dépêché, qui la protégea par un jeu combiné de sa fulgurante épée.
C’est à nous conter ce conte, prospectus admirable pour un inventeur philocome, que M. Ferrier a fort mal dépensé toutes les ressources de son honorable talent. Le diable, par habitude, a dérangé le pieux travail. Dans la partie satanique de l’œuvre, la décoration du lupanar, ou la mise en scène de son orgiaque personnel, nous retrouvons, bien que diffus et désordonné, notre jeune coloriste. Son lupanar est fort bien, ma foi, et à ce luxe palatial nous le tenons pour un rendez-vous de la classe la plus dirigeante. Ses courtisanes livreraient, je vous jure, à saint Antoine un bien rude assaut. Ses ivrognes nous amusent, et Juvénal ne renierait point ses vieux débauchés. Mais, dans son miracle le coloriste s’est mystiquement évanoui. Son Agnès nous ennuie. C’est une sainte de cire, et bien prête à fondre au feu qu’elle allume. Sainte Agnès! un maître du seizième siècle l’eût réalisée tout simplement vivante et irrésistible comme Vénus, pour l’oratoire d’un cardinal. Les maîtres de ce temps-là, il est vrai, nous semblent un peu bien mécréants. Artistes incomparables, soit, mais, hélas! miraculistes fort médiocres.
Voici enfin le grand vainqueur de 1876, M. Sylvestre, deux fois couronné, M. Sylvestre, première des premières médailles, M. Sylvestre, Prix du Salon. Il était de notre jeune école, il était le présent radieux, il était l’espoir superbe. Un midi et une aurore. Devant sa Locuste en méditation criminelle avec Néron le public s’ébahissait, les professeurs se pâmaient. Quelques rares sceptiques, dont nous fûmes, ajournaient leur entraînement. Or, voyez les Derniers moments de Vitellius César, expédiés par M. Sylvestre. Quelle erreur, ô dieux immortels!
Ce n’est pas nous, certes, qui reprocherons à cet artiste le choix d’un tel et si merveilleux sujet. L’ignominie d’un César aura toujours de quoi nous plaire, et, puisqu’un destin complice enleva naguère à notre patriotisme cette amère consolation, force nous est bien d’accepter ce que nous offre l’antiquité féconde. Faute d’un Bonaparte, va pour un Vitellius. Mais aussi quelle sobriété, quelle simplicité, quelle clarté dramatique exigeait une semblable page! Rien, on le sait, ne fut édifiant et complet comme la turpitude dernière de ce mangeur du monde. La soldatesque et la plèbe l’ayant arraché de son refuge, la loge d’un portier, mirent à nu son corps immonde et grotesque, et puis le traînèrent aux Gémonies, la corde au cou, sous une longue avalanche d’ordures et d’outrages. Afin que son groin auguste fût visible pour tous, et qu’il contemplât quand même le renversement de ses statues, quelqu’un étaya son quintuple menton sur le pommeau d’une épée. Puis lentement l’on saigna et, par petits morceaux, l’on charcuta l’impérial porc.
M. Sylvestre a bien lu et fidèlement traduit ses auteurs. Il s’est efforcé de condenser en une grande toile les plus frappants détails de cette marche triomphale. Mais cette malice de composition, indéniable dans la petite scène de Locuste, n’est point la qualité maîtresse de Vitellius. La foule est confuse, et il faut en quelque sorte fouiller son tohu-bohu pour y découvrir çà et là de bonnes intentions, des essais heureux. Les groupes ne se dégagent point, les perspectives sont mal observées. Les gestes, disproportionnés aux actes, tiennent plus de la charge que du drame. On dirait une première répétition d’un cinquième acte de mélodrame, ou une pièce de cirque dont les acteurs et comparses ignorent ou exagèrent leur rôle, et ce tumulte attend un régisseur. Le Vitellius de grosseur nature n’est qu’un sac à vin fort embêté, dont la physionomie rappelle plutôt un emblème de cabaret que le buste si connu. Il est effaré, le César de M. Sylvestre, mais non épouvanté. Il ne sue point la terreur, il ne geint point, il ne supplie pas, comme geignit et supplia le Vitellius de l’histoire, promettant de servir en utile et consciencieux mouchard son successeur Vespasien. En somme, la première impression que l’on éprouve devant cette œuvre hâtive et mal venue, c’est un étonnement presque gouailleur, et, pour la modifier, il ne faut rien moins, je le répète, qu’un mûr examen. Voilà qui nous éloigne sensiblement de l’apothéose de 1876. Rien n’est perdu, toutefois. M. Sylvestre est à temps de réfléchir, et un abîme sépare encore son talent de la nullité lamentable de cet aïeul des Prix du Salon, M. Lehoux.
Mais revenons à M. Bastien-Lepage. L’assourdissant bruit qu’éveilla dans le Landerneau artiste son tableau des Foins couvre un peu l’applaudissement que décernent les délicats et les sincères à son Portrait de M. André Theuriet. Bastien-Lepage, portraitiste, n’avait plus à fournir ses preuves. Mais, à l’envers de tant d’autres, il est resté l’égal de lui-même. Ce personnage svelte et droit, un peu raide, dont le visage osseux offre des méplats si accusés, dont l’œil enfoui darde un noir et vif regard, cette tête de ligueur, volontaire et mélancolieuse, à la barbe pointue et aux cheveux grisonnants, c’est bien cet humoriste vibrant et fin, ce romancier charmant et sobre, austère et doux, ce talent supérieur, d’honnêteté et de modestie rares en notre temps de hâbleurs, André Theuriet. Tous deux, le peintre et l’écrivain, deux sincères, étaient faits pour se comprendre. Aussi le poète a-t-il si bien traduit le peintre, et le peintre si bien rendu le poète. Alors que je contemplais longuement cette précieuse toile, deux noms sans cesse me revenaient à l’esprit: Albert Durer et Holbein.
De Bastien-Lepage on va droit et de plain-pied à Louis Collin. Ils habitent le même idéal. L’auteur de cette belle idylle, Daphnis et Chloé, une des joies de notre Voyage en 1877, suit avec ses facultés personnelles la même route et livré le même combat que l’auteur des Foins. Il y a, entre le Portrait d’André Theuriet et celui de M. C. G. une remarquable concordance de vues, une évidente parité de manière, comme aussi entre les deux modèles une certaine similitude. Ce jeune homme, long et maigre, très-brun, à la barbe noire, à la figure pâle, un peu fatale, aux yeux très-noirs, debout, un bras pendant le long du corps, une main sur la hanche, en redingote noire, en pantalon gris, se détachant sur un fond clair, c’est une œuvre non hardie, mais très-franche, calme et nette, sans apprêt ni recherche, très-moderne enfin, qui marquera sa date précise dans l’histoire de notre art. On en peut tout autant dire du portrait de M. Collin père. Cet homme à tête et barbe blanche, lisant son journal auprès d’une fenêtre aux blancs rideaux, dans un clair intérieur tout ensoleillé, c’est là encore une de ces pages intimes, une de ces mélodies du at home que roucoule à plein gosier l’école anglaise, et que commence à si bien chanter, plus discrète et plus mesurée, notre jeune école française.
Le maître du genre, c’est Fantin Latour. Sa Famille D... a charmé tout le monde, savants et naïfs. Les barbons de la vieille critique ont beau lui reprocher la monotonie de ses sujets, le retour plus ou moins fréquent de telle physionomie mélancolieuse dans ses intérieurs toujours sévères, ils ne se font plus guère écouter de l’opinion, chaque jour plus indépendante. Elle s’est justement éprise de ce talent si solide et si chaste, de ce poète harmonieux dont le style, tout personnel, a gardé la fière allure de ses maîtres préférés, les Flamands et les Vénitiens, les Chardin et les Delacroix. L’an dernier, ne lui prédisions-nous pas le Louvre? En attendant, tout le monde, ce «tout le monde» qui, ayant plus d’esprit que Voltaire, en doit avoir infiniment plus que la direction des Beaux-Arts, décerne à M. Fantin cette préface du Louvre, le Luxembourg, où tant de croûtes moisissent doucement, sous la paternelle conservation de M. le conservateur perpétuel et directeur honoraire, marquis de Chennevières. Protégés médiocres, nullités convenables, rassurez-vous! M. Fantin ne vous ira point déranger.