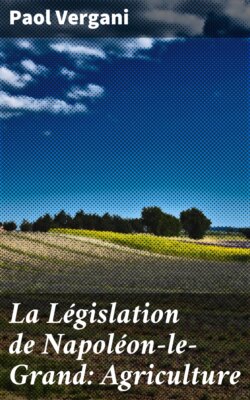Читать книгу La Législation de Napoléon-le-Grand: Agriculture - Paol Vergani - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Du Réglement hypothécaire contenu dans le Code Napoléon, Liv. III, Titre XVIII.
ОглавлениеTous les propriétaires ne se trouvent pas toujours avoir l’argent nécessaire pour les améliorations qu’exigent leurs terres, afin d’en tirer le meilleur parti possible, et pour qu’elles soient complètement cultivées; mais comme dans ce cas il n’est pas contraire aux règles d’une sage économie de contracter une dette, puisqu’au moyen du profit que le propriétaire tirera de ses améliorations rurales, il pourra, non-seulement servir avec facilité l’intérêt annuel du capital emprunté , mais encore le rembourser peu à peu, il importe infiniment aux progrès et à la perfection de l’agriculture chez tous les peuples, que la législation facilite les placemens des capitaux de ce genre.
Les Grecs, les plus défians et les plus rusés de tous les hommes, et qui ne prêtaient leur argent que sur une garantie réelle, inventèrent deux manières d’assurer leurs capitaux lorsqu’il les plaçaient, l’antichrèse et l’hypothèque. Quand ils se contentaient de l’hypothèque, et qu’en conséquence le fonds n’était pas livré aux mains du créancier, ils y mettaient des signes visibles qui pussent indiquer à tout le monde que l’héritage n’était pas entièrement libre. Démosthène dans son oraison contre Phænippe ainsi que dans celle contre Spudias fait mention de ces indices des hypothèques. L’usage en devait être bien ancien et de beaucoup antérieur même à Solon, puisque ce législateur, qui, comme chacun le sait, avait promulgué en faveur des débiteurs une loi qui les déchargeait d’une partie considérable de leurs dettes, et les avait mis même par la suite en état de s’en libérer entièrement au moyen de l’augmentation de la valeur numéraire des monnaies, se vantait dans ses vers, au dire de Plutarque, d’avoir balayé , dans le territoire de l’Attique, les signes dont il était jonché.
Quelqu’un a avancé que Rome avait emprunte des Grecs, conjointement avec l’hypothèque, l’usage même des marques extérieures dont nous venons de parler. Quant à moi, cette opinion ne me semble nullement fondée. En effet, l’hypothèque chez les Romains n’eut, pendant long-tems, et même jusqu’à l’Empereur Adrien, rien de commun avec celle des Grecs que le nom; puisqu’à Rome, durant cc laps de tems, non-seulement on obligeait le fonds au créancier, mais même on le lui remettait. Cette tradition effective du fonds était une conséquence nécessaire de l’ancienne jurisprudence romaine, suivant laquelle les obligations simples et nues ne donnaient lieu à aucune action dans le droit civil; en conséquence, une hypothèque fondée sur une simple stipulation, comme elle se pratiquait chez les Grecs, se serait trouvée réduite à une simple action personnelle, qui n’aurait pu autoriser le créancier à revendiquer pour lui même le fonds hypothéqué, quoique passé dans les mains d’un tiers: ce qui constitue le caractère et l’avantage de l’hypothèque. C’est pour que le fonds fût réellement garant de la dette, que par une de ces fictions de droit, si familières aux Romains, on simulait une vente au moyen de laquelle le créancier entrait en possession de l’héritage à lui hypothéqué, et y restait jusqu’à la restitution pleine et entière de la somme prêtée. Un pareil usage était très-embarrassant et très-incommode, parce que, outre qu’on ne pouvait dans tous les cas ni dans tous les tems remplir rigoureusement les formalités exigées pour ces ventes fictives, elles déplaisaient également aux débiteurs et aux créanciers: aux premiers, qui se voyaient dépouillés de la possession de leurs biens, aux seconds qui n’aimaient pas à se charger de l’embarras de l’exploitation et de la culture d’un fonds qu’ils ne devaientpas toujours garder. Aussi cette fiction de droit fut entièrement abrogée par la nouvelle jurisprudence qu’introduisit l’Empereur Adrien dans son Edit perpétuel, où l’on déclarait expressément que le Préteur maintiendrait à l’avenir les hypothèques contractées, même par une simple-convention . Chacun voit donc aisément par lui-même que si l’usage des marques extérieures des hypothèques employées par les Grecs a eu effectivement lieu à Rome, ainsi qu’on l’a prétendu, ce n’a pu être qu’après la promulgation de l’Edit perpétuel, époque à laquelle seulement les Romains commencèrent à connaître l’hypothèque proprement dite. En effet l’objet, ou pour mieux dire, le but de ces signes extérieurs n’existait pas auparavant, puisque le fonds, comme nous l’avons dit, passait toujours dans les mains du créancier; et il est évident que cet usage ne fut pas même introduit à Rome après la nouvelle législation d’Adrien, car nous ne trouvons dans les livres de Justinien, qui a adopté le réglement hypothécaire de l’Édit perpétuel, aucune loi enjoignant l’obligation d’apposer les susdites marques aux fonds hypothéqués.
Si cette précaution, imaginée par les Grecs pour la sûreté des créanciers, tendait réellement à produire ce bon effet, elle avait, d’un autre côté, l’inconvénient de pécher par excès. Ces signes visibles apposés aux fonds, indiquant à chaque moment, même aux personnes qui n’avaient aucun intérêt de le savoir, que ces biens étaient grêvés, devenaient aussi par-là, trop préjudiciables au débiteur; et dans le cas, sans doute assez fréquent qu’il joignît à la qualité de propriétaire, celle aussi de commerçant, cette notoriété trop grande de ses engagemens pouvait entièrement ruiner son crédit.
Mais, au contraire, le système que les nations modernes de l’Europe ont adopté, d’après les lois romaines, de baser uniquement l’hypothèque sur les actes d’une stipulation cachée, était trop nuisible aux créanciers. Il ne leur offrait certainement aucune garantie contre la mauvaise foi, puisque l’homme qui d’après les apparences semble pouvoir inspirer le plus de confiance, est souvent celui qui en donne le moins; et dans le fait, tous les pays offrent une infinité d’exemples de créanciers qui ont perdu malheureusement leur argent pour avoir été primés par d’autres, qui avaient sur les mêmes fonds des hypothèques antérieures, et dont ces infortunés n’avaient pas même pu soupçonner l’existence.
Henri III, roi de France, touché de ces exemples si répétés de perversité et de mauvaise foi, contre lesquels la peine du stellionat n’était qu’un faible rempart , et jaloux de les prévenir par la suite, ordonna, par son édit de 1590, que les hypothèques n’eussent aucune force en justice, si elles n’étaient enregistrées et contrôlées. L’expédient était réellement bien adapté , puisque, de cette manière, on prenait un juste milieu entre l’usage de ces marques extérieures des Grecs, qui plaçaient à chaque instant sous les yeux de tous la situation affligeante d’un particulier, et entre cette obscurité fatale qui livrait sans défense la bonne-foi à l’intrigue et à la perversité : mais cet édit fut malheureusement révoqué par un autre du même prince, en date de 1598. L’édit de Henri IV de 1606, et celui de Louis XIV de 1663, tendant aussi à donner de la notoriété aux hypothèques, eurent la même fâcheuse issue. Cette révocation constante et si brusque de lois d’une utilité si évidente, ne doit être attribuée qu’à quelques - uns de ces manèges secrets de l’intérêt particulier qui, dans tous les pays et dans tous les tems, ont si souvent contrarié l’esprit du bien public. Telle est effectivement la cause qu’assigne à cette révocation un habile jurisconsulte, dont la France déplore encore la perte. «Les hommes puissans
» (c’est M. Treillard qui parle), voyaient s’évanouir
» leur funeste crédit. Ils ne pouvaient plus
» absorber la fortune des citoyens crédules qui,
» jugeant sur les apparences, supposaient de la
» réalité partout où ils voyaient de l’éclat .»
Il est vrai que quelques parties de la France, sur-tout du côté du nord, jouissaient en vertu de leurs coutumes particulières du bonheur d’avoir des institutions tendantes à la publicité des hypothèques; et ce même avantage ne manquait pas non plus à quelques autres états de l’Europe, parmi lesquels on distinguait depuis long-tems la vaste étendue de pays qui, faisant anciennement partie des Gaules, fut dans la suite connue sous la dénomination de Belgique. Tous ces réglemens particuliers néanmoins, aussi bien que l’édit de Louis XV de 1771, dirigés vers le même but, celui de prévenir les inconvéniens des hypothèques secrètes, étaient bien loin du degré d’étendue et de mérite auquel la législation hypothécaire a été depuis portée par le Code Napoléon. La simple lecture du titre XVIII du livre III, où cette législation est contenue, suffit pour faire voir sur-le-champ combien elle a été perfectionnée dans ses plus petites parties; et quiconque voudrait en pénétrer plus à fond les beautés, n’aurait qu’à parcourir l’excellent discours de M. Treillard, dont nous venons de parler, sur ledit titre XVIII. Il est sur-tout consolant de voir que ce réglement hypothécaire du Code Napoléon, restreignant notablement le privilège immémorial du fisc, prescrit que l’hypothèque que le trésor a sur les biens de ses comptables, doit elle-même être assujétie à l’obligation de l’inscription aux registres publics, aussi bien que celle des particuliers, et que conformément à la loi enjointe aux particuliers, cette hypothèque du fisc doit être regardée comme prescrite et périmée, si elle n’est pas renouvelée dans l’espace de dix années. Aussi l’orateur déjà cité faisant allusion à ces deux dispositions lumineuses, s’écrie-t-il avec raison. «Le Gouvernement s’honore
» d’avoir placé ce principe dans le code de la
» nation. Elle est soumise par le même motif
» aux délais ordinaires de la prescription. Quel
» citoyen pourrait regretter ensuite d’observer
» une loi dont le gouvernement lui-même n’est
» pas affranchi ?»
Une législation aussi sagement combinée dans toutes ses parties relativement à cet intéressant objet des hypothèques, écartant même le plus petit danger d’être circonvenu, et inspirant une entière confiance entre les contractans, tend par sa nature à faciliter et à multiplier les placemens et prêts du numéraire, qui comme nous l’avons observé au commencement de ce chapitre, sont si avantageux à l’agriculture par les améliorations qu’ils donnent la possibilité d’y faire. En effet si on réfléchit à la grande difficulté que l’on éprouvait autrefois en Italie pour emprunter sur la simple hypothèque des biens fonds, on verra qu’elle ne provenait que du manque de cette institution de l’enregistrement des hypothèques; tandis que dans toute l’étendue des Pays-Bas, où, ainsi que je l’ai observé, cet enregistrement était en vigueur depuis long-tems, ces placemens d’argent s’opéraient avec toute la facilité possible. Ce fait se trouve clairement constaté dans une déclaration faite par le Parlement de la Flandre française au sujet de l’édit de Louis XV cité ci-dessus. «Les hypothèques,
» y est-il dit, se conservent de la
» même manière dans les Pays-Bas français,
» autrichiens, hollandais, et dans le pays de
» Liège, et les peuples de ces différentes dominations
» font entr’eux une infinité d’affaires
» avec une confiance entière.»
» Dans la Silésie prussienne, dit l’historien
» de Fédéric II, les hypothèques des terres
» nobles anciennement étaient reconnues et
» enregistrées par un collége de la province,
» moyennant quoi les prêteurs étaient assurés
» que les terres n’étaient pas plus chargées d’emprunts
» qu’elles n’en pouvaient supporter.
» Le grand chancelier Cocceji, dans ses vieux
» jours, voulut décharger les collèges de cet
» embarras, et laisser aux particuliers le soin
» de s’assurer eux-mêmes de ce qu’ils pouvaient
» prêter aux possesseurs de terres. Il arriva que
» des seigneurs hypothéquèrent pour cent cinquante
» mille écus de terres qui n’en valaient
» pas cinquante mille.....Cette réforme inconsidérée,
» dit le même écrivain, avait fait
» perdre tout crédit aux gentilshommes, en sorte
» qu’ils ne trouvaient plus absolument à emprunter
» de l’argent pour les besoins les plus
» urgens. »
Mais cette facilité donnée aux placemens des capitaux productifs d’intérêt pécuniaire, n’est pas le seul avantage que l’agriculture de l’Empire Français ait ressenti de ce règlement hypothécaire du Code Napoléon.
Les progrès de cet art si intéressant exigent, selon tous les écrivains, que les contrats de vente et d’acquisition de terres se multiplient autant qu’il est possible: la raison en est claire. Dans un état où une rotation continuelle de pareils contrats n’existerait pas, ce serait une preuve que les personnes opulentes emploieraient leurs capitaux à tout autre objet qu’à l’acquisition des terres, et qu’ainsi l’agriculture ne serait point en honneur chez la plus grande partie de la nation. La prohibition des primogénitures et des fideicommis a écarté le principal obstacle qui s’opposait jadis à un but si désirable. Mais cependant on ne serait jamais parvenu à l’atteindre entièrement, si à cette lumineuse disposition on n’eût ajouté le réglement hypothécaire. Moyennant ladite prohibition des primogénitures et des fideicommis, celui qui aurait eu à sa disposition du numéraire, aurait aisément trouvé à acquérir un fonds de terre, et n’aurait plus tremblé comme auparavant d’être dépouillé du fonds acquis par le droit d’un tiers, qui serait venu à découvrir une ancienne substitution, dont ce même fonds aurait pu être grevé. Mais ce capitaliste aurait craint d’être inquiété par quelqu’un qui aurait acquis sur ledit fonds une hypothèque antérieure; et une crainte de cette nature pouvait le porter à employer son capital à toute autre chose qu’en acquisition d’un fonds de terre. Dans une société bien organisée, toutes les lois doivent être intimement liées, afin de parvenir ensemble au même but, celui du bien public, et l’observation que je viens de faire est une nouvelle preuve qu’une prérogative si précieuse se trouve effectivement dans la législation de Napoléon-le-Grand. Le réglement hypothécaire dont on a parlé jusqu’ici a entièrement écarté l’autre obstacle, qui autrefois tendait à rendre rares les acquisitions en terres; ainsi cette loi et l’autre, sur la prohibition des substitutions, tendent avec une heureuse harmonie à multiplier les contrats de ventes des fonds de terre, ce qui est très-avantageux aux progrès et à la perfection de l’agriculture.