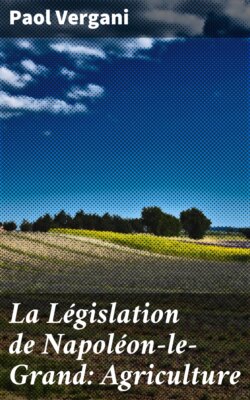Читать книгу La Législation de Napoléon-le-Grand: Agriculture - Paol Vergani - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Des articles 1743 et 22 36 du Code Napoléon, concernant les baux à long-terme.
ОглавлениеMAGON SUFFÈTE de Carthage, dont les livres sur l’agriculture ont reçu tant d’éloges des plus célèbres agronomes latins, et qui furent même traduits en cette langue par ordre exprès du Sénat de Rome, immédiatement après la destruction de sa rivale, commence par dire que celui qui achète une propriété rurale, n’a rien de mieux à faire que de vendre sa maison de ville, de peur d’être tenté de préférer l’habitation de cette dernière. Il voulait donner à entendre par là que ce qui influe le plus sur les progrès et la perfection de l’agriculture, c’est la présence continuelle du propriétaire sur son bien, en un mot, l’œil du maître: maxime judicieuse et vraie, mais qui n’était plus susceptible d’être généralement suivie à Rome, à l’époque de la publication des livres de Magon.
Les anciens Romains, sans même en excepter les patriciens les plus distingués, cultivaient par eux-mêmes les terres qui leur appartenaient; et si cette méthode est sans contredit la meilleure. pour l’intérêt de l’agriculture, il est certain aussi qu’elle ne peut avoir lieu que dans une société naissante où les terres soient le plus également possible réparties en petites portions entre tous les habitans, et où par conséquent chacun d’eux n’en possède que ce qu’il peut exploiter par lui-même; et dans le fait, la prodigieuse admiration que causa dans Rome le spectacle des Curius, des Cincinnatus, des Fabricius et des Serranus, passant tout couverts de poussière de la charrue au consulat et à la dictature, et après avoir rempli ces charges reprenant la manche de la charrue, cette admiration, dis-je, prouve évidemment qu’on avait abandonné depuis long-tems à Rome cette vie laborieuse, et que les exemples en étaient assez rares.
Les Romains s’étant donc éloignés de l’égalité primitive des possessions, et ne pouvant plus par la suite cultiver de leurs propres mains toute l’étendue de leurs terres, furent contraints de se faire aider par des mercenaires, qui, à la vérité, travaillaient sous leurs yeux. C’est ce qui les obligeait à passer une grande partie de l’année à la campagne. C’est pour cela que ce qu’on appelait chez eux villa, ou la maison de campagne, se divisait en deux parties, la rustique et l’urbaine; la première était destinée à loger les cultivateurs, et à serrer les instrumens aratoires et les récoltes; l’autre, c’est-à-dire, l’urbaine, ainsi appelée de ce qu’elle était mieux bâtie et presque à la mode de la ville, servait à l’habitation du propriétaire.
Mais cette seconde coutume, elle - même, ne se soutint pas long-tems chez les Romains. A mesure que chacun étendit sa propriété, et que ni les deux arpens, à la possession desquels Romulus avait borné les citoyens, ni les sept fixés par la seconde loi agraire promulguée après l’expulsion des rois, ni même les cinq cents tolérés par l’indulgence de la loi licinia, ne fixèrent plus les possessions des riches, il devint impossible aux propriétaires de faire sentir leur présence dans toutes leurs terres en même tems. A mesure qu’avec les dépouilles des provinces conquises le luxe et les plaisirs entrèrent dans Home, on se lassa du séjour de la campagne, ou si l’on y allait encore quelquefois, ce n’était certainement pas pour y tenir un œil attentif sur la culture, mais au contraire pour y étaler la pompe et la somptuosité des maisons de plaisance, dans lesquelles on s’était tellement écarté de l’ancienne simplicité, qu’au dire de Valère Maxime, ces nouveaux bâtimens couvraient plus de terrain que n’en occupaient les champs entiers de Cincinnatus .
Ces causes de l’éloignement des Romains pour l’agriculture, ont encore aujourd’hui le même effet chez les nations civilisées de l’Europe: et l’espoir de rappeler les hommes, à cet égard, au système ancien, serait aussi vain que la prétention de les réduire à la frugalité primitive des mets, ou à l’antique simplicité des vêtemens. La société, le théâtre, le jeu, la vanité, la mollesse, les affaires litigieuses, les emplois civils, le commerce, sont autant de liens qui enchaînent dans les villes, le noble, le magistrat, l’avocat, le négociant, en un mot, presque toutes les différentes classes de propriétaires.
Ces personnes-là ne pouvant donc ou ne voulant pas se réduire à veiller elles-mêmes à la culture de leurs propres terres, comme nous avons vu que le conseillait l’habile général carthaginois, il ne leur reste que d’avoir recours à un expédient qui supplée à leur présence de la manière la moins désavantageuse; elles prennent donc le parti d’affermer leur bien, et c’est pour cela que nous voyons aujourd’hui cette méthode généralement répandue dans toute l’Europe, malgré les nombreuses déclamations du vulgaire des agronomes.
Ceux-ci se trompent manifestement, quand bien même on ne considérerait que l’intérêt particulier des propriétaires, puisque sans cette ressource des baux, la majeure partie de ces propriétaires eux-mêmes se trouveraient misérables au milieu de leurs vastes possessions, faute d’avances, de tems ou d’industrie pour les faire valoir.
Mais on découvre toujours de plus en plus la faiblesse de ces déclamations, si on considère l’intérêt général de l’Etat, relativement à l’agriculture, qui est d’augmenter le plus qu’il lui est possible la reproduction, annuelle; quelque grande, en effet, que l’on veuille supposer l’activité d’un propriétaire particulier, il est incontestable que, généralement parlant, cette activité n’égalera jamais celle d’un fermier; et la raison en est claire. Le premier n’est animé que par le motif du profit, tandis que le second, outre ce motif, a encore celui de ne pas perdre. Si le fermier ne retire pas de sa culture de quoi payer la somme convenue avec le propriétaire à titre de louage, il éprouve une perte manifeste; mais il en éprouverait encore une, lorsqu’après avoir tiré du fonds de quoi acquitter son fermage, il ne lui resterait rien ou presque rien, puisque dans chacun de ces deux cas, il aurait perdu le fruit de ses peines, ses capitaux, et par conséquent l’espoir d’améliorer son sort, (seul but qu’il pût se proposer dans le contrat par lequel il a pris ce fonds à bail). Quelle énergie doit donc lui inspirer ce double et si puissant motif, de ne pas perdre, et de gagner! Qui ne voit pas que continuellement stimulé par ces deux aiguillons, il ne négligera aucune industrie, aucune amélioration, pour que le fonds puisse être complètement cultivé ?
Cette grande activité se retrouve effectivement dans la majeure partie des fermiers. Je suis né dans un pays où l’agriculture est portée à un point très-grand de perfection. Tous les écrivains étrangers font cet éloge du Milanez, que pour trouver un autre pays qui ait su tirer un plus grand parti de l’irrigation (opération des plus intéressantes pour l’agriculture), il faut recourir jusqu’à la Chine. Or le système des baux est tellement généralisé dans le Milanez, que le mot fittabile, c’est-à-dire fermier, est synonime de celui d’agriculteur. Le territoire de Bologne, dans un autre genre de culture, savoir celle qui ne dépend pas des arrosemens, est aussi lui-même très-renommé. Eh bien! on peut dire que ce même système des baux y constitue le système général de culture. Les fermiers bolonnais sont si intelligens et si industrieux, qu’ayant, depuis environ un demi-siècle, étendu leurs spéculations agraires sur les campagnes voisines du Ferrarais, on reconnait généralement dans ce pays, que c’est à eux que l’on est redevable de l’état florissant qui distingue aujourd’hui ce fertile et immense territoire, où avant cette époque l’agriculture était très-négligée et languissante. Si à Rome, dans le tems de sa plus grande splendeur, lorsque les propriétaires perdirent l’antique attachement pour l’agriculture, si, dis-je, on y eût introduit les baux à ferme, dont l’usage est à présent si répandu dans toute l’Europe, cet art, le plus important de tous, ne serait pas assurément tombe dans une aussi grande décadence, ni la subsistance d’une cité , que le nombre de ses habitans rendait équivalente à un royaume entier, n’aurait pas dépendu du moyen éventuel et précaire de l’arrivée des flottes de l’Egypte .
Mais s’il ne reste pas le plus léger doute que le système d’affermer soit en général très-favorable aux progrès et à la perfection de l’agriculture, cette utilité se manifeste toujours de plus en plus, lorsqu’il s’agit de baux à long terme, par la raison que, dans ce cas, l’effet bienfaisant de l’amélioration des fonds est plus certain. Quand les fermiers ont en leur faveur un contrat de cette nature, ils trouvent toujours leur intérêt à employer une portion de leurs capitaux à rendre la ferme meilleure, parce qu’ils peuvent raisonnablement espérer qu’ils les recouvreront avec profit avant l’expiration dit bail. Ajoutez à cette considération, qu’au moyen de ces baux à long terme, on écarte tout-à-fait la seule objection raisonnable, qu’au milieu de tant de vaines déclamations on ait faite contre ce système d’affermer, qui est que le fermier cherchera à tirer du fonds le plus qu’il pourra, sans s’inquiéter si le fonds même effrité devient stérile pour l’avenir. Ce danger, en effet, n’est à redouter en aucune manière dans un bail à long terme, puisque, comme tout le monde le voit, cet épuisement forcé du terrain tournerait non au préjudice du propriétaire, mais à celui du fermier, qui dans les années successives de la durée du bail, n’obtiendrait qu’une reproduction moins florissante et moins prospère.
Il y a plus d’un demi-siècle que les écrivains de toutes les nations, pour exciter leurs gouvernemens respectif à s’occuper de l’agriculture, font constamment valoir l’exemple de la Grande-Bretagne. C’est ce qu’ont fait sur-tout les économistes, en criant presqu’à chaque page de leurs ouvrages, Angleterre.) Angleterre! Ils nous vantent, et jusqu’à l’ennui, la liberté accordée par cette nation à l’exportation des grains qui pourtant, à vrai dire, n’est pas à beaucoup près aussi illimitée qu’ils le prétendent. Ils exaltent sans cesse les primes par lesquelles cette même nation a cherché à encourager de plus en plus cette exportation; mais ils gardent un prudent silence sur ce que le gouvernement anglais, à partir du règne de Henri VII, c’est-à-dire dans l’espace de plus de trois cents ans, s’est occupé sans relâche à favoriser les baux à long terme, tandis que, suivant l’opinion de l’auteur le plus profond qu’ait eu cette nation en fait d’économie politique, ces soins du gouvernement avaient infiniment plus contribué que les deux expédiens indiqués ci-dessus, à l’agrandissement et à la prospérité de l’agriculture de la Grande-Bretagne .
Cette faveur que méritent les baux à long terme, à cause de leur influence sur l’agriculture, n’a point échappé à la sagacité du nouveau législateur des Français. C’est le but direct de l’article 1743 du Code civil, dans lequel l’Empereur, s’écartant de la sanction du droit romain dans la loi Emptorem fundi cod. locati, prescrit que, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins que la réserve n’en ait été faite dans le contrat de bail. La loi de Justinien que je viens de citer avait véritablement son motif, qui était que l’acquéreur, n’étant que successeur à titre singulier, ne doit pas, comme le successeur à titre universel, être tenu des engagemens personnels de son auteur; mais cette raison, qui nous en a imposé pendant tant de siécles, n’était au fond qu’une pure argutie légale. L’orateur du gouvernement qui a fait au Corps-Législatif l’exposé du titre du Code Napoléon concernant le contrat de louage, l’a très-bien démontré . Et, comme il a été remarqué ensuite par un autre orateur qui prit la parole à l’occasion de la discussion de ce même titre du Code, cette innovation était manifestement sollicitée par l’intérêt public. «Elle favorise
» ( disait-il) les baux à longues années qui sont
» les plus utiles aux progrès de l’agriculture, et
» qui invitent le plus les fermiers à faire à la
» terre des avances dont ils sont assurés d’être
» remboursés .
Une autre disposition du Code Napoléon tendant à favoriser les baux à long terme des biens ruraux, se trouve à l’art. 22 56, qui veut que ceux qui possèdent pour autrui, et par conséquent les fermiers, ne puissent jamais prescrire par quelque laps de tems que ce soit. Et, dans le fait, si l’intérêt de l’agriculture exige que l’on multiplie ces baux à longues années, on a très-bien remarqué dans le Corps-Législatif, au sujet de l’article ci-dessus, qu’il fallait écarter de l’esprit du propriétaire jusqu’à la plus légère inquiétude que, de cette jouissance assez prolongée, le fermier pût se faire un titre contre le propriétaire lui-même, et le dépouiller .
Cette tendance de la législation civile des Français vers les baux à long terme est d’autant plus prudente et bien imaginée que, dans cette partie, les propriétaires, généralement parlant, n’entendent pas leurs véritables intérêts. Jaloux de voir à chaque renouvellement de bail leurs revenus s’accroître, et se flattant de pouvoir effectivement obtenir cet accroissement, bien loin de songer à conserver d’anciens fermiers, ils sont disposés à leur préférer, et ils leur préfèrent en effet, quiconque leur offre la plus légère augmentation de rente.