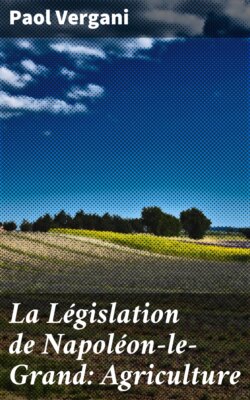Читать книгу La Législation de Napoléon-le-Grand: Agriculture - Paol Vergani - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION.
ОглавлениеTable des matières
LA France a toujours été regardée, même par les étrangers, comme un des pays de l’Europe les plus avantageux pour l’agriculture. Arthur Young, qui a consacré quatre années à visiter les différentes provinces de ce royaume, et qui les a toutes examinées sous leurs rapports agronomiques, avoue, sans balancer, que le sol de la France l’emporte de beaucoup sur celui de la Grande Bretagne. La surface de cette contrée a encore mérité les éloges du voyageur anglais: il a remarqué qu’on n’y rencontre que peu de montagnes; car il ne regarde point comme telles les collines et encore moins les simples éminences auxquelles on donne en France le nom de montagnes, et qui en même tems qu’elles servent à rendre les perspectives plus intéressantes, n’excluent pas la culture des productions qui ne peuvent pas venir dans les parties tout-à-fait montagneuses. Les véritables montagnes n’existent que dans les provinces méridionales: et Young ajoute qu’il les a toujours vues couvertes d’excellens pâturages ou couronnées de belles chataigneraies; qualités que Columelle désirait dans les montagnes . L’admiration de l’agronome anglais se manifeste encore plus lorsque de la nature du sol et de la surface il passe au climat:
«De toutes les centrées de l’Europe,
» dit-il, il n’en est peut-être pas une qui
» prouve autant que la France combien
» le climat influe sur la prospérité d’un
» territoire.» Et parmi les preuves nombreuses qu’il en donne, je n’en citerai qu’une seule; c’est que d’immenses étendues de terrain, qui en Angleterre ne pourraient être employées qu’à des garennes ou à faire paître des moutons, en France, cultivées en vignobles, donnent un des plus riches produits .
La position physique de la France augmentait encore le prix de ces avantages du sol et du climat, puisque par cette position elle se trouvait à même de verser les fruits de son industrie rurale dans une infinité d’autres Etats; et cela d’autant plus aisément que de pareils transports étaient facilités par le grand nombre de rivières qui la traversent en tous sens, et se jettent dans les deux mers qui baignent ses côtes.
Des dispositions de la nature aussi favorables n’ont pourtant pas été toujours secondées par le gouvernement; il les a même quelquefois ouvertement contrariées, et ce qu’il y a de plus étonnant, c’est que cela est arrivé précisément sous ce règne si glorieux, où toutes les autres branches de l’administration reçurent des développemens et des améliorations remarquables. La grande prédilection de Colbert pour les manufactures, au moyen desquelles il s’était proposé d’attirer dans le royaume l’or d’une grande partie de l’Europe, est connue de tout le monde. Comme il savait très-bien que l’heureux succès de ce genre d’industrie dépend sur-tout du bon marché de la main-d’œuvre, et que ce bon marché dérive principalement de l’abondance des subsistances, non-seulement il défendit la sortie hors du royaume des principales productions de la terre, mais il en rendit encore la circulation dans l’intérieur extrêmement onéreuse par la fixation du prix des denrées. Si ce ministre obtint véritablement, pendant son administration, ce qu’il s’était proposé, c’est-à-dire, de voir naître comme par enchantement, et s’agrandir de la manière la plus notable ces manufactures qui excitèrent sur-le-champ l’admiration et même l’enthousiasme de toutes les nations de l’Europe, on ne peut se dissimuler que l’agriculture n’en reçût un terrible contre-coup. Les riches cessèrent d’employer leurs capitaux à l’acquisition et à l’amélioration des terres, dont le produit était avili. Le laboureur quitta son village et vint chercher dans les villes une. existence moins pénible, en se consacrant aux travaux des arts de luxe. En un mot, la décadence de l’agriculture fut si grande et si rapide, que peu d’années après, sous le ministère de Colbert lui-même, la perte qu’éprouva l’Etat dans cette branche de sa richesse a été évaluée, par un auteur français contemporain, à quinze cents millions par an : assertion probablement exagérée, mais qui ne fut pourtant pas contredite; ce qui, selon un écrivain italien très-estimé, démontre au moins que la nation en reçut un dommage considérable .
L’idée du préjudice apporté à l’agriculture par cette faveur exclusive que l’on accorda à l’industrie des arts sous le règne de Louis XIV, était si généralement enracinée chez les Français, et avait tellement frappé leur esprit, que c’est à elle, et à elle seule, que l’on doit attribuer le merveilleux succès de la secte des économistes, qui prit naissance dans cette nation vers le milieu du siècle dernier; secte dont les adeptes ne prêchaient qu’agriculture, en décriant les arts comme une industrie tout-à-fait stérile, et qui ne méritait, en conséquence, ni les soins, ni la protection du gouvernement. Cet enthousiasme exclusif pour l’agriculture était un autre excès. L’agriculture est certainement la première et la plus importante des sources de la richesse publique; mais elle n’est pas la seule. Par l’agriculture, on obtient les produits de la terre; mais par les arts on en augmente la valeur, on en étend l’usage. Et c’est uniquement par le concours et le développement simultané de ces deux branches de l’industrie qu’un état peut parvenir à ce haut degré de prospérité et d’opulence que les économistes, de leur ton d’inspirés et avec leur assurance dogmatique, promettent aux peuples purement agricoles, mais que l’expérience du passé et du présent démontré ne se trouver que chez les nations qui, à l’exercice de l’agriculture unissent encore celui des arts et des manufactures.
Le nouveau Législateur des Français n’a point négligé les arts; il y a plus: ce fut un des premiers objets vers lesquels il tourna ses soins, dès qu’il fut à la tête du gouvernement. La ville de Lyon le sait bien, elle qui, dans les premiers instans du nouveau régime consulaire, ressentit les heureux effets du rétablissement de ses métiers que la main destructrice de la révolution avait brisés en un seul jour. L’Empereur n’a cessé depuis de s’occuper de la régénération entière, non-seulement de cette capitale de l’industrie française, mais encore de toutes les autres cités manufacturières. Et une preuve très-éclatante de la sollicitude de Sa Majesté pour les manufactures nationales, c’est l’exposition publique faite à Paris sur la fin de 1806, de divers produits provenant des fabriques disséminées sur toute la surface de l’Empire, classées selon leurs différens genres, et suivant l’ordre des départemens. Certes, on n’avait jamais offert un spectacle plus intéressant à la curiosité et à l’empressement des nombreux spectateurs. Si les arts de luxe et d’agrément s’y montraient dans tout leur éclat et toute leur pompe, et attestaient à la nation que la longue interruption qu’ils avaient éprouvée pendant la révolution ne leur avait pourtant rien fait perdre de ce bon goût et de cette élégance dans lesquels on s’accordait universellement à regarder les Français comme inimitables; il était encore plus consolant de voir que la nation était alors beaucoup plus avancée même dans les arts utiles. Les casimirs dont la fabrication était autrefois inconnue en France se trouvaient en abondance à cette exposition, et leur qualité était parfaite. La quinquaillerie, pour laquelle la nation avait toujours été tributaire des Allemands et des Anglais, montrait combien dans ses ramifications sans nombre elle se trouvait alors multipliée et perfectionnée. La teinture qui en France, dès le tems de Colbert, s’était déjà élevée à un tel point de beauté qu’elle surpassait de beaucoup celle de toutes les autres nations, paraissait à tous les yeux, même à ceux des juges les plus sévères, avoir acquis un nouvel éclat; et conjointement à l’art de teindre, on voyait aussi notablement perfectionnées toutes les autres manufactures qui dépendent des procédés chimiques; en un mot les produits de l’industrie nationale en tout genre offerts au public dans cette circonstance furent tels et si nombreux, qu’il fallut multiplier les couronnes beaucoup au-delà du nombre fixé par le gouvernement, qui ne s’attendait pas à voir réunis tant d’objets dignes de récompense.
Mais si Sa Majesté a apporté les plus grands soins à ranimer les arts et les manufactures, ceux qu’elle donnait en même tems à l’agriculture ne furent ni moins grands, ni moins heureux.
Les écrivains qui, dans ces derniers tems, ont parlé d’encourager l’agriculture, sans tomber pourtant dans l’excès et dans les idées outrées des économistes, s’étendent beaucoup sur le ressort des récompenses et des distinctions. C’est pour eux un vaste sujet de déclamations. Quel effet ne produit pas, dans leurs ouvrages, la description de la fête que l’on célébrait anciennement dans la Perse, à jour déterminé, fête où le fastueux monarque, après avoir déposé toutes les marques de la royauté se voyait confondu parmi les laboureurs, auxquels il avouait être redevable de toute sa puissance, et finissait par leur donner un festin splendide qu’il partageait avec eux? L’intérêt est encore plus grand dans le tableau que nous font ces mêmes écrivains, d’une fête semblable qui se célèbre à la Chine depuis la plus haute antiquité ; puisque le chef de cette immense nation honore non-seulement les agriculteurs, mais même l’agriculture, en se montrant chaque année, pendant huit jours de suite, conduisant la charrue, ouvrant un sillon, remuant la terre avec le hoyau; et finissant par distribuer des charges à ceux qui l’ont le mieux cultivée. On n’oublie pas non plus de nous rappeler que la première monnaie frappée par les Romains, eut pour empreinte une brebis ou un bœuf, emblèmes de l’abondance; que les tribus rustiques avaient le pas sur les tribus urbaines; que les magistrats suprêmes de la république béchaient la terre de leurs propres mains, et qu’ils se glorifiaient souvent de donner à leur famille un surnom qui rappelât à la postérité l’occupation favorite de leurs ancêtres.
Ces exemples, je le répète, sont brillans, et fournissent un vaste champ à l’éloquence, mais, si dans l’économie politique, comme dans toutes les autres sciences, on doit s’arrêter, non aux déclamations, mais au froid raisonnement et à la simple vérité, je dirai que, pour encourager l’agriculture, il est un moyen infiniment plus puissant que celui des récompenses et des distinctions, c’est de faire que chacun trouve son intérêt à porter le plus loin qu’il pourra l’agriculture, et qu’elle soit une profession véritablement lucrative . Avant qu’un propriétaire se laisse entraîner par l’enthousiasme de l’honneur à étendre et perfectionner la culture de ses terres, il faut qu’il ait goûté le miel du profit. Avant que le paysan sache ce que c’est qu’une distinction honorable, il faut qu’il sache ce que c’est que l’aisance et la commodité : un cœur opprimé par la pauvreté n’a d’autre sentiment que celui de sa misère.
Mais, si on a bientôt dit que l’art du législateur, en fait d’agriculture, consiste à la rendre une profession vraiment lucrative, combien ne faut-il pas de recherches et de soins de sa part, pour que la nation lui soit redevable d’avoir atteint réellement un but si important? Il doit, avant tout, écarter les obstacles qui s’opposent à son dessein: et de quelle pénétration ne faut-il pas qu’il soit doué pour bien connaître ces obstacles, et distinguer les véritables de ceux qui ne sont qu’apparens? Il faut encore remonter jusqu’à leurs causes, puisque sans cela le remède ne serait qu’un simple palliatif; et ce n’est pas tout encore. Après avoir reconnu ces obstacles, après avoir bien déterminé les causes qui les ont fait naître, il faut penser aux remèdes; et ici se présente une autre difficulté ; elle est telle que, pour la surmonter, il ne faut rien moins que toute la sagesse du législateur, puisque souvent, en voulant éviter un mal, on lui en substitue un autre encore plus grand. C’est de quoi les économistes nous fournissent un continuel exemple. Ils ont bien su découvrir les maux qui opprimaient l’agriculture presque dans toutes les contrées de l’Europe; mais lorsqu’il s’est agi d’en indiquer le remède, ces hommes, qui se regardaient comme les seuls clairvoyans, ne se sont montrés que des politiques purement théoriciens, supposant sans cesse un monde idéal, ne considérant les mesures qu’ils proposaient que du côté qui leur paraissait le plus favorable, et ne se doutant pas même qu’on pût rencontrer dans l’exécution de leurs projets ni obstacles, ni inconvéniens; en sorte que l’agriculture qui en France, sous le règne de Louis XIV, avait tant souffert par l’oppression dans laquelle elle était, comme nous venons de le faire voir, l’agriculture, dis-je, courut risque, pendant le dernier règne, et au commencement de la révolution, de souffrir encore davantage, parce que les mauvais remèdes proposés par les économistes avaient été malheureusement adoptés par les personnes qui avaient alors la plus grande part au gouvernement.
Aucune de ces observations n’a échappé à Napoléon-le-Grand. Il a su combiner sa législation avec une telle sagesse, qu’en même tems qu’il écartait tous les obstacles qui pouvaient nuire aux progrès de l’agriculture, cet art recevait les plus grands encouragemens; de sorte que l’on trouverait difficilement soit en France, soit ailleurs, aucun monarque qui lui ait prêté l’appui d’une main plus secourable pour en faire une profession vraiment lucrative.
Et comme la liaison qui existe entre la nouvelle législation de l’Empire français, et la prospérité de l’agriculture, est aussi facile à démontrer qu’elle est réelle et incontestable, je me suis déterminé d’en faire le sujet de cet ouvrage.
Lorsque j’ai entrepris ce travail, je n’avais d’abord en vue que les départemens italiens de l’Empire Français; je pensai que les propriétaires n’auraient pas tous une connaissance assez approfondie de la législation française, pour connaître par eux-mêmes les précieux rapports qu’elle a avec un art qui a toujours été et qui est encore aujourd’hui la source principale de leur richesse.
Mais, en avançant, je jugeai que mon ouvrage pourrait intéresser, non-seulement les Italiens, mais encore les habitans des autres pays réunis à l’Empire, et qui sont également agricoles , et que peut-être même les habitans de l’ancienne France ne verraient pas avec indifférence, restreint dans un petit volume, le tableau des soins que le gouvernement a pris pour rendre à l’agriculture tous les avantages dont un sol et un climat fortunés la rendaient susceptibles; ainsi je me suis décidé à publier mon livre en français.
Je n’ignore pas qu’il n’est accordé qu’à peu de personnes de bien écrire dans un idiome qui n’est pas le leur; mais je sais aussi que, suivant l’avis d’un des plus célèbres écrivains modernes, tout-à-la-fois philosophe profond et excellent littérateur , la règle de n’écrire que dans sa langue maternelle est restreinte aux seuls ouvrages de goût, puisque ce n’est que dans ces ouvrages qu’on exige pour principal mérite l’élégance.
Je m’estimerais trop heureux si on ne trouvait dans cet ouvragé que des fautes de cette nature; mais il est plus d’une fois arrivé, que des livres médiocres, et même mauvais, en ont fait naître de bons: et je ne désespère point que quelque écrivain plus habile que moi, frappé de l’importance du sujet, ne veuille employer ses veilles à enrichir la législation rurale d’un commentaire semblable à ceux qu’on nous a donnés sur le Code Napoléon et sur celui du Commerce