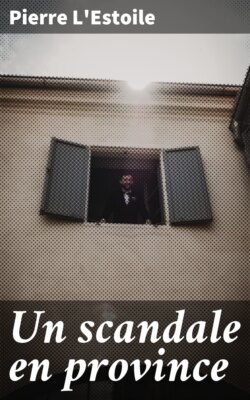Читать книгу Un scandale en province - Pierre L'Estoile - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII
En1849, il régnait encore, à Péronne, une certaine coutume bizarre dont l’origine remontait à une haute antiquité, connue sous le nom de «Droit de marché.» Un propriétaire n’avait pas licence–sur certains territoires –de prendre un fermier en dehors du pays.
Aucune loi, il est vrai, ne sanctionnait cette interdiction; mais le fermier étranger–s’il arrivait que le propriétaire en eût installé un –et le propriétaire lui-même subissaient tant de désagréments, que forcément ce dernier reprenait un fermier dans le voisinage. Seulement ici se présentait une difficulté nouvelle: si le précédent fermier avait été congédié sans des motifs d’indignité réelle, le propriétaire n’en trouvait point d’autre dans les environs, si bien qu’il ne lui restait plus qu’à cultiver sa terre lui-même. Dans cette hypothèse on le laissait tranquille.
Il est facile de concevoir, d’après cela, qu’un grand nombre de terrains devaient rester en friche autour de Péronne.
Or, il était arrivé qu’en1846M. Desrivières avait acheté, sur la route de Péronne à Amiens, une petite ferme et quelques hectares de terres.… labourables, mais en friche, et grevées de ce fameux droit de marché. Pendant deux ans, tout s’était passé on ne peut mieux: le notaire, au fait des coutumes picardes, avait adopté précisément le fermier congédié par le propriétaire précédent; cette manière de faire lui avait acquis les sympathies du voisinage; ses terres prospéraient sous une habile direction; sa ferme lui rapportait gros: il était enchanté.
Les choses en étaient là, lorsque, vers la fin de la seconde année, cet homme, en qui il avait mis toute sa confiance, vint le trouver et lui tint à peu près ce langage:
–Monsieur, mon fermage est trop cher, et je désire que vous me le diminuiez cette année, sans quoi je ne ferai pas un nouveau bail.
–Mon ami, répondit M. Desrivières avec bonté, je ne me refuse pas absolument à faire ce que vous dites, mais encore faudrait-il que je susse, avant de m’engager, dans quelles proportions vous désirez que je diminue votre fermage…
–Au moins d’un tiers, repartit impudemment le fermier.
–Vous n’y songez pas? cela est impossible.
–Il le faut cependant, car, sans cela, je cesse de cultiver.
–Je vous remplacerai, répliqua M. Desrivières, sans se dissimuler les dangers de cette réponse, mais emporté par une juste colère.
–Essayez, car moi je m’en vais.
Et, cela dit, le fermier sortit de l’étude du notaire, retourna aux champs, cultiva avec un soin extrême jusqu’à l’expiration de son bail… et puis disparut.
Le notaire, lui, fut fort embarrassé. Il fit appel à tous les cultivateurs du pays. N’en trouvant pas un seul qui voulût reprendre sa ferme, et sachant bien qu’il lui serait difficile de maintenir chez lui un étranger, il essaya de vendre sa propriété. Mais, dans ces conditions, la vente était presque impossible.
Bref, dans le courant d’avril, las des obstacles–prévus d’ailleurs–auxquels il se heurtait, M. Desrivières fit un coup de tête. Il prit un fermier belge. L’homme arriva, s’installa et ne rencontra tout d’abord que des figures souriantes. Mais, au bout de huit jours, les lettres anonymes–Péronne est le pays des lettres anonymes–pleuvaient dans l’étude du malheureux notaire, qui, chaque matin en parcourant son courrier, décachetait une épître dans le genre de celle-ci:
«Monsieur,
Si dans les trois premiers jours du mois de
mai vous n’avez pas renvoyé le nouveau fermier
que vous avez installé chez vous, votre ferme
sera incendiée dans la nuit du3au4. Quant
aux récoltes, trop vertes encore pour bien
brûler, ce sera pour plus tard.
A bon entendeur salut.»
La lettre qu’on vient de lire est celle que M. Desrivières reçut le30avril. Le notaire était trop du pays pour ignorer que ces sortes de menaces étaient souvent exécutées. Néanmoins, il pensa que peut-être, en prévenant tout à la fois le parquet, le commissaire de police et la gendarmerie, il échapperait à la loi commune: il garda donc son fermier. Mal lui en prit.
Dans la matinée du3mai, tandis que les prières publiques étaient dites à l’église, un homme que l’on ne connaissait pas à la ville remit à la cuisinière du notaire un paquet soigneusement ficelé et ne portant point d’adresse, en lui recommandant de le donner à son maître dès qu’elle le verrait. Vers midi, comme il revenait de la messe, M. Desrivières fut mis en possession du paquet; il l’ouvrit! c’était une botte d’allumettes. Il comprit; mais cette dernière menace ne put ébranler sa confiance dans les précautions qu’il avait prises.
A deux heures du matin, dans la nuit du3 au4, la ferme flambait.
Immédiatement toute la ville fut en rumeur. Aux premiers sons du tocsin, les pompiers avaient couru chercher les pompes et s’étaient élancés dans la direction où le sinistre leur était signalé.
Bientôt on sonna le boute-selle: les fenêtres de la caserne s’éclairèrent de toutes parts, et, quelques instants après, l’escadron désigné pour se rendre sur le théâtre de l’incendie fut sur pied. Cet escadron était justement celui auquel appartenait Mauzac; déjà les pelotons étaient formés lorsque le colonel parut. Il s’approcha du groupe des officiers et s’aperçut aussitôt que Guy n’était pas là.
–Où est le capitaine de Mauzac? demanda-t-il à un lieutenant.
–Nous ne l’avons pas encore vu, répondit celui-ci.
–Que diable peut-il donc faire?… murmura le colonel d’un ton de mauvaise humeur. Qu’on aille le chercher sur-le-champ!
Un brigadier, envoyé chez Guy, revint bientôt dire qu’il n’avait trouvé personne.
Le colonel laissa échapper un juron énergique. Il allait sans doute annoncer son intention de punir sévèrement le jeune officier, lorsque le tocsin, qui s’était un instant ralenti, redoubla d’intensité. C’était un indice que l’incendie prenait des proportions plus considérables; et dès lors le colonel ne songea plus qu’à courir où son devoir l’appelait.
.......................
Le lendemain, ou plutôt ce même jour, quelques heures plus tard, tous les cancaniers et cancanières de la ville, Laruelle et madame Desrivières en tête, savaient que le capitaine de Mauzac avait manqué à l’appel.
Mais comment la ville, comment la bourgeoisie de la ville avait-elle connu cette absence? Voilà ce que nul des amis du jeune homme ne put d’abord comprendre. Le sous-préfet, M. d’Ivry, était trop homme du monde pour ne s’être pas tu; il en était de même de M. de Serve, le procureur de la République. Quant au colonel du régiment de chasseurs, il n’avait guère de relations avec les Péronnais, et ce n’était certainement pas lui qui avait parlé.
Voici ce qui s’était passé:
En entendant sonner le tocsin, Laruelle s’était levé et avait cru de son devoir de fonctionnaire de se montrer sur le théâtre de l’incendie. Toute la nuit, il était resté là, pérorant dans les groupes, donnant des conseils aux pompiers, qui ne lui en demandaient pas, et portant parfois avec affectation un seau d’eau, afin qu’il fût dit qu’il avait pris une part active au sauvetage. Enfin, vers quatre heures et demie, la ferme étant entièrement consumée, il était rentré en ville.
Or le hasard voulait qu’il demeurât du côté opposé à l’incendie, aux environs de la rue d’Albert. Comme il allait introduire la clef dans la serrure de sa porte, il entendit derrière lui les pas d’un cheval. Il se retourna et s’aperçut, non sans surprise, que c’était un simple soldat monté sur un cheval d’officier, ce qu’il était facile de reconnaître à la selle.
Le percepteur eut aussitôt un soupçon qu’il se promit d’éclaircir. Il suivit donc le cavalier, le vit arriver à la porte de la ville, assista de loin au colloque qui eut lieu entre lui et la sentinelle. et remarqua qu’il revenait fort mécontent lorsque le passage lui eût été refusé par suite des ordres spéciaux donnés pour la nuit par le commandant de place.
Tout d’abord, Laruelle songea à interroger le soldat… mais c’était le moyen de ne rien découvrir, et il attendit. Vers six heures, il vit arriver Guy–et fut se coucher. Il savait ce qu’il voulait apprendre.
Guy fut mis aux arrêts.
Quant à Laruelle, quand il eut assez bavardé en ville, il songea à se rendre aux champs. Vers deux heures de l’après-midi, il s’en fut à Labassère.
–Madame, dit-il à la comtesse, je viens vous rendre un grand service.
–Lequel, monsieur? demanda Régine, très-surprise de cette entrée en matière.
–Madame, les instants sont précieux. J’irai droit au fait. M. de Mauzac est sans doute aux arrêts maintenant, car son absence a été constatée cette nuit.
La comtesse fit un haut-le-corps. Cependant elle se remit et répondit du ton le plus hautain:
–Eh bien! monsieur, en quoi cela peut-il m’intéresser? Je plains M. de Mauzac, et je le blâme tout à la fois, moi, femme d’officier, d’avoir manqué à son devoir.
Le Laruelle commençait à se sentir embarrassé. Le sang-froid et l’énergie de la frêle créature à laquelle il s’était proposé de faire peur le décontenançaient absolument.
–Madame, balbutia-t-il, j’avais pensé.… que… peut-être…
Régine l’interrompit; et, se levant:
–Monsieur, repartit-elle avec un sourire de mépris, vous avez mal pensé en songeant à apporter ici vos appréciations.
Laruelle s’était levé aussi, machinalement; et, peu après, la comtesse l’avait repoussé, sous le feu de son regard le plus fier, jusqu’à la porte du salon.
Elle ouvrit cette porte:
–Sortez, monsieur, dit-elle froidement au jeune homme, et ne reparaissez plus ici.
La porte se referma.
Après une seconde d’hésitation, le petit percepteur enfonça d’un geste résolu son chapeau sur sa tête. Il sauta dans la voiture qui l’avait amené, et murmura:
–Vous me le paierez tous deux!