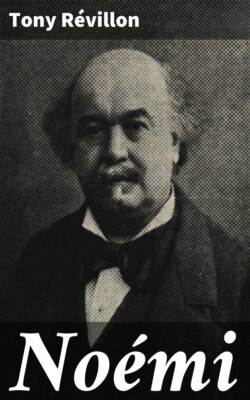Читать книгу Noémi - Tony Révillon - Страница 4
I
ОглавлениеMai1473.–Rue des Magasins-Obscurs, à Gênes. Le palais Adorno. La couronne ducale brille encore sur un écu de marbre, mais depuis un demi-siècle le grand portique qui donnait accès sur l’escalier d’honneur a été muré, et l’escalier lui-même a disparu. Au-dessus de l’ancienne cour carrée, des madriers entrecroisés supportent une toiture conique couverte de briques rouges, dont le rebord s’appuie sur la terrasse quadrangulaire qui surmontait les constructions primitives. Le jour arrive dans cette halle par dix fenêtres entre colonnes, d’où l’on aperçoit la mer. Le visiteur qui entre dans le palais par la rue se trouve dans une pièce étroite et haute, dont un rideau de tapisserie forme le fond, et dont l’unique meuble est un comptoir massif surmonté de balances à peser les métaux. S’il soulève la tapisserie, il s’arrêtera étonné et ébloui devant les richesses d’un bazar d’Orient.
Ici se déroulent les tapis, depuis la natte de sparterie ou de jonc tressé jusqu’aux laines veloutées de Smyrne et d’Aubusson. Là étinceilent les rejets éclatants des étoffes de Damas. Les soieries unies de la Haute-Italie contrastent avec les soieries brodées de l’Asie mineure et de l’Egypte. Puis viennent les dentelles flamandes filées à Bruxelles et à Valenciennes, les dentelles italiennes bordées à l’aiguille, les dentelles frangées de soie et d’or de la haute Loire et du Forez, tous les tissus à jour appelés «réseaux des femmes» par le prophète Isaïe.
Le quartier des cuirs succède à celui des étoffes et des dentelles: cuir maroquiné de Cordoue, cuir tanné de Liège, cuir de Hongrie fait avec des peaux de cheval apprêtées au sel et à l’alun, cuir de Transylvanie trempé dans la farine de seigle, cuir de Russie en peau de vache ou de veau que l’huile de bouleau pénètre d’un étrange parfum.
L’ivoire apparaît sous toutes ses formes: ivoire d’Afrique, plus dur et d’un grain plus serré que l’ivoire d’Asie; ivoire des dents d’hippopotame, plus fin que celui des défenses d’éléphant; ivoires blancs conservés sous des cages de verre; ivoires de couleur; et, sur une table d’ivoire et d’or, pareille aux tables des temples païens, des statuettes, des coffrets, des boîtes, des peignes, des cuillères, des manches de poignard en ivoire blanc, jaune et vert.
Les boiss: le bois de santal rouge que Salomon faisait venir d’Ophir pour construire le Temple, le bois d’ébène qui vient des Indes, le bois immortel tiré des forêts de Madagascar, le bois de rose qui croit au bord des canaux de la Chine, et le bois de Sainte-Lucie qu’on travaille dans les villages de la Lorraine.
Les fers, depuis les lingots d’un gris bleuâtre jusqu’aux chenets ornés de figures d’anges et de têtes de moines, chenets du cinquième et du sixième siècles avec des supports sur lesquels on tenait les plats au chaud, chenets du quinzième siècle avec des satyres et des femmes nues assis sur des globes enveloppés de feuillage. Les plombs, blanchis, jaunis, roussis, trahissant par la diversité des teintes la variété des combinaisons.
Enfin les armes et les costumes de guerre, musée merveilleux où revit l’histoire.
Cette épée ressemble à celle du roi Richard, qui partageait un bloc de fer, et ce cimeterre rappelle celui du sultan Saladin, qui coupait en deux un coussin de plumes. Voici toutes les armes, armes de jet, de main, de luxe ciselées et ornées, de guerre, de commerce, de traite, les couleuvrines de1380, simples tubes de fer fixés sur un chevalet, et les arquebuses de1425, à fourchette et à croc. Les casques en forme de bombe du temps de Hugues Capet suivent les casques à plaques et reposant sur un capuchon de cuir des soldats de Charlemagne. Le bouclier à lions doré du douzième siècle, grand à couvrir tout le corps du combattant, succède au bouclier du onzième siècle en forme d’amande, décoré d’un animal fantastique. Ce casque à grille, portant une couronne avec un lambrequin, couvrait le visage d’un chevalier du quatorzième siècle. Cette salade abritait la tête d’un arbalétrier du même temps. Si cette cotte à plaques de fer rivées sur un corsage de cuir a six cents ans et rappelle Rome, cette cotte de velours écussonnée date d’hier et caractérise le luxe qu’on commence à trouver partout, même dans les choses de la guerre.
Les épices dont les Portugais et les Anglais ont eu le monopole jusqu’au commencement du siècle, forment un des groupes importants de la Halle. Les «quatre-épices», girofle, muscade, poivre noir et cannelle, dominent dansce groupe, où figurent également les drogues: amômes, zédoaires, bétel, et les parfums: encens, myrrhe, kuphi composé d’encens, de myrrhe et de nard, aloès, safran, cinname, iris, huile de myrrhe employée par les Hébreux dans leurs cérémonies sacrées, résines qu’on fait brûler dans les cassolettes.
Mais les véritables trésors sont renfermés dans les caves. Là, dans des coffres et des armoires de fer, se trouvent l’or et l’argent sous toutes leurs formes: lingots, lames, feuilles, poudres, chaînes, vaisselles, qui représentent l’immobilité de la richesse, monnaies qui en représentent le mouvement. Leshanaps, vases en Allemagne, écuelles et tasses en Flandre, coupes et gobelets dans les pays latins, faits de métaux précieux, enrichis de pierreries, étincellent sur les rayons. Des diamants enveloppés de leur gangue, d’autres dont la gemme est découverte et dont la transparence, incolore, jaunâtre, brun clair, rose, verte ou bleue, éblouit le regard, sont entassés sans ordre, tandis que des écrins ouverts offrent les diamants en roses, au dessus taillé en facettes pointues, au dessous plat, les diamants en brillants taillés sur leurs deux faces, les diamants en table à la surface plane. A part, dans un coffret précieux, un diamant énorme, pesant367carats, représente le gage d’un emprunt contracté par un rajah de Bornéo, en attendant qu’il orne la tiare d’un pape ou la couronne d’un empereur.
Le premier coup de neuf heures–heure fixée par un règlement pour l’ouverture des magasins de Gênes–venait de sonner. Les commis et les serviteurs de la halle, groupés aux fenêtres, suivaient des yeux le mouvement du port avant de se mettre au travail.
Le sirocco avait soufflé la veille, et, au loin, dans le golfe, d’innombrables voiles qu’enflait encore le vent d’Afrique se dirigeaient vers la ville. A côté de la tartane génoise balancée par les clapotements de la houle, la galère de Malte aux flancs noirs fendait les vagues avec la régularité du soc qui trace un sillon. Les felouques marseillaises, les balancelles napolitaines, les caravelles espagnoles, semblaient escorte un grand chebec d’allure demi-commerçante, demi-guerrière, le plus imposant de tous ces navires et le plus lourdement chargé.
A sa vue:
–Le San-Stefano! s’écrièrent à la fois tous les commis.
Un jeune homme, ayant le teint blanc et les cheveux roussâtres d’un habitant du Nord, les yeux noirs et le profil typique de la race juive, se détacha d’un des groupes; il traversa la halle, souleva le rideau de tapisserie qui la séparait de la salle d’entrée sur la rue des Magasins-Obscurs.
Un vieillard petit et maigre, au nez crochu, aux yeux brillants dans les rides du visage, se tenait assis derrière le comptoir, vêtu de la longue houppelande et coiffé du bonnet jaune haut et carré imposé aux Juifs.
–Maître, dit le jeune homme, le San-Stefano arrive!
Le vieillard se leva brusquement. Ses mains tremblaient un peu.
–Le San-Stefano! Vite, Nathan, cours auport. Reçois mon vaisseau, donne les premiers ordres, prépare le débarquement. Dans une heure je te rejoindrai. Le San-Stefano! Je ne l’attendais que dans quinze jours! Vite, vite, mon fils, hâte-toi!
Nathan sortit rapidement. Le maître, soulevant à son tour la tapisserie, entra dans la halle.
Il la parcourut dans sa longueur, jetant autour de lui des regards gais. Arrivé près des fenêtres que les commis avaient quittées pour gagner leur poste:
–Oui, dit-il, c’est bien le San-Stefano!
Et il demeura immobile, à contempler le golfe.
Tout à coup:
–Jacob!
Le plus ancien des employés s’approcha de lui, des papiers à la main.
–Après-demain la Nina prendra la mer. Préviens le capitaine Morelli. S’il n’a pas rempli toutes les formalités nécessaires, qu’il se hâte. Il s’arrêtera à Marseille, à Barcelone, à Cadix, à Lisbonne et à Bordeaux. La traversée, aller et retour, ne devra pas durer plus de quatre mois. Dis en même temps au capitaine Damiani qu’il se prépare à mettre à la voile pour Alexandrie et Smyrne. Nous n’attendions le San-Stefano que dans quinze jours, mon vieux Jacob!
Le patron et le commis échangèrent un petit rire de compères auxquels arrive une bonne nouvelle.
–Maître, dit Jacob, je suis embarrassé. Nous sommes en règle avec Marseille, Cordoue, Anvers, toutes les places; mais la maison Lorbach de Cologne nous doit dix mille génovines, et nous devons la même somme à la maison Valentin de Strasbourg.
–Eh bien! nous enverrons les dix mille génovines à Strasbourg, et mon agent, au prochain voyage du San-Stefano dans les Pays-Bas, touchera les dix mille génovines de Cologne.
–Impossible, maître, car pas une des routes qui mènent à Strasbourg n’est sûre en ce moment. Le roi de France, le duc de Lorraine et l’empereur d’Allemagne d’un côté, de l’autre les ducs de Bourgogne, de Bretagne et le roi d’Angleterre sont en guerre, et, que nos dix mille génovines soient arrêtées en route par les Lorrains, les Français ou les Allemands, les Bourguignons, les Bretons ou les Anglais, elles n’en arriveront pas davantage à la maison Valentin et n’en seront pas moins perdues pour nous.
–Tu as raison. Attends.
Le vieux marchand se mit à réfléchir.
–La maison Lorbach n’est-elle pas en relation avec la maison Valentin?
–Assurément, maître.
–Eh bien! nous écrirons simplement à Lorbach de payer dix mille génovines à Valentin, contre un reçu qui déchargera à la fois notre maison de sa dette envers la maison de Strasbourg et la maison de Cologne de sa dette envers nous. Me comprends-tu?
–Si bien, que je vous proposerai d’agir de même avec tous nos correspondants. Ainsi le commerce serait à l’abri de la guerre, des violences, du vol à main armée, de tous les risques que lui font courir nos ennemis.
–C’est cela. Ecris donc cette lettre, Jacob. Ensuite tu viendras me la soumettre.
Le juif regarda encore une fois le San-Stefano, et, quittant la halle, il reprit sa place derrière le comptoir de la première pièce.
A peine était-il assis que la porte sur la rue s’ouvrit et se referma sur un jeune homme de haute taille qui portait le costume des capitaines de la marine marchande, la dalmatique bleue rayée de blanc et de jaune, et la barrette bleue à double filet d’argent. Quoique ce jeune homme parût à peine trente ans, ses cheveux blonds étaient déjà gris sur les tempes. Il avait une tête aux traits accentués, de beaux yeux bleus, brunis par la pensée, le teint hâlé du marin.
–Maître, dit-il, je me nomme Christophe Colomb. Je suis né en Corse et j’ai étudié à Pavie. Mais depuis l’âge de quatorze ans je n’ai d’autre patrie que la mer. Mes études, mes lectures, mes réflexions, mes voyages m’ont amené à cette conviction que la carte du monde que nous connaissons est incomplète. Pour les anciens, la terre s’arrêtait aux colonnes d’Hercule, et je suis allé aux îles Canaries, où les indigènes m’ont montré des objets façonnés de main d’homme que la mer avait apportés de l’Occident. Je crois qu’en dépassant les Canaries et en naviguant toujours à l’ouest, je trouverais une route nouvelle pour arriver plus promptement à l’Inde et à la Chine, qui doivent se prolonger à l’est bien plus loin qu’on ne l’a cru jusqu’ici. Pour chercher cette route, il me faut un vaisseau. Je l’ai demandé à Sa Seigneurie le doge et au sénat de Gènes, qui ne m’ont pas répondu. Je viens vous le demander à vous.
–A moi!
–Oui. Tout à l’heure, sur le port, j’écoutais les marins, les portefaix et le peuple. Tous parlaient des immenses richesses du juif Moïse. Les Frégose et les Doria sont pauvres auprès de vous. Il y a cinquante ans, votre père fut expulsé du territoire de la République, parce que la République désespérait de lui rendre tout l’argent qu’il lui avait prêté. Vous, pour revenir, vous avez offert d’anéantir cette créance, et aujourd’hui on vous doit une somme double de celle à laquelle vous avez renoncé. Vous avez un palais pour y loger vos magasins, et ces magasins sont encombrés de tous les produits du monde. Vos caves recèlent de l’or, et le golfe est plein du mouvement de vos vaisseaux. Ces vaisseaux, vous les exposez tous les jours dans des navigations périlleuses et lointaines. Donnez-moi le commandement de l’un d’eux. Laissez-moi chercher avec vous, pour vous, la route occidentale qui mène, j’en suis sùr, au pays des épices, de l’ivoire et des diamants!
La voix du jeune homme s’était élevée; ses yeux brillaient; il avait une lueur au front.
Le juif l’avait écouté en silence, Colomb espérait.
–Peut-être, dit enfin le vieillard, trouverez-vous la route dont vous parlez. Mais, pour une chance que vous auriez de la découvrir, j’en courrais cent, moi, de perdre mon vaisseau. Les voyages de découverte n’entrent pas dans le cercle de mes opérations. Vous me semblez un hardi marin. Demandez-moi le commandement d’un navire pour aller porter des toiles de Flandre à Smyrne et en rapporter des tapis et de la soie, à la bonne heure! Mais, pour les Indes, je continuerai à prendre l’ancienne route.
Le front de Christophe Colomb s’était assombri.
–Je vous remercie, dit-il. Vous me proposez d’aller en Orient, et c’est l’Occident qui m’attire, comme le Nord attire l’aiguille de ma boussole. J’attendrai la réponse du doge et du sénat de Gènes, et, s’ils me repoussent comme vous, je retournerai à Lisbonne, où je gagne ma vie en faisant des cartes de géographie pour les autres, en attendant de m’en servir pour moi-même.
Il salua d’un geste ferme de la main et sortit.
Un nouveau visiteur entrait dans la boutique; un tout jeune homme, presque un adolescent, le duvet aux joues, les grands yeux noirs limpides, l’air à la fois doux et hardi; pour costume un haut-de-chausses et une dalmatique de velours noir, une petite dague à gaine de velours à la ceinture, la toque noire à plume blanche.
–Maitre, dit-il, je me nomme Michel-Ange Buonarotti, fils de Ludovic Buonarotti, ancien podestat de Chiusi et de Caprese. Nous sommes pauvres. Mon maître Ghirlandajo m’a enseigné la peinture. La nature et l’étude de l’antiquité m’ont fait sculpteur. Compagnon des fils de Laurent le Magnifique, j’ai assisté enfant aux fêtes du palais des Médicis. Mais le pain de la tyrannie est amer pour un Buonarotti, dont les ancêtres conduisaient au combat les citoyens de la libre Florence. J’ai quitté mon pays natal, et je suis venu demander l’hospitalité à la ville de Gènes. Je n’y ai trouvé qu’indifférence ou mauvais accueil. Prêtez-moi deux cents écus. Dans un an, j’aurai fait une œuvre si grande que tout le monde s’inclinera devant elle; mais il me faut un atelier, du pain, le bloc de marbre dont je tirerai la pensée, le mouvement et la vie.
–Jeune homme, dit le juif, je m’entends mieux aux choses du commerce qu’à celles de l’art. Si votre ciseau fouille trop avant, si votre main donne un coup de maillet trop fort, adieu le bloc de marbre, et adieu mon argent! Même en admettant la statue faite, lui trouverez-vous un acheteur? Où sont mes garanties? Avez-vous des bijoux, des terres?
–Je n’ai rien, dit le jeune homme, que la certitude de mener à bien l’œuvre dont je parle.
Le juif hocha la tête.
–Vous ne partagez pas ma confiance; adieu!
La porte fut brusquement poussée. Un troisième visiteur, en justaucorps de buffle, le bonnet de travers, l’épée traînant sur les dalles, vint se camper en maître devant le comptoir.
–Juif, je suis le baron de Gondio, lieutenant du comte de Campo-Basso, qui sert Charles, duc de Bourgogne et de Flandre.
–Que désire Votre Seigneurie?
–Ma Seigneurie désire de l’or. Je ne suppose pas qu’on aille chez un juif pour autre chose. J’ai levé une compagnie de cent hommes, qu’il me faut nourrir, payer et conduire en Flandre. Je te rembourserai après la campagne.
–Après la campagne? Et si vous êtes tué, qui me paiera?
–Lorsque tu armes un vaisseau, juif, tu sais qu’il peut se perdre en route. Tu l’armes cependant, calculant que s’il revient le bénéfice sera le double ou le triple de la perte dont tu auras couru la chance. Eh bien! tu feras pour moi comme pour ton vaisseau. Je te signerai un billet du double de l’argent que tu me prêteras, afin de compenser les chances de ma mort. Tu es un joueur et je suis ta carte. Je te promets d’en prendre soin.
–Ce que vous demandez est impossible.
–Impossible!
Gondio détacha son épée, et, la posant sur un des plateaux de la balance:
–Je suis gentilhomme.
Le juif s’inclina de nouveau.
–Il me faut deux mille écus.
–Deux mille écus! s’écria le juif en levant les mains. Je ne les ai jamais eus. Les marchandises que contiennent mes magasins, les vaisseaux qui les transportent pour en rapporter d’autres, constituent toutes mes richesses. Je fais des échanges et j’ai tout juste chez moi la somme nécessaire aux dépenses de ma maison.
–J’attends! dit Gondio.
–Seigneur, je dis la vérité.
–J’attends!
Il fit un geste de menace.
Le vieillard se leva, tremblant.
–Je n’ai pas deux mille écus. Peut-être, en réunissant toutes mes ressources, trouverai-je une partie de cette somme. Je vais voir, chercher. Prenez un siège. Je reviendrai bientôt !
Et, son bonnet jaune à la main, humble, courbé, le vieux Moïse se dirigea vers la halle.
Resté seul, Gondio reprit son épée, et, s’approchant d’une fenêtre, regarda distraitement le spectacle de la rue.
Il entendit un bruit léger, se retourna.
Par une porte latérale une jeune fille venait d’entrer dans la boutique, et elle demeurait immobile, les yeux fixés sur lui.