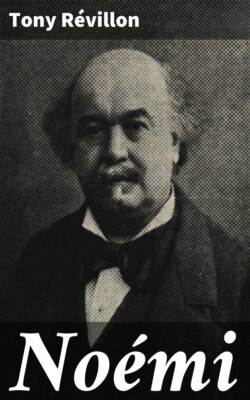Читать книгу Noémi - Tony Révillon - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPREMIÈRE PARTIE
ACHETEZ!
Table des matières
I
Table des matières
Vers une heure du matin, une des portes-fenêtres du cercle s’ouvrit. Un jeune homme traversa lentement la terrasse et vint s’accouder sur la balustrade à l’angle de la place de la Concorde et des Champs-Elysées. Il demeura ainsi un instant immobile; puis, brusquement, il se redressa, et, jetant son chapeau sur un des fauteuils de fer à l’Américaine épars derrière lui, il passa à plusieurs reprises son mouchoir sur son visage. Au momentnt de de le remettre dans sa poche, il s’aperçut que sa main tremblait. Il fit un effort de volonté: le tremblement de la main cessa, et les lèvres, que remuait un rire nerveux, se tendirent et redevinrent fermes. La tète haute, il regarda devant lui et vit, dans la lumière bleue d’une nuit d’été, les massifs noirs, l’obélisque, les colonnades, les Villes de pierre et les fontaines. C’était son Paris, le Paris des palais, des cercles, des jardins, des avenues, le Paris des riches. Et il venait de perdre au baccarat son dernier billet de mille francs.
Ce jeune homme se nommait Michel-Etienne-Marie de Gondie.
Le premier de sa race qui vint en France, François-Marie de Gondio, était un cadet de Piémont. Vieille famille, beaucoup d’enfants, peu d’argent: on se faisait prêtre ou soldat. Vers la fin du quinzième siècle, les Français avaient passé les Alpes. Pendant les seizième et dix-septième, les Italiens leur rendirent leur visite. Seulement, c’étaient des armées françaises qui allaient en Italie. Les Italiens, eux, arrivaient un à un, tout au plus par groupes, jamais par troupes. Une fois chez nous, ils y faisaient fortune et s’y acclimataient si bien qu’ils ne songeaient plus à retourner chez eux. Ils gouvernaient l’Etat avec les Médicis et les Mazarin, créaient les cafés avec les Casati et les Procope, commandaient les armées avec les Broglio et les Gondio.
Notre cadet entra au service, fit bravement la première guerre d’Espagne et devint lieutenant-général au moment où Louis XIV devenait majeur.
Son fils fut un des soldats de Turenne; il commandait une des vieilles bandes dont le sang paya l’Alsace. Un peu plus tard, envoyé dans le Midi, il traita les protestants des Cévennes comme il avait traité les paysans du Palatinat. Il mourut maréchal de France.
Le troisième Gondie négocia des traités, et le quatrième livra des batailles. En1789, à Versailles, il était un des chefs de l’armée de la contre-révolution; mais, dès le lendemain de la prise de la Bastille, il vit clair dans le sort de la royauté, passa en Allemagne, et fut un des premiers émigrés qui entrèrent en Champagne avec les Prussiens. Plus tard, il servit avec les Anglais et les Russes.
Son fils vécut à l’écart pendant l’Empire. Pair de France sous la Restauration, il fit partie de la coterie des doctrinaires, composée de professeurs et de philosophes, très-raides de leur personne, très-absolus dans leurs idées, mais, par-dessus tout, désireux de les appliquer eux-mêmes.
Ces hommes d’Etat voyaient dans la monarchie constitutionnelle le dernier mot de l’esprit humain, et, puisque les priviléges héréditaires de la noblesse n’existaient plus, ils remédiaient à cela en élargissant un peu le cadre des aristocraties pour y faire entrer les hauts fonctionnaires et les citoyens riches. La haine de César et l’horreur du peuple. La loi faite par eux, pour eux, leur assurant à la fois la liberté contre la tyrannie d’en haut et tous les moyens de défense contre les besoins et les aspirations d’en bas. Pour faire respecter cette loi, se montrer impitoyable à l’occasion. Ni attendrissement, ni pitié, ni surtout initiation des classes inférieures à la vie publique. Tout pour la doctrine et les ministères. Au début, ils étalaient leur dévouement à la dynastie légitime; mais ils acceptèrent très-bien la dynastie de juillet. Religieux du reste, qu’ils fussent protestants ou catholiques, la religion faisait partie de la doctrine. Pour la garantie de leur monopole, deux préfets de police sont nécessaires: celui du quai des Orfévres et Dieu.
Le Gondie doctrinaire eut son heure de popularité sous la Restauration, en combattant pour les libertés bourgeoises contre l’ancien régime pur. Sous Louis-Philippe, il fut un des propriétaires du pays légal, et il eût été ministre comme ses amis de Broglie, Duchàtel et Guizot, si la mort eût tenu compte de son ambition. Sa veuve, grande dame d’une façon beaucoup plus absolue qu’il n’était grand seigneur, ne reparut pas à la cour et mena la vie austère et dévote du faubourg Saint-Germain. Elle entendait une messe basse tous les matins, occupait ses journées à broder des devants d’autel et présidait une OEuvre. M. de Gondie eut élevé son fils pour la pairie et lui eut fait donner cette forte éducation à laquelle l’aristocratie anglaise doit ses hommes d’Etat; l’enfant, placé chez un répétiteur, aurait suivi les cours d’un collége et il aurait fait son droit. Madame de Gondie, après avoir essayé d’un précepteur abbé, mit l’enfant chez les jésuites, désireuse avant tout d’en faire un bon catholique et un fidèle sujet de la branche aînée. Lorsqu’elle mourut, en1855, voici la vie édifiante que menait le dernier des Gondie, majeur depuis un an:
Son valet de chambre entrait chez lui à midi. De midi à deux heures, il s’occupait de sa toilette, trouvant un quart d’heure pour faire un court déjeuner: des viandes froides, des œufs, une côtelette, du thé. Parfois survenait un camarade de collége ou un fournisseur. Avec le camarade, la conversation tournait dans le cercle des filles, des chevaux, des paris, des gilets, des articles des petits journaux et des pièces des petits théâtres. Avec le fournisseur, il suffisait d’écrire le mot «accepté» et de signer son nom en travers d’une bande de papier ornée d’une Loi tenant des balances au-dessus d’un Aigle. A trois heures, le jeune homme montait à cheval. A cinq heures, il était au club, demandant ce qu’il y avait de nouveau, ou chez une des trois cents femmes qui forment le sérail libre de la jeunesse millionnaire ou titrée. A sept, s’il ne dinait pas avec sa maîtresse aux Provençaux ou chez Philippe, il dinait au cercle. A neuf heures, il causait à haute voix à l’orchestre des Bouffes ou des Variétés. Puis, à minuit, il retournait au club achever ce qu’il est convenu d’appeler la soirée, depuis qu’on appelle matinée une fête qui commence à trois heures après midi.
Au mois d’août il allait à Dieppe ou à Trouville, au mois de septembre à Bade; il chassait en automne, et courait les steeple-chases au printemps.
Rien qui ressemblât à une pensée d’avenir. Une paresse d’esprit incroyable. Une activité incessante toujours appliquée à des riens.
Etienne vécut ainsi pendant douze ans, dépensant d’abord le double de son revenu, n’ayant plus ensuite que le revenu nécessaire pour payer les intérêts de sa dette et prenant sur son capital, enfin, ce capital disparu, gardant encore une certaine force de crédit, comme un wagon lancé sur des rails garde,–sa vitesse acquise épuisée,–une certaine force d’impulsion. Mais, depuis deux ans, le wagon était arrêté. Etienne n’aurait pas trouvé une balle de bouchons chez l’usurier le plus hardi. Après trois déménagements, il avait vendu ce matin son dernier mobilier. Il venait de perdre son dernier billet de banque.
Tout cela s’était fait naturellement, avec le temps, peu à peu, sans gaspillage, sans enthousiasme, sans générosité. La fortune des Gondie n’était pas très-considérable. A peine eùt-elle suffi à faire vivre honorablement une douzaine de familles d’employés, et son héritier l’avait fait durer douze ans. Il est vrai que pendant douze années il n’avait jamais eu, sauf les cas de chance au jeu, cinquante louis dans sa poche dont il put disposer. L’emploi de chaque recette était fixé d’avance. Quand le jeune homme touchait dix mille francs, il se trouvait toujours qu’il en avait douze mille à payer le lendemain. Aux femmes, il donnait des bij oux achetés à crédit. Il devait à ses fournisseurs, à son valet de chambre, à son concierge, aux garçons du cercle. Il était perdu.
Blond, l’œil d’un bleu froid, la moustache fine et claire, il ressemblait à un jeune lord par les allures, le costume, la manière de monter à cheval; mais, sous cette convention purement extérieure, il demeurait original, c’est-à-dire naturel. Rien en lui des Gondio doctrinaires et diplomates; tout ce qui peut se retrouver au dix-neuvième siècle des Gondio aventuriers et soldats: la bravoure, l’effronterie, un peu de cruauté. Il avait rompu brutalement, sans souci du chagrin qu’il causerait, avec les rares femmes qu’il avait connues en dehors des actrices et des filles. Avec les hommes il était froid et cassant jusqu’à l’insolence.
Sans études sérieuses, sans lectures, il connaissait très-bien la vie, savait au juste à quoi s’en tenir sur le mobile des actions d’autrui par rapport à lui: «Un tel me recherche parce que ma compagnie lui plaît. Un tel parce qu’il est un esprit à la suite et qu’en marchant derrière moi il s’épargne l’embarras de choisir lui-même son chemin. Un troisième m’oblige parce qu’il n’ose pas faire autrement, mais dans son for intérieur il a d’avance réduit le service qu’il me rend au minimum indispensable pour qu’il garde son caractère de service. Cette femme a eu des bontés pour moi parce que je suis comte. ette autre parce que je suis riche, cette autre Darce que je suis jeune, et cette autre parce que na personne lui plaît.» Et il se jugeait quitte envers tous et envers toutes.
Depuis deux ans qu’il vivait d’expédients, de hasards, passant quelquefois une semaine sans avoir de quoi payer ses cigares, il était devenu plus hautain et plus glacé. «Les amis de mon Dère, ducs, académiciens et pédants, me méprisent. Les amis de ma mère, pieux, étroits, antédiluviens, lèvent les bras au ciel quand on prononce mon nom. Au cercle, on me tient pour un décavé qui ne se refera pas.» Il se disait cela, et il montrait un front d’airain qui arrêtait même la pensée d’une plaisanterie.
Ce jeune homme de trente-quatre ans, ruiné, endetté, déclassé, était un homme. Il s’imposait.
Il n’avait ni volé au jeu, ni accepté de sa dernière maîtresse autre chose que des dîners; mais sa situation était connue, par conséquent elle devenait intolérable. Il le savait, et cependant, lui si résolu, si décisif, si prompt à prendre parti, il attendait,
Un sentiment nouveau était né en lui, qui, lui faisait une loi de rester sur son terrain avec ses irmes. La sueur qu’il avait essuyée tout à l’heure sur son front était celle de l’agonie: «Je ne puis plus attendre». Il s’avouait vaincu.
Deux membres du cercle entrèrent sur la terrasse: un colosse à la face apoplectique, aux épaisses moustaches pendantes, et un homme jeune encore, chauve, pâle, la moustache blonde à pointes cirées et l’impériale, ayant cette allure militaire qui caractérisait les hommes du second empire. Le premier était un général qui ressemblait à un capitaine de cavalerie, et le second un homme d’Etat qui ressemblait à un général de sergents de ville.
Ils se montrèrent Gondio du regard.
–Gentil garçon! dit le général. Vous devriez faire quelque chose pour lui.
–Impossible. Il est trop compromis. Au commencement, nous faisions ce que nous voulions. Maintenant nous faisons de la moralité. Ce gentil garçon, comme vous dites, n’a même plus la chance d’un beau mariage. Il est tombé dans la dette criarde, et il donne le bras à la des Orthies. On prétend qu’elle veut se faire épouser. Elle en viendra à bout.
–Nom de Dieu! Le descendant d’un maréchal de France!
–Eh bien! c’est cela, il est descendu.
Gondie se retourna, vint à eux, leur serra correctement la main, et, quittant la terrasse, il sortit du cercle.
A la porte, il monta dans une des voitures qui stationnent toute la nuit dans cette partie de la rue.
–A Boulogne, monsieur le comte? lui dit le cocher qui le connaissait.
Gondie fit signe que oui, et, s’enfonçant dans le fiacre, il s’endormit du lourd sommeil qui suit les Waterloo.