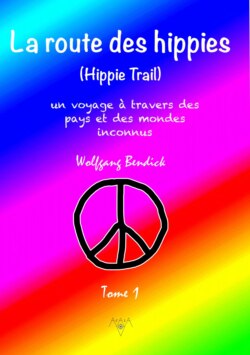Читать книгу LA ROUTE DES HIPPIES - TOME 1 - Wolfgang Bendick - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2. LEVER DU JOUR
ОглавлениеA 8 heures je décolle. Je quitte le village pour m’engager sur la nationale. Après avoir passé les dernières maisons, je prends conscience de l’aventure dans laquelle je me suis engagé. Les larmes me montent aux yeux, mes lunettes d’aviateur sont embuées. Je gare le lourd convoi sur le bord de la route et j’ôte mes lunettes. A travers un voile de larmes, je regarde en bas le village. Douze ans auparavant au même endroit mon père avait fait arrêter le camion de déménagement. Nous étions tous descendus, et il nous avait montré la ‘Terre Promise’ comme Moïse à son époque, en disant : « Là en bas, le toit avec le poteau électrique, c’est notre nouveau chez nous ! »
J’y avais vécu beaucoup de moments difficiles, car pour un enfant du Nord il n’était pas simple de vivre en Bavière. Mais pour l’instant je ne me remémore que les beaux souvenirs du passé comme dans un film en accéléré, et je sais que c’est un adieu pour toujours ! C’est peut-être là le prix de la liberté que de se remettre entre les mains de son destin… Peu à peu mes larmes s’assèchent et la souffrance des adieux se transforme en une attente des choses à venir, pleine d‘émotion. Je passe la vitesse et redémarre. Je me sens comme l’oiseau tombé du nid et qui découvre tout à coup l’univers qui l’entoure.
Tout au long des dix kilomètres qui suivent, je revois dans ma tête défiler la soirée d’hier. On était allé à l’ancien bras de la rivière. Rien ne s’était passé entre nous comme d’habitude et contrairement à ce que j’avais espéré pour cette ultime soirée : « D’abord le boulot, ensuite le Schnaps », avait dit Marion. Alors je m’étais mis à la tâche comme l’aurait fait une pelleteuse. Nous étions arrimés l’un à l’autre, tendrement enlacés et nous couvrant de baisers, tandis que nos langues se touchaient à la découverte de nos bouches. Nos dents aussi se touchaient et notre tension était palpable à leur contact. Tout en moi aspirait à vivre intensément le toucher de sa peau, ou du moins à caresser quelque chose en bas de son ventre. Pas de geste déplacé, me disais-je, surtout ne pas détruire la magie de l’instant présent…Nous n‘étions que trop les enfants de notre époque, à vrai dire coincés, tel mon sexe que je libérai discrètement de sa position, prêt à se rompre de désir. Les étoiles nous faisaient un clin d’œil malicieux, la lune voilait discrètement son visage comme pour nous plonger dans une obscurité intime et nous donner du courage…
Mais tout cela n’était pas nécessaire, car en fait rien ne se passa. Au premier contact, mes doigts en quête de son corps se heurtèrent à la cuirasse impénétrable de ses sous-vêtements. Portait-elle une ceinture de chasteté ou était-ce un porte-jarretelles de sa mère qui défiait le libre cours de ma curiosité ? Au bout d’un moment elle tira de sa poche une flasque et dit : « Bon, maintenant le Schnaps ! »
Il faut dire que jamais auparavant je ne m’étais senti aussi frustré qu’à ce moment-là ! Nous restâmes étroitement enlacés pendant un certain temps encore, nous frottant l’un contre l’autre, faisant augmenter notre pression sanguine à un point tel que la chaleur de nos deux corps nous contraignit à ôter nos pullovers. Elle profita de cet instant pour me passer autour du cou un lacet de cuir, comme je l’avais fait moi-même quelques jours auparavant. « Chaque fois que je regarderai la lune, je penserai à toi ! », murmura t’elle en m’offrant un baiser. En reprenant mon souffle, je lui bégayai « J’espère, aussi quand tu regarderas le soleil ! » « Et toi donc ? » « Moi aussi, bien sûr, comme toi, je le ferai chaque fois ! » Nous nous promîmes alors l’un à l’autre de bien garder le lacet. Seul l’autre aurait le droit de le dénouer. Dans un an et demi au plus tard, quand elle aurait son bac, il me faudrait revenir et cette fois nous voyagerions ensemble. D’ici là c’était nos pensées qui nous unissaient. Je la raccompagnai jusque chez elle, et après une dernière étreinte je partis sans me retourner. J’entendis la porte de sa maison se refermer à clef…
Pourquoi farfouiller encore dans le passé ? C’est fini ! Il s’éloigne à 70km/heure, il faut regarder devant seulement, en direction de l’est où le soleil est en train de se lever derrière les montagnes. Comme le monde est beau ! Le disque rougeoyant du soleil, le souffle du vent en roulant, le bouillonnement du moteur, tout ça me donne un tel sentiment de bien-être ! Le parfum de la liberté monte en moi, tandis que je suis la bande noire de la route. Il me revient en mémoire la chanson « Père et Fils » de Cat Stevens et je chante à tue-tête : « J’ai été un jour comme toi à présent », surtout la troisième strophe : « Comment faire pour lui expliquer ? Quand j’essaye, il tourne une fois de plus le dos. Toujours la même vieille histoire. Dès l’instant où je pouvais parler, je devais écouter. Il y a une solution à présent, c’est que je parte, je le sais, je dois partir ! » Oui, je devais partir et je suis parti ! Me voici en route pour l’inconnu !...
Le passé est quand même coriace, il ne vous lâche pas si facilement, je le retrouve partout dans ce vieux monde : Cette route sur laquelle je circulais à présent, combien de fois l’avais-je empruntée pour aller à l’école, par tous les temps, en toutes saisons, au début en mobylette, plus tard en voiture. J’en connaissais le moindre virage, la moindre ligne droite. Et pourtant cette fois c’était différent : un side-car, ça ne se conduit pas comme une mobylette ou une voiture, et en plus je me trouvais sur une route à sens unique et sans fin que je ne réemprunterais plus jamais en sens inverse…
Je fis une pause sur une place de parking où j’avais déjà assez souvent passé la nuit dans mon Combi VW quand j’étais trop fatigué sur le chemin du retour à l’école. A partir d’aujourd’hui j’avais le temps. Je me bourrai une pipe et fis quelques pas pour me dégourdir les jambes, lorsque mon regard se posa sur ma moto. Superbe look ! Devant, le pare-brise en biais lui donnait presque l’apparence d’une Harley Davidson. La caisse du side-car était fermée par une bâche qui la rendait étanche. A l’arrière étaient entassés trois roues complètes et trois pneus à crampons flambant neufs, qui formaient une tour de Pise penchée en biais vers l’arrière. Sur le porte-bagages de la moto j’avais fixé mon sac de marin plein de fringues. A gauche de la roue arrière pendaient une sacoche et un bidon d’essence, un autre se trouvait dans le side-car. Ils étaient encore vides. Je fis le tour du véhicule pour vérifier les fixations et regardai dans le rétroviseur. Un visage barbu m’apparut, avec un casque-bol aux couleurs du drapeau allemand et des lunettes d’aviateur qui me faisaient penser à Antoine de Saint-Exupéry et au « Petit Prince », un de mes livres préférés. Comme avait dit le renard, « on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ».
Je retendis les fixations des roues de secours. Puis je me débattis un peu comme un moulin à vent avec mes bras qui tremblotaient car le guidon était difficile à contrôler, et le side-car tirait surtout en montée beaucoup vers la droite. En descente quand le moteur freinait, c’était l’inverse, il poussait, et dans les deux cas je devais contrebraquer énergiquement. Combien pouvait peser l’ensemble ? La moto et le side-car dans les 350 kilos, plus l’équipement et moi, au moins 500 kilos d’après moi. Ma pipe s’était éteinte. Je touchai les tambours de frein qui étaient aussi chauds qu’elle. Sous le carter du cardan de la roue arrière une goutte d’huile suintait, tandis qu’une autre était tombée sur la jante et se répandait sur le pneu. Merde ! Quelque chose avait dû chauffer, ou bien est-ce que la purge du bouchon de remplissage était bouchée ? Je la dévissai et soufflai pour la nettoyer. L’essentiel, c’est que le moteur tourne, me dis-je. Je baissai les lunettes, remis les gants, un coup de kick avec le pied, encore et encore, sans résultat. Quelle invention stupide, ce kick parallèle au châssis qui avec son mécanisme de pivotement agit sur le vilebrequin ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il y avait tout simplement trop de jeu ! Pourquoi donc Monsieur Zündapp n’a t’-il pas procédé comme chez BMW, qui a un moteur où le kick est perpendiculaire à l’axe de déplacement ? A force de donner des coups de kick, je commençais à transpirer. J’enlevai alors les gants et les lunettes qui étaient déjà embuées, puis le casque. Rien ne bougeait. J’enlevai le capuchon de la bougie. Une étincelle ? L’essence ? Ça marchait. Qu’est-ce que ça pouvait bien être ? Peut-être la bobine d’allumage trop chaude ? Il me vint alors soudain une idée : Je renfilai casque, lunettes, gants. Le parking était en pente douce. Je passai au point mort, poussai de toutes mes forces, ça roulait à nouveau, je sautai en selle, j’enclenchai la seconde sous les protestations de la transmission, j’embrayai doucement… Sous un nuage de fumée, le moteur se remit en marche. C’était bon !...
Arrivée à Hohen Peissenberg : Je dévale les virages, c’est un vrai plaisir, je joue avec l’accélérateur et le frein selon la direction des virages et selon la pente. Je passe devant les maisons aux façades inclinées par l’exploitation du charbon. Direction Weilheim. Au loin la B2. Auparavant encore un passage à niveau. A mon approche les barrières se ferment, les voitures sont à l’arrêt devant moi. C’est bon, les freins fonctionnent. Le train passe en trombe, tandis que les barrières restent fermées. Peu après arrive un long train de marchandises en contresens avec d’innombrables wagons, c’est trop long pour mon moteur qui fait preuve d’impatience et s’arrête. Merde ! quelques coups de kick, bien sûr en vain !... Pendant ce temps les voitures derrière moi ne cessent de klaxonner, ce qui est compréhensible, d’ailleurs j’aurais fait de même. Une fois la file des voitures d’en face passée, c’est enfin à notre tour. Les visages derrière les vitres ne semblent pas particulièrement satisfaits, moi non plus, car je n’ai parcouru que 50 des 50 000 km qui m’attendent ! Les passagers du dernier véhicule ont pitié de moi, descendent, et à quatre nous essayons de pousser le mien. Je me dis que ce sont peut-être aussi des motocyclistes. Au bout de cent mètres environ, la moto redémarre et dégage à nouveau une épaisse fumée. Surtout ne pas s’arrêter ! Peu après mes sauveteurs me dépassent en entonnant un concert de klaxon et me font de la main le signe de la paix par la vitre ouverte. Je me dis qu’aujourd’hui encore je vais devoir trafiquer la bobine d’allumage. Je jette alors un coup d’œil au poignet sur mon énorme montre de plongée : bientôt midi ! Je pourrais me faire inviter à déjeuner dans mon ancienne école, où je dois récupérer l’argent de la vente de ma BMW si indispensable à ma bourse de voyage ! A peine 2000 DM pour m’emmener jusqu’en Australie !
Les cloches sonnent midi, lorsque mon attelage pénètre dans la cour du séminaire. Il fait beau, les fenêtres du réfectoire sont ouvertes, une foule de curieux attirés par le bruit de mon char d’assaut se penchent pour voir. Je m’apprête à mettre le side-car dans le sens du départ au cas où il faudrait pousser, et décris une courbe serrée sur la droite. Est-ce-que je vais trop vite, est-ce que je freine au lieu d’accélérer ? Seul un conducteur de side-car expérimenté aurait pu me dire à cet instant quelle erreur j’avais commise, toujours est-il que le side-car se soulève d’un coup, et qu’effrayé à l’idée que tout va se renverser, je freine désespérément. Mais l’attelage par chance reste en équilibre, et au bout de quelques secondes interminables il finit par retomber sur ses roues. Dans l’attente des moqueries des spectateurs, et tout honteux, j’aurais envie de disparaître dans l’asphalte. A ma grande surprise ils applaudissent avec enthousiasme. « Super, quelle maîtrise ! » s’écrient-ils. Joseph, le nouveau propriétaire de mon ancienne « compagne de route », vient vers moi. Je me dis qu’il doit avoir hâte de me régler. « Ta caisse, c’est de la camelote ! Tu m’as entubé ! » s’exclame-t-il. « Quoi ? » dis-je tout étonné. « Tout est flambant neuf et révisé ! » Il réplique alors : « Comment ? Il n’y a même pas de régulateur, la dynamo ne marche pas, et tu as tout branché directement sur la batterie ! » En riant je lui rétorque : « Regarde de plus près ! Le voyant de contrôle de charge fonctionne, c’est donc que tout est ok. Le régulateur est dans le phare pour éviter toute surchauffe ! » Alors qu’une cohorte d’élèves se presse autour de nous, Joseph dévisse le réflecteur et trouve le régulateur. « Ce n’est pas une mauvaise idée ! » s’écrie-t-il. Il me vient alors à l’idée que le problème de ma Zündapp pourrait bien venir aussi de là : Le régulateur ou la bobine en surchauffe ! J’accepte l’invitation à déjeuner et Joseph me règle la BMW. Pendant ce temps mon moteur a refroidi et redémarre pour ma plus grande satisfaction. Je reprends alors la route sous les exclamations des curieux et leurs souhaits de bon voyage. Afin d’éviter l’horrible craquement de la première, je passe d’abord la seconde puis rapidement la première. Il faut qu’ils gardent une bonne impression de moi !
Le compte est bon, mon estomac est satisfait, mon gros matou ronronne, que demander de plus pour être heureux ? Direction à présent l’autoroute pour Sauerlach. Il faut que j’avance un peu aujourd’hui, avant tout sortir d’Allemagne, ce qui sera mon objectif du jour. En contournant Salzburg et à la vue des silhouettes des églises et des châteaux, je me laisse bercer un peu par le souvenir des concerts et des visites antérieures, tandis que me revient en mémoire la chanson de Hans Albers et de « la Paloma » que je me mets à chanter à tue-tête d’une voix aussi fausse et tonitruante que le moteur de ma moto, peut-être afin de chasser la tristesse qui m’envahit, mais avec des paroles à moi : « La campagne est verte, le ciel infini, depuis ma moto mon regard plonge vers le vaste monde, il faut regarder en avant, pas en arrière vers mon pays natal, et faire confiance à Dieu… » Chanter me rend encore plus triste, mais la tristesse aussi peut être belle…
Peu après Salzburg je quitte l’autoroute en quête d’une petite route, puis d’un chemin et d’un endroit caché. Avant d’éteindre le moteur, je positionne le side-car légèrement dans le sens de la pente, on ne sait jamais…Il fait encore jour, et le silence après ce long trajet est presqu’aussi lourd que le moteur. C’est seulement maintenant que je perçois le picotement dans mes bras et l’engourdissement de mes mains. Quelques mouvements de bras et quelques pas de course. Je me dis qu’un peu d’exercice à chaque pause me fera du bien ! Rapidement la tente est montée. Pas une maison, pas un chat à l’horizon, personne pour me déranger. La moto sent l’huile brûlante, mais bientôt c’est l’odeur de la soupe chaude qui domine. Je suis lessivé, mais un sentiment de bonheur m’envahit car je suis venu à bout de ma première étape. Ma vieille caisse a besoin de repos, et donc pour la suite on verra demain…
La nuit fut fraîche, j’avais mal aux bras et surtout aux mains à force d’avoir tenu le guidon. J’eus des difficultés au début à trouver le sommeil, car l’obscurité renforçait tous les bruits alentour. Au loin quelques aboiements, s’agissait-il de chiens ou de loups ? Je fourrai mes papiers au fond du sac de couchage et déposai mon couteau finlandais à portée de main. J’avais sur moi 1000 DM en traveller-chèques que j’avais changés à la banque, et en plus 1000 DM en espèces que j’avais cachés dans une ceinture spéciale qui tenait mon jeans. J’avais longtemps réfléchi avant de trouver la solution idéale : une bande de cuir de 15 cm de large et de la longueur d’une ceinture normale, pourvue d’un motif de rivets au milieu dans le sens de la longueur, repliée pour un tiers vers l’intérieur du côté rugueux et pareillement de l’autre côté comme un tube. Tout en maintenant le tout par des pinces à linge, je martelai les bords repliés pour qu’ils gardent la forme, je rivetai ensuite le cuir plié en trois à chaque extrémité que je taillai en pointe d’un côté et fixai de l’autre à la boucle qui consistait en deux fers à cheval repliés. J’avais déjà vu ça porté par un cowboy au cinéma, à l’époque où moi aussi je voulais devenir cowboy, l’idée du tour du monde m’étant venue plus tard. J’avais mis mes billets dans cette sorte de ceinture dont le tout était maintenu par les passants du pantalon. Avec le temps les plis étaient devenus si anguleux qu’on aurait dit une ceinture plate et que les rivets faisaient illusion.
Les jeans et la ceinture cachés sous le tapis de sol faisaient office d’isolant pendant la nuit. Je portais mes papiers dans une pochette autour du cou que je gardais souvent la nuit. Quant aux traveller-chèques, je les avais soit dans les chaussettes soit dans une poche de pantalon, ainsi qu’un porte-monnaie avec la monnaie de chaque pays. Je me sentais rassuré d’avoir tous les objets de valeur répartis et de savoir que si je faisais une mauvaise rencontre, il me resterait toujours quelque chose. Je me sentais à présent armé pour la nuit et j’avais déjà dormi tant de fois dehors, de préférence à la belle étoile ! Je savais que ce n’était pas de la nature ou des animaux que venait le danger, car en fait, le plus grand danger pour l’homme, c’est l’homme…
A la nuit tombée, alors que j’étais pris encore dans mes songes, une voix d’oiseau retentit soudain suivie peu après d’une réponse, d’un bref silence, puis à nouveau d’un autre appel. Ce babillage à deux se transforma en chant choral et se métamorphosa peu après en une symphonie orchestrale. Jamais auparavant je n’avais entendu un concert d’oiseau aussi intense. La raison en était sûrement la proximité de Salzburg, la métropole de la musique ! C’est alors que me revint en mémoire le dernier tube de Cat Stevens : ‘Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing fresh from the word…’ (Le jour s’est levé, pareil au premier matin, le corbeau chante comme le premier oiseau du monde, louant son chant, louant le lever du jour, louant la parole qui jaillit dans la fraîcheur du matin ...) J’ouvris avec précaution la fermeture éclair de la tente d’où je m’extrayai en rampant. Tout en restant invisibles, les oiseaux continuaient à chanter en rythme, et ce malgré mon apparition. Pieds nus j’allai dans la rosée du matin au premier arbre pour l’arroser. Des vapeurs s’élevaient. En mai les nuits sont encore fraîches et ma première tentation fut de ramper à nouveau dans mon sac de couchage bien douillet. C’est alors que je vis la moto et que la matinée insouciante prit fin : Il y avait du tournevis dans l’air ! J’avais dormi nu, car je trouve que c’est ainsi qu’il fait le plus chaud, alors que les vêtements sont d’un meilleur usage comme isolant du sol. Après avoir enfilé une chemise, puis en me déhanchant pour enfiler une jambe de pantalon avec difficulté à cause des pieds humides, je changeai de méthode, m’assis et enfilai d’abord les chaussettes. Tout allait comme sur des roulettes : bottes aux pieds, col roulé, en route pour le menu du jour !
Un peu de pression dans le réchaud, un peu d’essence, un coup de briquet, et ça démarre ! Peu après, l’eau frissonna dans la casserole sur le réchaud chuintant, et un arôme épicé de thé se répandit. C’est à cause de ce drôle de breuvage que les Anglais avaient conquis la moitié du monde ! Le thé de huit heures fut le premier petit-déjeuner de mon périple : thé, pain suédois, miel, et la sensation pour moi d’être un invité dans un pays de cocagne…
Voilà que les premiers rayons du soleil percent à travers la ramure et offrent au monde une myriade de couleurs inconnues. La forêt me semble soudain plongée dans une troisième dimension, et lorsque peu après une chaleur bienveillante se répand, j’ai la sensation d’appréhender une quatrième dimension. Les oiseaux s’apaisent, mais pas mon esprit qui est préoccupé depuis un moment déjà par la moto. Par quoi commencer ? J’en fais le tour. C’est quoi ces deux rayons de roue en travers sur la roue arrière ? Incroyable ! Il y en a même trois de cassés, par chance sur le côté. J’arrive à les décoincer et à les extraire à l’aide d’une pince combi et d’une clé à rayons de leur écrou. Je cherche dans le side-car les rayons de rechange qui doivent être enveloppés quelque part dans un chiffon. Je tombe aussi sur la pompe et dégonfle le pneu par précaution. Il ne manquerait plus que je crève ! La caisse s’abaisse lentement. J’aurais dû la caler pour pouvoir tourner la roue ! J’enfourne les nouveaux rayons, les visse. Je cherche le cric, contrôle sur les trois roues tous les rayons qui doivent être un peu retendus. J’essuie l’huile de la jante de la roue arrière, car il y a une légère fuite au niveau du cardan. Il ne reste plus qu’à espérer que l’huile ne s’infiltre pas entre le pneu et la jante ou n’atteigne pas les freins. Ensuite un peu de gymnastique avec la pompe et le pachyderme s’élève lentement…
Tous ces détails m’ont détourné du problème essentiel, l’allumage. Heureusement que le propriétaire précédent avait pensé à tout ! J’enlève alors le couvercle du bloc-moteur et change les bobines, vérifie le câblage avec la dynamo et dévisse le couvercle. Les rainures des vis sont bien abîmées. Est-ce que cette pièce avait été déjà souvent dévissée ? Un peu d’eau de pluie ou de condensation s’en échappe. J’enlève avec un chiffon la rouille et l’eau et souffle le tout avec la pompe en laissant ouvert pour que ça sèche, tout comme ma tente que je démonte et fourre avec le sac de couchage et le reste dans le side-car. J’amarre fermement l’ensemble, en prenant soin d’enlever tout trace de campement. Après avoir remis le couvercle sur le moteur, me voici enfin prêt à avaler de nouveaux kilomètres !
J’ouvre les robinets d’essence, ferme le clapet du starter, actionne le kick. Encore et encore…rien ne se passe ! Normal, le moteur est froid, il faut attendre un peu, par contre moi j’ai de plus en plus chaud. Je commence à me déshabiller à nouveau, me voici bientôt en bras de chemise, et si ça continue, je vais me retrouver tout nu avec une feuille de vigne ! Le désespoir m’envahit, la colère monte en moi, ainsi que le doute sur mon engin. Je ressors alors l’outillage et redémonte, puis enlève le couvercle, la routine, quoi ! Ils auraient pu installer des clips en usine à la place de ces vis qui font perdre du temps, et pourquoi pas aussi sur le vilebrequin, voire même partout pour enlever plus rapidement les aimants de la dynamo ! Je vais le leur proposer, comme ça il se peut qu’un jour une moto porte le nom de l’inventeur des clips, c’est-à-dire le mien ! En attendant je dévisse la bobine que je remplace par l’ancienne : Huit minutes et les deux mains pleines de cambouis, c’est mon nouveau record ! Cette fois je ne range pas les outils. Un coup de kick, je n’en crois pas mes oreilles, le moteur démarre ! Je ne vais pas tarder à croire au miracle si ça continue ! J’augmente le ralenti pour que le moteur ne s’éteigne pas, remballe tout l’outillage en un temps record et bondis sur le dos de mon pachyderme… On dirait un décollage ! Il bondit de joie, replie les oreilles et met les voiles presque comme Dumbo, mais il est trop lourd et continue alors sa course sur trois roues, tandis que derrière nous plane un nuage bleuté en lisière de forêt.
Dans ma tête les pensées tourbillonnent presque aussi vite que l’huile dans le carter. D’où peut donc bien venir la panne ? Apparemment pas de la carburation. Je comprends qu’en fait, à coup sûr, c’est la bobine d’allumage qui est défectueuse, et alors une question se cristallise dans mon cerveau en ébullition : Que va-t-il se passer si les autres pièces de rechange sont aussi de la camelote ? Je vais faire le périple avec 200 kg de déchets ! Ce n’est pas possible, me dis-je, les motards sont des copains qui s’entraident, quant aux pièces défectueuses, on les balance, on ne les vend pas comme pièces de rechange !
Un quart d’heure de trajet sans problème suffit à rétablir totalement ma confiance. Avec le temps on s’habitue à tout. Le bruit bizarre du cylindre de gauche ne me laisse pas de répit au début, et je me demande s’il y a du jeu dans les paliers du vilebrequin, mais dans ce cas-là ce serait des deux côtés. Je n’avais en tout cas rien remarqué avant d’avoir remonté le moteur, même pas de jeu excessif au niveau de la bielle. Restent les soupapes …Il faudrait des lunettes aux rayons X ! C’est peut-être mon imagination, mais le cylindre droit ne fait pas le même bruit que celui de gauche. Est-ce à cause du side-car ? Le moteur tourne bien. Depuis déjà 500 km ! Le problème du moment est que mon pachyderme a très soif mais un très petit réservoir. Avec un plein j’ai fait exactement 200 km, et il consomme presqu’autant que mon vieux Combi. A la station-service suivante je remplis donc un des bidons d’essence pour ne pas rester en rade par mégarde. Ma moto n’a pas de jauge d’essence, simplement un robinet de réserve, et je ne veux pas vider le réservoir de peur de ne plus pouvoir redémarrer…
Je roulais à présent sur une route nationale. Chaque coup de frein ou d’accélérateur se portait sur mes bras. Chaque virage demandait une concentration et une technique parfaite. De simple motard je devenais peu à peu capitaine d’attelage. Je roulais à travers des vallées alpines verdoyantes, gravissais des cols, traversais des villages de contes de fée et des villes au décor magique. Seulement je n’aimais guère les villes. Les files de voiture dans les embouteillages et les feux tricolores, tout cela n’était pas de mon goût. Pour voir des villes et en faire la découverte je n’aurais pas eu besoin de partir loin, car on en a à profusion en Allemagne. Moi je voulais voir des pays, des paysages, des terroirs, les espaces entre les villes, leurs habitants, et leur mode de vie !
Devant moi s’étendait Graz, et au loin une brume rougeoyante attirait mon attention, annonçant au fond de la large vallée l’émergence dans un léger voile de brume des ateliers d’usine couleur rouille et des hauts-fourneaux, tandis que les cheminées continuaient à cracher des nuages pestilentiels. C’est ça, la matière dont est faite ma moto… Même ma bouche avait un goût de métal, et en me mouchant à la pause suivante je remarquai que mon mouchoir avait la même couleur de rouille.
Je poursuivis poussivement ma route, m’étant promis d’arriver en Yougoslavie avant la fin du jour, en dépit de mes douleurs dans les bras et aux fesses. Après avoir longé des montagnes qui rapetissaient et des vallées fluviales qui s’élargissaient, j’atteignis en fin d’après-midi la frontière qui était ouverte du côté autrichien. A cet endroit les douaniers se concentraient sur les véhicules entrants, alors qu’à la frontière yougoslave ils étaient alignés à la queue leu leu. Ils avaient de quoi faire, la plupart des automobilistes étant dans les deux sens des travailleurs émigrés turcs, ce qui n’était pas particulièrement du goût des Yougoslaves. Ouverture du capot, contrôle de la plaque d’immatriculation, du coffre et du porte-bagage. Il fallait sortir et mettre tout sens dessus dessous, et les douaniers se comportaient comme des clientes farfouillant dans les corbeilles au moment des soldes pour tout mélanger ou tout étaler sur le sol. Les voitures devant moi avaient un drôle d’air avec pour la plupart sur le toit une brouette avec une roue gonflée. En Turquie il semblait régner une sorte de folie des travaux d’urbanisation, et ceux qui avaient déjà amené une brouette lors de leur précédent retour chez eux transportaient à présent une bétonnière. Souvent le chargement sur le toit avait le même volume que la voiture, et les bâches de protection claquaient au vent tout en se désagrégeant peu à peu.
Cette attente éternelle commençait à m’énerver ! Si j’éteignais le moteur, il ne redémarrerait sûrement plus. C’est pourquoi je longeai la file au pas, lorsqu’un douanier se précipita vers moi pour me faire signe de regagner la file d’attente. Avec ce side-car surchargé, il devait me prendre pour un travailleur émigré turc bien que je n’aie pas de brouette. « Moi pas Turc ! », m’écriai-je, « moi Allemagne ! » Il s’approcha de moi et jeta un coup d’œil sur le side-car en surcharge. Je fus soudain envahi par l’idée d’avoir à tout déballer comme ces pauvres Turcs, mais il vit ma carte du monde et mon itinéraire, se para de son sourire le plus amical, et sans contrôler quoi que ce soit me souhaita bon voyage en allemand en me faisant un signe de la main.
Bientôt j’arrivai à Maribor. « Une belle petite ville ! » pensais-je. Etant dans l’obligation de changer de l’argent, et comme il y avait une place de parking de libre en pente, je me hasardai à faire un arrêt. A peine avais-je fermé les robinets d’essence, enclenché une vitesse et placé une cale devant la roue arrière, casque et lunettes sous la bâche du side-car, que je me retrouvai entouré d’une bande de gamins qui piaillaient, tout à leur excitation de me voir et ouvrant de grands yeux ébaubis devant mon véhicule, comme devant un module lunaire. Je les pointai du doigt, puis mes yeux et mon side-car : ils avaient compris et le surveilleraient en mon absence !
Après avoir trouvé la banque et échangé 50 DM, je fis un tour de ville. Quel plaisir enfin, après être resté tant de temps assis ! Je regardai alors mes bras. J’avais le sentiment qu’ils faisaient deux mètres de long et touchaient le sol. Devant la vitrine d’un coiffeur je brossai avec les doigts mes cheveux aplatis par le casque, je me fîs à moi-même un sourire de réconfort et me rendis dans un café au bord de la rivière pour y déguster une bière et une glace. Aujourd’hui c’était jour férié ! J’étais arrivé en Yougoslavie sans grosse panne pendant le trajet et pouvais enfin m’adosser sur le bord du siège, en étirant mes membres avec délectation. Ah que ça faisait du bien ! Je devrais installer une sorte de chaise-longue sur mon ‘attelage’ avec un dossier amovible ! Pas sûr que le contrôle technique soit d’accord, mais ici j’étais hors de portée de sa vue. Certaines maisons avaient déjà un caractère oriental, les gens étaient différemment vêtus, et la vie se déroulait en grande partie dans les rues et les ruelles. Je trouvais même que les rues avaient un goût d’Orient. De retour à ma moto la plupart des enfants avaient disparu, sauf quelques-uns restés assis sur une margelle à proximité, empêchant quiconque de s’approcher de trop près. Je retrouvai mon casque et mes gants avec l‘impression que rien ne manquait. Je crois que dorénavant je ferai toujours ainsi et choisirai quelques enfants comme anges gardiens !
Je sortis de mon véhicule un sachet de ‘Gummibärchen’, ces petites sucreries à la gomme en forme d’ourson que ma mère m’avait donné et je les leur offris. Leurs yeux pétillaient de joie et ces bonbons étaient pour eux tout aussi exotiques que pour moi le morceau gluant de « Halva » que j’avais acheté à un stand dans la rue. Par précaution je démarrai en laissant rouler mon véhicule. Il n’aurait plus manqué que ça, montrer aux Yougoslaves que les motos allemandes n’étaient pas fiables ! Ils n’achèteraient alors que des Honda ou autres espèces d’autocuiseurs à riz japonais au nombre d’adeptes sans cesse croissant…
La route m’appelait à nouveau irrésistiblement et le souffle du vent me caressait le visage. Bien que celle-ci fut encore en bon état, le trafic était parfois intense. Il s’agissait de trouver la bonne vitesse pour éviter le plus possible à la fois d’être doublé et d’avoir à doubler. Hormis les véhicules motorisés, la route était empruntée par des attelages à cheval, ce qui explique qu’il fallait faire souvent un usage intensif des freins, avant de pouvoir doubler quand quelqu’un venait d’en face. J’avais l’impression d’être replongé en enfance, au temps où le laitier ou le boulanger venaient nous livrer avec leurs charrettes tirées par des chevaux. Quel n’était pas mon plaisir alors de les caresser et de me réchauffer les mains sous leurs crinières ! J’aimais cette odeur délicieuse qui émanait d’eux, même quand ma mère me faisait le reproche de « sentir le canasson ». Dans les champs qui délimitaient la route des deux côtés travaillaient des gens aux vêtements colorés, amoureux de cette terre qu’ils cultivaient et semblaient de loin gratouiller comme un animal. Il y avait des enfants qui gardaient les brebis dans les prés ou au bord de la route, et parfois un chien s’aventurait à m’attaquer ou à me courir après et faisait demi-tour au bout d’un moment, tête haute, tout fier d’avoir chassé un si grand intrus !
A la recherche d’un endroit à l’écart pour la nuit, je trouvai un ruisselet agrémenté d’une petite prairie verdoyante dans une courbe et qui semblait m’inviter. Pour ne pas être vu je voulus monter la tente dans l’obscurité, et assis sur le siège de mon side-car, je laissai mon esprit vagabonder sous les volutes de ma pipe encore fumante à l’issue de cette longue journée. J’avais été habitué à être toujours actif, à m’instruire ou à travailler. Comme l’école en règle générale ne durait que jusqu’à midi, j’avais accepté en Allemagne un job l’après-midi chez « Union Plastik », un nom bien grandiloquant pour une entreprise de seulement trois personnes. En outre je donnais des cours de rattrapage, ce qui me permit d’entretenir mon combi VW, de me procurer la moto, d’économiser pour le voyage, et certes pas par le trafic de drogue comme le répétaient dans mon dos les gardiennes aux langues bien pendues de la morale villageoise ! De toute façon à cette époque je ne connaissais rien des drogues, encore moins que ces grenouilles de bénitier toutes recroquevillées !
Enfin pour une fois j’allais faire l’apprentissage de l’oisiveté ! C’est alors que soudain je vis sur le bras droit de la fourche télescopique une fuite d’huile, de la vraie huile, et plus exactement de l’huile d’amortisseur : il fallait réparer… Bien que ne l’ayant pas souhaité, je dus me mettre à la tâche et différer cet apprentissage. Qu’est-ce que cela voulait dire concrètement ? Je n’allais sûrement pas trouver de joints dans les environs, et pour ce qui est du démontage de la fourche j’aurais besoin à ma connaissance d’une clef spéciale. Alors il n’y avait plus qu’une solution, rajouter de l’huile régulièrement et espérer que ça s’arrangerait tout seul quand commenceraient les routes mal pavées…
Je déchirai un bout de chiffon que j’enveloppai autour du tube plongeur, en le fixant avec un nœud de cabestan pour que l’huile ne parvienne pas jusqu’aux freins, puis rajoutai de l’huile, car il n’y en avait plus ! Heureusement que j’avais été dans la Marine et avais appris à me débrouiller ! Je fis pareil de l’autre côté qui aussi était à sec. Je commençais à me familiariser avec ma moto ! J’avais failli oublier l’engrenage de la roue arrière qui avait également soif d’huile et m’étonnais que le frein arrière de ce foutu engin fonctionne encore ! Quant au moteur, le niveau d’huile était aussi horriblement bas, et qui plus est on ne pouvait pas dire que j’avais vraiment beaucoup roulé ! A mon grand étonnement le niveau d’huile de la boite de vitesses était correct, par contre il y avait quelque chose d’argenté dans l’huile. A la rigueur ça aurait pu être du graphite ajouté, mais s’il s’agissait d’un dépôt argenté, ça ne pouvait venir que de l’intérieur, peut-être de l’aluminium du carter ou des traces de métal dues au frottement des pignons. Il aurait été bon en tout cas que je fasse rapidement la vidange… Tout en faisant un check-up je remarquai trois autres rayons cassés, ainsi qu’une usure excessive et anormale d’un côté du pneu arrière, comme s’il avait été fraisé. Des questions me traversèrent l’esprit : Est-ce que le parallélisme est incorrect ? Est-ce que ça existe pour un attelage avec un side-car, ou s’agit-il d’une usure normale ? Je n’avais parcouru que 700 kilomètres et j’avais déjà bouffé un pneu ! J’estimais qu’avec mes six pneus je ne pouvais faire que 4000 kilomètres et à peine atteindre l’Afghanistan. En plus il y avait deux autres roues sur mon véhicule ! Mais trouve-t-on cette taille là-bas ? Je laissais mes pensées vagabonder, tout en montant la tente et en écoutant la radio qui diffusait des sonorités un peu orientales propices à me remettre de bonne humeur.
Après avoir été chercher de l’eau au ruisseau pour la faire chauffer, en fouillant dans les provisions je trouvai des nouilles et du goulasch qui étaient donc au menu du jour. Etant au pays de la puszta j’ajoutai à cela une bouteille de vin rouge ambré que je m’étais achetée dans une station-service, tout en laissant le moteur allumé. En même temps je me dis que les side-cars devraient être équipés d’un frein à main, et à défaut coinçai un morceau de bois entre la pédale de frein et le cadre : Heureusement que le besoin rend ingénieux ! Un peu plus tard je ne pus résister à l’envie de faire un petit feu de camp entre le ruisseau et le talus de la berge, en me laissant bercer par une musique romantique et de la poésie diffusées par la radio. Un poème qui me semblait destiné disait : « Je rêve d’un pays qui n’existe pas ». Il s’en suivit des mélodies mélancoliques qui me firent presque monter de nostalgie les larmes aux yeux. Etait-ce le mal du pays ou le mal des pays lointains ? Une fois l’émission terminée, je sortis mon harmonica et jouai tout doucement l’air du Tsarévitch, la chanson préférée de mon père et aussi un peu la mienne, souvenir d’une enfance heureuse. A mesure que le feu pâlissait, les étoiles redoublaient de scintillement, tandis que je m’enveloppai dans mon sac de couchage.
Un frais parfum épicé et inconnu embaumait la campagne, et après un petit déjeuner frugal, surtout du thé chaud, je sortis tout mon outillage du side-car. Mon regard tomba sur une enveloppe qui jusque-là n’avait pas attiré mon attention. « D’où vient-elle comme ça si subitement ? Tombée du ciel ? » me demandai-je. Je l’ouvris, déchiffrai d’abord la signature pour en connaitre l’auteur. C’était Norbert, un bon copain un peu plus jeune que moi, mais tout aussi excentrique : les esprits libres s’attirent… « Cher ami et grand frère, comme je t’envie de pouvoir tout envoyer promener et partir à l’aventure ! Comme j’aurais aimé te suivre, mais ma lâcheté m’en empêche et ma plus grande peur est de finir ma vie comme les autres en bon bourgeois ! Je suis de tout cœur avec toi ! Fais ce voyage pour nous tous qui n’avons rien dans le ventre ! A un de ces jours peut-être ! Norbert. »
Normalement on a des pièces de rechange avec soi pour précisément ne pas avoir à les utiliser... C’est plus ou moins pour se rassurer et pour des raisons psychologiques. Chez moi c’est différent, et je me risque à les utiliser toutes. En les voyant entassées, je me demandais bien combien de jours j’allais bien pouvoir en faire usage. En tout cas il était midi quand j’eus fini mon inspection matinale et que vint donc l’heure d’une petite collation. A vrai dire les contrariétés persistantes m’avaient gâché l’appétit, qui était inversement proportionnel à celui de mon moteur ! J’avais l’intention de gagner Belgrade dans la journée, soit 400 kilomètres, ce qui était faisable. « Je mets le casque ou pas ? Allons, ne sois pas si pessimiste ! », me dis-je. En fait, tout n’est qu’une question de pensée positive ! On se prépare au décollage, on met la clef de contact, et c’est parti…Et bien, non, c’est raté ! Pas le moindre petit voyant qui s’allume ! Ah oui, j’oubliais ! Il y a une vitesse enclenchée ! Point mort, rien ne s’allume non plus, le klaxon reste muet, bien que la veille j’ai enlevé la clef et éteint les phares. Et là où je me trouvais, il aurait fallu un tracteur pour me remorquer ! Avais-je inconsciemment prévu tout cela ou était-ce ma prévoyance habituelle ? J’avais avec moi une batterie neuve et même un chargeur ! Ceci dit il ne servait pas à grand-chose, car pour tout courant il n’y avait que le ruisseau ! Il fallait donc changer la batterie…La position point mort illuminait l’horizon de mes espérances, comme l’étoile de Bethlehem ! En même temps que je reprenais espoir, ma pensée positive me revenait, et grâce à elle et quelques coups de kick le moteur se réveilla. Un épais nuage de fumée s’éleva au-dessus de cette tâche de verdure idyllique où je me trouvais, et sans le moindre remerciement aux elfes du ruisseau et des prairies environnantes, je levai aussitôt le camp.
Retour sur la grande route : les crampons des pneus se débarrassaient au fur et à mesure de la terre qui se soulevait en gerbes de feu. Il y avait toujours cette odeur qui m’accompagnait déjà depuis hier, non pas de gaz d’usine comme à Graz, ni, du moins c’est ce que j’espérais, d’usine chimique. Comme hier également je voyais les paysans s’agiter partout dans les champs. A l’occasion d’un bref arrêt je les observai, occupés non à planter ou à semer, mais à récolter le dos courbé des oignons de printemps à tubercules blancs ressemblant à des petits poireaux, à les extraire du sol après l’avoir assoupli au moyen d’une fourche et à les déposer en rangs serrés, par centaines, par milliers, que dis-je, par centaines de milliers ! Des femmes avec un fichu sur la tête tapotaient la terre collée aux racines et assemblaient les oignons en bottes, avec lesquelles certaines d’entre elles me faisaient un signe amical. Je compris enfin que cette odeur qui recouvrait tout le territoire, c’était celle des oignons !