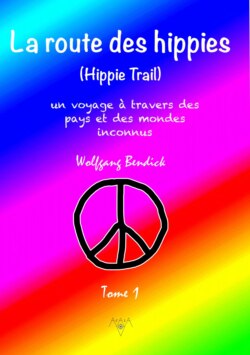Читать книгу LA ROUTE DES HIPPIES - TOME 1 - Wolfgang Bendick - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5. EN ROUTE
ОглавлениеMe voici à présent sur le bord de la route, pouce en l’air, à mes côtés les bagages que j’avais fait peser à la douane, soit 27 kg au total : Le poids de la liberté ! Au bout de quelques minutes à peine, une Mercedes noire, apparemment une 600 aux vitres teintées, s’arrête avec comme passager un jeune homme avec de grosses lunettes de soleil, et au volant à ma grande surprise un vrai chauffeur en uniforme. « Ou vas-tu ? » me demande-t-il. « A Istanbul ! ». Il me dit alors : « Moi, je vais d’abord récupérer quelque chose à Thessaloniki et ensuite à Istanbul. Allez, monte ! » Ce type avec ses doigts couverts de bagues et son bracelet ne me revient pas… C’est probablement une sorte de dealer, peut-être un fils de diplomate qui fait son petit trafic avec la voiture à papa. Je me dis que je pourrai toujours descendre de voiture et qu’un tiens vaut mieux que deux tu l’auras… A peine ai-je saisi mon sac à dos et ouvert la porte que l’homme aux lunettes noires me dit : « 100 DM ! La frontière est fermée, mais avec mon passeport de diplomate on va pouvoir passer ! » Je claque alors la porte et m’assois sur mon sac à dos. « Bon, allez, 50 DM ! dit-il, ce à quoi je lui rétorque : « Je préfère aller à Athènes ! » Après qu’il ait fait un signe au chauffeur, la vitre se referme et la voiture s’éloigne.
D’après les panneaux il reste 40 kilomètres à parcourir d’ici Thessaloniki. Peu avant il y a une route qui descend vers le sud en direction d’Athènes. Ma décision est prise : si la frontière est fermée à Edirne, je me rends à Athènes et de là continue mon périple, libre à présent de voyager par terre ou par mer. Soudain j’aperçois deux autres auto-stoppeurs s’éloigner du poste-frontière, pouce levé. La première voiture qui passe s’arrête aussitôt et les embarque, et tandis que je les interpelle pour leur faire savoir qu’ils doivent faire la queue comme tout le monde, ils démarrent devant moi en ricanant et en me faisant un signe de la main de résignation : « Pas de chance pour toi ! »
Peu après, un automobiliste en route pour Thessaloniki propose de me déposer à l’embranchement pour Athènes, la durée du trajet étant à peu près d’une demi-heure. En chemin nous croisons plusieurs triporteurs, des engins de transport bâchés avec une benne à l’arrière qui me font penser à ma vieille Zündapp et me demander s’il ne s’agit pas là de vieux engins de guerre. Sur la gauche non loin de la route se dressent d’énormes halles d’usines et dont l’une arbore en lettres capitales le nom ZÜNDAPP. C’est donc ici que les Allemands avaient vendu l’entreprise au moment de l’interruption de la fabrication en Allemagne, à l’époque où tout le monde ne voulait plus rouler qu’en voiture ! Il suffit de faire 2000 kilomètres vers l’est pour trouver des débouchés, en attendant le jour où tout le monde pourra s’offrir le luxe de se payer une voiture. Ensuite il n’y a plus qu’à vendre l’usine, 4000 kilomètres plus loin en direction du sud ! J’aurais pu me procurer ici des pièces de rechange, mais franchement j’étais content que mon rêve ou plutôt mon cauchemar à moto ait pris fin ! Devant moi apparait bientôt un embranchement, un rond-point géant. Et qui vois-je alors descendre de voiture ? Les deux « voleurs de voiture » de la frontière ! « Ça roule vite ! » dit le premier. « Je me présente : Je suis le Prince et voici mon copain le Duc ! » Je me dis qu’ils plaisantent, tout à l’heure le soi-disant diplomate, et maintenant le noble allemand ! « Ce sont vos patronymes ? » En riant ils me répondent : « Non, nos surnoms ! » « Eh bien moi, c’est Wolfi ! » dis-je à mon tour.
« Veux-tu partager le casse- croute avec nous ? » me demande le Prince. « Nous t’invitons, nous avons de la vraie charcuterie fumée ». On cherche alors un endroit propice, et sur l’ilot du rond-point nous finissons par trouver quelques grosses pierres sur lesquelles nous nous installons confortablement. Ils me disent venir de Basse-Bavière, vouloir aller en Turquie, et peut-être plus loin par la suite, en Inde. « Moi aussi ! » leur dis-je, tout à mon étonnement de ne plus être le seul à envisager cette destination. Le Prince avait reçu de sa tante, après avoir dissipé les premières craintes de cette dernière pour un tel projet et pour qu’il ne meure pas de faim en Inde, du lard qu’ils grignotaient depuis qu’ils avaient quitté le lieu de leurs joutes chevaleresques. De surcroît ils avaient acheté dans une boutique à la frontière deux bouteilles de Retsina.
Le Duc, après avoir déployé la charcuterie fumée d’un linge, se met à la découper en tranches fines avec son canif. Nous entendons alors s’approcher quelques grosses motos, des flics grecs qui nous ont espionné, chevauchant deux Zündapp KS 601 toutes reluisantes, avec un pare-brise identique à la mienne. Ils font deux fois le tour du rond-point pour se faire une image de nous en trois dimensions sans doute, et nous nous retrouvons tout à coup encerclés au sens strict du terme, ce qui suscite chez nous trois en même temps la même réaction : « Merde, des flics ! » Ceux-ci coupent alors les gaz, garent leurs engins à côté de notre ilot, sans se soucier de savoir si leurs bécanes gênent la circulation. « Kali Mera ! » disent-ils, ou quelque chose comme ça, en ôtant leurs grosses lunettes de soleil. Nous les saluons d’un sourire grimaçant et patientons. « Allemands ? » demande l’un des deux. Cela doit être inscrit sur notre front… « Nai ! » lui dis-je, ce qui veut dire « oui ». C’est le moment de mettre en œuvre mes connaissances en grec. Le Prince, est-ce par aplomb ou par gêne, leur offre des tranches de lard finement coupées en précisant que c’est une spécialité, un mot international compris de tous. Les policiers, tels des caricatures de leurs homologues américains, ôtent leurs gants, remontent un peu le bas de leur pantalon et s’agenouillent. Nous rompons le pain avec eux et leur passons « le sang du Christ » dans une bouteille, à défaut de calice, ainsi que le fumet. « Pas mal, la police grecque ! », fais-je remarquer. Sont-ils l’exception qui confirme la règle ou l’inverse ? Toujours est-il qu’il est facile de communiquer, quand l’amitié entre les peuples passe, comme cela semble être le cas ici, par l’estomac. L’un des deux policiers me demande alors : « Qu’a dit ton copain ? », ce à quoi je lui réponds dans une traduction approximative : « Superbes engins ! » Ils ne vont quand même pas nous inviter à faire une virée ! « Moi aussi j’ai une Zündapp ! » dis-je, ce qui est presque vrai, même s’il ne s’agit plus que d’un moteur et de deux boîtes de vitesse entreposés dans la cave de mes parents. « Où ça ? » me demande-t-il d’un ton inquisiteur. « Chez moi en Alemania », estimant qu’il vaut mieux rester approximatif. Incrédule, il s’exclame d’un ton affirmatif : « Mais, Zündapp, ce sont des motos grecques ! » Je me dis que ce n’est pas la peine de le contredire, car aucun policier ne supporte cela, d’autant plus qu’ils ne peuvent croire qu’un hippie comme moi, c’est du moins ce qu’ils doivent s’imaginer, puisse posséder une « vache sacrée » comme ça. Les bouteilles une fois vides, leurs doigts encore graisseux et noirs, ils se mettent tout à coup à changer de ton. Quel acte de bravoure, deux flics équipés d’un pistolet face à une meute de trois hippies pacifistes ! « Papiers ! » Nous croyons à une plaisanterie et rions, mais les Grecs comme les Anglais d’ailleurs ont un autre sens de l’humour, peut-être même les policiers l’ont-ils remplacé par le sarcasme à défaut d’humour ! Toujours est-il qu’ils font une mine renfrognée, en feuilletant en détail de leurs doigts graisseux les passeports que nous leur présentons.
Pourquoi les policiers sont-ils donc toujours aussi circonspects ? Est-ce pour se rendre importants ou se repaitre de la peur qu’ils suscitent chez leurs victimes ? « Qu’avez-vous dans le sac à dos ? De la drogue ? » En l’ouvrant, nous répondons sans rire, du moins pas à gorge déployée : « Des fringues ! » Une idée me traverse alors l’esprit : Pourvu qu’ils ne découvrent pas mon pistolet ! Cette hantise ressurgira à chaque nouvelle frontière. Après avoir fouillé dans les sacs et jeté par terre quelques affaires, ils s’exclament en nous rendant nos passeports : « Disparaissez ! » Nous pensons avoir mal compris et qu’ils nous souhaitent en fait la bienvenue, tandis que nous replions avec une infinie lenteur nos affaires éparpillées et rangeons avec minutie nos sacs à dos.
Avec une certaine impatience ils interrompent le trafic qui n’est pas dense à cette heure-ci, nous dirigent vers le bas-côté de la route et nous disent en montrant le panneau avec l’inscription ATHINAI : « Dégagez et pas d’autostop ! C’est interdit ! Continuez à pied ! » Ils nous font alors comprendre que si nous ne dégageons pas d’ici une heure, ils vont nous arrêter.
Alors que la nuit tombe, le Prince s’exclame : « Ces trous du cul vont bientôt avoir fini leur journée de travail ! » A peine a t’il dit cela, qu’ils se hissent sur leur selle et décampent en direction de Thessaloniki. « Ouf ! Enfin ! » reprend le Prince, soulagé, ce à quoi je rétorque : « Attendons encore un peu ! » Et en effet nous n’avons pas traversé la moitié de la localité que nous entendons au loin pétarader les motos de notre bande de rockers en uniforme qui se rapprochent lentement. « Marcher, marcher ! » s’écrient-ils en allemand, en nous montrant la direction d’Athènes. En ricanant, ils appuient alors sur le champignon et détalent, nous laissant quelques minutes de répit.
Le Duc montre du doigt une sorte de talus ou de digue qui s’élève derrière les dernières maisons et que nous grimpons et dévalons à la suite, tandis que l’un d’entre nous qui est caché derrière le promontoire monte la garde. Cinq minutes se sont à peine écoulées que les voilà déjà de retour, nous cherchant partout du regard, moteur au ralenti. Une fois qu’ils se sont suffisamment éloignés, notre vigie leur crie : « Allez ! rentrez chez vous, enfoirés, la journée de boulot est terminée ! «
Nous préférons rester sur place pour la nuit, car avec cette police qui rôde dans les environs c’est trop dangereux. Nous nous mettons alors à l’aise en étendant les ponchos, sacs de couchage par-dessus. Les deux acolytes avaient échangé quelques drachmes à la frontière, ce que j’avais complètement omis de faire, tout préoccupé que j’étais par ma moto. Le « Duc » s’esquive peu après dans l’obscurité en direction de la localité, réapparait un quart d’heure plus tard avec du pain et deux bouteilles de Retsina et dit : « C’est un joli petit village, mais il vaut mieux que nous restions dans notre cachette ! »
Allongés sur nos sacs à dos à la lueur du croissant de lune, nous parlons de nos aventures, tout en déballant nos provisions pour apaiser une petite faim naissante. Comme mes compagnons ne trouvent pas le tire-bouchon qui a dû se perdre quelque part sur le rond-point, à moins que les flics ne nous l’aient fauché, j’extrais mon couteau finlandais de son étui et passe la lame délicatement sur le col de la bouteille, comme je l’avais déjà vu faire au cinéma, sauf que c’était avec un sabre et qu’il s’agissait de champagne. Après un coup sec avec le couteau, un « pling » aigu retentit, et je n’ai plus en main que le cul de la bouteille en morceaux, ainsi que le manche en bois avec deux centimètres de lame, et le pantalon et les bras tâchés de vin ! Nous voilà assis et dépités. « Comme les trompettes de Jéricho ! », précise le « Prince » au bout d’un moment, « dommage pour le pinard ! » « Dommage aussi pour mon couteau ! » Pour ne pas mourir de soif, nous poussons alors le bouchon de l’autre bouteille avec un bout de bois dans son col.
Au mois de mai les nuits sont déjà plus longues, et comme nous avons beaucoup de choses à nous dire et que nos gosiers sont plutôt secs, le « Prince » s’esquive furtivement, se mêle aux flâneurs et fait l’achat de deux autres bouteilles. « Ce gout me fait plutôt penser à de la pisse de chat. » dis-je. « Comment ? » me demande-t’-il, « tu en as déjà gouté ? » Je lui rétorque en riant : « Cela a à peu près le même goût, et rien ne vaut franchement le vrai vin. » « Espèce d’ignorant ! » réplique alors le Prince, « ce n’est qu’en adoptant le mode alimentaire d’un pays qu’on apprend à connaitre sa culture ! » « Très bien » lui dis-je, « mais pourquoi le Retsina a-t-il donc ce goût si bizarre ? »
« Cela remonte à une certaine époque où dans cette région il y avait en permanence des guerres », me dit-il. « Du temps de son occupation par les Turcs, ces derniers avaient confisqué tout le vin aux paysans et s’en délectaient. Bien que le Coran interdise officiellement la consommation de vin, Allah est généreux, et comme en plus il ne pousse pas grand-chose dans cette région en dehors du vin et que l’eau n’est pas très bonne, les Turcs préféraient le vin. » En en prenant une gorgée de la bouteille qu’il me tendit, je lui objectai que je ne comprenais pas comment les Turcs avaient pu apprécier ce breuvage. « C’est justement ça ! » me dit-il, « les Grecs se disaient que s’ils faisaient du mauvais vin, les Ottomans n’en boiraient sûrement pas, et c’est pour cette raison qu’ils y mélangèrent un peu de sève de pin. Et en effet quand les Turcs goûtèrent le crû de l’année, ils le trouvèrent si horrible qu’ils préférèrent leur café. Par précaution d’ailleurs les Macédoniens s’en tinrent à cette recette, car on ne peut jamais être sûr que la situation politique ne va pas changer ! »
Le lendemain matin, nous partîmes à pied en direction du sud pour être hors de portée des flics et en gardant entre nous une distance de 300 mètres, afin d’avoir plus de chance d’être pris en stop. Soit la Grèce est par excellence le pays de l’autostop, soit Tyche la déesse de la Fortune avait jeté son dévolu sur moi, toujours est-il qu’au bout de quelques minutes une voiture si cabossée que sa marque était méconnaissable, s’arrêta. Derrière le pare-brise éclaté apparut un visage rond avec à la place des yeux deux verres de lunette épais, pareils à des couvercles de bocaux de verre. Le conducteur s’arrêta 20 mètres plus loin et je me précipitai alors vers lui avec mon lourd sac sur l’épaule...
Au prix de quelques soubresauts et de quelques coups d’accélérateur et d’embrayage laborieux, nous voici à présent en route. Je me demande bien s’il a le permis de conduire et même si en fait il est obligatoire en Grèce… Par chance il maitrise mieux l’anglais que la conduite, et c’est à 70km/h tout au plus que nous rampons en direction du sud sur le bas-côté droit de la route. Parfois il réussit à doubler un attelage à cheval, mais en général c’est nous qui nous faisons dépasser à grand coups de klaxon.
Pendant un moment nous longeons la côte où une mer d’un magnifique bleu limpide contraste avec l’arrière-pays stérile et caillouteux, avec des ruines antiques en bordure de route de tous côtés, quelques voiliers et un bateau à vapeur qui sillonnent la mer, le soleil, des cèdres et des pins de ci de là, bref une Grèce telle qu’on se l’imagine…
Depuis mon départ je me sens envahi pour la première fois par une insouciance totale mais passagère, car je me rends compte rapidement que l’art de la conduite n’est pas son fort, ce qui m’oblige d’ailleurs une douzaine de fois avant Athènes à lui redresser le volant pour éviter le pire. Peu à peu nous faisons mieux connaissance et j’apprends qu’il travaille au théâtre de Thessaloniki, sans plus de détail, et que sa femme est infirmière, un métier salutaire quand son mari conduit de la sorte ! D’ailleurs comme il avait déjà eu auparavant beaucoup d’accidents, il avait dû lui faire la promesse de ne pas dépasser les 70 km/h et de prendre si possible des autostoppeurs, car quatre yeux valent mieux que deux en pareille circonstance !
A notre droite se dresse l’Olympe du haut de ses 3000 mètres, recouverte de forêts sur le bas, puis de rochers et d’éboulis, et enfin d’une coupole de neige depuis laquelle les dieux ont dirigé autrefois le destin de l’humanité ! Je me dis alors qu’ils n’ont pas dû avoir chaud et se sont plutôt ennuyés, se contentant de fomenter des guerres entre les hommes et de les regarder se massacrer entre eux, quand ils n’étaient pas impliqués dans des histoires de fesses ! Aujourd’hui les dieux sont absents, mais pas les guerres !
A un moment donné, la mer cède le pas aux montagnes que la route traverse. Nous faisons une pause, et errant à travers les ruines, je touche pour la première fois des pierres taillées il y a 3000 ans par un tailleur de pierres et assemblées par des maçons. En passant mes mains sur leur surface lisse et les yeux clos, j’imagine des hommes en sueur couverts de poussière et maniant avec une infinie patience les outils les plus rudimentaires. Combien pouvait peser un tel bloc ? Comment les déplaçait-on et avec quelles techniques étaient-ils superposés ? Peut-être se sont-ils posés à l’époque la question de la finalité de leur labeur et d’une éventuelle vie meilleure où il n’y aurait pas à réaliser sans cesse ces constructions mégalomanes, où les guerres ne détruiraient plus indéfiniment tout et ne plongeraient plus les hommes dans le malheur le plus profond. Doutaient-ils alors déjà de l’existence des dieux ?
Le sol est rocheux, avec très peu d’humus, le plus souvent quelques taches parcimonieuses. Les racines des cyprès et des pins en quête de prise et de nourriture cherchent souvent en surface une fente par où pénétrer, ça sent la résine, les troncs sont collants au contact de leur écorce rugueuse. J’extrais une goutte sèche de résine d’une fente de l’écorce, la porte à mes lèvres et la mastique. Elle a un goût de Retsina et se colle dans le creux de ma dent, des heures après j’ai encore l’arrière-goût rafraichissant en bouche. Comme la marche pas plus d’ailleurs que la conduite ne sont les points forts de mon chauffeur, des gouttes de sueur perlent sur ses joues, il est en nage.
A un moment donné nous apercevons en contrebas la Mer Egée, et pour caractériser cette magnificence il ne me vient à l’esprit que le mot certes rebattu de « pittoresque ». Les situations critiques s’accumulent, et il me semble faire office d’ange gardien auprès de mon chauffeur dont je dois corriger souvent la trajectoire, et qui refuse de me confier complètement le volant. Tout en regardant à droite et à gauche, il me cite des noms de batailles ou de lieux saints, ce qui lui fait rapidement perdre le sens de l’orientation et confondre le côté droit et gauche de la route. Toute la Grèce ressemble à un musée géant.
Nous nous arrêtons alors non loin de la mer à proximité d’un monument semblable à un mur, et sur lequel un guerrier armé d’un bouclier et d’une lance monte la garde, les Thermopyles. C’est là que les guerriers grecs sous l’égide de Léonidas défièrent le roi des Perses, avant de se faire exterminer à l’époque de Xerxès, le conquérant perse dont les troupes étaient largement supérieures en nombre. Une stèle ancrée dans le sol annonce aux lointains descendants que nous sommes : « Etranger, annonce aux Lacédémoniens que nous gisons ici pour avoir obéi à leurs lois ! » Même moi l’objecteur de conscience, je me pose la question de savoir si une guerre ne peut pas être juste. Quand la liberté est en jeu, l’homme est prêt à tout…
L’après-midi, nous posons les pieds là même où les Grecs en l’an 490 avant J-C ont remporté la victoire décisive contre les Perses : Marathon, à 42 kilomètres d’Athènes. Dois-je parcourir à pied cette dernière étape avec 27 kg sur le dos, plus que l’équipement de guerre complet d’un Hoplite ? Quant à celui qui avait apporté à Athènes la nouvelle de la victoire, ce devait être un de ces Gymnètes qui faisaient économie de vêtement en combattant nu. Je préfère pour ma part continuer avec mon chauffeur.
En bordure de route surgissent des banlieues crasseuses, dont les lignes téléphoniques et électriques forment une gigantesque toile d’araignée reliant les maisons entre elles. Bien que mon chauffeur semble perdu dans la cohue citadine, nous arrivons bientôt dans son quartier où il me dépose. A pied, puis en bus, je m’insinue dans les rues en direction du centre antique. Dans l’air, au-dessus de cette ville géante saturée de gaz d’échappement et semblable à un tampon gris de coton, trône sur l’Acropole le temple du Parthénon, d’une blancheur resplendissante à la lueur du soleil.
Je me fraye un chemin à travers la foule dense des autochtones et des touristes, dans les ruelles étroites bordées de chaque côté par des boutiques de souvenirs aux vendeurs entreprenants et par des restaurants aux effluves odorantes alléchantes. Dans un petit troquet je commande une bière et un sandwich au nom incompréhensible, et me masse les clavicules endolories par le poids du sac à dos que l’aubergiste dépose à ma demande sous le comptoir. A présent soulagé, je gravis une des ruelles étroites qui mènent à l’Acropole, érigée sur un rocher abrupt et accessible seulement à certains endroits. Qui plus est, tout le site du temple est clôturé, ne serait-ce déjà que pour encaisser les entrées des visiteurs. Au fur et à mesure que je monte, les gens se font de plus en plus rares, et pour finir la ruelle se transforme en un sentier qui serpente à travers des broussailles desséchées et contourne des blocs rocheux abrupts.
Ayant découvert un petit emplacement en saillie idéal pour la nuit, je redescends en ville et me laisse emporter par le flot des touristes, en direction des curiosités de la ville. A cause de la chaleur des ruelles je cherche refuge dans une église orthodoxe, où une fois le portail refermé, un silence enrobé de fraicheur m’enveloppe. L’or des icônes brille faiblement à la lueur de quelques rares rayons de soleil qui percent à travers les carreaux manquants des vitraux multicolores aux encadrements de plomb. Des visages ovales légèrement inclinés de vierges et de saints me dévisagent avec leurs yeux en amande, une main levée et les doigts symboliquement écartés. Dans ce silence au léger parfum d’encens un profond sentiment de béatitude me submerge : je suis sur la route, enfin, après tant d’années… tel un des membres du Cercle des Pèlerins du Pays du Levant… !
A la tombée du jour je vais récupérer mon sac à dos dans le bar, après m’être procuré un peu de pain, de féta et une bouteille de bon vin. A la montée je fais régulièrement des haltes à cause du poids de mon sac à dos, mais surtout pour ne rien perdre du coucher de soleil, pour moi le plus beau moment de la journée. Tout en mangeant je regarde, tandis que peu à peu la nuit tombe mais seulement ici sur les hauteurs, car en bas un océan de lumières se répand tel une voie lactée terrestre au-dessus de cette ville géante dont le Pirée doit être l’extrémité juste avant de se jeter dans la mer. Alors même que l’horizon vient de perdre sa dernière lueur rougeoyante, le bruit assourdi de la ville me parvient aux oreilles. Le sol à mes pieds est dur et accidenté, formant une étroite bande rocheuse délimitée par quelques buissons noueux au feuillage dense, propices à éviter toute chute. Adossé à la paroi rocheuse, je reste là assis dans mon sac de couchage, dominant du regard le berceau de l’Occident, là même où tout a été expérimenté, de l’anarchie à la démocratie en passant par l’aristocratie…
Une légère sensation de froid m’arrache soudain aux bras de Morphée et me ramène sur terre, au moment même où Aphrodite dans toute sa majesté émerge des flots et vient me réchauffer. Puis je me rends avec mes bagages à la consigne de la gare et me renseigne sur les correspondances ferroviaires et maritimes. Un train part toutes les dix minutes pour le Pirée, ainsi qu’un bateau en soirée pour l’île de Chios, ce qui me laisse la journée pour marcher sur les traces des philosophes…
En cours d’histoire j’avais déjà vu des images de temples, mais la réalité dépasse la fiction, cette grandeur, cette puissance… Le grouillement des premiers touristes au pieds des colonnes fait penser à des fourmis. Comme tout le site est clôturé et que je ne trouve pas de passage dans la clôture, je me joins à la file des touristes, paye mon obole et pénètre enfin dans l’antre de ce monde antique, où des groupes de visiteurs alignés comme des cars suivent le guide du troupeau qui arbore le plus souvent un fanion aux couleurs du pays de ses petites brebis.
Je rôde alentour pour tout découvrir par moi-même et m’approche toutefois de temps en temps d’un groupe, quand je souhaite des précisions sur l’histoire d’un des édifices, comme par exemple le fait que la base des colonnes du plus grand temple dédié à la déesse de la guerre Athéna, entièrement détruit par les Perses puis reconstruit sous Périclès, mesure plus de deux mètres pour une hauteur de près de quinze mètres.
En le regardant, je m’imagine le tas de ruines pareil à un puzzle géant et les difficultés à le reconstituer. A l’angle est de la façade se dresse un échafaudage d’acier sur lequel un tailleur de pierres est en train d’effectuer des travaux de restauration, à moins qu’il n’entaille des morceaux des parties rénovées pour les faire paraitre plus anciennes. Au rythme des coups de marteau se succédant à la minute, il me semble qu’il réinvente la lenteur. A ma vue il s’exclame : « Toi allemand ? » Incroyable ce sens de la physionomie chez ces gens ! J’apprends qu’il était à Aix-La-Chapelle où comme travailleur immigré il a appris à travailler, alors qu’ici il fait l’apprentissage du temps.
Il y eut certes les destructions par les Perses, mais plus tard d’autres guerres, l’usure du temps et la malice des Anglais qui ont remplacé par des copies les personnages féminins de la salle « Koren », qu’ils ont déplacés dans leur British Museum. Il y eut aussi d’autres musées qui ne voulaient pas être en reste et des collectionneurs privés, ce qui explique les entassements de pierres dont la position exacte et la fonction doivent être déterminées par les chercheurs au moyen de textes anciens ou de récits de voyage de l’Antiquité.
Les élèves du monde entier n’aiment pas trop évoquer les Grecs, car ce sont eux qui ont inventé la géométrie ! Les enseignements de Pythagore ont peut-être été découverts lors de l’édification ou de la planification d’un temple, et il faut mentionner Euclide, Thalès et bien d’autres encore, la trigonométrie, le calcul du cercle, le nombre PI, l’algèbre qui connut ici son développement et l’atome dont la signification étymologique est « indivisible », et dont l’existence ne fut confirmée que des siècles plus tard. Ce sont les Grecs qui ont engendré notre monde moderne, celui-là même qui à son tour réussit à diviser l’indivisible et être ainsi peut-être à l’origine de sa propre perte…C’est ici au sommet de l’Aéropage que beaucoup de grands penseurs dont le plus célèbre et qui fut condamné à mort, Socrate, ont prodigué leur enseignement. Un autre, Diogène, renonça à toutes les richesses du monde et s’enferma dans un tonneau où il vécut comme Huckleberry Finn. Ici aussi furent expérimentées toutes les facettes de l’amour, dont certaines idées furent reprises à leur compte par les Hippies, qui en plus inventèrent la notion de paix inconnue de l’Antiquité.
Revenons à notre visite : en contrebas s’ouvre l’hémicycle d’un amphithéâtre dont les rangées de sièges en demi-cercle plongent vers la scène, créant des conditions idéales pour l’acoustique. C’est là qu’est née la tragédie qui n’est pas simplement une pièce de théâtre à l’issue triste, mais dans laquelle un héros fait œuvre de justice et d’injustice en même temps, en respectant certaines lois et en en transcendant d’autres. En d’autres termes et pour l’exprimer plus simplement : un disciple qui veut se marier, demande conseil à Socrate qui lui répond : « Fais ce que tu veux, tu le regretteras de toute façon ! »
La Grèce se compose de plus de 3000 iles, y compris les plus minuscules, et même si seulement 1/10ième est habité, il faut une grosse flotte pour maintenir la liaison entre elles et avec le continent. En quelques minutes j’arrive en train au Pirée, et avant d’apercevoir le port je le sens déjà. Le bateau remplace ici le train. Sur une carte je regarde les différentes liaisons et correspondances qui à l’intérieur de la Grèce sont d’un prix à défier toute concurrence, ce qui n’est pas le cas pour celles avec la Turquie qui coûtent dix fois plus cher. Je décide de me rendre sur l’ile de Chios proche de la côte turque et éloignée d’à peine vingt kilomètres de Cesme, pensant qu’il y aura bien une correspondance…
6 DM la traversée sans cabine ! Je me procure un sandwich auprès d’un commerçant ambulant pour la traversée, et voici qu’entre dans le port « L’Adonis » d’un blanc étincelant sous le soleil de cette fin de journée. Presque tous les passagers debout contre le bastingage côté terre observent les manœuvres d’accostage du bateau ou cherchent du regard des visages connus parmi la foule qui se presse le long du quai. Le navire a une envergure de 90 mètres de long pour 15 mètres de large, avec des portes d’accès latérales pour les voitures et les poids lourds. Un bref son de corne de brume retentit et fait sursauter les passagers. Il accoste sans remorqueur, ce qui laisse penser qu’il est équipé d’un propulseur d’étrave dans la proue. Un flot presque ininterrompu de gens se déversent alors par les passerelles d’embarquement et les appontements sur le quai, suivi de celui des véhicules qui jaillissent de ses entrailles. Sur l’embarcadère règne un désordre indescriptible qui ne se dissipe qu’au bout d’un certain temps. 2000 passagers ? Oui, au moins ! Les vagues huileuses avec des débris flottant en surface viennent heurter en douceur le mur du quai. Les cordes d’arrimage crissent légèrement au rythme de la houle qui agite le navire. L’air est imprégné d’un mélange de goudron de bois, de gaz d’échappement de diesel, et d’odeur de poisson : Bref une ambiance de port !