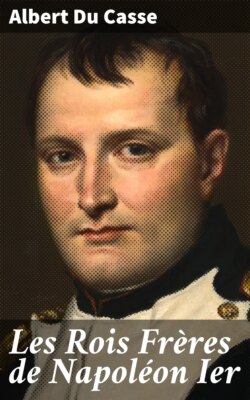Читать книгу Les Rois Frères de Napoléon Ier - Albert Du Casse - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
1778-1806.
ОглавлениеTable des matières
Louis Bonaparte, troisième des frères de Napoléon Bonaparte, naquit à Ajaccio (Corse) le 2 septembre 1778, sous le règne de Louis XVI. Bien que la famille Bonaparte soit d'origine italienne, l'île de Corse ayant été cédée sous Louis XV à la France, Louis et ses frères naquirent Français et non Italiens, comme quelques auteurs l'ont écrit.
La longue carrière de Louis Bonaparte peut se diviser en trois parties bien distinctes:
1o Celle qui s'étend du jour de sa naissance (1778) au moment où il monta sur le trône de Hollande (1806), période pendant laquelle on le voit vivre auprès de son frère Napoléon et se montrer entièrement dévoué à ses projets.
2o Celle qui comprend les quatre années de son règne en Hollande, son abdication, son exil volontaire, la chute de l'empire (de 1806 à 1815).
3o Enfin, la partie qui embrasse l'exil forcé des membres de la famille de l'empereur après Waterloo, jusqu'à la mort de Louis, à Florence, le 25 juillet 1846.
Nous parlerons peu des premières années de Louis. Lorsque Paoli livra l'île de Corse aux Anglais, la famille Bonaparte vint s'établir près de Toulon, à Lavalette, puis bientôt après à Marseille. Louis, âgé de 14 ans, se trouvait au milieu des siens. Il n'avait pu faire, dans ces temps de troubles, que de médiocres études, mais son caractère, empreint déjà d'une teinte philosophique, s'était développé par les malheurs mêmes qui avaient, depuis sa naissance, accablé ses parents. Élevé par Joseph, l'aîné de ses frères, devenu le chef de la famille à la mort de leur père Charles Bonaparte (23 septembre 1785), soutenu par Napoléon, officier d'artillerie, il entra en 1793 dans la vie active, à peine au sortir de l'enfance. Napoléon commandait l'artillerie au siège de Toulon, il venait souvent à Marseille, soit pour hâter les préparatifs du siège, soit pour y voir sa famille. Dans un de ses voyages, il déclara que Louis était d'âge à se faire une carrière honorable, et qu'il ne voulait pas le voir plus longtemps inactif. Il obtint de leur mère que le jeune homme se rendrait à l'école de Châlons pour subir l'examen nécessaire à son admission dans le corps de l'artillerie. Louis partit avec des passeports visés par les représentants du peuple, mais en passant à Lyon, alors sous la terreur qu'inspiraient d'horribles massacres, il courut de véritables dangers. Il ne put sortir de cette malheureuse ville qu'avec peine et à la faveur de ses passeports. Il continua sa route, se dirigeant vers Châlons-sur-Marne. À Chalon-sur-Saône, on lui apprit la dissolution de l'école d'artillerie. Effrayé de ce qu'il avait vu, de son isolement (Louis avait alors 15 ans), le jeune homme revint dans sa famille. Après la prise de Toulon, Napoléon Bonaparte, créé général de brigade, vint à Marseille, prit avec lui son frère Louis et se rendit à l'armée des Alpes-Maritimes où il venait d'être nommé commandant en chef de l'artillerie. Louis fut adjoint à son état-major avec le grade de sous-lieutenant. Le soir de la prise de Toulon, Napoléon, pour qui, depuis longtemps déjà, tout était objet d'étude sérieuse, avait fait visiter à son frère les attaques de la ville. Il lui avait indiqué, sur le terrain même, les fautes commises, puis, lui montrant l'endroit où la terre était jonchée de cadavres, il s'écria:
«Si j'avais commandé ici, tous ces braves gens vivraient encore. Jeune homme, apprenez par cet exemple combien l'instruction est nécessaire et obligatoire pour ceux qui aspirent à commander les autres.»
Louis Bonaparte fit sa première campagne à l'armée des Alpes-Maritimes. Il assista à la prise d'Oneille (7 avril 1794), à celle de Saorgio (29 avril), au combat de Cairo (21 septembre), et fut nommé lieutenant dans une compagnie de canonniers volontaires en garnison à Saint-Tropez. Une loi nouvelle exigeait que les officiers d'état-major rentrassent dans les régiments. Il resta quelques mois dans la petite ville de Saint-Tropez, puis il fut envoyé à l'école d'artillerie de Châlons-sur-Marne pour y subir ses examens.
Après la journée du 13 vendémiaire (4 octobre 1795), Bonaparte, devenu général en chef de l'armée de l'intérieur, donna l'ordre à son frère de se rendre à son état-major auquel il l'avait attaché. Louis refusa d'abord de quitter Châlons, désireux de se faire recevoir avant tout dans l'artillerie, mais il dut obéir à l'ordre formel qui lui fut envoyé, et il se rendit à Paris en décembre 1795. Pendant la campagne de 1794 en Italie, les représentants du peuple, très désireux de faire quelque chose d'agréable au général Bonaparte, avaient voulu conférer à Louis le grade de capitaine; Napoléon s'y était opposé, à cause de l'âge de son frère (16 ans à peine). Cependant, il se plaisait à rendre justice à cet enfant devenu bien vite un jeune homme plein de bravoure et de sang-froid. Il racontait avec bonheur que le jour où Louis fut au feu pour la première fois, loin de montrer de la crainte ou même de l'étonnement, il avait voulu lui servir de rempart. Une autre fois, Napoléon et Louis se trouvaient à une batterie en barbette sur laquelle l'ennemi faisait le feu le plus vif. Les défenseurs baissaient souvent la tête pour éviter les boulets. Napoléon remarqua avec joie que son jeune frère, imitant son exemple, restait droit et immobile. Il lui en demanda la raison:
«Je vous ai entendu dire, repartit Louis, qu'un officier d'artillerie ne doit pas craindre le canon; c'est notre arme!»
Lorsque Napoléon reçut le commandement en chef de l'armée d'Italie, en 1796, il résolut de mener avec lui son frère Louis qui arrivait de l'école de Châlons. La guerre, pendant laquelle il s'était montré d'une grande bravoure personnelle, n'allait ni à ses instincts humanitaires, ni à ses goûts philosophiques, ni à ses idées dénuées de toute ambition. Ce fut pendant le peu de temps qui s'écoula entre le retour de Louis de l'école de Châlons et son départ pour Nice, qu'il connut à Paris Madame de Beauharnais, Hortense et Eugène.
Louis avait 18 ans quand il commença sa seconde campagne. Il la fit, non plus seulement comme attaché à l'état-major du général en chef, mais en qualité de l'un de ses aides de camp. Il était encore lieutenant. Bien qu'à un âge où tout ce qui est nouveau attire, où tout ce qui est bruit, ambition, renommée, charme, Louis Bonaparte sentait un vide dans son cœur. La carrière des armes lui paraissait sans attrait. Il soupirait déjà après l'étude, la retraite, la vie paisible. Ces biens il ne devait pas les connaître pendant toute sa longue existence. Son caractère encore rempli de contrastes était à la fois grave et romanesque, vif et flegmatique. «Louis a de l'esprit, fait-on dire à Napoléon à Sainte-Hélène, il n'est point méchant, mais avec ces qualités un homme peut faire bien des sottises et causer bien du mal. L'esprit de Louis est naturellement porté à la bizarrerie et a été gâté encore par la lecture de Jean-Jacques. Courant après une réputation de sensibilité et de bienfaisance, incapable par lui-même de grandes vues, susceptibles tout au plus de détails locaux, Louis ne s'est montré qu'un roi préfet[54].»
Il est permis de douter que Napoléon ait porté un tel jugement sur son frère. Louis était fort peu désireux d'une réputation quelconque, et ses malheurs, depuis son avènement au trône de Hollande, vinrent précisément, ainsi qu'on le verra plus loin, de n'avoir pas voulu être un roi préfet. Louis, pendant la campagne de 1796, fit preuve de bravoure en plusieurs circonstances, mais (comme il le dit lui-même dans l'ouvrage qu'il publia en 1820) il le fit par boutade et sans s'occuper d'acquérir une réputation militaire. Il montra du zèle, du sang-froid, nul désir d'avancer, nulle idée d'ambition. Il avait surtout une répugnance invincible pour les excès de toute nature. Il cherchait à remplir ses devoirs, ne se ménageant pas, mais sans tirer vanité de ses actions, sans chercher à se faire valoir. Au passage du Pô (7 mai) il franchit le fleuve un des premiers, avec le colonel Lannes; à la prise de Pizzighettone (9 mai) il entra dans la place par la brèche avec le général d'artillerie Dommartin; à l'attaque de Pavie, ayant reçu l'ordre de suivre l'opération, d'examiner la position de l'ennemi et d'en venir rendre compte à son frère, il resta seul, à cheval, exposé plus que tout autre au feu terrible des défenseurs de la ville. Pavie fut en partie pillée, elle avait mérité ce juste châtiment, cependant ce spectacle révolta Louis, et à partir de ce moment et pendant le reste de la campagne il fut triste, taciturne. Il prit part à la bataille de Valeggio (12 août), au passage de vive force du Mincio, à l'investissement de Mantoue. À la tête de deux bataillons, il fut chargé de s'emparer du pont de San-Marco sur le Chiese, au moment où Bonaparte, après quelques mouvements aussi habilement conçus que rapidement exécutés, se préparait à livrer le combat de Lonato (13 août) et la bataille de Castiglione. La veille de ces belles journées, Louis fut expédié par son frère au Directoire pour rendre compte de l'état des choses, et du retour offensif des Autrichiens de Wurmser. «Maintenant, «dit-il à son jeune aide de camp, tout est réparé: demain je livrerai la bataille; le succès sera des plus complets, puisque le plus difficile est fait, on doit être entièrement rassuré, je n'ai pas le temps de faire de longues dépêches, dites tout ce que vous avez vu.» Louis témoignait son regret de quitter l'armée dans un moment pareil. «Il le faut, ajouta Napoléon, il n'y a que mon frère que je puisse charger de cette mauvaise commission; mais avant de revenir, vous présenterez les drapeaux que nous conquerrons demain.» Peut-être Napoléon qui, quoi qu'on en ait dit, était bon, sensible surtout pour ses frères et pour ses sœurs, avait-il voulu éloigner ce jeune homme des champs de bataille dans lesquels il savait bien qu'il devait, avec une poignée d'hommes, remporter la plus éclatante victoire ou périr lui et sa petite armée? Louis partit donc, remplit sa mission, reçut du Directoire le grade de capitaine et présenta, quelques jours après, ainsi que le lui avait promis son frère, les drapeaux enlevés par nos soldats à Castiglione, drapeaux que Bonaparte avait envoyés par l'aide de camp Du Taillis. Louis se hâta ensuite de rejoindre son général et il put assister au troisième acte du grand drame qui se jouait alors du Pô à la Brenta. Il prit part à la bataille de ce nom, et une part des plus glorieuses aux trois journées d'Arcole (15, 16, 17 novembre). À la première journée, Louis fut celui des aides de camp de son frère qui contribua le plus à le sauver, lorsque le général tomba dans le marécage au bas de la chaussée, après les tentatives faites inutilement pour déboucher de cette chaussée étroite, sur le village d'Arcole. Voyant Napoléon prêt à disparaître dans les eaux bourbeuses, il risqua sa vie avec Marmont pour le tirer de ce mauvais pas; puis il tenta de nouveau, mais en vain, d'enlever le pont[55]. Pendant la seconde journée d'Arcole, Louis non seulement combattit vaillamment près de son frère, mais il fut chargé de la mission difficile et dangereuse de porter des ordres de la plus haute importance au général Robert. Il n'y avait pas d'autre chemin pour remplir son périlleux devoir que de suivre une chaussée balayée par le feu des Autrichiens. En revenant auprès du général en chef par la même route, il courut les mêmes dangers, dont cependant il fut assez heureux pour se tirer sans blessures: «Je te croyais mort, lui dit son frère avec joie en l'embrassant.»
En effet, on était venu annoncer que Louis avait été tué. Peu de temps après, lorsque Napoléon marcha sur Rivoli, au secours de Joubert, Louis fut encore chargé d'une mission épineuse à Peschiera. Il rendit à cette occasion un grand service à l'armée, en ralliant une colonne de fuyards et en arrêtant l'ennemi qui s'avançait sur ses derrières. Lorsqu'il revint auprès du général en chef, Napoléon lui témoigna publiquement la satisfaction que lui faisait éprouver sa conduite pendant cette affaire de Rivoli (14 janvier 1797).
Jusqu'en 1796, Louis, d'une forte constitution, avait joui d'une bonne santé; mais s'étant trop peu ménagé pendant cette longue campagne, ayant d'ailleurs été soumis trop jeune à de trop rudes fatigues, ayant éprouvé plusieurs accidents, fait plusieurs chutes de cheval, il commença à ressentir les effets d'une existence au-dessus de ses forces physiques. À Nice, après le siège de Toulon, il était tombé de cheval par la faute de Junot, qui avait effrayé à dessein sa monture pour voir s'il était bon cavalier. Il s'était fait à l'œil gauche une blessure grave dont il conserva toujours la cicatrice. Après la paix de Campo-Formio, lors de son retour à Paris, ses chevaux s'étaient emportés dans la descente de la montagne de Saint-André, en Savoie; il s'était démis le genou.
Tout cela, joint aux fatigues de la campagne d'Italie, lui fit désirer de prendre, pendant quelque temps, les eaux de Barèges qu'on lui avait conseillées, mais il ne put exécuter son projet. Napoléon s'apprêtait à s'embarquer pour l'Égypte, il avait décidé d'emmener son frère, que d'ailleurs, pour une raison secrète, il ne voulait pas laisser à Paris.
Pendant son dernier séjour en France, Louis avait été visiter à la célèbre pension de madame Campan, à Saint-Germain, sa sœur Caroline, et s'était épris d'une amie de cette sœur, fort jolie personne, dont le père avait émigré. Il confia son penchant à Casabianca, ami de son frère Napoléon, ancien officier supérieur de la marine, qui fut effrayé pour Louis des conséquences de cette passion naissante. «Savez-vous, lui dit-il, que ce mariage ferait le plus grand tort à votre frère, et le rendrait suspect au gouvernement?» Le lendemain Napoléon fit appeler Louis et lui donna l'ordre de partir immédiatement avec ses trois autres aides de camp pour Toulon où ils devaient l'attendre et passer avec lui en Égypte[56]. Louis attendit quelque temps, à Lyon, son frère que le Directoire avait retenu dans la crainte de voir la guerre se rallumer avec l'Autriche, à la suite d'une imprudence de Bernadotte, ambassadeur à Vienne.
Il suivit la division Kléber jusqu'au Caire; mais Napoléon, au moment où il partit pour la Syrie, résolut d'expédier en France un homme sur lequel il pût compter pour faire connaître exactement au Directoire l'état des affaires en Orient et pour lui faire envoyer des secours. Il choisit son frère Louis. Il savait que ce retour en France était sans inconvénient pour son cœur, puisque, après son départ de Paris, la jeune personne qu'il aimait avait été forcée de se marier. Louis partit donc avec les drapeaux pris sur l'ennemi. Il s'embarqua sur la plus petite, la plus vieille, la plus délabrée des chaloupes canonnières. La flotte avait été détruite à Aboukir. Pendant deux mois, il eut à lutter contre la tempête, à éviter les vaisseaux turcs, russes, anglais, portugais croisant dans la Méditerranée entre la France et l'Égypte. Il fut retenu pendant 27 jours en quarantaine à Tarente; de nouvelles tempêtes l'assaillirent quand il reprit sa route. Une seule et mauvaise pompe soutenait son fragile navire qui faisait eau à chaque instant. La situation fut un instant si désespérée qu'il donna l'ordre au capitaine de son bâtiment d'entrer à Messine, bien qu'on fût en guerre avec Naples. La force du vent ayant poussé le bateau hors du détroit, une frégate anglaise lui donna la chasse et il se décida à jeter à la mer les drapeaux qu'il devait présenter au Directoire. Toutefois, après avoir fait escale à Porto-Vecchio en Corse, il parvint à débarquer en France. Aussitôt il fit toutes les démarches en son pouvoir pour avoir des secours, mais il ne put obtenir d'abord que l'envoi de quelques avisos montés par des officiers porteurs de dépêches. Le gouvernement refusa d'expédier des troupes. Louis ne trouva d'aide, au ministère de la guerre, que dans le général Dupont. Enfin, quand on eut quelques détails sur l'expédition de Syrie et sur la seconde bataille d'Aboukir, le Directoire se décida à envoyer des secours et des troupes. Louis s'occupait des préparatifs du départ, qu'il hâtait de tout son pouvoir, lorsque l'on apprit le débarquement à Fréjus du général Bonaparte. Louis partit aussitôt pour aller avec Joseph et le général Leclerc au devant de Napoléon. Il tomba malade à Autun et ne put rejoindre son frère qu'à Paris. Il reprit immédiatement, près de sa personne, son poste d'aide de camp, et fut promu chef d'escadron au 5e de dragons.
Après le coup d'État du 18 brumaire, Louis fut immédiatement promu au grade de colonel commandant le 5e régiment de dragons. Ce régiment tenait alors garnison à Verneuil, étant chargé d'aider à la pacification de la Normandie. Louis fut obligé, fort à contre-cœur, de le rejoindre dans cette ville. Le jeune colonel était désolé d'être employé à une mission de ce genre, à l'intérieur. Il fit tout son possible pour éviter cette tâche désagréable, mais il ne put rien obtenir à cet égard du premier consul. À son grand désespoir, la ville de Verneuil ne tarda pas à être le théâtre d'un horrible événement, si commun dans les guerres civiles. Quatre malheureux prisonniers amenés par des soldats dans la ville furent jugés par un conseil de guerre et condamnés à être passés par les armes. Louis, pressé de présider le conseil de guerre, refusa avec indignation, repoussant prières, ordres, menaces. Il écrivit à son frère pour obtenir la grâce des condamnés. Il était trop tard, on procéda à leur exécution malgré toutes ses tentatives pour les sauver. Cette tragédie l'émut au point de lui faire prendre en horreur le métier des armes. Il resta dans son logement, comme pour un jour de deuil, ordonna à ses officiers d'en faire autant, et accueillit avec joie l'ordre, arrivé quelques jours plus tard, de se rendre en garnison à Versailles et ensuite à Paris. Deux escadrons du 5e de dragons furent alors organisés sur le pied de guerre et prêts à faire partie de l'armée de réserve qui se rassemblait à Dijon. Louis croyait en prendre le commandement, mais ils furent mis sous son lieutenant-colonel et lui-même resta à Paris. Ce fut à cette époque que son frère commença à lui parler de mariage et à le presser d'épouser la fille de Joséphine. Louis, soit qu'il ne voulût faire qu'un mariage d'inclination, soit qu'il crût à une incompatibilité d'humeur et de caractère entre lui et Hortense, refusa. Peut-être aimait-il encore au fond du cœur l'amie de pension de sa sœur. Au retour de sa brillante campagne de Marengo, le premier consul revint à ses idées d'union entre son frère et sa fille d'adoption. Pour éviter toute contrainte à cet égard, Louis demanda et obtint de faire un long voyage sous le prétexte d'assister aux manœuvres de Postdam. Il devait même ensuite compléter ce voyage dans le Nord, en visitant la Saxe, la Pologne, la Russie, la Suède et le Danemark. Lorsque Louis arriva à Berlin, les manœuvres étaient terminées, mais il fut reçu avec tant de bonne grâce par le roi et la reine Louise, qu'il séjourna un mois entier dans la capitale de la Prusse. Il quitta cette ville pour se rendre à Dantzick et de là à Saint-Pétersbourg. À Dantzick, il tomba malade, et comme, pendant les trois semaines qu'il y fut retenu, la guerre éclata de nouveau entre la France et l'Autriche, il se décida à revenir à Paris. Après quelques jours passés à Brunswick où le duc régnant le reçut à merveille, il revint près de son frère. Le premier consul renouvela alors ses instances pour lui faire épouser Hortense. Louis ne pouvait se décidera s'enchaîner aussi jeune (il n'avait que 23 ans). Pour ne pas céder aux sollicitations de Bonaparte et de sa belle-sœur, il fit comprendre son régiment de dragons dans le corps dirigé sur le Portugal. Toutefois, ayant été prendre congé de son frère à la Malmaison, il y fut retenu par lui et par Joséphine pendant près de trois semaines. Un beau jour, il partit brusquement pour Bordeaux et Mont-de-Marsan. Dans cette dernière ville, on le reçut avec de grandes démonstrations, et on lui rendit même, à cause de sa parenté avec le premier consul, de tels honneurs que, fort modeste et très simple de goûts et de manières, il fut choqué de toute la mise en scène dont il se trouvait être l'objet. Le préfet vint le complimenter à la tête des autorités du département et le président du tribunal, vieillard vénérable, commença d'un ton solennel un discours dont les premiers mots étaient: «Jeune et vaillant héros...» Louis ne put en entendre davantage; il sauta en riant sur le discours, l'arracha d'une manière vive mais familière des mains du pauvre président auquel il répondit tout haut: «Je vois que ce discours s'adresse à mon frère, je m'empresserai de lui faire connaître les bons sentiments que vous avez pour lui. Je puis vous assurer qu'il y sera très sensible.»
Louis entra en Espagne à la tête de son régiment (1801), il passa quelques semaines à Salamanque, vint à Ciudad Rodrigo, puis il se rendit avec Leclerc, général en chef de l'armée française, au grand quartier général de l'armée espagnole alliée de la nôtre. Joseph, l'aîné des Bonaparte, négociait alors la paix générale. Il y eut un armistice, le jeune colonel conduisit son régiment à Zamora. Il obtint ensuite un congé pour prendre les eaux de Barèges, que sa jambe malade et un rhumatisme à la main droite rendaient nécessaires à sa santé. Il resta aux eaux les trois mois de juillet, août et septembre 1801, et revint à Paris en octobre, au moment de la signature des préliminaires de paix avec l'Angleterre (traité d'Amiens).
Ni Bonaparte ni Joséphine n'avaient abandonné leurs projets de mariage pour Louis et Hortense. Louis plaisantait parfois de ce projet dont il regardait l'exécution comme impossible, cependant la persistance de son frère et de sa belle-sœur finit par l'emporter. Un soir, pendant un bal à la Malmaison, il donna son consentement et le jour de la cérémonie nuptiale fut fixé au 4 janvier 1802. Le contrat, le mariage civil, le mariage religieux furent hâtés. Tout s'accomplit, mais sous les plus tristes auspices, tant était grand et réel le pressentiment secret des deux époux des malheurs qui devaient découler pour eux d'une union presque forcée et mal assortie. Louis avait 24 ans; sa constitution formée de bonne heure et déjà maladive était en avance sur son esprit, sur son caractère encore plein de naïveté et de bonne foi. C'est de ce moment que date pour lui une sorte de tristesse, de découragement moral qui contribuèrent à empoisonner son existence. Du reste, nous ne pouvons mieux faire pour donner une idée exacte de cette union que de renvoyer le lecteur à ce que le roi Louis, au commencement de son ouvrage sur la Hollande, en dit lui-même.
De 1802 à 1804, Louis resta presque constamment soit à son régiment, soit aux eaux thermales. En 1804, son frère le nomma général de brigade en lui laissant le commandement du 5e de dragons.
Après la proclamation de l'empire (1804), Louis fut promu au grade de général de division et entra en même temps au conseil d'État, à la section de la législation. Le 2 décembre 1804 eurent lieu le sacre et le couronnement, puis le nouveau souverain pressa de tout son pouvoir les préparatifs d'une descente en Angleterre. Louis, devenu prince français, reçut le commandement de la réserve de l'armée composée de deux régiments de cavalerie et de deux divisions d'infanterie. L'empereur le fit colonel général des carabiniers. Il s'établit avec ses troupes près de Lille, et comme il se trouvait à portée des eaux de Saint-Amand, il en profita pour en faire usage, car sa santé devenait de plus en plus mauvaise. Il était presque paralysé des doigts de la main droite, et les eaux de Plombières où il avait été l'année précédente, loin de le soulager, avaient empiré sa situation. Celles de Saint-Amand ne lui réussirent pas mieux.
Quand le projet de descente fut abandonné et la campagne d'Allemagne entreprise (1805), Louis croyait devoir commander le corps de réserve en Allemagne. L'empereur préféra lui confier, en son absence, le commandement de Paris et donner la réserve à Murat devenu maréchal. Pendant toute cette glorieuse campagne et jusqu'à la fin de 1805, Louis resta chargé des importantes fonctions qu'il devait à la confiance de son frère. En même temps son frère Joseph gouvernait la France au nom de l'empereur.
Louis n'avait dans ses attributions que les affaires militaires. Avec peu de troupes, il maintint l'ordre, malgré les embarras financiers, les intrigues et l'agitation de tous les partis. Sous prétexte de la pénurie des finances, du discrédit de la banque, dans l'attente des événements et peut-être aussi poussés par quelques factieux, des rassemblements considérables se montraient chaque nuit sur divers points de la capitale. Le successeur de Murat au commandement de cette grande ville, non seulement parvint à conjurer les dangers qui pouvaient résulter de ces attroupements, mais il veilla aussi sur les côtes de l'Ouest, sur Brest, sur Anvers et sur la Hollande. Il assistait au conseil des ministres et correspondait journellement avec Napoléon. Bientôt une nouvelle occasion se présenta pour le jeune prince de déployer son activité. Les Anglo-Suédois et même les Prussiens menacèrent assez sérieusement les côtes de la Hollande et le nord de la France pour que, de la Moravie où il était allé combattre les armées austro-russes, Napoléon envoyât l'ordre à Louis de former le plus rapidement possible une armée du Nord destinée à couvrir les chantiers d'Anvers et la Hollande. Le conseil des ministres trouvait de grandes difficultés à l'exécution des volontés impériales, Louis les leva toutes. Il agit avec tant de zèle et d'intelligence, qu'un mois, jour pour jour, après le décret de Napoléon, il put écrire de Nimègue au vainqueur d'Austerlitz que l'armée du Nord, complètement organisée sous son commandement, était prête à tout. Cette armée se composait des deux divisions Laval et Lorge à Juliers (sur le Rhin) et de deux autres divisions, en position à Nimègue. Toutes ces troupes étaient sur les frontières de la Hollande et de la Westphalie, elles couvraient le Rhin, la Hollande, Anvers et pouvaient faire face sur tous les points à l'ennemi, de quelque côté qu'il voulût se présenter. En moins d'un mois, les places du Brabant furent mises en état de défense, les Hollandais reprirent courage, et la Prusse qui, peu de jours avant, ne voyait pas un homme pour lui disputer les frontières de la France, montra une extrême surprise. La rapide formation de l'armée du Nord ne laissa pas que d'avoir une certaine influence sur les négociations avec la Prusse. Napoléon apprit avec joie que l'armée française du Nord avait effrayé cette puissance au point que M. de Haugwitz, ministre du cabinet de Berlin, commença par demander que l'ordre fût donné aux troupes de Louis, alors sur les frontières du duché de Berg, de s'arrêter. L'empereur témoigna à son frère sa satisfaction, non seulement dans ses lettres particulières, mais encore dans un des bulletins de la grande armée. À la nouvelle de la victoire d'Austerlitz et de la paix, Louis renvoya à Paris les troupes tirées de cette ville, car l'empereur avait paru mécontent de ce qu'une partie de ces troupes avait été renforcer les divisions en Hollande. Le prince se rendit ensuite de sa personne à Strasbourg, au-devant de son frère qui le reçut froidement. Louis comprit plus tard d'où venait cette froideur. Napoléon, après l'avoir blâmé de ce qu'il avait distrait des troupes de Paris pour les envoyer dans le Nord, le blâma d'avoir trop vite renvoyé ces troupes en France. Enfin, il lui sut mauvais gré de son prompt départ de la Hollande. Quelques mots échappés à l'empereur, sur ses projets futurs relativement à ce pays, commencèrent à l'éclairer.
«Pourquoi l'avez-vous quitté? dit-il à Louis; on vous y voyait avec plaisir, il fallait y rester.—La paix une fois conclue, répondit celui-ci, j'ai tâché de réparer la faute que vous m'aviez reprochée dans vos lettres, en renvoyant à leur poste les troupes que j'en avais fait sortir pour l'armée du Nord. Quant à moi, à qui vous avez laissé le commandement militaire de la capitale en votre absence, mon devoir était de m'y trouver à votre retour, si je n'avais pas cru mieux faire en venant à votre rencontre. Je conviens, ajouta-t-il, que les bruits qui circulaient en Hollande sur moi et sur le changement du gouvernement dans ce pays ont hâté mon départ. Ces bruits ne sont pas agréables à cette nation libre et estimable, et ne me plaisent pas davantage.»
L'empereur fit comprendre alors, par sa réponse, quelque vague qu'elle fût, combien ces bruits étaient fondés. Mais Louis s'en inquiétait peu; il était persuadé qu'il trouverait aisément moyen de refuser le haut rang qu'on lui destinait, rang qu'il n'ambitionnait pas et qui faisait l'objet des vœux les plus ardents de plusieurs autres membres de sa famille.
Après le traité de paix, l'empereur se rendit de Strasbourg à Paris; Louis l'y accompagna. On touchait au moment où Napoléon allait mettre une couronne sur le front de ce jeune homme dénué de toute ambition, d'un caractère déjà naturellement porté à la tristesse, et que son union mal assortie rendait plus taciturne encore. Aux tracas intérieurs, allaient se joindre pour lui les soucis d'une royauté dont il ne sut pas mieux se défendre que de son mariage.
Nous devons dire ici quelques mots des négociations relatives à l'érection de la Hollande en royaume en faveur de Louis Bonaparte.
Après Austerlitz et la signature du traité de Presbourg, Napoléon, voulant assurer son système du blocus continental, songea à ériger en royaume la république batave. Des négociations sérieuses furent entamées entre le gouvernement impérial, représenté à La Haye par le général comte Dupont-Chaumont et le grand-pensionnaire Schimmelpenninck. Lorsque Napoléon crut les négociations assez avancées, et eut la certitude que le chef de la république batave était dans ses intérêts, il le fit engager (lettre du commencement de janvier 1806) à envoyer à Paris une députation chargée de s'entendre avec le gouvernement français sur les moyens à prendre pour introduire plus de stabilité dans les affaires de Hollande. Le 11 février 1806, Schimmelpenninck écrivit à M. de Talleyrand, notre ministre des relations extérieures, pour l'assurer de sa volonté de se prêter à toutes les vues de l'empereur, relativement à l'affermissement de l'union de la France et de la Hollande. Quelques jours plus tard, le 27 du mois de février, et lorsqu'il crut l'effet de sa lettre du 11 produit, le grand-pensionnaire demanda par une note confidentielle un accroissement de territoire pour la Hollande, du côté de la Prusse, accroissement promis, disait-il, et toujours ajourné. La Hollande désirait le pays situé entre l'Ems et le Wéser (l'Ost-Frise, la principauté de Jever, le bas évêché de Munster, le comté d'Oldenbourg, le comté de Bentheim, Steinvord, le haut évêché de Munster, etc.), pour reculer les frontières bataves jusqu'à l'embouchure du Wéser. Dans cette note toute confidentielle et adressée à M. de Talleyrand, il est fait appel à la générosité de l'empereur, pour lequel le dévouement du pays sera inaltérable.—Le 29 mars, le gouvernement français fut prévenu que l'amiral Verhuell, de retour à La Haye de sa mission à Paris, avait eu des conférences avec le grand-pensionnaire, à la suite desquelles la convocation des États avait été décidée pour le 1er avril. Le 31 mars, Verhuell écrivit à Talleyrand que l'impression produite sur le grand-pensionnaire, relativement aux intentions de l'empereur, avait été vive; qu'il ne pouvait résoudre seul la question déclarée invariable par Napoléon; que le prince Louis et sa femme seraient bien reçus en Hollande, et que les notables n'hésiteraient pas à se ranger autour d'eux. Bientôt, les intentions de l'empereur sur la Hollande commençant à être devinées, des brochures contre la domination de l'étranger furent publiées dans ce pays. Napoléon devint furieux[57]. Le 15 avril, le général Dupont prévint que les États allaient envoyer à Paris une commission en tête de laquelle seraient Verhuell, Goguel, Van Styrum, Six et Porentzel. En effet, la députation arriva à Paris le 25 avril. Verhuell se hâta de voir Talleyrand avant la réception de la députation. L'empereur apprit alors qu'une assez violente opposition au gouvernement monarchique se laissait entrevoir à La Haye; qu'une adresse se signait à Harlem, demandant, au nom des précédents du pays et de l'honneur national, le maintien de la république. Cela n'empêcha pas la commission de rédiger deux adresses à Napoléon pour lui demander d'accorder à la Hollande son frère Louis comme chef suprême de la république batave, roi de Hollande. Un traité fut alors conclu (le 24 mai à Paris, et ratifié le 28 à La Haye) pour l'adoption du gouvernement monarchique. Le grand-pensionnaire refusa de ratifier le traité, mais il promit de rester simple particulier à La Haye et d'y vivre tranquille. Il est juste d'ajouter que l'avènement du roi Louis et de la reine Hortense au trône de Hollande fut assez bien accueilli dans tout le pays. Un seul cas d'opposition se présenta. M. Serrurier, ministre français, qui avait remplacé momentanément à La Haye le général Dupont en congé, rendit compte de ce fait, dans une lettre du 14 août, à Talleyrand. Une tentative de révolte eut lieu parmi les matelots de l'un des bâtiments de la flotte, à l'occasion de la prestation de serment au roi. Le marin qui portait la parole au nom de ses camarades fut tué sur place, d'un coup de pistolet, par l'amiral De Winter. Tout rentra à l'instant dans l'ordre, et le serment fut prêté sans résistance.
La royauté fut établie en Hollande, et fondée sur des lois constitutionnelles. Le prince Louis ne fut pas consulté. Il apprit par des rumeurs sans authenticité qu'il était fortement question de lui pour cette nouvelle couronne. Les membres de la députation vinrent enfin le trouver (le 5 juin, après la déclaration faite par l'empereur au Sénat), ils l'informèrent de tout, en l'assurant que la nation serait heureuse de le voir à sa tête. Louis, fort peu désireux de s'expatrier, dépourvu d'ambition, refusa, donnant pour prétexte les droits de l'ancien Stathouder. La députation revint bientôt à la charge, en lui annonçant la mort du Stathouder. «Le prince héréditaire, lui dit-elle, a reçu Fulde en indemnité; vous n'avez donc plus d'objection raisonnable; nous venons, appuyés du suffrage des neuf dixièmes de la nation, vous prier de lier votre sort au nôtre, et de nous empêcher de tomber en d'autres mains.» Napoléon fut plus explicite, il fit entendre à son frère qu'il avait accepté pour lui et que s'il ne l'avait pas consulté, c'est qu'un sujet ne pouvait refuser d'obéir. Le prince réfléchit alors que s'il persévérait dans son refus, il lui arriverait sans doute ce qui était arrivé à Joseph qui, après avoir rejeté l'offre de l'Italie, se trouvait à Naples. Il résolut toutefois de faire une nouvelle tentative et il écrivit à Napoléon que s'il était nécessaire que ses frères s'éloignassent de la France, il lui demandait le gouvernement de Gênes ou du Piémont. Napoléon refusa. Quelques jours après, le prince de Talleyrand, ministre des relations extérieures, vint lire, à Saint-Cloud, à Louis et à Hortense, le traité avec la Hollande et la constitution de ce pays. Le prince eut beau dire qu'il ne pouvait juger sur une simple lecture un projet de cette importance, qu'étranger aux discussions et au travail qui avaient eu lieu, il ignorait si on ne lui faisait pas promettre plus qu'il ne lui serait possible de tenir, il fallut accepter. Louis avait été nommé grand-connétable de France, l'empereur décida que cette dignité lui serait conservée. Louis voulut tirer prétexte de sa santé, du climat de la Hollande, Napoléon répondit qu'il valait mieux mourir sur un trône que vivre prince français. Il n'y avait plus qu'à obéir, c'est ce qu'il fit en assurant qu'il se dévouerait à son nouveau pays avec zèle et qu'il chercherait à justifier, dans l'esprit de la nation, la bonne opinion que l'empereur avait sans doute donnée de lui. Le 5 juin avait été fixé pour la proclamation du nouveau roi. Après un discours de l'amiral Verhuell et une réplique de Napoléon, ce dernier, s'adressant à son frère, lui dit: «Vous, prince, régnez sur ces peuples.... Qu'ils vous doivent des rois qui protègent ses libertés, ses lois, sa religion; mais ne cessez jamais d'être Français. La dignité de connétable de l'empire sera conservée par vous et vos descendants; elle vous retracera les devoirs que vous avez à remplir envers moi, et l'importance que j'attache à la garde des places fortes qui garnissent le nord de mes états et que je vous confie.» Louis répliqua, et dans son discours on put remarquer cette phrase: «Je faisais consister mon bonheur à admirer de plus près toutes les qualités qui vous rendent si cher à ceux qui, comme moi, ont été si souvent témoins de la puissance et du génie de Votre Majesté. Elle permettra donc que j'éprouve des regrets en m'éloignant d'elle, mais ma vie et ma volonté lui appartiennent. J'irai régner en Hollande, puisque ces peuples le désirent et que Votre Majesté l'ordonne.» Dans son message au sénat, à propos du royaume de Hollande, Napoléon termine en disant: «Le prince Louis, n'étant animé d'aucune ambition personnelle, nous a donné une preuve de l'amour qu'il a pour nous, et de son estime pour les peuples de la Hollande, en acceptant un trône qui lui impose de si grandes obligations.»
On voit par ce qui précède que le nouveau souverain avait fait pour refuser la couronne tout ce qu'il était humainement possible; que loin de désirer la haute position qui lui était offerte, il la redoutait; qu'en un mot, il sacrifiait à la politique de son frère sa liberté, son indépendance, ce qui lui restait de bonheur sur la terre. Toutefois, dès qu'il eut accepté, son intention bien arrêtée fut de se consacrer entièrement à sa nouvelle patrie, et de régner pour la Hollande seule; de là vinrent les tiraillements, puis bientôt après les discussions et enfin les rapports quasi-hostiles qui ne tardèrent pas à s'établir entre les deux frères, entre les deux souverains, et qui aboutirent finalement à l'abdication de Louis et à la réunion de la Hollande à la France.
En plaçant sur la tête de Louis la couronne de Hollande, Napoléon entendait faire de lui un roi-préfet; en acceptant cette couronne, Louis voulait être un roi-souverain. La politique de l'empereur jeta toujours du froid entre lui et ceux des membres de sa famille qu'il mit sur les trônes. Cela ne pouvait être autrement. Selon qu'on se place à un point de vue différent, on voit les mêmes choses sous un aspect qui n'est pas le même. Napoléon partait de ce principe, que tout souverain par sa grâce à lui, l'empereur des Français, devenait par le fait même, non seulement son obligé comme homme, comme roi, mais encore qu'il devait contraindre les peuples dont il lui donnait le gouvernement à tout sacrifier à la politique française, même les intérêts les plus chers. C'était partir d'un principe injuste et inapplicable dans la pratique. En supposant qu'un roi sur le trône consente à n'être qu'un préfet couronné, ses peuples n'ayant pas les mêmes motifs pour suivre le sillon tracé par un état voisin, pourront vouloir s'en écarter. De là doit résulter forcément des levains de discorde, soit entre le souverain protecteur et le souverain protégé, soit entre le souverain protégé et les sujets. Voilà pourquoi, à partir du jour où il se mit à fabriquer des rois de famille, Napoléon fut toujours en discussion avec les siens. Un seul des princes qu'il éleva près de lui suivit aveuglément sa politique, le prince Eugène; pourquoi? La raison en est bien simple, c'est qu'Eugène n'était que vice-roi et non roi d'Italie. Le jour où il eût gouverné en son nom, Eugène, malgré son affection profonde, son respect sans bornes pour son père adoptif, n'eût probablement pas consenti à tout ce que voulait l'empereur. Eugène, en restant vice-roi d'un état dont la couronne était sur la tête de Napoléon, remplissait son devoir, sans éprouver aucune répugnance à agir comme il le faisait. Murat à Naples, Joseph en Espagne, Louis en Hollande, Jérôme en Westphalie, n'étaient pas dans la même position. Rois-préfets, ils perdaient leur prestige aux yeux de leurs sujets; rois-souverains, prenant les intérêts de leurs peuples, ils contrariaient souvent les vues de celui qui les avait mis sur le trône, ils excitaient son ressentiment, se faisaient accuser par lui d'ingratitude; puis, comme malgré son affection pour les siens Napoléon n'était pas homme à abandonner, pour quelque considération que ce pût être, ses gigantesques projets, il cherchait bientôt à briser ceux qu'il avait élevés. De là ces lettres acerbes entre lui et ses frères, ces reproches continuels, ces refus de sa part d'accéder à leurs demandes, quelquefois fort justes, et de remplir même les engagements qu'il avait contractés à leur égard. Joseph, en Espagne, avait beau être roi par la grâce de son frère, pouvait-il abandonner les intérêts de l'État dont on lui confiait les rênes, jusqu'à accueillir, comme le voulait l'empereur, la ruine financière d'abord, le démembrement de ses États ensuite? Louis, roi malgré lui de la Hollande, pouvait-il voir sans chagrin le dépérissement du pays dont il avait juré de maintenir les droits, parce qu'il entrait dans le système de la France de sacrifier tous les intérêts commerciaux pour réduire l'Angleterre?
Avec son accession au trône de Hollande, se termine la première partie de l'existence de Louis Bonaparte, période heureuse si on la compare à celles qui la suivirent.