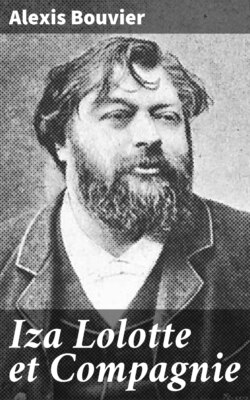Читать книгу Iza Lolotte et Compagnie - Alexis Bouvier - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
SUITE DU PRÉCÉDENT
ОглавлениеTable des matières
Pour justifier le sourire contraint, le front soucieux du cavalier qui venait d’arriver, nous devons en aller chercher les motifs à l’hôtel de la rue de la Loi et faire assister le lecteur à la scène qui s’y est passée depuis le départ de la belle courtisane.
Quelques minutes avant que la Grande Iza descendît de chez elle, un homme, petit, basané, ayant l’aspect d’un Méridional, s’était présenté à l’hôtel, demandant M. Oscar de Verchemont.
Le domestique l’avait accueilli en l’interrogeant:
–N’êtes-vous pas M. Cadenac?
–Si, justement.
–Monsieur vous attend; je vais le prévenir de votre arrivée.
Le domestique était entré quelques secondes dans le cabinet de son maître et en était ressorti disant:
–Monsieur Cadenac, veuillez entrer.
Il fut introduit dans un bureau luxueux; M. Oscar de Verchemont vint au-devant de lui et lui demanda vivement:
–Bonjour, Eusèbe. Eh bien! m’apportez-vous ce que je vous ai demandé?
–Oui, monsieur le comte, oui.
Et comme, en répondant, il le regardait fixement, l’air étonné, M. de Verchemont lui dit:
–Qu’as-tu à me regarder ainsi? Qu’ai-je donc de singulier?
–Oh! il y a bien longtemps que je n’ai vu monsieur le comte.
–Suis-je donc bien changé?
Eusèbe ne répondit que par un mouvement de tête.
–Ah! mon pauvre Eusèbe, tu sais bien des choses. Tu comprends une partie de ma douleur; mais nous n’avons pas le temps de parler longtemps aujourd’hui. Je suis attendu. Renseigne-moi sur les choses les plus importantes que je te demandais, car, ce soir, je dois terminer l’affaire qui me rendra le calme.
–Oh! pauvre monsieur Oscar, fit tout bas le petit bonhomme, regardant en dessous, mais affectueusement, son maître.
–Ainsi, tu as les fonds?
–J’ai les chèques et la plus grande partie des hypothèques, pour lesquels il faut votre signature, mais qu’on pourra toucher ici en quelques jours.
–Très bien. Ainsi le domaine de Lordenac, les près, les bois, les moulins tout enfin, tu as réussi au prix que je t’avais indiqué?
–J’ai dû faire encore une concession.
–Mais il est vendu?
–Oui, monsieur le comte.
–Tous les biens de ma mère!
–C’est signé d’hier, dit lugubrement Eusèbe.
–Vendus!
–Oui, monsieur le comte.–
–Tu me parlais d’hypothèques?
–Je n’ai pas voulu.–se reprenant vivement– je n’ai pas osé traiter pour le château de M. le duc.
–Et pourquoi?
–Monsieur, j’ai vendu tous les biens, toutes vos propriétés de Touraine et d’Anjou, puis celles de Lordenac; j’ai cru devoir réserver le domaine de votre famille. C’est là que vous êtes né, monsieur Oscar, c’est là qu’était née Mme la comtesse votre mère, c’est là qu’était né votre aïeul, M. le duc, c’est là qu’il vivait; c’est là, dans la grande salle, que sont tous les portraits de la famille, les portraits de mes vieux maîtres, depuis monseigneur le Balafré jusqu’à vous, monsieur le comte.
Il pleurait en parlant, le vieil Eusèbe, et Oscar de Verchemont faisait de pénibles efforts pour cacher son émotion.
–J’ai cru, monsieur le comte, que vous auriez trop de chagrin si vous perdiez ce vieux château.
–Enfin! enfin! Pour avoir la somme, qu’as-tu fait? Car tu as la somme entière?
–Oui, monsieur le comte, oui, grâce à Dieu; avec la vente des deux derniers biens qui nous restaient, j’ai fait la plus forte somme; puis j’ai trouvé, pour avoir le reste, un prêt sur hypothèque.
–Sur le vieux château?
–Oui, monsieur le comte.
–Et de combien donc?
–Seize cent mille francs.
–Qu’est-ce que tu me dis là? Le château du duc ne vaut pas cela.
–J’ai trouvé.
–Et les fonds? on les aura? c’est sérieux?
–Oui, monsieur le comte, il ne faut pour cela que votre signature
–Mais c’est, de mes biens, celui que j’estime le plus, mais qui vaut le moins.
–Il fallait ce chiffre pour compléter la somme, et je l’ai trouvé, monsieur le comte, fit Eusèbe embarrassé.
–Enfin c’est fait, fit Verchemont, pressé; je puis donner ma promesse et m’engager. Tu as les trois millions?
–Je les ai, fit Eusèbe avec un soupir.
–Merci, mon vieil Eusèbe, merci! Ma journée est absolument prise. Ce soir, nous avons du monde, et nous ne pourrons causer sérieusement. Demain nous reparlerons de tout cela. Ce soir, je peux donner ma parole? Du moment où je peux agir, c’est pour moi le point capital. Depuis deux jours, je ne vis pas; ton télégramme m’avait rempli d’inquiétude.
–Monsieur le comte, je n’avais qu’une promesse et ne pouvais rien dire.
–Tu as sagement agi. Tu dois être épuisé; va prendre un peu de repos et fais-toi servir ce que tu voudras; ta chambre est préparée depuis deux jours.
–Oh! monsieur, excusez-moi; mais j’ai eu vingt-quatre heures de chemin de fer.
–Allons! au revoir, Eusèbe, à demain; repose-toi; nous causerons.
M. de Verchemont sonna; un domestique vint, et, sur son ordre, il emmena Eusèbe dans la chambre qui lui avait été réservée.
Seul, de Verchemont se laissa tomber sur un fauteuil et fondit en larmes, balbutiant entre ses sanglots:
–Oh! ma jeunesse! Oh! mes souvenirs! Oh! ma pauvre mère! pardon! pardon! je suis si malheureux! je l’aime!.
Il resta ainsi, longtemps, la tête cachée dans ses mains, s’enfonça dans les plus sombres pensées; il ne s’éveilla qu’en entendant frapper à la porte. Alors, se redressant, se secouant et exhalant la conclusion des idées qui tourmentaient son cerveau:
–Ah! baste! La mort finit tout; ce n’est qu’une seconde d’énergie.
Il cria:
–Entrez!
Son valet de chambre parut et lui dit:
–Madame fait prévenir monsieur qu’elle part et elle prie monsieur de la rejoindre immédiatement.
–Eh bien! venez vite, Justin, habillez-moi.
Quelques minutes après, le comte Oscar de Verchemont montait à cheval, se rendant au bois de la Cambre, où nous l’avons vu arriver le front tout soucieux de ce qu’il venait d’apprendre.
Lorsqu’il s’approcha de la belle Iza Lolotte, on s’écarta pour qu’il pût lui tendre la main. La voyant encore sous l’impression qu’elle avait ressentie en voyant Huret dans la foule, il lui demanda:
–Mais, qu’avez-vous, Iza? voussemblez souffrante. Que vous est-il arrivé?
–Mais rien, monsieur, fit-elle se dressant; j’étais impatientée de vous voir arriver si tard. Vous venez quand la course est terminée.
–Ne m’en voulez pas, ma chère belle; je viens seulement d’avoir la réponse pour l’affaire dont je vous ai parlé.
–Ah! fit-elle vivement, est-ce terminé?
–Oui, ce soir je signerai avec la personne que vous savez.
–Descendez de cheval et montez près de nous.
–Non; permettez-moi d’aller jusqu’au pesage, puis nous retournerons à Bruxelles.
–Vous savez que ce soir nous dînons chez Van Ber-Costeinn?
Un des jeunes gens dit alors:
–Verchemont, vous allez boire avec nous à Van Ber-Costeinn; c’est son cheval Nichette qui a gagné.
On lui tendit une coupe, et le toast recommença.
Le comte Oscar de Verchemont semblait embarrassé, gêné, au milieu de ce monde. Il paraissait contraint dans ce milieu. C’est à peine s’il mouilla ses lèvres dans la coupe qu’on lui tendait, et qu’il rendit aussitôt au valet de pied.
Il se tourna vers Iza, lui disant:
–A tout à l’heure.
Et, lançant son cheval au galop, il tourna la piste, se dirigeant vers l’enceinte du pesage.
Depuis quelques mois seulement, le comte Oscar avait quitté la France, pour aller retrouver celle qu’il adorait, et, depuis ce jour, sa vie était bien changée.
Celle qu’il avait connue autrefois si réservée, si mystérieuse, s’était tout à fait transformée. Était-ce pour oublier les tourments qu’elle avait endurés? Était-ce pour ne pas penser à la honte qu’elle avait subie en se voyant expulser de France? Était-ce parce qu’un secret était dans sa vie et qu’elle n’y voulait pas penser?
La Grande Iza menait à Bruxelles une vie tapageuse, scandaleuse, brillante et bruyante, ayant hôtel, chevaux, équipages, allant grand train, gâchant l’argent. Tout Bruxelles parlait des fêtes qu’elle donnait la nuit dans son hôtel de la rue de la Loi; elle vivait rieuse, gaie, à côté du jeune gentilhomme toujours plus sombre, souffrant de tout cet éclat et ne pouvant y résister.
Elle était fidèle à son amant, et, à cause de cela, certains disaient qu’ils s’étaient mariés secrètement. Vivant, sinon honnêtement, fidèlement, elle avait les apparences de la vie la plus dépravée, toujours entourée des femmes les plus connues par les viveurs, obligeant Verchemont à se faire l’ami des gommeuxde haute volée de Bruxelles. On racontait d’elle des folies, des extravagances, des fêtes singulières où les femmes avaient des costumes d’une simplicité toute primitive; vivant au milieu de toutes ces femmes faciles, elle seule restait imprenable, disant bien haut qu’elle n’aimait et n’aimerait qu’un seul homme, le comte Oscar de Verchemont.
Le malheureux avait mangé d’abord les rentes, puis il avait vendu les prés, les fermes, les bois, les terres. Tout cet argent s’engloutissait à mesure, sans rien laisser dans les mains où il passait.
C’est alors que, tout autour d’Iza, on la désignait sous le nom de Iza la Ruine.
C’est le nom que lui donnaient les bourgeois; car, dans son entourage, on l’appelait la Lolotte.
Le comte était visiblement changé; son front plissé, ses yeux éteints, ses lèvres sèches attestaient qu’il était surmené par cette vie sans repos. L’éternel besoin d’argent venait le tourmenter sans cesse; puis peut-être aussi était-il anéanti par les violences amoureuses. de celle qu’il aimait. Il avait vieilli de vingt ans en moins d’une année, le comte Oscar de Verchemont.
Au contraire, la Grande Iza, la belle Lolotte, était dans tout l’éclat de sa beauté. Elle paraissait toujours de vingt à vingt-cinq ans. Ses grands yeux avaient la douceur du velours; leurs grands cils mettaient, par leur ombre, une langueur dans le regard plein de voluptueuses promesses, augmentant le brun des pupilles en rendant plus net le blanc de l’orbe; le nez malin, charmant, était fin, franc de lignes; ses narines, roses, presque diaphanes, se dilataient selon l’impression ressentie; les lèvres, d’un rouge ardent, étaient toujours fraîches, humides, formant par le rire un splendide écrin pour les dents d’une blancheur de nacre; les oreilles, toutes petites, étaient d’une transparence rose; le front était resté pur, superbe, dans l’encadrement de magnifiques cheveux, si noirs qu’ils avaient les reflets bleus des ailes du corbeau.
Oh! c’était bien la même toujours; tracas, tourments, folies, amour, fatigues, rien ne l’avait changée. Elle avait toujours ce charme, cette grâce sauvage, cette allure étrange et distinguée qui la faisaient remarquer entre toutes; ce corps superbe dans sa doucè langueur, –ce corsage robuste et plein de grâce, ces formes fermes et élégantes à la fois rappelaient et les sculptures grecques et les admirables femmes de la Renaissance. Elle eût pu servir de modèle à Praxitèle comme à Jean Goujon.
Sur son visage, l’esprit flottait; l’œil, la bouche’ étaient provocants, et l’éclair de son regard révélait une ardeur que chacun aurait voulu juger.
Nous l’avons dit, elle se flattait bien haut de n’avoir qu’un amour, de Verchemont, et, quand on lui parlait de la santé chancelante de l’ancien magistrat, elle avait un sourire qui semblait dire:
–C’est mon œuvre.
Comme les goules, ses baisers étaient mortels, et elle en était fière.
Pour elle, Verchemont avait tout sacrifié, perdant à Paris sa situation et sa considération, à Bruxelles sa dignité et sa fortune. Il était entraîné, il le sentait et ne pouvait résister; au bout du chemin, c’était l’abîme; il fermait les yeux pour ne pas le voir, et il marchait. C’était la décadence du gentilhomme.
Il était convaincu de l’amour exclusif de sa Lolotte, et assurément il aurait ri et ne se serait pas fâché si on lui avait dit que, certaines nuits, Lolotte, dans un costume étrange et couverte d’un grand manteau, s’en allait courir dans un coin de Saint-Josse-ten-Noode, pour ne rentrer chez elle qu’aux premières lueurs du matin. Oui, il aurait bien ri, car cela n’était pas possible à croire.
La dernière course s’achevait au milieu de l’indifférence générale, la plus importante étant finie. La foule commençait son mouvement de retraite, se dirigeant vers les avenues, afin de voir le défilé du retour; les voitures préparaient leur départ, les domestiques rentraient hâtivement dans les caissons les paniers de Champagne; chacun se replaçait; les jeunes gens remontaient dans leurs phaétons, les femmes s’étendaient sur les coussins de leurs équipages.
Oscar de Verchemont apparut à cheval; il fit signe aux postillons, et la grande calèche à la Daumont dans laquelle était mollement assise la Grande Iza partit en produisant, dans sa marche lente, le même sentiment de curiosité exprimé par ce chuchotement:
––C’est elle, Iza Lolotte, la Grande Iza, celle de la banque Flamande.
Sur un signe de la jolie femme, Oscar arrêta son cheval, remit les guides aux mains d’un valet de pied et vint s’asseoir dans la grande calèche, qui se mêla alors à l’immense défilé des voitures retournant à Bruxelles.
–Eh bien! nous avons terminé? demanda aussitôt Iza à Yerchemont.
–Oui, c’est fini; cette fois encore la banque sera sauvée.
–Il fallait donc beaucoup?
–Plus de deux millions.
–Ah1et vous les avez?
–Je les recevrai demain matin.
–Croyez-vous qu’il n’est pas bien imprudent de remettre encore cette somme à la banque?
–J’ai promis.
–Encore pourriez-vous en distraire une partie pour payer les fournisseurs!
–Ma chère enfant, ne vous occupez pas de cela, cela regarde mon homme d’affaires.
–Mais vous n’allez pas, au moins, laisser tout en l’état dans l’administration de la banque et n’y pas faire les changements que vous avez arrêtés?
–J’agirai selon les avis que vous m’avez donnés; je me suis entendu avec le conseil représentant les actionnaires; tous les employés de la caisse sont changés; le caissier général sera remplacé par la personne que vous m’avez recommandée; dès son arrivée, elle entrera en fonction. Ainsi, nous serons sûrs d’elle, et cela évitera la dernière catastrophe qui pourrait arriver.
–Vous avez reçu, sur elle, les renseignements que je vous avais fait demander?
–Oui, ils sont excellents; c’est un homme rompu aux affaires, d’une parfaite honorabilité, ayant tenu un emploi de ce genre dans une banque qui n’a pas réussi, la banque Franco-Hongroise, et dont la famille habite là-bas. Ce qui m’a fait ne pas hésiter, c’est que, cette personne, étant étrangère, n’ayant aucune connaissance ici, sera à l’abri des entraînements qui, à mesure que j’y entre, m’effrayent davantage chaque jour.
–Et pourquoi cet effroi, mon cher ami? N’êtes-vous pas le maître absolu de votre situation? Vous êtes sans famille.
–Oh! si, fit-il en lui prenant affectueusement une main entre les siennes; j’ai foi en toi, dont l’avenir m’inquiète. Si un malheur m’arrivait!
–Si un malheur vous arrivait, Oscar, je voudrais le partager avec vous, comme vous avez partagé mes peines.
––Merci, fit-il.
Et, comme elle se penchait un peu sur lui, il la pressa, tressaillant à la tiédeur de sa joue.
–Ainsi, lorsqu’il arrivera, vous l’installerez immédiatement dans sa place?
–J’ai fait ainsi que vous m’avez dit, ma chère Iza. Je sais qu’il est un peu de votre famille. M. Carle Zintsky a dans l’administration même–le conseil de surveillance l’a voulu ainsi–son appartement; il est préparé. Fort probablement vous serez avertie la première de son arrivée; faites-moi prévenir, et j’aviserai.
–Merci; vous êtes toujours bon pour moi et les miens.
–Vous avez fait le bonheur de ma vie. Dieu veuille qu’en entrant dans l’administration il y apporte aussi le bonheur et la chance. 1
–C’est un intelligent, sachez-le, et, avant peu, il vous dira la cause du mal.
–Mais ne parlons plus d’affaires. Que faisons-nous ce soir? Ne m’avez-vous pas dit que nous allions chez Van Ber-Costeinn?
–Oui, mais vous devez vous trouver avec ces messieurs au cercle. Vous aurez la bonté de me descendre à l’hôtel en vous y faisant conduire. Vous dînez sans nous, entre, hommes, je crois; vous avez des paris à régler, à causer de la course, je ne sais.
–Que ferez-vous, alors?
–Je dîne à la maison avec deux amies qui doivent venir. Puis ce soir nous irons ensemble à la Monnaie.
–J’irai vous prendre alors à la fin du spectacle pour vous mener chez Van Ber-Costeinn.
–Si vous voulez. Nous pouvons nous retrouver chez Van Ber-Costeinn, puisque vous restez avec ces messieurs, si vous jouez. Faites comme il vous plaira, ne vous gênez pas; si vous n’êtes pas à la sortie du théâtre, j’irai seule.
–Oh! j’y serai.
La Grande Iza ne put réprimer un mouvement d’ennui à cette réponse. Oscar ne le vit point.
Les voitures étaient si nombreuses qu’on devait marcher au pas; mais on arrivait près du parc, et, moins foulés, les postillons reprirent une plus vive allure.
Quelques minutes après, l’équipage s’arrêtait rue de la Loi, et un valet de pied ouvrit la portière.
Oscar descendit, présenta sa main aux deux dames, et, offrant son bras à la Grande Iza, il la conduisit jusqu’au perron, où il lui dit:
–A ce soir, au revoir.
Et, remontant en voiture, il se fit conduire au cercle.
Iza exécuta ponctuellement ce qu’elle avait dit. Le soir, elle se trouvait dans une loge à la Monnaie; mais, un peu avant la fin de la représentation, prétextant qu’elle avait oublié quelque bibelot à l’hôtel, elle quitta le théâtre, prit une voiture sur la place et se fit conduire à Saint-Josse-ten-Noode.
La vigilante s’arrêta devant un petit hôtel garni; Iza y entra. Au bruit de la voiture, un homme était accouru, qui vint lui prendre la main et la fit monter au premier étage, où elle entra dans une chambre de modeste apparence.
–Enfin, te voilà! lui dit-il, assieds-toi; je sais que tu as du nouveau; j’ai vu Norock.
–Ah! tu l’as vu? Tu sais alors qu’il a rapporté les papiers de Léa et, Dieu merci! le coffre.
–Je le sais. Oh! j’avais confiance en lui, il est très adroit. Maintenant, autre chose; mets-toi à ton aise, retire ton manteau.
–Non, non. Je n’ai pas le temps.
Et, entr’ouvrant son manteau:
–Tu vois, je suis en toilette de soirée. J’ai quitté le théâtre plus tôt pour qu’il ne vînt pas me rejoindre. Il faut que je parte aussitôt; nous passons la nuit chez Van Ber-Costeinn, à côté du jardin Botanique. Écoute-moi.
–Qu’y a-t-il?
Elle lui prit les mains, l’attira vers elle, l’embrassa chaudement sur les lèvres et dit:
–Aujourd’hui, à compter de demain, nous allons commencer. Fais bien attention; combine bien, agis avec calme, je suis prête à tout. Il faut qu’avant trois mois nous en ayons fini.
–Ah! c’est fait?
–Oui, je vais lui dire qu’un télégramme m’annonce ton arrivée. Tu es en route depuis deux jours; tu seras à Bruxelles demain dans la journée. Pars ce soir pour le Luxembourg; là-bas, tu revêtiras ton costume, et demain tu reviendras, afin d’arriver dans la journée à l’hôtel. Là, je te présenterai; tu resteras au siège même de la banque; tu as un appartement, mais j’en ai les clefs. Tu seras immédiatement installé. Les fonds que l’on reçoit demain, et avec lesquels vont être payés les coupons, suivant la combinaison que tu m’as censé envoyée de là-bas, et qui t’a placé en si haute estime auprès de ces messieurs, vont relever la banque. La publicité va être vivement poussée, l’argent étant en caisse. L’émission va être lancée, les versements se feront, et, avant deux mois, l’affaire sera faite. Alors, mon Carle, alors, nous partirons tous les deux; nous serons vraiment, toi, le prince, et moi la princesse de Zintsky.
–Mais lui?:
–Il sera mort!
–Oh! non, point d’assassinat, point de crime! évitons cela.
–Grand niais, va! Il sera mort, et c’est lui qui se tuera. Allons, je m’en vais bien vite. Adieu! adieu!
Elle l’embrassa sur les lèvres; puis, dégrafant son manteau, se cambrant en arrière pour découvrir sa gorge décolletée par sa robe de soirée, le regard brûlant, elle s’abandonna toute frissonnante en lui disant:
–Embrasse-moi le cœur.
Le grand et brun garçon appliqua sur son sein sa lèvre rouge, la tenant dans ses bras, appuyant son visage sur sa gorge.
A chaque caresse des lèvres, la Grande Iza tressaillait, vibrant comme sous un choc électrique. Puis, jetant des notes de son rire clair, elle se dégagea vivement de l’étreinte, se secouant en disant:
–Laisse-moi, laisse-moi, tu me rendrais folle. Adieu, Carle, à demain!
Alors, s’enveloppant dans son manteau, cachant son visage, avant que l’homme eût eu le temps de prendre la bougie pour l’éclairer, elle descendit rapidement l’étage, monta en voiture et dit au cocher:
–Au jardin Botanique!
Moins d’un quart d’heure après, la vigilante s’arrêtait sur l’allée, devant le jardin Botanique. Iza paya le cocher et remonta vers la demeure de Van Ber-Costeinn.
C’était un charmant petit hôtel, d’apparence assez simple, à l’extérieur discret, bien clos par ses persiennes, bien voilé par les stores et les doubles rideaux.
A cette heure, n’était la porte grande ouverte, jetant au dehors un flot de lumière, deux ou trois domestiques attendant les invités à l’entrée, le vestibule splendidement éclairé jusqu’au bas du grand escalier, la maison semblait endormie extérieurement.
Iza était connue des gens, car, aussitôt qu’elle se présenta, les valets se précipitèrent; la double porte vitrée s’ouvrit.
A son arrivée au pied de l’escalier, un valet prit son manteau. Tout en arrangeant sa coiffure du bout de ses doigts, tapotant sur sa robe pour bouffer les plis de la jupe, elle demanda du ton famillier d’une habituée de la maison:
–M. de Verchemo.nt est-il arrivé?
Le valet s’inclina en répondant:
–Oui, madame, il monte à l’instant.
Elle gravit aussitôt les marches. Arrivée au premier, les portes s’ouvrirent devant elle.
On entendait des bruits de voix, des rires.