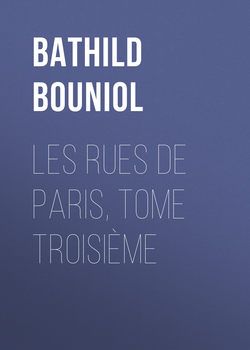Читать книгу Les Rues de Paris, tome troisième - Bouniol Bathild - Страница 3
LES RUES DE PARIS
EUSTACHE LESUEUR
ou Le Sueur
I
Оглавление«Soyez sûr qu'un peintre se montre dans son ouvrage autant et plus qu'un littérateur dans le sien» disait à ses élèves David, qui ne faisait que répéter ce qu'avait écrit Diderot. C'est là une vérité (quoiqu'on puisse et doive admettre des exceptions) qui ne saurait mieux s'appliquer qu'à notre Lesueur par ce que nous savons de sa vie, encore que sur celle-ci on souhaiterait plus de détails, de ces détails intimes qui révèlent l'homme et que, pour les obtenir, nous n'ayons cependant plaint aucune fatigue, négligé nulle recherche. Il s'en faut peu que nous ayons lu tout ce qui a été écrit et publié depuis deux siècles sur Lesueur et qui formerait bien des volumes, mais sans pouvoir connaître autrement que dans ses grandes lignes la vie du grand artiste, «cette vie si courte et si remplie, dit un écrivain contemporain, et qui est presque un mystère.»
Eustache Lesueur était né à Paris, rue de la Grande-Truanderie, le 18 ou 19 novembre 1616, 1617 et même 1619 suivant d'autres. Il eut pour père Cathelin Lesueur, d'une famille plébéïenne, originaire de Montdidier, pour mère Élisabeth Torroude. Quoique simple tourneur en bois et non sculpteur, comme l'ont dit des biographes, Cathelin Lesueur, appréciant de bonne heure les dispositions remarquables de son fils pour le dessin, le fit entrer dans l'atelier de Simon Vouet, premier peintre du roi, où il se rencontra avec Ch. Lebrun, son futur rival. «Il commença à peindre sous M. Vouet, (dit Guillet de Saint-Georges, le premier en date comme biographe et dont le témoignage est d'autant plus précieux) et en retint quelque temps la manière, mais ensuite il la changea avantageusement, et étant secouru de nouvelles études, de la force de son génie et de ses dispositions naturelles, il peignit enfin d'une correction et d'une grâce qui l'ont fait entièrement admirer1.»
Mais ce qui fut plus précieux à Lesueur que les conseils de Vouet, ce furent ceux du Poussin à qui il avait été présenté ou se présenta, lors du séjour en France de l'illustre artiste; et, dit-on, celui-ci garda si bon souvenir du jeune homme que, retourné en Italie, il prenait la peine de dessiner à son intention les plus belles statues antiques et lui envoyait ces études, trésor inappréciable aujourd'hui supposé qu'on pût le retrouver. Le procédé d'ailleurs n'a rien qui puisse surprendre de la part de Poussin; et il faut louer M. Vitet d'avoir maintenu, contre M. Dussieux2, dans sa nouvelle édition de l'étude sur Lesueur3, cette tradition ancienne des relations de maître à disciple entre Poussin et Lesueur, car, à défaut de preuves matérielles, elle a pour elle non pas seulement la vraisemblance, mais une sorte de certitude morale. Lesueur, en outre, s'aidait de tous les renseignements qui pouvaient servir à l'éclairer et le mettre dans la voie la meilleure, au point de vue de l'art: «Son goût, écrit Ch. Perrault, lui avait fait prendre, dans l'étude des figures et des bas-reliefs antiques, ce qu'ils ont de grand, de noble et de majestueux, sans en imiter ce qu'ils peuvent avoir de sec, de dur et d'immobile, et lui faisait tirer des ouvrages modernes ce qu'ils ont de gracieux, de naturel, d'aisé, sans tomber dans le faible et le mesquin.»
D'après un biographe, une circonstance particulière acheva de lui ouvrir les yeux et lui fut comme une sorte d'illumination: «La Couronne possédait quelques-uns de ces tableaux-diamants d'où jaillit le feu créateur, trésors trop cachés alors, peut-être aujourd'hui trop montrés aux regards; Raphaël apparaît enfin à Lesueur. La poésie du peintre d'Urbin fit sur ses organes délicats la même impression que l'harmonie de Malherbe sur ceux de la Fontaine: l'artiste s'éveilla complètement. Il comprit que l'imitation des formes et des couleurs doit avoir pour but celle du mouvement et du sentiment; la peinture ne lui sembla un art que lorsqu'elle est l'image poétique et l'expression accentuée de la vie. De ce moment, il fut peintre de l'âme plus que de la matière, c'est-à-dire que la représentation matérielle ne fut pour lui qu'un moyen de peindre les passions4.»
Combien Lesueur n'enviait-il pas l'heureux sort de son camarade Lebrun qui, grâce à la générosité du chancelier Seguier, prodigue pour lui de ses bienfaits et lui ouvrant si largement sa bourse, avait pu suivre Poussin en Italie. Pourtant ce fut peut-être pour notre artiste un bonheur de n'avoir pu réaliser ce rêve et quitter la France. Qui sait s'il ne dut pas à ce contretemps, cause pour lui de si vifs regrets, de rester lui-même et de ne pas exposer son talent à perdre quelque chose de sa sincérité, de sa candeur, de son originalité? M. Vitet est de cet avis et il le dit en meilleurs termes que nous: «Il ne savait pas que c'était sa bonne étoile qui le retenait loin de cette Italie si belle et si dangereuse. Sans doute il perdit l'occasion de fortes et savantes études; mais que de piéges, que de contagieux exemples n'évita-t-il pas! Aurait-il su, comme le Poussin en fut capable, résister aux séductions du présent pour ne lier commerce qu'avec l'austère pureté du passé? Son âme tendre était-elle trempée pour cette lutte persévérante, pour cet effort solitaire? N'aurait-il pas cédé? Et alors que seraient devenues cette candeur, cette virginité de talent, qui font sa gloire et la nôtre, et qui, par un privilége unique, lui ont fait retrouver dans un âge de décadence quelques-unes de ces inspirations simples et naïves qui n'appartiennent qu'aux plus beaux temps de l'art.»
Doué d'une âme tendre, porté même à la mélancolie, d'ailleurs profondément chrétien et honnête, Lesueur, presque à ses débuts encore comme artiste et nullement connu, se prit d'affection pour la sœur d'un camarade d'atelier, ou comme dit un écrivain du temps: «Quel-qu'un qui faisait de la peinture chez Lesueur.» Geneviève Goussé était fille d'un marchand épicier-cirier de la place Maubert, un notable bourgeois, mais, à cause de son fils sans doute, n'ayant nulle prévention contre les artistes. Il donna sans difficulté à Lesueur la main de la jeune personne (1644); la dot dut être assez mince, car nous voyons que les embarras de sa position et les exigences du ménage entravèrent momentanément l'essor du peintre par la nécessité de s'occuper de travaux d'un produit immédiat et certain. C'est ainsi qu'il dessina et grava des frontispices pour des thèses de théologie, qu'il peignit des médaillons pour des religieuses, des portraits de saints, etc. Heureusement, Vouet, alors surchargé de commandes, eut besoin de son aide et lui confia des travaux plus sérieux, notamment une Assomption pour une communauté. Vers la même époque, Lesueur peignit pour le cardinal de Richelieu, dans l'hôtel Bouillon, rue Platrière, huit sujets tirés du poème bizarre du Songe de Poliphile; la manière dont il exécuta ces tableaux, destinés à servir de modèles de tapisseries, commença à le faire connaître, mais bien plus encore le Saint Paul guérissant les malades par l'imposition des mains, une toile remarquable et qui ne trahissait plus en rien l'élève de Vouet.
Il fit ensuite divers autres tableaux et enfin s'occupa de la décoration du Cloître des Chartreux qui lui avait été commandée par le prieur et suivant d'autres par Anne d'Autriche «la sérényssime reyne qui était si légitimement prévenue du mérite de M. Lesueur,» dit Guillet de Saint-Georges. Il n'y a donc rien de fondé dans cette imagination, chère même à des biographes sérieux, et dont la Nouvelle Biographie de Didot, par exemple, se faisait tout récemment l'écho après l'Encyclopédie des gens du monde, qui l'avait empruntée à la Galerie Française: «Au dix-septième siècle, on récompensait les savants et les artistes par des emplois; Lesueur fut nommé inspecteur des recettes à la barrière de l'Ourcine. Dans l'exercice de cet emploi, il eut une discussion avec un gentilhomme qui ne voulait pas se soumettre aux exigences légales. Un duel s'ensuivit et fut vidé sous les murs des Chartreux du Luxembourg. Lesueur, ayant tué son adversaire, se réfugia dans le couvent et attendit que sa famille calmât celle de la victime. Ce fut là que, pour occuper ses loisirs et récompenser l'hospitalité des frères, il peignit cette belle série de tableaux de la Vie de saint Bruno.»
M. Vitet répond péremptoirement à M. Miel qui, le premier5, avait raconté cette anecdote: «C'est là un fait dont avant lui personne n'avait dit un mot, et comme il n'indique aucune preuve à l'appui de son allégation, comme nous savons au contraire par d'infaillibles indices que Lesueur, à l'époque où il le gratifie de cet emploi de commis, était entièrement absorbé par l'étude de son art, on doit tenir pour aussi peu sérieux l'emploi d'inspecteur des octrois que le fait d'armes de la barrière de l'Ourcine. Qu'on fasse bon marché de semblables sornettes, qu'on en démontre le ridicule, rien de mieux. Il ne faut pour cela ni documents nouveaux, ni preuves inédites: le simple bon sens suffit; et c'est sans aucun secours, sans autorité que nous-même, il y a plus de vingt ans, nous en avons fait justice.» Et en effet, quoi de plus ridiculement inventé que ce duel fantastique qui nous montre le sage et religieux Lesueur transformé en ferrailleur émérite et couchant, du premier coup, sur le pré son adversaire?
D'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit, les tableaux de la Vie de saint Bruno, ayant été tout probablement commandés par la reine, il n'y a pas plus de vérité, quoique plus de vraisemblance, dans l'autre version qui assigne pour cause à la retraite de Lesueur chez les Chartreux le chagrin profond qu'il ressentit de la mort de sa femme. Or, quand il commença son travail (1645), marié depuis une année à peine, il venait d'être père de son premier enfant qui ne devait pas être le dernier. La Galerie des chartreux, exécutée en trois ans, fut terminée en 1648 ou 1649; mais Lesueur, pour répondre à l'impatience des bons pères, pressés de jouir de leur cloître, avait dû se faire aider par son beau-frère, Thomas Goussé, et par ses frères, Pierre, Philippe et Antoine, qui peignirent, d'après ses dessins et compositions, plusieurs panneaux ou parties de panneaux. Cette collaboration, forcée en quelque sorte, explique l'infériorité de certains morceaux, et elle eut aussi l'inconvénient d'enlever à l'artiste une partie du prix convenu, qui fut plus que modeste; on le comprend, même alors que la reine en eût fait les frais, l'état des finances ne lui permettant guère d'être généreuse. Pour les vingt-deux tableaux, à ce qu'on assure, l'artiste ne reçut pas plus que tel peintre médiocre d'Italie pour un seul tableau commandé par des religieux de Bologne.
À cette époque (1649), fut créée l'Académie royale de peinture dont Lesueur fut un des douze premiers membres. Cette même année, chargé par la Confrérie des orfèvres de Paris de peindre le tableau de Mai à Notre-Dame, il fit le Saint Paul prêchant à Éphèse, une œuvre magistrale, remarquable par la composition, l'animation des figures et la richesse du coloris. Ce chef-d'œuvre lui fut payé 400 livres, je dis, 400 livres.
L'artiste exécuta, en 1650 et 1651, pour le monastère de Marmoutiers et d'autres communautés, divers tableaux dont ceux qui nous restent sont empreints, en outre du mérite artistique, de ce caractère profondément religieux, qui, par la sublimité de l'expression, ne laisse rien à envier aux vieux maîtres de l'Ombrie. C'est que comme eux Lesueur n'était pas seulement un peintre, mais un chrétien fervent, et qu'il ne faisait que traduire sur la toile les sentiments dont son cœur était rempli. «Pour faire pareille peinture il ne faut pas être sceptique», a dit M. Ch. Blanc qui n'est pas suspect. Quoi de plus admirable, de plus émouvant, par exemple, que le beau tableau des Martyrs saint Gervais et saint Protais, entraînés pour sacrifier aux idoles, et peint pour l'église Saint-Gervais?
1
Notice sur Lesueur, lue à l'Académie, le 5 avril 1690, l'année de la mort de Lebrun.
2
Archives de l'Art français, t. III.
3
Études sur l'Art, t. III.
4
Miel. Encyclopédie des gens du monde.
5
Galerie française, 1821.