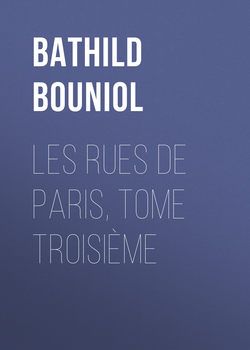Читать книгу Les Rues de Paris, tome troisième - Bouniol Bathild - Страница 6
LES RUES DE PARIS
MICHEL-ANGE ET TITIEN
I
Оглавление«Oui, Monsieur, que l'ignorance rabaisse tant qu'elle voudra l'éloquence et la poésie, et traite les habiles écrivains de gens inutiles dans les états: nous ne craindrons point de le dire à l'avantage des lettres, du moment que des esprits sublimes, passant de bien loin les bornes communes, se distinguent, s'immortalisent par des chefs-d'œuvre, comme ceux de Monsieur votre frère (Pierre Corneille), quelque étrange inégalité que, durant leur vie, la fortune mette entre eux et les plus grands héros, après leur mort cette différence cesse. La postérité qui se plaît, qui s'instruit dans les ouvrages qu'ils lui ont laissés, ne fait point difficulté de les égaler à tout ce qu'il y a de plus considérable parmi les hommes, fait marcher de pair l'excellent poète et le grand capitaine. Le même siècle qui se glorifie aujourd'hui d'avoir produit Auguste, ne se glorifie guère moins d'avoir produit Horace et Virgile. Ainsi lorsque, dans les âges suivants, on parlera avec étonnement des victoires prodigieuses et de toutes les grandes choses qui rendront notre siècle l'admiration de tous les siècles à venir, Corneille prendra sa place parmi toutes merveilles10.»
Ce que Racine disait des poètes à propos de Corneille, ne peut-on pas, ne doit-on pas le dire, des grands artistes, de ceux-là surtout qu'on nomme des maîtres et dont les chefs-d'œuvre, sujet d'éternelle admiration pour la postérité, nous ravissent non pas seulement par les merveilles de l'exécution, mais par la grandeur de la conception, la majesté du sujet, la noblesse et la sublimité des pensées! Michel-Ange et Titien, pour le plus grand nombre de leurs œuvres, et, sauf quelques réserves que nous indiquerons avec sincérité, méritent entre tous cette louange et sont au rang des plus illustres.
La vie du Titien (Tiziano-Vecelli) né à Cador, dans le Frioul, en 1477, offre peu d'évènements; elle est surtout dans ses œuvres. On raconte que, tout enfant encore, sa vocation se révéla par une figure de la Vierge qu'il peignit sur une muraille, avec du jus d'herbes, à défaut de couleurs. Son père le surprit au milieu de ce travail dont l'exécution l'étonna et dit à l'enfant:
– Voudrais-tu donc être peintre par hasard? Il n'est pas besoin de dire la réponse du bambin, envoyé, dès l'âge de dix ans, à Venise où demeurait un de ses oncles qui le plaça d'abord chez Gentil Bellin, et ensuite chez Jean Bellin, plus célèbre que son frère. Titien étudia assez longtemps dans l'atelier de ce maître. Mais un jour, ayant vu certains tableaux de Giorgione remarquables par la liberté de la touche et surtout la magie du coloris, il voulut connaître cet artiste et se mit sous sa direction. Dès l'âge de dix-huit ans, Titien était devenu si habile que le Giorgione, craignant en lui un rival, par suite des préférences marquées d'un amateur, prit de l'ombrage, et ils durent se séparer.
Un Jugement de Salomon, peint à Vicence, et plusieurs tableaux exécutés pour l'église de Padoue, commencèrent à faire connaître Titien; aussi le Sénat, lors de son retour à Venise, n'hésita pas à lui confier l'achèvement, dans la grande salle du conseil, du travail commencé par Jean Bellin qui venait de mourir. Titien s'acquitta de cette tâche difficile avec un tel succès que le Sénat, outre le prix convenu, «lui donna, dit d'Argenville, un office de trois cents écus de revenu.»
Bientôt après, il fut appelé à Ferrare par le duc pour y terminer également les peintures commencées par Jean Bellin dans le palais, et le prince, prompt à apprécier son talent, lui fit faire, en outre, son portrait, celui de la duchesse sa femme, et d'autres tableaux. À la cour de Ferrare, Titien connut plusieurs personnages célèbres de l'Italie, entre autres l'Arioste, qui composa, à la louange du jeune peintre, des vers répétés bientôt par tous les échos de la Péninsule et dont Titien voulut le remercier en faisant son portrait.
Être peint par cette main déjà merveilleusement habile, c'était un honneur et un bonheur dont les souverains mêmes se montraient jaloux; successivement Titien fit les portraits du pape Paul III, pendant son séjour à Ferrare, du duc et de la duchesse d'Urbin, de François 1er, à son retour en France, de Soliman II empereur des Turcs; plus tard, ceux de l'empereur Charles Quint, en 1530, et de beaucoup de princes, cardinaux, seigneurs. Le portrait ne lui faisait pas négliger la partie la plus élevée de l'art. Il exécuta alors, entre autres grandes compositions, son fameux tableau de saint Pierre martyr, pour l'église Saint-Jean Saint-Paul des Dominicains. Après la mort du Giorgione, son ancien ami, il fut chargé de terminer plusieurs de ses tableaux, et l'on n'eut pas à le regretter: «Le Titien, dit d'Argenville, avait plus de finesse que ce peintre, et une plus grande recherche dans tous les accompagnements de ses ouvrages. Ses portraits sont inimitables… On pouvait regarder ses tableaux de près comme de loin. Son grand travail était caché par quelques touches hardies qu'il répandait partout ce qui trompe ceux qui veulent copier ses tableaux. Enfin, il ne travaillait que pour dissimuler les efforts du travail.»
Titien avait dans le caractère de la grandeur et de la générosité. Il se trouvait non loin de Parme, lorsqu'il apprit qu'il était question, pour je ne sais quels projets imaginés par certains architectes d'accord avec d'autres ignorants, de détruire la coupole peinte à l'intérieur par le Corrége. À cette nouvelle, plein d'indignation, il accourt, et par l'autorité de son talent et de sa position, empêche cet acte inouï de vandalisme en conservant à la postérité ce chef-d'œuvre que le temps par malheur n'a pas assez respecté.
Lors du séjour de Titien à Rome en 1543, Paul III, dont il fit de nouveau le portrait, voulut qu'il logeât au Belvédère; le pape fut très-satisfait de ce portrait, mais bien plus encore d'un Ecce Homo, et ne pouvant se lasser de le contempler, il le fit placer dans la chambre où il se tenait habituellement. Dans son admiration pour l'artiste, l'illustre Mécène eut la pensée d'élever son fils Pomponio à quelque haute dignité ecclésiastique, mais Titien s'y refusa:
«Non, très Saint-Père, je ne crois pas que telle soit la vocation de mon fils; et sa vertu ne serait point à la hauteur de ces graves fonctions.»
L'artiste refusa pareillement pour lui-même d'autres faveurs, préférant retourner à Venise au milieu de ses amis. À quelque temps de là, il reçut, dans son atelier, la visite de Henri III, nommé roi de Pologne, qui lui demanda le prix de tableaux qu'il avait fort admirés.
– Sire, ils sont à vous! dit l'artiste, veuillez les accepter comme un petit présent du peintre.
Le roi remercia et fit emporter les toiles, mais, comme on le pense bien, sut dédommager l'artiste.
Titien, auquel son talent avait donné tout à la fois la gloire et la fortune, ne cessa de travailler même lorsque l'âge semblait lui conseiller le repos. On rapporte que, soit que sa vue ou son intelligence eut faibli, à cette époque, il eut la malheureuse idée de retoucher plusieurs tableaux de son meilleur temps et qu'il jugeait, bien à tort, peu dignes de son génie. Quelques-uns en souffrirent; par bonheur, ses élèves, avertis par cette expérience, mêlèrent aux couleurs de l'huile d'olive qui ne sèche point. Puis, le maître sorti, ils effaçaient avec une éponge toute trace du nouveau et malencontreux travail.
Titien, qui pendant de longues années avait eu ce rare bonheur d'une santé presque parfaite, avait atteint l'âge de 99 ans lorsque la peste éclata à Venise, et il fut une des victimes. Quoique, à cause du fléau qui sévissait cruellement, on eût interdit toutes les cérémonies funèbres, le Sénat ordonna qu'il serait fait une exception pour l'illustre artiste, honoré de magnifiques funérailles dans l'église Dei Frari (1575).
«Le Titien n'a été étranger à aucun genre: son talent varié les embrassa tous, et il brilla tour à tour dans les sujets sacrés, profanes, mythologiques et champêtres. Sévère dans le choix des figures, il ne le fut pas moins pour les détails; dans ses compositions rien n'est inutile et tout paraît nécessaire. On n'oserait supprimer les moindres accessoires sans craindre de détruire l'harmonie de l'ensemble. Peintre inimitable de la nature, il a excellé surtout à exprimer les nuances les plus délicates, les sentiments les plus opposés. C'est le même pinceau qui a imprimé l'horreur de la mort sur le visage de saint Pierre martyr, la résignation sur le front du Sauveur, la pudeur dans la Vierge, la honte dans Caliste, l'innocence dans les anges, la volupté dans Vénus, la douleur dans Marie, l'ivresse dans les bacchanales. Il ne se bornait pas à bien saisir le caractère d'une passion; il la nuançait de plusieurs manières en marquant, pour ainsi dire, les degrés de souffrance de chacun des principaux acteurs. Dans la Déposition du Christ au tombeau, par exemple, tout le monde est frappé de douleur; mais l'on voit la Vierge souffrir plus que la Madeleine et saint Jean, qui sont à leur tour plus accablés que Joseph et Nicodème.»
Ce jugement, porté sur le Titien par un critique distingué11 qui n'est que l'écho de beaucoup d'autres, ne saurait être adopté sans restriction, et malgré notre admiration enthousiaste pour le génie du grand artiste, au premier rang dans l'École Vénitienne, nous oserons dire qu'il y a peut-être ici exagération dans la louange. Le talent du Titien n'est point aussi complet et surtout aussi constamment égal que l'affirme le critique. La composition chez lui parfois se sent de la hâte du travail, et n'en déplaise au panégyriste, on pourrait ajouter ou retrancher sans inconvénient. Si les expressions parfois sont heureuses, sont admirables, d'autres fois aussi elles semblent banales, et certains personnages, venus au hasard du pinceau, ne sont guère que des comparses et n'ont point été assurément étudiés d'après nature. Le relief laisse peu à désirer de même que le modelé pour lequel Titien, si merveilleux dans la fonte des couleurs et le maniement du pinceau, se montre souvent incomparable. Le dessin parfois pourrait être plus sévère encore qu'on doive trouver exorbitante cette parole prêtée peut-être à Michel-Ange à la vue de la Danaé:
– Quel dommage qu'à Venise on n'apprenne pas à bien dessiner! Si le Titien était secondé par l'art comme il a été favorisé par la nature, personne au monde ne ferait si vite ni mieux.
Ce jugement excessif est d'un homme de parti pris qui ne voyait l'art qu'à un point de vue restreint sinon personnel. Le fait est que Titien, auquel on peut reprocher des négligences, des lacunes, par suite de la rapidité du travail, n'est pas, tant s'en faut, un médiocre dessinateur. Il a, quand son pinceau se surveille, la suprême élégance des formes, la pureté de la ligne, la grâce et la vérité des attitudes, la morbidesse des chairs, la finesse et la délicatesse extrême du modelé unies à une fermeté de contours et à une franchise de tons qu'on trouverait difficilement ailleurs. Il jette magnifiquement ses draperies témoin sa descente au Tombeau, pour moi son chef-d'œuvre parmi les tableaux du maître que nous possédons au Louvre. La composition est superbe, unissant grandeur et simplicité. Quelle noblesse dans les personnages, le saint Jean, la Madeleine, le saint Pierre, dont les figures pathétiques nous remuent si profondément, nous saisissent si fortement que l'émotion ne permet pas de s'apercevoir que la tête du Christ, perdue dans l'ombre, est la moins belle de toutes et ne rayonne point de ce grand et divin caractère qui devrait la transfigurer. Ce n'est pas impunément, quoiqu'on ait dit, que, par une erreur qui fut trop celle de son temps et d'autres temps, Titien traita, tour à tour et souvent à la fois, des sujets divers et opposés, sacrés et profanes.
Il ne me paraît pas du tout prouvé d'ailleurs qu'en général l'artiste réussît aussi bien les sujets tirés des Évangiles ou de l'Ancien Testament que ceux empruntés à la mythologie, j'entends au point de vue des expressions et de l'impression produite par le tableau. Que l'on compare par exemple, au Louvre, sa sainte Famille avec la Nymphe et le Satyre, et l'on verra combien celui-ci l'emporte sous le rapport de l'art, j'entends d'un art qui brille surtout par la perfection extérieure. Mais où peut-être Titien est supérieur encore, du moins pour les toiles que nous possédons au Louvre, c'est dans ses portraits qui le disputent aux plus admirables toiles de Van Dyck même, par la noblesse, la fierté des attitudes, le relief puissant, le modelé merveilleux, et surpassent peut-être le peintre de Charles Ier pour la solidité des tons. Aussi je suis tout à fait de l'avis de M. des Angelis quand il dit: «C'est beaucoup sans doute de retracer fidèlement la physionomie d'un homme; mais c'est bien un autre mérite de laisser sur ses traits l'empreinte ineffaçable de ses vertus et de ses vices. À toutes ces qualités plus que suffisantes pour constituer le grand peintre, Titien réunit celle d'être le premier coloriste de l'Italie. C'est en vain qu'on a examiné, qu'on a sacrifié même quelques-uns de ses tableaux pour surprendre son secret; il demeure caché sous l'éclat des couleurs et l'œil le plus exercé se flatterait en vain de suivre les traces d'un pinceau dont on ne peut assez admirer les prodiges.»
On comprend, en contemplant tel de ces chefs-d'œuvre, l'admiration des contemporains et en particulier de l'empereur Charles-Quint pour le grand artiste. En vérité je me sens de l'estime et presque de la sympathie pour cet illustre ambitieux, l'opiniâtre ennemi de la France, mais qui, glorieux Mécène, savait si magnifiquement honorer, récompenser le génie. On sait que, non content de prodiguer au Titien l'or et les pensions, en public, à la promenade, à cheval, il lui cédait toujours la droite, et comme certains courtisans paraissaient s'en étonner, il leur dit:
– Je puis bien créer un duc; mais où trouverai-je un second Titien?
Et un autre jour, l'artiste, grimpé sur son échelle, ayant laissé échapper son pinceau, le prince le ramassa et le lui rendit en disant:
– Titien mérite d'être servi par un Empereur.
D'Argenville, selon son habitude, dans son étude sur Titien mêle à sa prose quelques rimes, je n'ose dire, de la poésie en l'honneur du maître. Or, la pièce se termine par ces deux vers:
Heureux si son pinceau plus sage
N'eût blessé la pudeur par trop de liberté.
Et ce reproche qui fait honneur à la sincérité de d'Argenville, Titien l'a mérité. Pendant son séjour à la cour de Ferrare, l'artiste, connut, avec l'Arioste, le trop fameux Arétin dont le nom seul est une injure, et pour lequel déjà, Jules Romain, entraîné à illustrer, je ne sais quel poème immonde, avait souillé ses crayons. Sa liaison, quoique passagère avec ce détestable génie, fut-elle aussi fatale au Vénitien, en poussant son pinceau à de fâcheux écarts? Ou Titien, par une illusion, qui alors comme aujourd'hui trompa trop d'artistes, crut-il, par l'habitude de vivre dans un certain milieu, que les témérités du pinceau s'emportant jusqu'à la licence, n'étaient que l'exercice légitime de la liberté de l'art? Je ne saurais le dire, mais ce qui n'est pas douteux, c'est que dans son œuvre, à côté de tant de pages de l'ordre le plus élevé, s'en trouvent d'autres d'une inspiration bien différente, toute païenne, et qu'un peintre d'Athènes ou de Corinthe, au temps où fleurissait le culte de Venus d'Amathonte, n'eut pas désavouées! Fussent-elles de cette époque de la vie de l'artiste qu'un moraliste a appelées «la fièvre de la raison», il ne faut pas songer à les excuser, et lui-même sans doute, dans le recueillement des dernières années, les aura regrettées.
10
Jean Racine. —Discours prononcé à l'Académie française pour la réception de MM. Thomas Corneille et Bergeret.
11
Taillasson, Observations sur quelques grands peintres, 1807.