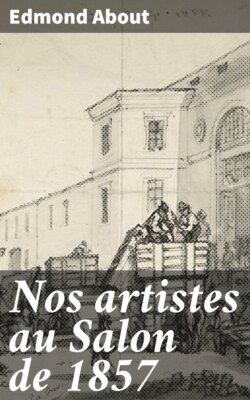Читать книгу Nos artistes au Salon de 1857 - Edmond About - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеTable des matières
M. Delacroix. — M. Ingres.
Romains, et vous, sénat, assis pour m’écouter....
Je supplie, avant tout, les dieux de m’assister.
Il serait impie de parler des artistes admis au Salon sans dire quelques mots sur M. Ingres et M. Delacroix. Ces deux maîtres du dessin président même aux expositions où ils n’assistent pas; ils exercent une telle influence sur l’art de notre temps, qu’on les retrouve invisibles et présents dans toutes les réunions d’artistes. Partout où trois peintres sont assemblés au nom du beau, M. Ingres et M. Delacroix ont place au milieu d’eux.
Poussin disait, en parlant de Raphaël: «Si vous le comparez aux modernes, c’est un aigle; si vous le comparez aux Grecs, ce n’est qu’un passereau.» M. Ingres et M. Delacroix sont des aigles dans l’école contemporaine. Lorsqu’ils auront leur place au Louvre, et que nous les comparerons aux maîtres du XVIe siècle, les critiques qui éplucheront leurs chefs-d’œuvre trouveront çà et là, chez l’un comme chez l’autre, la plume du passereau. Ils sont grands tous les deux, mais ils ne sont pas complets.
M. Delacroix, tel qu’il est, a exercé une influence générale sur les esprits de son temps. Il a suscité des ambitions, des imitations, des rivalités. Il a appris beaucoup, même aux artistes qui n’ont pas mis le pied dans son atelier: à ce titre, il est le créancier de notre siècle. Il a ouvert une voie, il a fait école, mais il n’a pas fait d’élèves. M. Ingres a eu moins d’influence sur son époque, et il a fait des élèves sans faire école. C’est qu’il a une doctrine et un enseignement transmissible. Il est un professeur excellent et sûr. On pourrait lui donner l’épithète que les Athéniens accordaient à Aristide. M. Delacroix est un autre homme. Je l’appellerais plutôt l’inimitable que le juste. Il court, bride abattue, dans une Amérique toute neuve, en dehors des chemins frayés. Suivez-le si vous pouvez, et surtout tâchez d’avoir un cheval assez vite. Il n’a pas le temps de détourner la tête vers les traînards et les maladroits qui restent en chemin ou culbutent dans les fossés. M. Ingres s’avance à pied comme Platon dans les sentiers de l’Académie, réglant son pas sur le pas de ses élèves.
L’un et l’autre arrivent au beau dessin, mais leur point de départ n’est point le même. M. Ingres est avant tout un peintre de portraits, M. Delacroix un peintre d’ensembles. L’un part de l’individu, l’autre de la masse. M. Delacroix voit une scène dans son entier; il fait intervenir dans un tableau toutes les conditions de la forme et de la lumière. Il peint au vif le lieu, l’heure, le jour, les mouvements des individus, mais il s’arrête, de parti pris, à une certaine distance de la perfection. M. Ingres saisit la figure humaine jusque dans ses formes les plus délicates et pour ainsi dire les plus intimes, mais il sacrifie la lumière, il laisse échapper l’ensemble, et il s’arrête sciemment et volontairement à une certaine distance de la vérité. L’art de M. Ingres est contemplatif: l’art de M. Delacroix est dramatique, même sans drame. L’un a la poésie des attitudes, l’autre la poésie des mouvements. Les figures jouent un rôle trop exclusif dans les toiles de M. Ingres, et trop secondaire dans celles de M. Delacroix. Il semble démontré que M. Delacroix est incapable de faire un portrait et M. Ingres de faire un tableau.
On peut dire contre M. Delacroix que le portrait est la pierre de touche des grands peintres. Raphaël, Titien, Véronèse ont fait d’admirables portraits. Les presbytes, qui ne voient que de loin et ne saisissent les choses que dans leur ensemble, ne passent pas pour avoir de bons yeux, et les esprits qui ne sauraient sans fatigue entrer jusqu’au fond d’une idée sont des esprits incomplets. De même, l’artiste quia trop d’imagination, de vivacité et de fièvre pour rester devant une figure jusqu’à ce qu’il ait fait son portrait, est un peintre insuffisant.
M. Ingres possède par excellence la qualité qui manque à M. Delacroix. Armé de cette volonté patiente qui fait les chefs-d’œuvre immortels, il s’installe devant une figure jusqu’à ce qu’il s’en soit rendu maître. Il prend le temps de voir et d’étudier, de faire et de refaire, et de suivre en tout point le précepte du grammairien Boileau. Il entre dans la vie de son modèle et pénètre dans toutes ses habitudes. Il n’a entrepris le portrait du comte Molé qu’après avoir vécu à sa table et dans son intimité. Lorsqu’il a commencé à peindre M. Bertin, il s’est aperçu que le modèle n’était pas dans son état normal, et qu’il lui manquait quelque chose. C’était un gros gilet de tricot que le journaliste portait habituellement sous ses habits, et qu’il avait dépouillé ce jour-là. Il fit rentrer M. Bertin dans ses habitudes, et vous reconnaîtrez sous la redingote l’épaisseur du tricot qui arrondit les bras. M. Ingres ne compte pas les séances: il n’épargne ni son modèle ni lui-même, et il a fait poser plus de quatre-vingts fois le duc d’Orléans.
L’infirmité de M. Ingres consiste à se préoccuper exclusivement des corps éclairés, sans tenir compte des qualités de la lumière qui les colore. Lorsqu’il a saisi la forme, il est content. Tout entier à la recherche des plans, il va droit devant lui sans se soucier du reste. Il fait entrer dans son atelier une lumière quelconque, pourvu qu’elle soit rationnelle. Il ouvre sa fenêtre comme un sculpteur. Quel que soit le jour et la saison, hiver, été, soir ou matin, il ne voit que la forme des corps. Il considère le soleil comme un instrument destiné à marquer par des ombres et des clairs le relief des objets.
Il y a, dans la nature, des teintes et des tons. Les tons expriment l’intensité de la lumière, les teintes en expriment la qualité. Les tons vont du blanc au noir, en passant par toutes les nuances de gris. Les teintes se composent de toute la richesse de l’arc-en-ciel. M. Ingres, dessinateur exclusif, supprime les teintes et ne voit que les tons. Il se prive d’une grande ressource, ou plutôt il en est privé.
Lorsqu’un homme habillé de rouge passe auprès d’un homme vêtu de bleu, la draperie rouge envoie un reflet sur la bleue. De son côté, la bleue déteint momentanément sur la rouge, et il se fait comme un échange entre les deux couleurs. Ce phénomène, facile à observer, n’est pas facile à rendre. M. Ingres le sait bien. Aussi a-t-il soin de proclamer que le reflet est indigne de la majesté de l’histoire.
Si M. Ingres ne faisait que des dessins, s’il avait pour profession de mettre du noir sur du blanc, comme les graveurs, nous n’aurions pas le droit de lui demander autre chose que ce qu’il nous donne. Mais du moment où l’on peint sur la toile, avec des couleurs, on s’impose à soi-même une obligation de plus. Le reflet est un accident, mais un accident régulier, qui se reproduit nécessairement, en vertu d’une loi de la nature. Nous sommes accoutumés à voir les corps échanger des reflets sous la lumière du soleil. Un homme qui aurait perdu son reflet nous paraîtrait aussi invraisemblable et aussi fantastique qu’un homme qui aurait égaré son ombre. Et si vous me placez devant un tableau où vous aurez tout rendu de la nature, excepté les reflets, je me croirai transporté dans un autre monde.
Le reflet est donc l’ennemi capital de M. Ingres, parce qu’il lui crée de grands embarras. Le vieux maître s’entendrait bien mieux avec la nature si elle était grise. Chaque fois qu’il entreprend un tableau, le reflet, comme le spectre de Banquo, se présente à la porte. On le laisse entrer quelquefois, mais à condition qu’il se tiendra sur le seuil, le chapeau à la main, prêt à déloger sur un signe.
Que voulez-vous? Il est si difficile de tenir compte de la couleur, alors qu’on est tout à la forme! C’est un vrai nœud gordien. Les maîtres du bon temps le dénouaient; M. Ingres l’a coupé. Il évite les taches rouges, bleues ou noires; le noir surtout lui fait horreur, et il regrette que la vessie de noir ne- se vende pas trente mille francs. Lorsqu’il risque, au milieu d’un groupe, une draperie de couleur, il l’éclaire comme si elle était blanche. A force de tâtonnements, de ménagements et de compromis de toute sorte, il arrive à faire non pas des tableaux, mais d’admirables bas-reliefs.
Quant à M. Delacroix, il n’a peur de rien, pas même du reflet. Il se met en pleine nature; son atelier est dans les champs, éclairé par un lustre qui s’appelle le soleil. Il accepte non-seulement les objets comme ils sont, mais la lumière comme elle tombe. Ne vous étonnez donc pas s’il est à l’aise pour reproduire les grands effets de la nature. Je vous ai prévenu qu’il ne savait pas faire le portrait d’un homme, mais il n’a pas son pareil, au moins de nos jours, pour faire le portrait d’un matin, d’un soir, d’une belle journée, d’un carrefour où l’on s’égorge, d’une bataille poudreuse, d’une chasse au soleil, d’une chambrée de juifs. Il dessine divinement, non pas avec du blanc et du noir, mais avec le prisme tout entier. Il sait quelles sont les couleurs qui avancent, quelles sont celles qui reculent. Il attrape la forme avec la lumière comme un chasseur qui fait coup double, et lorsqu’il a peint un tableau, il s’aperçoit qu’il l’a dessiné.
Malheureusement, la couleur est comme un vin généreux. Les buveurs d’eau sont les seuls hommes qui ne s’enivrent jamais. Un peintre sujet à la couleur est un peintre sujet à l’erreur. M. Delacroix sait risquer les taches, et il en abuse. Il rompt quelquefois par des oppositions violentes l’effet de ses tableaux. Le jaune, le vert, le rouge, le bleu, s’y livrent des batailles; les yeux du bon public se détournent de la mêlée. On va revoir les bas-reliefs de M. Ingres, comme après une journée brûlante on prend un bain froid.
M. Ingres avait applaudi sincèrement aux débuts de M. Delacroix. La Barque du Dante l’avait ravi. Il ne songeait pas à l’appeler bourreau de couleur; il ne voyait pas en lui le Robespierre de la peinture.
Mais le jour où M. Delacroix exposa le Sardanapale, l’auteur du plafond d’Homère rencontra un ami commun, et lui dit avec une tristesse profonde: «Ce jeune homme, je l’aimais; je l’admirais grandir; je voyais en lui le représentant de la vie. Mais il a consulté le génie du mal (Rubens). Eh bien, pars, fougueux jeune homme! Ne connais plus aucun frein; cours, saute les fossés, renverse les barrières, jusqu’à ce que tu te casses le cou!»
L’événement a donné tort à cette prophétie, et j’espère que la postérité ne lui donnera pas raison.
Les maîtres de M. Ingres sont bien connus; il les cite avec orgueil. Tout homme de noble race est fier de ses ancêtres. Il a étudié Mantegna, Raphaël, Michel-Ange, Fra Bartolomeo, André del Sarto, Poussin, Léonard de Vinci, et, par-dessus tout, ces grands statuaires dont les ouvrages nous sont parvenus sous le nom collectif d’Antiques. «Une nourriture saine, un atelier spacieux et la Vénus de Milo!» M. Ingres ne voit pas ce qu’un honnête homme peut désirer de plus.
La généalogie de M. Delacroix est moins connue, et l’on pourrait croire qu’il ne doit rien qu’à lui-même. Cependant il est du sang de Véronèse, de Rubens, de Titien, d’Albert Durer.
J’ajouterai, sans crainte d’être indiscret, qu’il a dans son atelier trois ou quatre antiques, et qu’il les copie et recopie constamment, tant il est convaincu que le premier coloriste de notre siècle ne serait qu’un artiste secondaire sans le dessin!
M. Ingres et M. Delacroix imitent les maîtres en maître. Le spirituel historien d’une grande querelle littéraire, M. H. Rigault, a résumé en quelques lignes vraiment belles les principes et les lois de l’imitation:
«Les modèles de l’art, dit-il, ne doivent être pour nous que des termes de comparaison avec la nature, qui nous aident à la mieux comprendre, à la mieux sentir. Nous devons étudier les œuvres des grands écrivains comme on étudie la traduction d’un auteur dont on ne sait pas encore parfaitement la langue; puis, quand nous la comprenons, nous devons les étudier encore, pour comparer notre interprétation à la leur, et la fortifier par leur autorité. Mais nous réduire aux livres où la nature est le mieux exprimée, sans communiquer avec la nature même, c’est consentir à ne jamais lire un chef-d’œuvre dans l’original, c’est nous résoudre à le juger par la traduction, c’est-à-dire à juger d’une belle personne par son portrait, quand nous pouvons contempler son visage. Les grands maîtres ne doivent être que des transitions pour arriver au maître suprême, la nature.»
Nous ne manquons pas d’artistes qui espèrent s’égaler aux maîtres à force de les imiter. J’en pourrais citer plus de trente qui, se transmettant de main en main une tradition illustre, font des pastiches de pastiches et des copies de copies. La nature, aux mains de ces gens, est comme le lait qu’on envoie dans les grandes villes: à chaque étape on ôte un peu de crème et l’on ajoute un peu d’eau, si bien qu’au bout du voyage, les vases sont pleins d’eau pure, et la crème est restée en chemin.