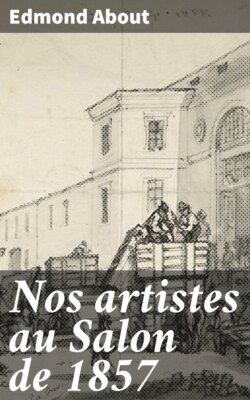Читать книгу Nos artistes au Salon de 1857 - Edmond About - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
ОглавлениеTable des matières
M. Gigoux; M. Gérome.
L’exposition de M. Jean Gigoux est, sinon une des plus agréables, au moins une des plus honorables du Salon. M. Gigoux n’est pas de ceux qui cèdent aux entraînements de la mode, et qui mesurent le grand art aux goûts mesquins de notre temps. Au milieu de ce débordement de jolies petites choses qui fait du Salon une vaste succursale de la rue Laffitte, le peintre franc-comtois vient jeter un tableau d’histoire, une étude académique et un portrait sérieux jusqu’à l’excès. On pourra reprocher à ce mâle talent de se complaire un peu trop exclusivement dans la montre de sa force, et de ne pas imiter les voyageurs antiques qui s’arrêtaient quelquefois au bord du chemin pour sacrifier aux Grâces. Mais dans un siècle comme le nôtre, quand la virilité dans les arts n’est pas un vice endémique, nous devons, avant tout autre propos, féliciter l’artiste qui peint des hommes en homme.
Je prévois que j’étonnerai quelques personnes et que j’en mécontenterai quelques autres en louant presque sans restriction la Veille d’Austerlitz. C’est un métier ingrat de recommander les choses qui ne savent pas se recommander elles-mêmes, ni prendre le public par les yeux. Mais je pense que les critiques ont pour devoir de mettre en évidence les qualités solides qu’on ne découvrirait pas sans eux. Quant aux apparentes, elles se montrent assez.
M. Gigoux a commenté solidement une demi-page de ces admirables mémoires que M. Thiers rédige au courant de la plume pour servir de matériaux à l’homme qui écrira l’histoire du Consulat et de l’Empire. Le soleil d’Austerlitz se lèvera bientôt sur l’horizon. L’Empereur a quitté les maréchaux pour faire à ses soldats une visite nocturne, et l’armée, enlevant au bout des fusils la paille des bivouacs, allume en son honneur un lustre de vingt mille flambeaux.
Le choix d’une telle donnée imposait à l’artiste des difficultés presque insurmontables. La profusion de la lumière, la dispersion de l’effet, la couleur étrange des feux de paille ont dû l’embarrasser sérieusement. Les costumes de ses personnages étaient mieux faits pour la guerre que pour la peinture. La discipline militaire ne laissait à sa disposition qu’un petit nombre de mouvements et d’attitudes; Une foule de soldats n’est pas une foule comme une autre, surtout en présence du chef. La discipline roidit les bras et gouverne mécaniquement les gestes des hommes. On ne voit que des attitudes en quatre temps, des mouvements de commande, aussi réguliers que ceux d’un télégraphe ou d’un cantonnier des chemins de fer.
A travers tous ces obstacles, M. Gigoux est arrivé à un effet large et simple. Ses personnages ne rampent pas comme des couleuvres, ne bondissent pas comme des lions; on ne trouve point dans leurs mouvements la souplesse désossée du jaguar et de la panthère; mais leurs pieds reposent carrément sur le sol dans les souliers d’ordonnance; on distingue des bras vigoureux dans les manches de leurs habits; des cuisses robustes habitent leurs culottes de peau. Les têtes et les mains, dessinées pour être vues de près, se soutiennent parfaitement, quoique le tableau soit placé trop haut.
Peut-être M. Gigoux a-t-il un peu abusé des lignes verticales. Son tableau est trop visiblement au port d’armes; mais je ne sais quel artiste, le baron Gros excepté, l’aurait su faire autrement. La seule figure manquée, dans cette vaste réunion d’hommes, est celle de l’Empereur; mais la figure de Napoléon, une des plus belles de notre siècle, est vouée aux méchants portraits, comme sa gloire aux méchants vers. M. Gigoux a fait glisser sur le nez un reflet d’argent, par une flatterie indirecte et un hommage secret à l’hôtel impérial des Invalides.
Le second plan est parfait. Une vraie foule s’agite dans une lumière rouge, semblable à la lueur d’un incendie. M. Raffet aurait peut-être trouvé ce fond-là, si M. Raffet savait peindre; mais je me plais à répéter que Gros seul était capable de faire mieux. Et ce n’est pas un éloge de peu de portée. Gros était un artiste de premier ordre, n’en déplaise aux rapins qui l’ont tué, et la Peste de Jaffa tiendrait son rang dans le salon du Louvre, en face des Noces de Cana.
Le Bon Samaritain n’est qu’une excellente étude. M’est avis cependant que M. Gigoux voulait faire quelque chose de plus. L’homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, le blessé que les voleurs ont dépouillé après l’avoir couvert de plaies, ressemble trop sensiblement à un modèle d’atelier. Je ne reproche pas à M. Gigoux d’avoir copié trop exactement le modèle et de n’y avoir rien ajouté de son cru. Ce que je regrette, c’est qu’il n’ait pas poussé l’étude un peu plus loin. Lorsqu’on dit d’une figure qu’elle sent trop le modèle, on sous-entend que l’artiste s’est borné aux perceptions un peu communes des commençants, et qu’il n’a pris de la nature que ce qu’un homme peu exercé y saisit du premier coup d’oeil. Il y a des pauvretés et des maigreurs dans la jambe droite; elle semble se modeler en creux. Les ombres entrent trop brusquement dans les chairs, et découpent la lumière d’une façon brutale. Cela ne nous empêche pas de voir que le modèle a la peau mince, trop mince peut-être, et assurément trop rose pour un Asiatique cuit au soleil dans le sable de Syrie. Les teints de feuilles de rose sont rares entre la Méditerranée et le Jourdain.
L’honnête homme de Samaritain est peut-être un peu loin du malheureux qu’il vient sauver. Je dis loin par la couleur plutôt que par la distance. M. Gigoux l’aurait fait entrer plus avant dans la composition s’il avait pris soin d’éclairer sa robe d’un simple reflet. Il aurait créé un point d’appui à la lumière intense qui illumine le torse du blessé, et il aurait lié son sujet par la couleur.
J’ai vu de près le Portrait de Mme la comtesse de Mniszech, et me voici dans un grand embarras. Si je vous dis que c’est un chef-d’œuvre, à part la tête et les mains, j’aurai l’air de me moquer du peintre et du lecteur. La tête et les mains ne sont pas des détails qu’on puisse manquer impunément, surtout dans un portrait.
Il y a dans ce tableau des qualités de forme et de couleur que je ne saurais trop louer; l’ensemble est excellent; l’attitude est parfaite; les habitudes du corps sont celles d’une femme vivante et élégante. Tout ce qui se laisse deviner sans se montrer aux yeux, le bras, la poitrine, la taille, tout est bien. La main qui porte sur la cheminée sort au bon endroit; je n’en dirais pas autant du pied qui se chauffe. La robe bleue est miraculeuse, bien dessinée, bien peinte, bien froissée, toute pleine de ces petits plis intimes que le mannequin ne donne pas et qu’il faut surprendre à la nature. Elle n’est ni en zinc, comme dans le portrait de M. Barrias, ni en papier-brouillard, comme dans les Deux Pigeons de M. Benouville, mais en bel et bon velours de soie de la meilleure qualité. Pourquoi diable la tête ne se cache-t-elle pas, au lieu de se montrer de cinq quarts? Pourquoi M. Gigoux, après avoir donné tant de soin au miroir et aux vases de la cheminée, a-t-il traité si rudement ce qui exigeait le plus de délicatesse? La tête est lourde, opaque, indigeste, c’est une tête de carton. J’excepte les cheveux, quoique la lumière y soit mesquinement accrochée. La main droite est alourdie par le travail, plombée, sans finesse. C’est la main d’une pensionnaire qui aura des engelures l’hiver prochain. M. Gigoux, qui manie supérieurement la couleur, s’est perdu ici dans les tons terreux et les demi-teintes sales.
Le public a donc le droit de passer condamnation et de dire que le portrait de Mme la comtesse de Mniszech est un portrait manqué. Mais j’aimerais mieux le garder tel qu’il est, avec ses qualités éminentes et ses énormes défauts, que de le donner à refaire à M. Barrias, à M. Cabanel, à M. Benouville, à M. Bouguereau, à M. Ricard, ou même à M. Hébert.
Je n’ai pas nommé M. Gérome: il est trop homme d’esprit pour jouer sa réputation sur un portrait.
M. Gérome a prouvé, il y a quelques années, qu’il était un dessinateur de grand talent. Depuis le Combat de coqs et l’Amour et Bacchus entrant au cabaret, il s’occupe moins de dessiner que de réussir. Je vous le dis en confidence; le public n’en sait rien; ne lui en parlez pas. M. Gérome me rappelle un peu ces braves qui sont entrés dans la vie par deux ou trois affaires d’honneur, et qui, vivant sur leur réputation, ne se battent plus. En vertu du même principe, on n’a plus guère besoin de dessiner, lorsqu’on a fait ses preuves. Si M. Mérimée, après avoir publié Colomba, avait écrit les mille et un volumes de M. Xavier de Montépin, tous les lecteurs se seraient-ils aperçus qu’il avait, changé de style?
M. Gérome est (comme on dirait en Angleterre) le lion de l’Exposition. Son Pierrot expirant a obtenu dès le premier jour un succès qui va croissant. L’Angleterre a payé 20 000 francs cette petite toile qu’un Anglais en voyage pourrait emporter dans sa poche. Les étrangers, comme les Français, raffolent de ce drame en miniature. Si la médaille d’honneur que l’Institut doit décerner était soumise au suffrage universel, c’est M. Gérome qui l’aurait.
Je puis donc, sans danger pour M. Gérome, discuter à mes risques et périls un succès établi, et nager innocemment contre le courant de l’admiration publique.
Le drame est bien fait, bien composé, touchant et pathétique: nous serons d’accord sur ce point. Aucun ouvrage de l’esprit ne réussit sans mérite, mais tous ne réussissent point par le mérite le plus élevé. Ne vous est-il pas arrivé quelquefois d’aller entendre un drame au boulevard? de subir l’effet inévitable d’une pièce bien construite, de trembler pour la victime, de murmurer contre le traître, de pleurer de vraies larmes à la péripétie, et, le rideau tombé, de dire en mettant le mouchoir dans votre poche: Suis-je bête de m’être intéressé à des hommes si mal dessinés!
Les personnages de M. Gérome sont six de ces braves gens que nous avons tous rencontrés du coude dans les couloirs de l’Opéra: un Pierrot, un Crispin, un Arlequin, un Osage, un Chinois, et un homme sérieux, qui, pour entrer au foyer et échapper aux fatigues de la danse, s’est affublé d’un domino. Sans doute, ces messieurs n’étaient pas de la même bande, mais ils auront dîné dans le même restaurant. Quelques paroles échangées d’une table à l’autre, un bouchon lancé maladroitement par une bouteille, un coup de coude dans l’escalier, l’honneur de reconduire quelque domino bleu, un rien les aura mis aux prises, le vin de Champagne aidant. Grâce à cette liqueur éminemment française, le Pierrot et l’Osage ont fait la partie de s’entre-détruire séance tenante. Ils ont recruté des témoins, loué une paire d’épées chez Francis Marquis et couru au bois, sans prendre le temps de s’habiller en hommes. On s’est battu, et le Pierrot a reçu quelques pouces de lame dans le côté droit, juste autant qu’il en faut pour mourir.
Voilà le prologue, qui se raconte tout seul et se fait deviner dès le premier coup d’œil. Maintenant, voici la scène: le Pierrot tombe à la renverse entre les bras du Crispin, qui le soutient comme il peut, à la force du genou. Le Chinois et le domino s’empressent autour du moribond. Quant à l’Osage, il a jeté son épée suivant la coutume, et sans doute il a commencé par courir à son adversaire; mais un de ses témoins, arlequin pour le quart d’heure, le prend et l’emmène vers les voitures.
Le spectacle de la mort a dégrisé tout le monde; il ne reste sur la figure des témoins que la terreur, la fatigue et un petit reste d’abrutissement. Il fait froid, ce froid triste qu’on rencontre le lendemain d’un bal. Les allées du Bois sont drapées d’une tenture de neige; un petit jour éclaire tristement les arbres dépouillés; le terrain est foulé et sali par les piétinements du combat. Quelques plumes de perroquet, tombées de là coiffure de l’Osage, indiquent que l’action a duré plusieurs minutes, et que le Pierrot a attaqué par des coupés. On aperçoit au fond du tableau un de ces fiacres fatigués qui ont fait trente voyages dans la nuit pour aller chez Bignon, chez Vachette, au café Anglais et à la Maison d’Or. Le décor est aussi dramatique que la scène qui s’y joue. L’esprit des regardants est frappé de mille contrastes à la fois. On est saisi de voir le plaisir si près de la mort, la solitude si près de la foule, le silence des bois-si près de l’orchestre de Musard, la fournaise où l’on danse si près du cimetière où l’on repose.
Vous avez vu? compris? senti? Vos réflexions sont faites? Passez maintenant et laissez approcher ceux qui regardent par-dessus votre épaule. Vous gagneriez peu de chose à rester là plus longtemps, et le tableau y perdrait.
Je ne veux discuter ni le fond de la pièce, ni la vraisemblance, ni surtout ces misérables questions de priorité qui font tant de bruit autour des théâtres du boulevard. M. Couture a peint, lui aussi, un duel de Pierrots, et il assure qu’il avait déposé son esquisse à la chambre de commerce avant M. Gérome. Quelle que soit la date de son brevet, l’invention n’est pas nouvelle, ou plutôt ce n’est pas une invention. Le bois de Boulogne a vu deux ou trois de ces duels enfarinés, et l’idée est tombée dans le domaine public, surtout si les inventeurs sont morts. Ce qui eût été intéressant, c’est de voir le tableau de M. Couture exposé en concurrence dans la salle de M. Gérome. Mais M. Couture vend ses tableaux à la veille de l’exposition. M. Couture boude le public et la critique; M. Couture ne nous pardonne pas sa chapelle de Saint-Eustache; M. Couture s’est retiré dans sa tente où il panse les blessures d’une malade bien chère: sa vanité.
M. Gérome a voulu représenter un drame contemporain. Il est peut-être à regretter qu’un chapeau de l’année, un habit noir, une pièce du costume de nos jours ne marque pas la date de son tableau. Peut-être aussi y a-t-il certaine invraisemblance dans l’âge de ses héros. Que des étudiants, au sortir du bal, trouvent plaisant de se. tuer dans leurs costumes, c’est un enfantillage facile à comprendre. Mais ici les combattants et les témoins sont parvenus à l’âge d’homme et même de notaire. A quarante ans, lorsqu’on va sur le terrain, on peut oublier de faire son testament, d’écrire à sa femme et de pourvoir à l’avenir de son fils, mais on n’oublie pas de mettre un pantalon noir. Parlons peinture.
Le sujet tout entier repose, avec le corps du Pierrot, sur un seul genou du Crispin. C’est un point d’appui un peu mince et qui ne rassure pas assez l’attention des spectateurs. Quand nous voyons sur le boulevard une maison de quatre étages s’appuyer de tout son poids sur quatre colonnettes de fonte, nous sommes obligés de faire un effort pour nous rappeler que le fer est assez solide pour en porter si pesant. Devant les ouvrages de l’art, l’esprit doit être rassuré, calme et sans inquiétude. Ici, le danger est d’autant plus agaçant que maître Crispin ne fait aucun effort visible, et que le pauvre Pierrot est terriblement long. Avant le coup d’épée, sa tête devait heurter la bordure du tableau.
Le Chinois et le Domino personnages secondaires, ont des figures par trop secondaires. On dirait que, pour de simples figurants, M. Gérome n’a pas voulu se mettre en frais d’individualité. Il s’est dit que le pavillon couvrirait la marchandise et que le public n’irait pas regarder jusque-là. L’Arlequin ne marche pas, et ses jambes ne sont pas des jambes. Regardez-les de près, et vous verrez qu’elles sont modelées comme ces balles bourrées de foin que les enfants achètent au Luxembourg. Enfin, le personnage principal, le Pierrot, laisse bien à dire. M. Gérome connaît le public. Il sait qu’il suffit de nous jeter une idée à la figure pour nous fermer les deux yeux. Quand je peux dire à mon voisin: «Voyez! les gouttes de sueur ont détrempé cette farine et percé ce masque blafard!» j’oublie de regarder si le dessous est en chair et en os, ou simplement en caoutchouc. Nous prenons un détail dramatique pour le fond même du sujet; nous donnons gain de cause à l’avocat qui nous émeut.
Il serait |absurde de |demander à M. Gérome les qualités qui lui manquent, comme par exemple la verve; mais je crois être dans mon droit en l’adjurant de ne plus cacher les talents qu’il a. Il peut dessiner comme pas un des jeunes; il a tort de profiter de l’entraînement et de la facilité du public pour escamoter le dessin. Lorsqu’on sait le nu comme il le sait, lorsqu’on s’est assis un instant à quelques pas des divins artistes de la Grèce, il n’y a ni sujet, ni succès, qui justifie un Arlequin bourré de paille et un Pierrot modelé en mie de pain. Les dimensions de la toile ne sont pas une excuse. Nous avons au Louvre, entre le Louis XIII et le Richelieu de Philippe de Champagne, une toute petite Noce, où les personnages, pour être des Lilliputiens, ne sont pas moins des individus vivants et parlants. M. Gérome, s’il n’y prend garde, est menacé de tourner au Gérard Dow, et cela (Dieu nous soit en aide!) avec la fécondité de Rubens.
Son faire, recouvert d’une couche de monotonie et d’ennui, me rappelle ces orateurs qui disent tout de la même voix et du même geste. Ou plutôt il me fait penser à ces cathédrales gothiques dont les parois intérieures sont cachées sous plusieurs couches de badigeon. Encore a-t-on la ressource de les gratter à vif pour retrouver d’admirables nervures et des détails exquis. Vous auriez beau gratter les nouvelles toiles de M. Gérome, vous ne retrouveriez ni le Combat de Coqs, ni l’Intérieur grec. Nous sommes loin du temps où M. Gérome, par quelques velléités de désintéressement dans l’art, nous promettait un amant passionné de la nature. Le voilà qui met le poli à la place du fini, une sécheresse pétrifiée à la place du dessin. Il invente un procédé courant pour exploiter son talent acquis et produire, bon an, mal an, une pacotille de demi-chefs-d’œuvre.
La Prière chez un chef arnaute et les Recrues égyptiennes traversant le désert supportent mieux l’examen que le Pierrot agonisant. C’est que M. Gérome est un de ces riches qui savent dépenser leur bien à propos. Il ne s’est pas mis en frais de dessin dans le tableau de carnaval, parce que le dessin n’était pas indispensable au succès de l’ouvrage. Mais lorsque la marchandise n’est point couverte par le pavillon, lorsque l’élément dramatique, qui justifierait tout, vient à manquer, M. Gérome fait un petit sacrifice: il dessine.
Cette sage et libérale économie l’empêchera de se démonétiser comme tant d’autres. On s’est lassé de M. Hamon et de sa monnaie blanche, et les sous marqués au coin de M. Picou ne passent plus. M. Gérome aura cours aussi longtemps qu’il aura vie. Il sait renouveler son bagage, accroître ses ressources; il ne craint pas d’aller quérir des idées originales, des types curieux, des paysages nouveaux sur les bords du Danube ou du Nil. Ses vues d’Égypte sont intéressantes, à part le mérite de l’exécution qui est petit. On n’y trouve ni une élude bien approfondie de la forme, ni un sentiment bien vif de la solidité, ni un amour bien passionné de la couleur. Les pierres semblent un peu ramollies par le soleil; les chameaux, fussent-ils au premier plan, sont pauvrement rendus, et le badigeon fatal attriste tout. Hardi qui, sur la vue de pareils tableaux, prendrait le paquebot d’Alexandrie et risquerait le voyage! Mais, sans aller si loin, on s’arrête à les regarder, et l’on admire comment un homme d’esprit sait renouveler ses succès sans renouveler son talent.