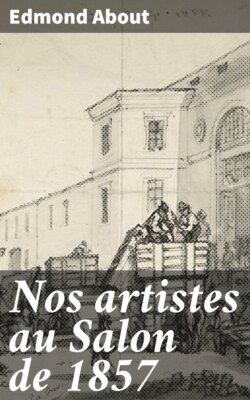Читать книгу Nos artistes au Salon de 1857 - Edmond About - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеTable des matières
M. Hippolyte Flandrin; M. Amaury Duval; M. Maréchal (de Metz).
L’ouvrage le plus parfait du Salon de 1857 est un portrait de femme par M. Hippolyte Flandrin.
M. Hippolyte Flandrin est le plus excellent de tous les élèves de M. Ingres, le continuateur de sa tradition, l’héritier présomptif de sa royauté. M. Delacroix mourra comme Alexandre: on taillera quelques douzaines de gilets dans son manteau de pourpre. L’héritage de M. Ingres restera indivis entre les mains de M. Flandrin.
Je ne sais pas jusqu’où M. Flandrin serait allé, s’il eût travaillé sans maître et livré à lui-même. Peut-être est-il un de ces fils qui sont heureux que. leur père soit né avant eux. Peut-être les vieillards, ces flatteurs du passé, se serviront-ils du génie du maître pour battre en brèche le talent de l’élève. Il y a des plantes qui ne savent grandir que le long d’un tuteur. M. Flandrin a trouvé dans M. Ingres son tuteur naturel, mais il a poussé haut et droit. La postérité, si elle est juste, l’appellera Flandrin sans erreur comme André del Sarto s’appelle André sans défaut.
Le public des expositions court aux peintures bruyantes, comme dans les rues de Paris la foule s’attroupe autour d’une maison où l’on crie. Bien des gens passeront devant le portrait de Mme L., comme devant une tragédie de Racine, un chant de Virgile, et tant d’autres choses parfaites qui n’attirent l’attention par aucun défaut remarquable. Raison de plus pour que nous nous arrêtions ensemble en présence d’un des plus beaux types de cette perfection du dessin, dont je voudrais vous montrer en même temps la loi et l’exemple.
J’espère que le gracieux modèle qui a prêté sa beauté à M. Flandrin me pardonnera de faire entrer ses charmes dans la discussion. C’est un ennui auquel on s’expose lorsqu’on envoie son portrait au Salon. Les plus beaux ouvrages de la nature, comme les chefs-d’œuvre de l’art, sont sujets à la critique. Dieu même, au dire des Écritures, a livré le monde aux discussions des hommes: Tradidit mundum disputationibus.
M. Flandrin avait à peindre une beauté saine et bien portante. La figure est plutôt ronde qu’ovale; les traits ne sont pas étirés, les bras ne sont pas maigres, ni les mains pâles. M. Hébert aurait eu fort à faire s’il avait voulu donner à Mme L. ce qu’il recherche sous le nom de distinction. Cependant l’œuvre de M. Flandrin est le portrait distingué d’une, femme très-distinguée. M. Courbet, en exagérant la force et la santé, serait peut-être parvenu à peindre une bouchère: M. Courbet ressemble un peu à cette source auvergnate qui pétrifie tout ce que vous plongez dans ses eaux.
La figure de Mme L., telle que la nature l’a faite, n’est pas dessinée par grands plans unis, sans méplats sensibles, comme la Minerve antique. C’est une figure toute moderne et toute française, modelée par petits méplats, accidentée par mille facettes. M. Flandrin pouvait insister sur cette qualité et représenter cette jolie tête comme un bouchon de carafe ou comme un de ces miroirs brillants où l’alouette se laisse prendre. Il a accepté les plans que la nature lui offrait, sans les exagérer. Peut-être les a-t-il simplifiés un peu: c’est l’esprit de l’école. Il y a moins de danger à omettre vingt détails vrais qu’à en ajouter un faux. Dans un orchestre, la suppression de quelques violons affaiblit imperceptiblement la symphonie; il ne faut qu’une note fausse pour tout déranger.
Le portrait de Mme L. est calme, reposé, et sans expression définie, comme tous les portraits de maîtres. Une figure qui rit, qui pleure ou qui chante est un sujet de tableau, et non plus un portrait. Libre à M. Grosclaude et à ses complices de représenter telle ou telle grimace, et même de la loger au Luxembourg. Un portrait est la représentation de l’individu dans les lignes de sa figure et dans l’habitude de son visage, et il y a de la sottise à faire ou à admirer des portraits expressifs. En retraçant une disposition spéciale de l’individu, un accident de sa vie, une idée qui traverse sa cervelle, vous vous privez du plus beau de votre art, qui est de peindre l’homme tout entier.
Il y a une mise en scène dans toute œuvre de l’art, sans excepter le portrait. M. Flandrin possède, comme M. Ingres, le talent de bien présenter son modèle au public. Tel homme est à sa place sur la toile; tel autre a l’air d’un intrus, et vous seriez tenté de le mettre dehors. Une posture noble, une attitude à la fois libre et digne, sont comme une prise de possession du cadre, et font que le modèle y est chez lui. Vous apprécierez mieux la mise en scène des portraits de M. Flandrin, si vous les comparez à la plupart de ceux qu’on voit à l’exposition.
Ce qui est plus difficile à comprendre, pour peu que vous soyez étranger aux choses de la peinture, c’est la suite, et, pour ainsi dire, la continuité du dessin. Une tête bien peinte présente une surface non-seulement unie, mais une. On sent que la moindre agitation, le trouble le plus léger, la sensation la plus imperceptible changerait l’apparence extérieure de l’être tout entier, comme une pierre tombée dans l’eau ride toute la superficie d’un lac tranquille. Les choses se passent ainsi dans la nature, et par conséquent dans la peinture. Les portraits de M. Chaplin et de M. Hofer, qui ne sont pas des artistes sans talent, manquent de cette qualité indispensable. Vous diriez des mosaïques de pièces et de morceaux, des maquillages inégaux où le rouge et le blanc sont tombés en plusieurs endroits. Je vous montrerai tel portrait de M. Chaplin qui, vu d’une certaine distance, a l’aspect martelé d’un travail de chaudronnerie où l’on peut compter les coups frappés par l’ouvrier. Ce n’est pas une vérité nouvelle que l’art doit cacher ses secrets. Les plus beaux chefs-d’œuvre sont ceux qui ont l’air de s’être fait tout seuls, et l’artiste prend une peine inutile, s’il nous laisse voir qu’il a pris de la peine. Regardez maintenant l’air d’aisance qui règne dans le portrait de Mme L. On dirait que l’artiste l’a peint d’un seul coup de pinceau, parce que tout s’y tient en un bloc.
Les détails de l’ajustement sont rendus avec amour; mais cette passion ne va pas jusqu’au fétichisme. Nous avons des peintres que l’on croirait voués au culte de la dentelle et du satin. Heureux d’exécuter parfaitement un certain genre d’accessoires, ils subordonnent le principal au point de le négliger tout à fait. Ils lâchent toute leur meute sur la trace de la petite bête, et ils ne gardent pas un seul chien pour chasser la grosse, qui est l’homme. Tout Paris a vu des portraits de femme où la robe faisait tort à la tête; des portraits d’homme où la figure était la très-humble servante d’une paire de bottes, vernies comme au passage de l’Opéra. M. Flandrin a trop de goût pour intervertir à ce point l’ordre de la nature. Il sait que lorsqu’on rencontre une jolie femme, on s’aperçoit de sa beauté avant. de remarquer sa toilette; on rend hommage aux dieux qui l’ont faite avant de célébrer la couturière qui l’a habillée. Il a suivi le précepte de Raphaël, qui disait que le peintre doit mettre tout son soin à toutes choses; mais il n’a pas donné plus de temps au satin de l’habit qu’au satin de la joue. La robe est riche et de belle étoffe; la dentelle, exécutée de très-près, a cette couleur un peu sale de toutes les dentelles de bon aloi; les bijoux ne sont pas confectionnés en manière de trompe-l’œil, mais assez bien indiqués pour que l’on s’en contente. Ce coin de fauteuil jaune a dû donner bien du mal à l’élève de M. Ingres; mais ce n’est pas peine perdue, car vous ne vous en apercevriez point, si je ne vous le disais.
La couleur générale du tableau est dans une gamme douce, mais on ne s’ennuie pas à la regarder, et les teintes un peu faibles ne vous mettent point de froid dans les veines. M. Flandrin ne cherche pas l’éclat, mais l’harmonie. Sa couleur est voilée, modeste, un peu triste si vous voulez; elle n’est jamais ni crue, ni disparate, ni injurieuse. Elle arrive au charme quelquefois.
J’ai dit que M. Flandrin était sans erreur, je n’ai pas dit qu’il fût sans défauts: nous avons tous les nôtres. Quand M. Ingres tombe au-dessous de lui-même, il est Chinois. Quand M. Delacroix se trompe, il est barbare. Quand M. Flandrin faiblit, il est tiède. Son portrait d’homme devrait légitimement être plus ferme, et plus accentué que son portrait de femme. C’est le contraire qui est arrivé. Cette tête, assez belle d’ailleurs et bien modelée, manque de fermeté. On ne sait de quel côté la lumière arrive dans les cheveux; la robe d’avocat est éclairée trop uniformément du haut en bas. Les ombres sont moins franches, et fatiguées çà et là de demi-teintes.
Il est bien entendu que j’épluche ce tableau comme les professeurs de rhétorique corrigent les vers de Virgile. Le nom de son auteur et la place où je le mets indiquent assez qu’il s’agit d’une œuvre excellente, et faite dans le véritable esprit du portrait.
Il y a trois façons de faire un portrait: celle d’Albert Durer, qui n’est pas sotte; celle de M. Dubufe, qui est funeste; celle d’Holbein, de M. Ingres et de M. Flandrin, qui est la bonne.
J’écarte préalablement les portraits symboliques. Les symboles sont fort jolis en littérature; je les goûte moins en peinture. Les poëtes grecs ont représenté l’Occasion sous les traits d’un personnage demi-chauve qui porte un toupet sur le front, et l’occiput dépouillé de cheveux. Rien de plus ingénieux que cette figure: il faut saisir l’occasion dès qu’elle vient à nous; une fois qu’elle a passé, il est inutile de courir après elle; on ne sait plus par où la prendre.
Le portrait de l’Occasion, exécuté par un peintre ou par un sculpteur, serait un triste portait.
Un peintre qui essayerait de faire le portrait du socialisme; un sculpteur chargé de pourtraire l’ordre moral, la liberté dans la loi, la cour des comptes, seraient des artistes à plaindre. Je les vois d’ici, se trémoussant dans leur art pour rendre des idées qui ne sont pas de leur domaine. Ils savent ce qu’ils ont à dire, et la matière rebelle s’oppose à l’expression de leur pensée. Vous diriez des poissons rouges enfermés dans un bocal de verre: ils voient une mouche à leur portée, et chaque fois qu’ils s’élancent pour la saisir, ils donnent du nez contre la muraille de cristal.
Aucun artiste ne perdrait son temps à faire des portraits symboliques, s’il savait que tous les arts sont séparés par des haies transparentes, que chaque muse a sa besogne, et qu’il est aussi impossible à la peinture d’empiéter sur la poésie qu’à la musique de représenter la couleur bleue. On a singulièrement exagéré la solidarité des arts. Ne croyez pas qu’un écrivain, un peintre et un compositeur puissent se repasser un même sujet et le traiter tour à tour à leur manière. Les écrivains expriment nettement des idées claires; les musiciens traduisent vaguement des sentiments confus; la peinture a sa poétique propre. Une belle face d’homme arrêtée dans une certaine attitude, une articulation bien faite, la distribution de l’ombre et de la lumière à la surface des muscles, voilà la poésie du peintre et sa musique. La Joconde de Léonard de Vinci et le portrait noir de Raphaël sont des œuvres aussi poétiques qu’un peintre pouvait les faire. Une idée littéraire introduite sous la peau gâterait tout.
Un peintre de talent, M. Ary Scheffer, s’est donné plus de mal que tous les poissons rouges de l’univers entier. Il a dépensé une vie très-illustre et très-occupée, à broyer des idées sur sa palette et à dessiner des quintessences avec la pointe d’une abstraction. Et cependant le portrait symbolique de saint Augustin n’est comparable ni à la Joconde ni au portrait noir.
Si vous voulez bien le permettre, nous ne donnerons le nom de portrait qu’à la représentation d’un individu vivant, copié d’après nature.
Offrez à Albert Durer un modèle qui ait le nez un peu long, les yeux un peu bouffis, les lèvres un peu épaisses. L’artiste, frappé de ces trait caractéristiques, allongera le nez, grossira les yeux, renforcera l’épaisseur lippue des lèvres. Il fera un portrait chargé, une caricature. Il traitera la nature en maîtresse adorée dont on accepte aveuglément les caprices, dont on sert les fantaisies, dont on adopte les idées en les exagérant.
M. Dubufe, placé devant le même modèle, amincira artistement les lèvres et en gardera juste assez pour dessiner un as de cœur au milieu du visage. Il émondera le bout du nez comme un branchage inutile; il renfoncera délicatement les yeux dans leurs orbites. Si le modèle est content de se voir ainsi raccommodé, il n’a que ce qu’il mérite. Si, par-dessus le marché, il donne son argent à celui qui l’a dépouillé de son individualité, tant pis pour lui; je ne le plains pas. Mais, pour être conséquent et aller jusqu’au bout de cette doctrine, ô modèle trèsngénieux, vous devriez commander votre buste à un tourneur en métaux, car la forme sphérique est la plus belle de toutes, suivant le sentiment de Platon.
Les maîtres (et ce mot nous ramène à M. Hippolyte Flandrin) peignent l’homme tel qu’il est et le nez comme il se comporte.
J’ai dit que la nature avait dans Albert Durer un amant un peu fou. Elle a dans M. Dubufe et ceux de son école des ennemis irréconciliables. Elle prendrait les armes à chacune de leurs productions, si elle n’était pas accoutumée depuis longtemps à voir la main de l’homme mutiler ses plus beaux ouvrages. Elle se console avec quelques amis sincères qui adorent en elle la source immuable de toute beauté, et qui la prennent tendrement comme elle est.
M. Amaury-Duval est un de ces artistes de bien. Mais ce n’est pas au Salon qu’il faut chercher son talent, si nous voulons le trouver tout entier.
La Tête de jeune fille, étude peinte, est fine, froide et triste. Les qualités de M. Amaury-Duval y sont bien, mais non pas dans leur expression la plus élevée. Si vous voulez le juger sur ses chefs-d’œuvre, allez revoir le portrait de son père et un certain por» trait bleu que nous avons tous admiré en 1855. Ces deux toiles ont leur place marquée au musée du Louvre.
Sans aller si loin ni remonter si haut, arrêtez-vous devant quatre portraits de femmes et d’enfants qui sont exposés dans la galerie des dessins. Vous y verrez M. Amaury-Duval tel qu’il est lorsqu’il boit dans son verre, lorsqu’aucune réminiscence, aucune influence du passé ne s’interpose entre le modèle et lui. Toutes les fois qu’il aborde directement la nature, il lui dérobe toutes ses finesses, toutes ses séductions, toutes ses délicatesses. Aucun homme, pas même M. Flandrin, n’est plus apte à saisir les formes et à dessiner simplement. Il est né peintre de portrait, c’est-à-dire peintre de première force. Dans l’école, on le trouverait plus original que M. Flandrin, capable de fouiller plus profondément une figure, de la rendre plus individuelle et partant plus ressemblante.
Malheureusement, M. Amaury-Duval gâte à plaisir les heureuses qualités qu’il a reçues, lorsqu’il imite les maîtres ascétiques de la peinture primitive. Si, au lieu de consulter Giotto, Beato Angelico, Masaccio et tous ceux qu’on appelle en Angleterre les Préraphaélites, il se mettait bravement en présence du modèle, il serait un autre homme. Pourquoi chercher la naïveté lorsqu’on sait tout, et dépenser tant d’adresse à se rendre maladroit? Un peintre célèbre de notre temps disait en présence de certaine chapelle: «La naïveté d’Amaury est celle d’une veuve de quarante ans, qui demande si les enfants se font par l’oreille.»
Cette réflexion vous reviendra sûrement en mémoire, si vous regardez son tableau du Sommeil de l’Enfant Jésus. L’artiste a trouvé péniblement des maigreurs, des petitesses, des lourdeurs archaïques, mais il a eu beau faire, on n’apprend pas la naïveté.
Il a exposé il y a deux ans un portrait de Mlle Rachel qui n’était ni beau, ni vrai, et que le jury aurait refusé sans la signature. C’est que le peintre avait sacrifié à l’art symbolique, qui est un faux dieu. Il avait voulu représenter du même coup la tragédienne et la tragédie, et peut-être même certain rôle de tragédie. Que de choses à la fois! les maîtres n’en font pas tenir autant dans un seul tableau. S’il avait fait tout simplement le portrait de Mlle Rachel, nous aurions peut-être un chef-d’œuvre de plus.
Une seule fois en sa vie, M. Amaury-Duval a pu satisfaire et concilier son amour du vieux et son amour du vrai, lorsqu’il a peint à Saint-Merri la légende de sainte Philomène. Mais il n’a été aussi heureux ni à Saint-Germain en Laye, ni dans sa chapelle de Saint-Germain l’Auxerrois. Il y a dépouillé la finesse de ses perceptions, il s’est brouillé avec la nature, et il s’est trompé d’autant plus infailliblement qu’il employait la fresque.
La fresque est spontanée, brutale, terrible. Elle n’admet ni la timidité, ni l’hésitation, ni la recherche du mieux, ni le repentir des fautes. Il faut réussir du premier coup, ou jamais. L’artiste qui aborde la fresque doit être sûr de sa main comme un soldat qui court au feu doit être sûr de sa conscience; il faut s’attendre à mourir sans confession. M. Amaury-Duval n’était pas l’homme de la fresque; il peint lentement, et achève un portrait de séance en séance.
Ce n’est pas ainsi que travaillent M. Ingres et M. Flandrin. Si M. Ingres fait un portrait en quatre-vingts séances, c’est qu’il fait quatre-vingts portraits. Il effacera demain tout ce qu’il a fait aujourd’hui, et il recommencera l’œuvre jusqu’à ce qu’il ait contenté son goût ou tué son modèle; mais le portrait qu’il a entamé ce matin est fini ce soir. Il ne se mettrait pas au lit s’il connaissait une tache dans son tableau. Il dit à ses élèves: «Vous pouvez mourir subitement; on peut apposer les scellés chez vous: il ne faut pas que les huissiers surprennent une lumière dans vos ombres, ou une ombre dans vos lumières,» Si l’on veut juger la facilité fabuleuse de ce génie laborieux, il faut jeter les yeux sur ses dessins. Les dessins de M. Ingres sont comme les lettres de Voltaire, qui valent mieux que ses tragédies.
Serons-nous encore dans le chapitre des portraits, si nous parlons du Christophe Colomb de M. Maréchal? c’est une question délicate. Ce Colomb, comme le Galilée de l’an passé, se fait une place entre le portrait proprement dit et le portrait symbolique. M. Maréchal n’a pas entrepris de représenter sur le papier une idée abstraite; il s’attaque à des hommes de chair et d’os, mais qui sont morts depuis longtemps et qui ne posent dans aucun atelier.
Un causeur de beaucoup d’esprit et de savoir, M. Feuillet de Conches, a publié dans je ne sais quelle revue un article fort intéressant sur les portraits de Christophe Colomb. On en montre partout, à Versailles, en Italie, en Espagne et en Allemagne: le malheur est qu’ils représentent tous des hommes différents.
La conclusion de l’auteur, si j’ai bonne mémoire est que l’inventeur de l’Amérique n’a été peint au naturel que par la plume de son fils. C’était une figure blanche, piquetée de taches de rousseur, et couronnée de cheveux roux qui blanchirent avant l’âge. Il est facile de voir que M. Maréchal n’a pas plus copié ce portrait-là que le portrait de Versailles. A quoi bon choisir entre sept ou huit peintures dont pas une n’est authentique? L’artiste a suivi la tradition, non pas la tradition de famille qui est peu connue, non pas la tradition des érudits qui est contradictoire, mais la tradition populaire.
Aux yeux de la foule, les martyrs de la trempe de Galilée et de Colomb sont des hommes solides, noueux, et tant soit peu rugueux. Les personnages de M. Maréchal sont donc ayant tout des traditions habillées. Admirablement habillées, on ne saurait le dire trop haut. L’aventurier qui n’était rien, qui a été tout, et qui est retombé dans une disgrâce pire que le néant, l’homme qui a trouvé un nouveau monde pour la Castille et pour Léon, por Castilla y por Leon, revient chargé de fers dans cette Espagne qu’il a faite si grande. Il traverse comme un malfaiteur l’Océan qu’il a conquis. Il va comparaître devant un juge, et c’est tout le triomphe que la reconnaissance des rois lui a préparé. Tout un poëme d’orgueil et de colère, de génie et de désespoir bouillonne sous l’écorce épaisse du grand homme. A la façon dont il se tord dans ses chaînes, on devine qu’il les fera ensevelir avec lui dans un cercueil, comme pour emporter au pays d’outre-tombe un monument de l’ingratitude des hommes. Cependant la mer indifférente glisse paisiblement le long des flancs du navire, et le soleil, qui a vu bien d’autres injustices, rougit les barrières de l’horizon.
M. Maréchal a rendu vigoureusement ce que nous avons tous dans l’esprit. Il a donné un corps sublime à la tradition populaire. Ce tableau de tribune, éloquent comme un discours de la rue, est digne de toutes les sympathies d’en haut et d’en bas.
Faut-il ajouter maintenant que M. Maréchal a élevé le pastel à la puissance de l’huile? Il lui a donné une intensité dont Latour serait tout ébahi. On peut dire qu’il a créé à l’usage des artistes de son temps un moyen nouveau, et pris un brevet de perfectionnement qui vaut un brevet d’invention. Je pense qu’il a poussé ce nouveau genre de pastel aussi loin qu’il peut aller. Il a fait comme Gay-Lussac, qui découvrait une loi et en tirait lui-même les dernières conséquences. C’est l’homme qui trouve un diamant et qui le monte lui-même, au lieu de le livrer au bijoutier.
Tous les accessoires de son Colomb, comme ceux du Galilée, sont rendus avec une sobriété, une franchise et une puissance qui les rendent éloquents et leur font jouer un rôle. Il y a là un coffre de bois que j’admire; et pourtant je ne suis pas plus Flamand qu’un autre. M. Maréchal vit loin de Paris et de ses succès, dans une solitude laborieuse, entouré de jeunes artistes à qui il enseigne ce que personne ne lui a appris. Nous le retrouverons dans ses élèves.