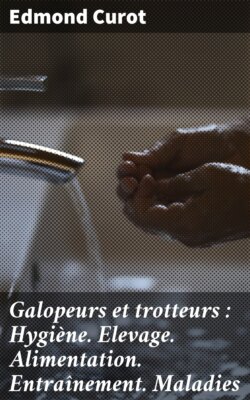Читать книгу Galopeurs et trotteurs : Hygiène. Elevage. Alimentation. Entraînement. Maladies - Edmond Curot - Страница 46
DE L’ALLAITEMENT MATERNEL
ОглавлениеComposition chimique et propriétés vitales du lait. — Bases physiologiques de l’allaitement maternel. — Détermination du bilan lacté. — Influence de l’alimentation sur le rendement lacté. — Hygiène de l’allaitement maternel.
On peut considérer que le jeune sujet a eu d’abord besoin de la protection maternelle pour être soustrait complètement à l’action du milieu extérieur pendant la période qui précède la naissance; puis ensuite, au début de sa vie, son appareil digestif seul a besoin que cette protection se prolonge, et la nature fait incomber à la mère cette sollicitude spéciale, en la chargeant d’élaborer elle-même, par son propre organisme, l’aliment du premier âge.
Ainsi l’allaitement est le complément de la gestation. L’allaitement naturel est le plus avantageux pour la mère et le produit; chez la mère, il écarte les accidents du côté de la mamelle et ceux d’origine pléthorique; le jeune trouve dans le lait l’aliment physiologique; de plus, dès le début de l’alimentation, le colostrum ne peut se remplacer.
Le premier aliment, le lait maternel, a une influence décisive sur la précocité ; les jeunes qui ont été les plus rapidement allaités sont toujours ceux qui, à l’âge adulte, atteignent les plus forts poids parce que leur aptitude digestive a subi une gymnastique fonctionnelle progressive. Rien ne peut faire regagner le temps perdu par un allaitement parcimonieux, les éleveurs ne devraient pas oublier ce précepte.
On peut poser en fait que toute femelle «bonne nourrice» donne toujours de bons produits, et il importe d’apporter dans la sélection des mères toute son attention aux caractères qui assurent chez elle l’existence d’une si précieuse qualité.
Dès le début, indiquons en nous basant sur des données physiologiques, la supériorité de l’allaitement maternel sur l’allaitement artificiel.
Dans l’allaitement maternel, le nouveau-né trouve un lait adapté à ses besoins physiologiques, la composition chimique variant avec les différentes périodes de l’allaitement; il profite surtout des ferments spécifiques (zymases), qui jouent un rôle prépondérant dans la digestion et l’assimilation.
Le lait, dans la pratique de l’allaitement maternel, est pris, — pourrait-on dire — aseptique; il est en effet démontré que sauf pour les premières gouttes qui proviennent des canaux galactophores et qui peuvent être souillées par quelques germes, accidentellement introduits par le mamelon, le lait provenant d’une mamelle saine est exempt de microbes.
Avant d’aborder l’hygiène de l’allaitement maternel, nous allons indiquer la valeur nutritive du lait et ses propriétés biologiques trop souvent méconnues des éleveurs. Le lait, d’après son analyse chimique, peut être considéré comme l’aliment complet et physiologique de la période du jeune âge.
Le nouveau-né trouve en lui tous les éléments dont il a besoin pour sen entretien et pour le développement de son organisme, et donné seul, en quantité suffisante, il peut, pendant longtemps, assurer la croissance normale.
Il importe donc que les mamelles de la mère fournissent au nouveau-né une assez grande quantité de lait. Du reste, il est rare qu’il n’en soit pas ainsi, au moins pendant la période initiale, car il est encore peu exigeant sous ce rapport. Deux litres et demi à cinq litres de lait, suivant leur taille, suffisent en général aux jeunes pendant les cinq à six premiers jours qui suivent leur naissance, et il est peu de juments qui ne soient alors en état de fournir cette quantité.
La digestion et l’assimilation faciles du lait, son état liquide, qui ne nécessite ni mastication, ni salivation préalables, ni aucune des opérations mécaniques qu’exigent les aliments solides,le rendent éminemment propre à l’alimentation des jeunes. En dehors des principes immédiats indiqués par l’analyse chimique, le lait renferme des ferments qui jouent un rôle important. On sait qu’il y a dans le lait des femelles des ferments solubles: une amylase (BECHAMP), une anaérozydase (DUFOUY), une lipase (MARFAN et Ch. GILLET), un ferment coagulant, la fibrine. Ces ferments ne sont pas les mêmes ou n’ont pas les mêmes caractères dans les laits de toutes les espèces; ainsi l’anaéroxydase est constante et très active dans le lait de vache; la lypase y est en quantité minime.
Ces faits montrent que le lait d’une espèce même corrigé au point de vue chimique ne pourra jamais, au point de vue strictement physiologique, remplacer le lait d’une autre espèce.
A côté des ferments spécifiques du lait, il est probable qu’il y en a d’autres communs à tous les laits ou qui peuvent du moins se suppléer dans une certaine mesure; — la possibilité de l’allaitement artificiel avec un lait étranger, en constitue une preuve.
En somme, le lait n’est pas un liquide inerte; ce n’est pas un liquide qui intervient dans la nutrition seulement par les matériaux chimiques; c’est un liquide vivant, capable, par ses propriétés biologiques, d’agir sur le développement et la santé des jeunes sujets.
Cette nouvelle notion a une importance biologique considérable, et nous verrons dans la suite le rôle important que jouent les enzymes du lait dans les échanges nutritifs des jeunes sujets. Parmi les propriétés vitales du lait, s’il en est de communes à tous les laits, il en est d’autres qui sont propres au lait de chaque espèce, qui sont spécifiques. Et ceci nous fait comprendre pourquoi on ne peut trouver dans le lait d’une autre espèce l’équivalent complet du lait d’une espèce et fait prévoir la fréquence des troubles digestifs dans l’allaitement artificiel.
L’organisme du nouveau-né étant encore inachevé la nature pourvoit à cette insuffisance fonctionnelle en préparant dans l’organisme maternel un aliment, le lait, qui remplit deux conditions: 1° d’être d’une digestion facile et par suite de ne pas exiger des ferments digestifs bien actifs; 2° de renfermer des ferments stimulateurs et régulateurs de la nutrition que les tissus du jeune n’élaborent pas en quantité suffisante.
D’ordinaire, l’affection maternelle est développée chez la jument qui vient de mettre bas; il est pourtant des exceptions. Dans toutes les espèces, les primipares sont généralement moins bonnes mères que les femelles plus âgées: le cas est assez fréquent chez les juments nymphomanes ou chez celles qu’on fait pouliner à un âge assez avancé.
Il est des poulinières que la présence de l’homme semble indisposer contre leur nouveau-né qu’elles accueillent à coups de dents et de pieds et qui finissent pourtant par se familiariser avec lui dès qu’on s’éloigne et qu’on les laisse seules.
Si la mère ne lèche pas convenablement son poulain, on pourra le saupoudrer de sel pour l’engager à le faire; si cette manœuvre reste sans résultat, on devra le sécher par des frictions exécutées avec un linge chaud ou un chiffon de laine, puis le couvrir.
En matière d’élevage, on peut affirmer que l’avenir du jeune sujet est intimement lié à un allaitement copieux et prolongé ; le rôle dévolu aux femelles nourrices pendant la période initiale de la croissance est donc prépondérant, et la formule «telle mère, tel produit», pourrait être érigée en axiome.
Les poulains résultant de «fortes nourrices» sont bien développés sous le rapport de la musculature, de l’ossature, de la taille, du pourtour thoracique, etc.; ceux provenant de «nourrices médiocres» sont malingres, chétifs et, malgré une hygiène sévère, ils fournissent un contingent élevé dans la morbidité et la mortalité du jeune âge.
La lactation doit être bien surveillée dans les premiers jours qui suivent la naissance; il faudra s’assurer si la mère a beaucoup ou peu ou point de lait; c’est ce dont on s’apercevra facilement d’abord au volume de la mamelle et des veines lactées et ensuite si l’on voit sortir du lait en excès par la commissure des lèvres du nouveau-né.
On ignore les limites entre lesquelles varie la quantité de lait sécrétée par la jument pendant les vingt-quatre heures; on suppose toutefois, en tenant compte des besoins nutritifs du poulain pendant la première période de l’allaitement, que la production journalière moyenne doit varier de 8 à 10 litres.
L’hyperlactation est d’une rareté exceptionnelle chez les poulinières de pur sang.
Néanmoins, il peut arriver, surtout dans les premiers jours de l’existence du jeune, que celui-ci ne puisse pas consommer, surtout s’il est atteint de débilité congénitale, tout le lait sécrété par la mère; dans ces conditions, on devra traire celle-ci partiellement, pour la soulager et éviter des complications inflammatoires. Cette précaution permettra également de remédier aux troubles digestifs (indigestion laiteuse) observés chez les sujets trop avides.
Le lait s’échappe quelquefois spontanément en dehors, c’est lorsque la sécrétion est trop abondante et qu’on néglige de traire les poulinières privées de leurs petits. Dans ce cas, les conduits galactophores et les sinus du mamelon sont tellement distendus que la compression à laquelle le liquide est soumis force la résistance de l’orifice de ce sinus.
L’hyperlactation correspond, sous le rapport de l’aptitude laitière, aux femelles «bonnes nourrices», qui en fournissant un allaitement copieux tant quantitatif que qualitatif, assurent le développement régulier et rapide du jeune sujet.
L’insuffisance du rendement lacté, l’hypolactation, cause fréquente de l’emploi de l’allaitement artificiel, peut être quantitative quand la quantité totale de lait journalière fournie est inférieure à la normale; elle est qualitative lorsque le lait sécrété dans les vingt-quatre heures est en quantité normale, mais présente une trop faible proportion de principes nutritifs. L’analyse chimique permet seule de conclure. Le plus souvent les deux causes existent, et pour combler l’insuffisance des matériaux nutritifs, l’allaitement mixte est indiqué.
Dans le cas d’hypolactation le jeune sujet ne présente pas les signes d’une maladie déterminée, mais la courbe de son poids est notablement au-dessous de la normale; la maigreur, conséquence de l’autophagie, s’accuse, le poil est terne, indices d’une nutrition défectueuse.
SIGNES INDIQUANT L’APTITUDE LAITIÈRE DES NOURRICES
Bien que cette question soit du domaine de la zootechnie, nous ne pouvons nous dispenser, vu l’importance du sujet, d’en faire une brève étude.
Les caractères indiquant l’aptitude laitière des poulinières ont trait à la conformation générale, à la finesse du tégument et au développement des mamelles.
La jument doit posséder au plus haut point tous les caractères de son sexe, sveltesse, élégance des formes, hanches écartées, bassin large, abdomen ample, poitrine mince, tête fine, etc. L’œil limpide et le regard doux seront les signes d’un caractère tranquille et indolent.
La réduction du squelette, la minceur et la souplesse de la peau, la finesse et le brillant des poils sont des qualités à rechercher.
Les renseignements fournis par la peau sont très utiles et ce sont à peu près les seuls dont on puisse disposer sur les primipares dont la mamelle n’a pas encore fonctionné et dont les formes corporelles n’ont pas encore acquis la régularité désirable.
Peau fine, souple, mobile, se détachant facilement des tissus sous-jacents, douce au toucher, voilà ce qu’il faut rechercher.
Une abondante irrigation sanguine de la mamelle est la raison physiologique d’un fonctionnement actif; le puissant réseau de veines superficielles, en fournissant la mesure de la quantité du sang qui sort, et par conséquent qui circule, nous apportera un élément d’appréciation de premier ordre. On les explore facilement en passant la main à plat sous le ventre et en suivant lentement les inflexions des vaisseaux.
Les trayons doivent être suffisamment gros et bien plantés de façon à ne constituer aucun obstacle dans l’allaitement maternel.
Il est élémentaire et toutefois indispensable de traire quelques gouttes de lait pour s’assurer que les canaux galactophores ne sont pas obstrués et que les mamelles fonctionnent bien.
Les anomalies des mamelles sont rares, et lorsqu’on les observe, elles sont dues, soit à une hypertrophie considérable du tissu adipeux péri ou intra-mammaire, soit au contraire à une atrophie plus ou moins avancée du parenchyme glandulaire.
Dans les retards de croissance, quand l’enquête ne permet pas d’incriminer le rendement lacté, il faut penser à la mauvaise qualité du lait et rechercher les causes capables de la déterminer.
Il y a des laits pauvres qui contiennent une proportion insuffisante de beurre ou de caséine et qui, par suite, ont une valeur alimentaire médiocre. Ils peuvent entraîner des arrêts de croissance par hypoalimentation.
Il y a des laits riches qui, inversement, renferment trop de beurre ou de caséine et peuvent provoquer, surtout si les rations sont un peu fortes, des troubles de l’appareil digestif.
Dans les deux cas, l’hygiène alimentaire de la mère pourra modifier les qualités du lait.
Parmi les causes d’origine maternelle capables de faire varier la composition du lait, citons la période des chaleurs.
A ce moment, par suite de l’action génitale sur les grandes fonctions, la sécrétion mammaire est modifiée. Au point de vue quantitatif, on observe une diminution, quelquefois un tarissement presque complet.
L’analyse chimique ne révèle pas de modifications qualitatives; et cependant le lait des vaches en chaleur a éprouvé des changements sensibles dans ses propriétés, à en juger par son odeur forte et son altération rapide. Il y a, certainement, à cette période, élimination par la mamelle de certaines toxines: et ce sont elles qui produisent des accidents gastro-intestinaux chez les jeunes sujets.
Pour les mêmes raisons le lait provenant des vaches nymphomanes ou taurelières, ne sera pas utilisé pendant la période de l’allaitement artificiel.