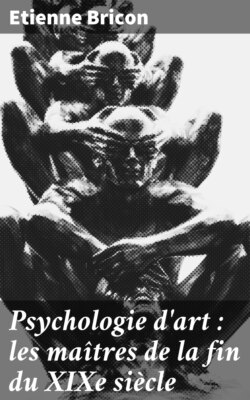Читать книгу Psychologie d'art : les maîtres de la fin du XIXe siècle - Etienne Bricon - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L’EXALTATION DE LA VIE
ОглавлениеM. Roll aime passionnément la vie: il l’exalte en sa pensée et sa préoccupation de la traduire est constante; l’animation des êtres dans la nature animée l’attire.
La vie, c’est la sève. C’est tout ce qui respire et tout ce qui s’agite, ce qui chante et ce qui bruit, c’est le perpétuel devenir et la perpétuelle mobilité : le souffle passe et les êtres s’animent, et tout vibre autour d’eux. La vie ininterrompue s’exprime en de continuels ondoiements. Chaque mouvement est un désir; il est une aspiration vers l’instant prochain, d’où nous sommes emportés sans cesse vers l’instant qui doit le suivre. Et toujours les printemps renaissent. Passionné pour cette vie qui est la joie et qui en se dérobant devient la douleur, M. Roll l’a poursuivie de tout temps, anxieux de la saisir, ambitieux de la peindre.
Il devait avoir au cours de cette époque-ci le plein épanouissement de sa force. Né à Paris en 1847, il a, lors de ses vingt ans, surmonté dans son âpre conviction des résistances de famille, craintives et obsédantes; et il traverse l’atelier de M. Harpignies, passe quelques mois à l’Ecole des Beaux-Arts sous l’autorité de M. Gérôme, un peu plus longtemps s’arrête chez M. Bonnat. Mais sa nature vigoureuse et indisciplinée était mal faite pour accepter une tutelle. Après avoir débuté au Salon de 1870 par un paysage du soir, il expose en 1874 Don Juan et Haydée, tableau fait de souplesses, dans la manière de l’élégant Baudry qui peignit de si charmante sorte le mouvement du second Empire, et, en 1876, la Chasseresse, où la vie déborde. Déjà conscient de sa puissance et maître d’elle, il va. chercher cette vie qu’il aime dans l’individu et il va la chercher dans la foule.
La vie individuelle se présente à nous sous deux aspects: tantôt elle est le passant anonyme de qui nous ne retenons qu’un mouvement, tantôt l’être que nous voulons approcher en abordant sa personnalité. Mais ces deux aspects peuvent se confondre parfois, et sans doute il est plus juste de dire que nous considérons dans un individu soit un mouvement isolé, soit sa personnalité même. Ainsi dans la vie quotidienne, comme dans les œuvres de l’esprit, nous ne percevons et ne retenons des comparses d’arrière-plan qu’un signe unique; mais, à mesure que leur importance grandit et qu’ils s’avancent dans le champ de notre vision, nous saisissons un nombre toujours plus grand de leurs mouvements, jusqu’à ce que nous les observions dans leur entière physionomie: au surplus le peintre n’arrive à ce point extrême que dans le travail du portrait où une vérité individuelle doit s’affirmer. Alors qu’une forme aperçue lui suffit à indiquer une figure de fond, il augmente, pour donner à son personnage une signification plus grande, la réalité de son modèle; mais si précisée qu’elle devienne, celui-ci garde toujours quelque chose d’indéterminé, — parce que quelque chose d’inexprimé reste en lui, — jusqu’à ce qu’il pose pour le portrait, car ce dernier seul exige nécessairement la représentation essentielle d’un être, que le peintre doit comprendre de toute la pénétration de ses yeux et avec toute leur acuité.
M. Roll a étudié la vie dans l’homme, qu’il passe ou qu’il demeure. Regardant des individus quelconques qui ne- lui sont que des exemples, il ne s’intéresse pas à leur seule agitation, car il sait ce que le calme peut donner à la vie d’intensité, mais il exprime leur existence telle qu’elle se propose, bruyante ou muette, dans une série de représentations qui va de la Fête de Silène au Vieux Carrier. La Fête de Silène est l’Animation véhémente, le désordre des bacchantes folles de se sentir vivre, tournoyant dans l’exaspération de leur mouvement autour du vieillard imbécile: au Salon de 1879, elle sembla un hurlement de vie. Trois ans plus tôt, M. Roll avait exposé cette Chasseresse, dans l’élan de sa fougue emportée sur un cheval blanc qui se cabre, tandis que ses grands lévriers attaquent une panthère, — insoucieuse d’être une déesse dans sa satisfaction d’être une femme. Avec une égale ardeur il s’attache à la vie calme, dont l’énergie se repose, la cherchant dans Femme et Taureau, où une jolie fille sourit en sa souple jeunesse, appuyée mutinement contre l’énorme tête de la bête brutale; et dans l’Eté. où de jeunes femmes parmi des herbes folles causent auprès d’enfants qui s’ébattent; et dans la Manda Lamétrie, fermière, du musée du Luxembourg, saine paysanne à la vie tranquille, qui porte avec sa vigueur lente un seau de lait sous l’envahissante frondaison des arbres; et dans le Vieux Carrier, immobilisé en son hébétude.
Bien plus, mis en présence de ces individus qui pourraient n’être que des indications de vie, M. Roll s’intéresse à eux et, curieux de leur personnalité, il les note dans leur réalité complète; tels titres de ses tableaux sont dans cet ordre d’idées singulièrement suggestifs: à côté de Manda Lamétrie, fermière, voici Roubey, cimentier, voici Marianne Offrey, crieuse de vert, voici la Femme Ragard, voici Louise Cattel, nourrice. Comme il estime que c’est la manière la plus certaine de se rapprocher de la nature, il étudie son modèle jusque dans la vérité du portrait; mais, avec quelque précision qu’il l’observe, préoccupé seulement de faire un «morceau» vrai et vivant, il ne saurait, en Copiant une forme, arriver jusqu’au portrait même, Puisque celui-ci comporte essentiellement l’idée de rechercher dans un individu tous les éléments propres à en donner l’expression subjective.
D’ailleurs, si l’on se place au seul point de vue de l’art, le portrait est avant tout un exemple d’huma nité : il doit donc présenter la plus grande somme possible d’humanité, prenant son importance par la quantité des éléments d’expression. Sans doute le plus insignifiant des êtres fournit déjà un document humain; mais cet intérêt initial croît à mesure que la sensibilité et l’intelligence se développent et que la physionomie devient plus mobile en des plans qui se multiplient, ou bien encore lorsque la beauté se présente dans la perfection de la forme; et l’intérêt est capital à un certain moment. C’est ainsi que M. Roll, manieur magistral de la vie, a représenté Jules Simon, Alphand, Alexandre Dumas fils, et aussi M. Yves Guyot et M. Rochefort: Alphand qui marche, Alexandre Dumas, inachevé, qui pense, saisissant en sa sobriété profonde, dont l’énergie vibrante est contenue et comme enveloppée. Et il peint des portraits de femmes, de celui de Jane Hading à celui de Mme Waldeck-Rousseau, adoucissant et assouplissant sa vigueur pour les féminines délicatesses, percevant la troublance de leurs yeux. Et encore le beau portrait de l’Enfant à cheval, élégant, animé, emballé, joyeux, en course vers l’horizon qui s’aperçoit et pour la vie qui s’ouvre.
Ce que M. Roll aime dans l’individu et ce qu’il veut surprendre en lui, il l’aime et il le poursuit dans la foule, cette mêlée d’individus qui est un monde de vies. La foule est faite parfois de multitudes, parfois un petit nombre suffit à la composer: c’est par la fusion des existences qu’elle se détermine. La foule est remous et tourbillon; elle ressemble aux éléments en marche, au fleuve qui déborde ou au vent qui gronde. Elle est le tumulte, elle est le vertige. Toujours elle se laisse emporter par quelque contagion, enthousiasme ou haine, effroi ou joie; ou plutôt elle est l’âme commune de plusieurs. Et lorsqu’elle passe, on sent le souffle populaire passer: la foule en mouvement est toujours peuple. Le peuple, c’est le grand anonyme fait de myriades d’êtres, impersonnel et indéfini, énorme dans son activité, admirable en son endurance, Mobile comme la mer qu’un coup de vent soulève, susceptible d’être détestable dans ses naïves impressions et de prêter son intelligence d’enfant à tous les malfaiteurs de l’idée, capable surtout d’être bon, vigoureux et magnifique.
M. Roll a la sensation de la foule; et dans son œuvre il en exprime la beauté. Avant lui, Courbet avait peint des réunions de personnes, non des foules; et si l’on s’arrête auprès des maîtres d’autrefois qui ont représenté la cohue humaine, — très peu nombreux et Presque tous très grands, — du prodigieux Michel-Ange, qui, dans le Jugement dernier, a remué des Mondes, au bouillonnant Salvator Rosa, qui ne cherche dans les masses que leur impression de confusion, on observera qu’ils ont tous représenté la cohue des hommes par transposition et par imagination: jamais un peintre florentin n’a noté la turbulence du peuple sur la Signoria, ou joyeuse ou menaçante, dans un temps où cependant elle était formidable. Aussi bien est-ce la une idée moderne que les goûts des artistes du passé ne leur avaient pas permis de concevoir. Sans doute des foules se meuvent dans les épopées d’Homère, et aussi sur les frises du Parthénon, mais c’en est d’héroïques, imaginées par des génies grandioses qui s’approchent de l’âme du peuple pour lui demander des inspirations; sans doute des foules passent dans Shakespeare et dans Rembrandt, mais perçues seulement par la divination du génie: l’idée exacte en reste moderne.
Le premier parmi les peintres, M. Roll l’a exprimée — avec une sûreté telle et une telle puissance que son originalité en demeure unique, cependant qu’elle se montrait vers le même temps dans les livres de M. Zola. Chez l’auteur du Centenaire du 5 mai comme chez celui de Germinal, il y a une sensation du mouvement populaire née de la compréhension du peuple-individu et de la compréhension du peuple-masse, plus puissante chez M. Zola, plus juste chez M. Roll. Les foules bondissent, rieuses ou grondeuses, les foules s’étendent, les foules remplissent les yeux. Il faut avoir regardé se mouvoir dans l’animation de l’usine ou l’agitation de la rue cette marée humaine de têtes et de corps, tous divers et tous unis, pour saisir la vérité et la vie des toiles peintes de M. Roll, où chaque geste particulier est une indica tion du mouvement général. Alors, dans le Chantier de Suresnes, l’on voit passer vraiment le monde qui travaille au vacarme des outils et parmi la hâte de la tâche; dans la Guerre, la troupe des soldats inquiets qui marchent à travers la plaine immense voilée de fumée vers l’horizon inaperçu; dans la Fête du 14 juillet, la multitude qui s’amuse, fouettée de musique, au milieu du tumulte des cris et des désirs, tandis qu’un chef d’orchestre, dans une mesure endiablée, semble lui jeter le plaisir à pleines mains; dans le Centenaire, la foule aux bras levés qui s’enthousiasme en des trépignements, cependant que les eaux royales du bassin de Neptune lancent au clair soleil de mai leurs fusées vers le ciel.
Exaltation, exultation. La joie de vivre éclate dans cette aspiration continue à la vie, des jeunes femmes de l’Eté qui en goûtent doucement la douceur, et de Manda Lamétrie, fermière, qui en subit inconsciemment la volupté, jusqu’aux bacchantes exaspérées qui en veulent l’affolement. Des tressaillements passent. Et le peintre trouve une formule de sa pensée dans le titre de sa décoration de l’Hôtel de Ville, les Joies de la vie: des fleurs, des femmes, de la musique, les courses libres à travers l’espace, l’enchantement de la nature forte et charmante. Et son œuvre chante un hymne à la Vie.
Nous vivons dans l’air et nous vivons de l’air: il est le milieu essentiel où nous existons et dont chaque aspiration nous anime, faible et rare dans les intérieurs, riche et envahissant au ciel ouvert; nous sommes inséparables de lui. M. Roll regarde les êtres dans cet air qui les enveloppe, qui a, pour immatériel qu’il paraisse, sa couleur aussi bien que sa saveur et son parfum, et dont la réfraction comme l’intensité, toujours diverses, modifient incessamment notre aspect. Il le veut, à travers l’espace libre, donnant à chacun sa plus grande vigueur et son plus grand éclat; et le goût passionné qu’il en a naît ainsi naturellement de son goût de la vie. Ses tableaux d’intérieur sont tout à fait rares; la plupart de ses portraits même sont composés «au dehors» : tel celui du paysagiste Damoye, sortant de la gare Saint-Lazare, dans l’atmosphère d’une place publique; tel celui d’Alphand, surpris dans la rue. Il aime la nature avec tout ce qui vit en elle, les feuilles, les blés et les fleurs, les oiseaux qui volent ou les bœufs qui marchent, l’enfant, l’homme et la femme; et il l’aime dans l’air qui la baigne. Ses paysages sont une partie vivante de ses tableaux; il s’y attache et il entoure ses modèles d’une nature qui les vivifie, juste et puissante: tels ces champs de la Guerre qui sont, disait alors le critique de la Gazette des Beaux-Arts, «un des plus beaux paysages du Salon». Au surplus, M. Roll a toujours eu le désir du » paysage», depuis son premier tableau et depuis son premier maître, M. Harpignies. Et il a gardé le long de sa vie la passion du plein air, de l’atmosphère changeante que l’éclairement du soleil transforme sans cesse, se plaisant à ses états multiples, curieux même de la lumière des aubes en des études saisissantes de jour encore voilé.
Un tel amour de l’air et de la lumière, où s’affirme sa Personnalité et qui est la manifestation de son tempérament, a été déterminé aussi par l’influence des idées ambiantes et des études de son temps. Après les litres de 1840, amoureux déjà de la vraie nature, mais en poètes, étaient venus les impressionnistes chercheurs de la vérité de l’atmosphère, qui, restés impuissants dans leur tentative grandiose, devaient éclairer les peintres de la génération nouvelle et montrer la route à Bastien-Lepage, à M. Roll. Manet et M. Claude Monet étaient dans le plein élan de leur œuvre quand M. Roll commença de peindre. Il apprit d’eux à regarder l’espace et la vie, et il observa le mouvement des êtres et les mobilités de l’air; mais il en demeura profondément différent par la conception de l’art qui est pour lui, non une reproduction, mais une représentation vivante du monde; et, tout en s’attachant éperdument à en exprimer l’entière vérité, il donna aux choses qu’il vit l’interprétation particulière de son intelligence. Tandis que les peintres de figures impressionnistes, entraînés vers les brutalités de l’existence par leur goût de la réalité voyante, s’attardent souvent à la vie basse dans une sorte d’impuissance à la saisir plus haute, M. Roll la prend comme elle vient à lui, désireux de ses énergies et de ses beautés, sans vouloir trouver en elle, qui est une assez grande donneuse d’enseignements, autre chose qu’elle-même, — que ce soit les Joies de la vie qu’il peigne ou une Grève de mineurs. S’il étudie une femme à sa toilette, délaçant son corsage de bal, avec la chambrière qui se tient auprès d’elle, alors que M. Degas, qui reste un très grand artiste, l’eût voulue, dans sa violence de satirique, laide et méprisable, lui, trop respectueux de la vie pour s’en moquer, la note dans la simplicité de son mouvement habituel; et voilà que son œuvre en devient plus réelle. — Dans l’animation de la nature, il fait vivre l’individu et il fait vivre la foule.
Une idée a guidé constamment l’effort de M. Roll: la défiance de l’art, par amour de la vie. L’art est un danger: les artistes primitifs de tous les pays, qui n’avaient que des maîtres éloignés, les Italiens interrogeant les Byzantins, les Flamands interrogeant les Italiens, demandaient à la nature elle-même de les instruire; mais comme les tâtonnements de leur inexpérience avaient besoin de règles et de théories, maîtres sont venus et avec eux les écoles; et les temps académiques ont commencé. Assurément une école créait une atmosphère intellectuelle, mais bientôt trop respirée et vite étouffante, et les élèves affluant autour des maîtres ne demandaient plus guère à la vie que des références. Celui d’ailleurs qui donne une leçon doit savoir et comprendre plus que pouvoir, car, s’il est puissant, il attirera son élève et l’absorbera aux dépens de la nature: Raphaël a besoin de toute sa force pour se dégager du Pérugin. Alors que l’art est une lutte idéale entre l’homme et la vie, le maître n’a qu’à fournir à son élève les armes ou les outils qui lui sont nécessaires, puis il le laisse seul en face de la realité ou du rêve.
Les musées en leur magnificence sont redoutables encore pour l’artiste, s’il ne sait leur demander ce qu’ils lui doivent apprendre et s’il se laisse emprisonner par eux loin de la nature: le musée devra affiner le sentiment qu’il a du beau et, l’excitant à créer, être pour lui une provocation, non une inspiration; autrement, son influence est pernicieuse. Ni le maître ni le musée ne doivent détourner l’homme de la vision des choses.
Aussi M. Roll s’est-il de bonne heure éloigné de ses litres et, malgré la vigueur de son tempérament, il a redouté le charme des musées longtemps, témoignant à leur égard une crainte faite de son admiration du passé. Jamais encore il n’a voulu aller en Italie, le pays voluptueux, la terre saturée d’art, dont le soleil d’ailleurs n’appelait pas son génie; et il s’est cherché lui-même dans les pays du Nord, goûtant au reste par dessus tous lés autres le voyage de la vie de chaque jour à travers les rues. Il s’effrayait à la pensée de trouver dans l’Italie enchantée l’œuvre partout présente, obsédante, et de subir quelque puissante et insensible influence qui l’eût détourné de sa vision.
La vie doit être vue, et elle ne se laisse voir qu’à celui qui sait la regarder. Le monde extérieur s’offre à nous incessamment, mais nous ne le saisissons qu’avec des sens que l’éducation et l’habitude prédisposent; nous n’apercevons le plus souvent en lui que des choses que nous reconnaissons sans les connaître parce que nous ne savons pas les distinguer, — miroirs vivants qui prenons une image sans recueillir une impression. C’était un principe du grand Flaubert que nous devons fixer l’objet que nous rencontrons jusqu’à avoir de lui une idée qui nous en soit personnelle. Chaque spectacle en effet est divers pour chaque être, et non seulement la différence de nos tempéraments rend pour chacun de nous les choses différentes, mais la même chose vue par les mêmes yeux à deux instants est dissemblable, car l’homme change: c’est ce que le plus grand nombre ignorent, ou ce à quoi ils omettent de Penser, satisfaits superficiellement, et ne donnant ainsi à leur personnalité qu’un développement incomplet. Que ce soit une femme qui apparaisse en sa mobilité fugitive, ou les formes muettes d’un monument de pierre, ou des champs de blés d’or piqués de coquelicots rouges, ou la mer vaste jusqu’à l’horizon, nous devons regarder l’objet qui se présente comme si jamais personne avant nous ne l’avait fait; nous devons l’examiner, fût-ce une seconde, fût-ce une heure, rechercher sa forme, son mouvement, sa vie; mais la plupart ne sont habitués à voir que par les yeux des maîtres, c’est-à-dire par ceux des autres. Nous devons ouvrir sur la nature nos propres yeux grands et profonds. Ainsi fait M. Roll dans son travail de chaque jour; entraîné à observer la forme, il l’examine au moment où il va peindre et, la prenant de son regard, il se met à l’œuvre; et chaque fois que l’impression est traduite, il revient à la forme comme pour y puiser de la vie. Au reste, si amoureux d’elle que, à cinquante ans passés et après avoir conquis son art jusqu’au sommet, il se fera sculpteur pour la mieux tenir dans ses doigts.
Avec une telle manière de penser et de voir, M. Roll devait, lorsqu’il aborda la peinture officielle, y apporter la nouveauté révolutionnaire: le Centenaire du 5 mai 1789, qu’avait du reste préparé la Fête du 14 juillet, est un événement dans l’histoire de la peinture. Jusque-là la convention avait inspiré et réglé constamment la représentation des fêtes publiques dont les auteurs ne retenaient que l’apparat solennel sans y saisir le mouvement humain; et alors qu’on n’avait peint encore que les gestes de l’État, M. Roll peignit les gestes du peuple. Les idées de son temps le lui permettaient, et il put laisser éclater, au scandale de quelques-uns seulement, son besoin d’exprimer la vie. La peinture officielle, triomphe de l’attitude convenue et apprêtée, avait été celui aussi de la ligne académique, bien faite pour rendre une telle pose, — car la ligne n’existe pas dans la nature qui ne présente que des plans, et si elle est un procédé utile aux artistes, elle ne doit leur servir que d’indication, non d’expression. M. Roll, qui a la crainte de tous les académismes, — quand il exécute un tableau officiel comme lorsqu’il peint une fermière auprès de sa vache, — ne dessine pas des lignes, mais des formes; et il anime ses personnages par la seule vérité de leur mouvement surpris, puisque tout personnage s’anime, même s’il est officiel. Il représente la nation en fête célébrant à Versailles, Parmi des discours de ministres, le centenaire d’une tentative illustre dans un décor royal, en la jeunesse revenue de la printanière nature de mai, et tout vit, tout s’enthousiasme, tout déborde; et au palais de Versailles, dans l’ancienne salle du Sacre, l’immense tableau placé en face d’une œuvre de David, le solennel et l’impeccable, n’en trouve pas sa puissance atténuée. Il peint le «souvenir commémoratif» du pont Alexandre III, où, tandis que la foule des fonctionnaires se masse, empressée, derrière l’Empereur et le Président, la blanche théorie des jeunes filles, entourée d’air et d’espace, s’avance en une marche lente vers l’Impératrice, femme souriante et auguste.
M. Roll a la conception d’un art délivré des habitudes et, le voulant tel, il se détourne violemment d’un autre art qui est sous toutes ses formes celui des conventions. Et il lutte contre l’enseignement officiel, fait de l’inintelligente répétition du passé, où la vie ne s’enseigne pas; où les maîtres ambitionnent, en une exubérance de fol amour-propre, de donner à leurs élèves autre chose qu’un métier; où ils leur livrent, s’ils sont impuissants, les manières et les formules traditionnelles jetées toujours les mêmes aux esprits les plus divers, usées seulement d’avoir tant servi déjà, et leur imposent, s’ils sont forts, une écrasante personnalité en se flattant de faire d’eux des imitateurs; où enfin les jeunes gens oublient — ou plutôt ne savent jamais, car personne ne le leur apprend, — que, avant d’être un peintre, il convient d’être un homme.
Ainsi dédaigneux des routines et des pensées mortes, en tous ses désirs, en toutes ses œuvres, M. Roll exalte la vie.