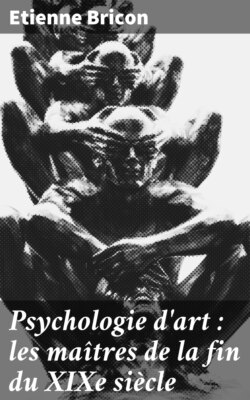Читать книгу Psychologie d'art : les maîtres de la fin du XIXe siècle - Etienne Bricon - Страница 17
LA PITIÉ HUMAINE
ОглавлениеL’amour de M. Roll pour la vie qui rayonne est doublé de pitié pour la vie qui souffre: un tel sentiment des choses donne à son œuvre, dès lors pleinement humaine, un caractère singulier de grandeur et il est une marque définitive de sa modernité. Lui qui, vigoureux, s’éprend de passion pour la vie chantante et triomphante, à la manière d’un géant bienfaisant il se prend de tendresse pour elle quand elle est vaincue.
Il aime la vie dans sa plénitude. Il ne la goûte pas à la manière des païens de Baïes ou de Tibur qui se plaisaient à se laisser exister en un abandon d’eux-mêmes et dans l’oubli des autres: chez eux, étant Une volupté, elle était un luxe; chez lui, elle est une force. Il en a le goût actif et il ne s’attache pas à elle Pour le plaisir qu’on y prend, mais pour l’énergie qu’on y dépense. Elle devient, lorsqu’on la détermine ainsi, le moteur de l’individu, qui le fait se développer dans son essor physique et dans sa volonté de comprendre et d’aimer: elle est l’expansion commune et concertante de tous les êtres, et il n’y a pas en elle l’égoïsme de la jouissance, car elle est l’harmonie. Aussi ce goût actif du maître qui lui fait aimer la vie universelle, le fait souffrir de tout ce qui la diminue. Il voit la vieillesse qui la reprend, il voit la misère qui la ronge, il voit la douleur qui l’étouffe, et il s’afflige de la vieillesse, de la misère et de la douleur, parce qu’elles sont des diminutions de la vie: l’être, atteint de la sorte, perd quelque chose de lui-même, et, amoindri par la souffrance, ne peut plus rien pour son développement, s’il ne se trouve soutenu par un peu de cette énergie qui est de la volonté accumulée; il manque de forces pour la lutte et, à moins que dans une crise la douleur aiguë ne l’excite à se redresser, il est sans pouvoir. La souffrance, c’est l’existence vaincue: M. Roll, par sa conception d’une vie agissante, devait nécessairement la comprendre. Au reste une pareille intelligence n’est pas aussi commune qu’on le semble croire, car les hommes qui ont de la vie une notion passive et égoïste n’y sont pas disposés: ils ne voient la douleur qui frappe devant eux ceux qui les entourent que sous la forme d’un inconvénient; ils n’éprouvent pas ce qu’elle a de condoléant et d’universel, et par conséquent ne peuvent ressentir pour elle de sympathie vraie. En comprenant la souffrance, M. Roll est singulièrement préparé à la sentir, et violemment il le fait avec tout ce qu’il y a de tendre dans sa nature. Il en tient donc le sens, profond en lui, — puisqu’il en a le sentiment avec la compréhension, — ce sens qu’on appelle la pitié.
La pitié est une impression générale que nous recevons à la vue des êtres souffrants et qui nous attire vers eux, appel entendu de tout ce qui manque de vie ou de beauté ; et nous avons de la pitié pour les choses encore: nous en avons pour tout ce qui est désolé. Cette perception de l’universelle souffrance se manifeste en nous diversement selon la diversité de nos idées et de nos tempéraments: elle devient en se réalisant, tantôt de la charité, tantôt de la miséricorde, ou de la clémence, ou de la compassion; chez les inactifs de la mélancolie. La pitié vient de ce que nous sommes des hommes et que rien d’humain ne nous est étranger, de ce que nous vivons sur la terre et que toutes les choses de la terre nous touchent. Par elle, nous nous intéressons aux êtres qui sont faits comme nous, qui ont les mêmes sens, les mêmes désirs, les mêmes emplois, les mêmes aspirations; aux animaux qui comme nous ont la vie, cette double faculté de sentir et d’agir; aux fleurs qui s’animent aussi en leur fragilité exquise; à la nature entière qui est notre bien et de sa variété incessante nous enveloppe incessamment. C’est le sentiment d’une immense communauté qui nous lie à tout ce qui existe, en nous attachant le plus profondément à ce qui nous approche davantage; car nous sentons surtout ce que nous voyons, et la vision reste le grand pourvoyeur de notre sensibilité : la pivoine rose aux pétales odorants qui s’effeuille à nos yeux nous émeut plus que la lointaine et inconnue mousmé qu’a étranglée au Japon son mari d’un mois. Ainsi la pitié nous entraîne; et les hommes nous semblent d’autant plus humains que nous passons plus près d’eux.
La pitié de M. Roll, née d’une fraternité qu’il accepte entre les hommes et lui, est active comme sa nature, car il aime ce qui souffre et tout amour est une action. Il ne s’attendrit pas, mais en homme fort, au cœur et à l’esprit mâles, il éprouve pour les malheureux une sympathie vraie faite de l’intelligence de leur mal et de son union d’âme avec eux; et la forme de sa pitié est la compassion. La compassion est un bienfait et, ainsi que tout ce qui vient de l’amour, elle est un bienfait d’une portée double, rendant meilleur celui qui l’éprouve et moins triste celui qui l’inspire. L’homme qui peut se dire d’un autre homme: «Il entend ce que je souffre», est du même coup soulagé : l’incompréhension qu’a de lui le monde qui l’entoure accroît la désolation du souffrant. Nous avons beau vouloir nous isoler fièrement et repousser la compassion qui vient à nous, dans l’orgueil de souffrir seuls, ou par une pudeur de nous laisser trop voir qui est surtout une crainte de n’être que mal vus, nous avons besoin de pitié quand nous souffrons. A la vérité ce qui nous est pénible et redoutable, c’est la curiosité des uns qui se distraient avec notre douleur ou la banalité des autres qui la regardent en passant; mais la compassion nous est toujours bonne, parce qu’elle est la pitié qui égale notre souffrance: en matière de sentiment surtout, «comprendre, c’est égaler», ce qui veut dire non pas jouir ou souffrir à l’égal de celui qui jouit ou qui souffre, mais se mettre à son niveau, être vraiment à son côté et voir les choses d’un même point de vue. L’on se rapproche, dans cet état d’âme, de tout affligé et on lui tend la main, car ce n’est pas à celui qui souffre à demander son aide à celui qui possède pleinement la vie, c’est à celui qui est heureux à l’offrir à l’autre. Tel apparaît le sentiment de M. Roll, et chacune de ses œuvres qui montre l’humaine misère nous excite à être des compatissants. Sa pitié ainsi se trouve singulièrement différente de celle de M. Zola, remueur de foules comme lui et descripteur puissant et magnifique des affres de la vie, parce que celui-ci s’intéresse aux êtres souffrants, mais ne les aime pas, et que la pitié qu’il a reste indécise et générale, sans forme déterminée, sans application humaine : M. Roll aime ceux qui souffrent et il semble les consoler en les aimant. Et la consolation, c’est la vie partie qui nous revient: tout passe, surtout la tristesse, car nous avons besoin de vivre, et dans nos larmes nous nous réjouissons d’un sourire d’enfant, d’un chant d’oiseau, d’un rayon de soleil.
M. Roll, qui éprouve déjà la sensation de la foule, a en même temps celle du peuple dont la vie immédiate, vigoureuse, sans atténuations et sans apprêts, l’attire; il se passionne pour cet être impulsif, plein de grondements et plein de douceurs, qui nous entoure de toutes parts et que parfois nous oublions de voir; et aux misères compliquées et délicates, quoique terribles, des gens riches, il préfère les misères simples et brutales du peuple vers qui sa compassion s’en va.
Il peint l’Inondation dans la banlieue de Toulouse, où des malheureux, réfugiés presque nus sur le toit de la chaumière que l’eau montante va submerger, sont terrifiés devant la mort qui passe et pris dans leur désespoir d’une surexcitation de vivre, la mère effarée tenant ses trois enfants, tandis que le père jette en avant son corps vers la barque approchante en regardant éperdu de ses yeux relevés la femme et les petits; et l’on sent que l’artiste, touché par la détresse de ces éplorés, s’efforce vers eux avec leurs sauveurs, et qu’il veut empêcher de mourir des êtres si âprement désireux de la vie.
Il peint une Grève de mineurs, — cet homme sans souliers, assis les coudes aux genoux, le ventre et les yeux vides, qui se demande avec hébétement ce que son lendemain va lui donner, et cet autre qui vient d’être arrêté et, immobile auprès de la femme qui allaite épouvantée de défiance, tend ses mains soumises aux menottes du gendarme, et ce vieux qui regarde de travers et se tait parce qu’à penser tout haut il irait en prison, — et encore cette femme inquiète pour son homme et qui veut l’empêcher de lancer la pierre imbécile qui cassera quelque chose; il évoque dans la lugubre atmosphère qui les glace et les étouffe ces frissonnants et ces vaincus, et il est comme au milieu d’eux, non pour les exciter dans une haine qui ne leur est qu’une douleur de plus, mais pour les comprendre et en adoucir leur souffrance.
Il peint l’Exode, — des ouvriers de la terre marchant à la clarté laiteuse de l’aube vers l’inconnu de l’heure suivante, la mère au sein épuisé serrant lamentablement son enfant contre elle, le père baissant la tête patient dans son habitude de souffrir, tous les deux allant à la recherche d’une terre bienfaisante qui les nourrira: l’on imagine qu’il les aimé et qu’il marche auprès d’eux le long du dur chemin; et il s’arrête ensuite avec eux quand ailleurs ils se reposent un instant sur la route, l’homme toujours debout, sa tête toujours baissée, puissant et beau dans sa résignation qui jamais ne désespère. Ce ne sont pas là les paysans de Millet calmes dans leur tâche quotidienne et satisfaits de la terre qui les garde sains, forts et bons: les ouvriers de la terre de M. Roll sentent l’existence leur manquer et ils sont, comme tous les malheureux, des chercheurs de vie.
Ainsi s’exprime sa pitié par la représentation intelligente et tendre de ce qui souffre; et il arrive là au moyen du fait, non de l’idée, parce qu’il est un réaliste. Devant lui, indéfiniment, la souffrance passe comme passe la vie; et il observe chaque être dans sa forme particulière en s’intéressant à chacun de ses gestes, car il veut, non imaginer, mais voir. Certes il n’a pas le dédain de l’idée, qui est la grande meneuse des hommes; mais pour lui chaque fait la porte en soi, et elle est inséparable du mouvement qu’elle suscite: il n’a pas le goût des abstractions.
Comme tout doit lui servir d’enseignement, il apprend à voir, à comprendre et aussi à aimer ceux qui, l’esprit plein de pensées ou le cœur plein dé désirs, tournent autour de lui dans le tourbillon humain. Il arrive à tenir de la sorte par l’analyse le monde extérieur en étudiant ses détails et notant ses particularités: analyser, c’est manier des yeux. Puis quand il a cherché les parties d’un tout, les éléments d’une existence, quand il connaît la réalité, il comprend qu’elle ne peut être présentée directement que dans le seul morceau d’étude, et il peint des modèles de vie individuels, ce Vieux carrier ou Marianne Offrey, crieuse de vert, qui sont d’admirables notes prises par un maître amoureux de la vérité ; et alors qu’elle ne peut être immédiatement transportée dans l’œuvre, il l’y transpose en l’interprétant et la simplifiant. Que ce soit la douleur de souffrir qu’il dise ou la joie de vivre, la Grève ou le Centenaire, la Guerre ou la Fête du 14 juillet, les Ouvriers de la terre ou bien l’Enfant à cheval, il interprète et il simplifie; dans la foule il recherche l’individu, dans l’individu le geste, qui en soient les expressions, et il élimine ce qui est inutile à l’œuvre. De ses yeux habitués à voir, il saisit d’abord les points de repère, les premiers plans de la pensée, et il donne à chaque chose une valeur déterminée par son importance d’indication. On peut regarder au hasard un de ses tableaux, on peut s’arrêter par exemple devant le Centenaire, et, cherchant de quels éléments se compose l’impression de foule et d’enthousiasme qu’il nous donne, l’on verra par quel travail M. Roll a traduit son idée. Car, malgré son peu de goût pour ce qui est abstrait, il en a constamment une, celle même qui, pour lui, se dégageant du fait, apparaît comme l’âme de chaque œuvre.
S’étant servi de l’analyse pour comprendre, il se sert donc de la synthèse pour exprimer; mais sa synthèse n’est pas celle qui coordonne et déduit, qui se détache du fait pour s’attacher à l’idée et dont le point extrême est le symbole; elle est seulement une réalité simplifiée. Le chemin qui mène de l’analyse à la synthèse va du savant au philosophe: M. Roll n’est ni un savant ni un philosophe, il est un homme. Sa conception est celle de Shakespeare, toujours mobile et de qui toute la force réside dans la familiarité de la vision et dans son intensité, si différent des écrivains français du XVIIe siècle qui recherchent en penseurs l’essence de la vie. Les êtres représentés ainsi dans leur réalité propre demeurent individuels, mais ils peuvent, débarrassés des contingences accidentelles qui les compliquent inutilement et présentés en leur nature entière, affirmer quelque chose d’universel. L’homme, la femme et l’enfant de l’admirable tableau de l’Exode sont des individus, ayant chacun sa personnalité, avec son corps à soi et avec son âme à soi, absolument particuliers, car dans le roulement indéfini des vies jamais encore ils n’avaient été vus et jamais plus ils ne seront vus; mais tout en eux étant de la souffrance et de la résignation, ils deviennent en restant réels des êtres généraux, et dans ces trois existences passe le drame universel; tandis que l’œuvre puissante nous pénètre, empreinte de cette splendide pitié humaine qui magnifie l’art de M. Roll en le faisant proche de nos douleurs comme il est proche de nos joies, et qui vient à cet homme plein de force et plein de bonté de son amour passionné pour la vie.