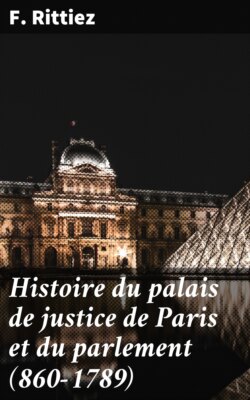Читать книгу Histoire du palais de justice de Paris et du parlement (860-1789) - F. Rittiez - Страница 5
CHAPITRE II.
ОглавлениеRobert II, dit le Pieux, fait bâtir le Palais avec magnificence. — Son inauguration. — La chapelle Saint-Nicolas. — L’église Saint-Barthélemy. — Ancienneté de cette église. — Elle est restaurée en 1772. — Le régime féodal. — Ses éléments constitutifs. — Les bénéfices héréditaires. — Des juges féodaux. — Fiefs de nature diverse. — Le roi Robert est excommunié. — Répudiation de Berthe, sa cousine. — Il épouse Constance, dite la volage. — De la cour féodale et de sa composition. — Du droit de vengeance. — Il est consacré par les lois barbares. — Les compositions. — Absence de peines dans la loi salique. — Guerres de ville à ville. Elles naissent souvent de causes futiles. — Règles observées dans ces guerres. — Des combats judiciaires ou par gages de bataille. — Formalités suivies dans ces combats. — Devoirs des juges.
Sous le règne de Robert II, fils de Hugues Capet (1003), l’esprit humain reçut une impulsion nouvelle; les vieilles églises, presque toutes construites en bois, disparurent pour faire place à des monuments solides, plus ornés et plus durables; les poëtes du midi sont appelés à sa cour: Guy d’Arezzo inventa la gamme; architecture, poésie, musique, tout sembla renaître à la fois. Le roi Robert contribuait lui-même à cette renaissance, il chantait au lutrin, il composait des hymnes qui n’étaient pas sans mérite.
Le palais des anciens comtes de Paris, à cette époque de renaissance architecturale, ne lui parut pas sans doute digne de la magnificence royale, et par son ordre, nous dit une ancienne chronique, ses officiers firent bâtir à Paris un palais remarquable, palatium insigne. — Lorsque le palais fut bâti, il voulut l’inaugurer avec pompe; il ordonna qu’au jour de Pâques, les tables y seraient dressées. Avant de commencer le repas il se lava les mains; alors de la foule des pauvres qui le suivaients’avança un aveugle, qui lui demanda l’aumône; le roi en badinant lui jeta de l’eau au visage. Aussitôt, à la grande admiration des assistants, l’aveugle recouvra la vue.
Ce miracle, ajoute la chronique, honora le palais, et y attira un grand concours de curieux. (Voyez Recueil des historiens de France, t. X, pag. 103.)
A cette construction remontent, dit-on, la chambre de la Conciergerie, qui devint plus tard la chambre nuptiale de saint Louis, la chapelle de la Conciergerie ainsi que celle de la Chancellerie.
Robert fonda en outre une autre chapelle du nom de Saint-Nicolas, sans qu’on sache au juste où elle était située: on croit cependant, avec quelque raison, qu’elle se trouvait là où est aujourd’hui la salle dite des Pas-Perdus. Cependant les auteurs diffèrent sur ce point, et d’autres la placent où est actuellement la Sainte-Chapelle. Voici ce que nous trouvons à ce sujet dans un discours de rentrée, prononcé il y a quelques années par un honorable magistrat, M. de Charencey: «Cette chapelle, dit-il, occupait la salle des Pas-Perdus, en face de la chapelle Saint-Barthélemy; les magnifiques et importantes dimensions de cette salle, qui ont toujours été maintenues, n’indiquent-elles pas, en effet, qu’elle a dû être un emplacement religieux? Il est certain, en outre, que, de temps immémorial, il y a eu dans cette salle une chapelle qui, à la vérité, a été incessamment refoulée, vers la partie orientale, sur la rue de la Barillerie, et qui a existé presque jusqu’au moment de la révolution. Ainsi, il faut bien le reconnaître, c’est sur un sol autrefois béni que s’agite, que se presse cette foule que des intérêts divers appellent, chaque jour, au sanctuaire de la justice.»
Le roi Robert a été surnommé le Pieux, et méritait de l’être, car il était bon, dévot et charitable; aussi se laissait-il facilement tromper et dépouiller; néanmoins, sa grande piété n’empêcha pas qu’il ne fût excommunié, au commencement de son règne, pour avoir épousé Berthe, sa parente, et on le vit alors, pendant quelque temps, relégué et abandonné de tous au fond de son palais. Tous les évêques qui avaient eu part au mariage, allèrent à Rome, faire satisfaction au pape; les sujets du roi et ses courtisans même se séparèrent de lui, et ceux qui étaient obligés de le servir faisaient passer par le feu toutes les choses qu’il avait touchées pour les purifier.
Nous ne pouvons pas mentionner les diverses chapelles attenant au Palais, sans nous arrêter quelques instants sur l’église Saint-Barthélemy, d’abord chapelle, puis église royale et paroissiale, qui était située rue de la Barillerie (actuellement boulevard Sébastopol), en face le Palais du roi Robert.» Ceux-là se trompent, nous disent les auteurs du Dictionnaire historique de la ville de Paris, qui disent que cette église était la chapelle de nos rois de la première et la seconde race, et qui assurent que la reine Clotilde y fit baptiser deux de ses enfants, l’un en 485, et l’autre en 486. Comme le palais des rois des deux premières races était hors de la Cité, il n’en faut pas davantage pour être convaincu que l’église de St-Barthélemy n’était pas leur chapelle, mais elle l’était du palais des comtes, et des que Hugues Capet fut parvenu à la couronne, elle devint chapelle royale et c’est depuis ce temps-là que nos rois s’en sont déclarés les fondateurs.»
Elle était anciennement desservie par des chanoines réguliers, et vers l’an 963, Salvator, évêque d’Aleth en Bretagne, aujourd’hui Saint-Malo, étant venu à Paris pour se mettre à couvert des Normands, il y apporta une grande quantité de reliques, parmi lesquelles était le corps de saint Magloire; il les présenta à Hugues Capet, pour lors comte de Paris et roi dans la suite, qui les fit déposer dans l’église collégiale de Saint-Barthélemy. Ce prince ayant fait agrandir considérablement cette église, en fit sortir les chanoines, qui furent transférés dans la chapelle de Saint-Michel, dans l’enclos du Palais, et on mit à leur place des moines bénédictins, avec un abbé qui à perpétuité devait être pris parmi eux; il fit en même temps dédier l’église en 986, sous le nom de Saint-Magloire-Barthélemy.
Elle fut restaurée en 1772. Elle a été plus tard en partie démolie, et sur son emplacement on avait pratiqué au rez-de-chaussée des passages publics.
Nous ne voyons pas jusqu’ici qu’il y ait eu dans le Palais, ni même dans la Cité, aucun édifice particulier consacré à la justice: ceci ne doit pas nous surprendre beaucoup, car au temps de Hugues Capet et de Robert le Pieux, nous étions en pleine féodalité, et les mœurs du temps avaient singulièrement simplifié la forme de la justice. La plupart des conflits se vidaient en champ clos par la voie du combat judiciaire, et les autres cas se résolvaient au moyen des odalies et des épreuves. Nous entrerons plus loin dans des détails précis touchant les usages et mœurs judiciaires pratiqués alors.
Robert II avait trouvé la féodalité marchant fièrement à son organisation définitive, organisation puissante, qui amena la France à n’être plus en quelque sorte qu’un vaste territoire habité par des peuples divers, et ce n’est pas le roi Robert Il qui pouvait lutter contre le courant qui entraînait alors la société vers le régime féodal.
On a réduit à trois points principaux les éléments constitutifs de ce régime:
1° La nature particulière de la propriété territoriale qui était réelle et héréditaire et qui imposait cependant au possesseur, sous peine de déchéance, certaines obligations personnelles;
2° La fusion de la propriété du sol avec la souveraineté politique, qui aujourd’hui est la prérogative exclusive du gouvernement;
3° Un système hiérarchique d’institutions judiciaires et militaires, qui liaient tous les possesseurs de fiefs et qui en faisaient une vaste association.
Ce qui donna surtout au régime féodal une grande puissance, ce qui en devint en quelque sorte la base constitutive, ce fut le principe de l’hérédité appliqué aux bénéfices.
Dans le principe, les bénéfices, ou récompenses territoriales, étaient concédés aux grands de l’État pour services rendus pendant la guerre; ces bénéfices, qui venaient de la munificence royale, rentraient, à leur mort, entre les mains royales.
On les appelait fiefs, ou feoda, des deux mots fe ou fee, qui signifiaient récompense, et od, propriété, bien.
Tons les possesseurs de fiefs n’exerçaient pas les mêmes droits dans les limites de leurs domaines. Les feudataires qui s’étaient mis en révolte contre la dynastie carlovingienne et qui l’avaient renversée du trône, avaient généralement usurpé dans leur plénitude tous les droits régaliens. Ils promulguaient les lois, ils rendaient la justice, ils étaient chefs suprêmes des armées, ils faisaient la paix ou la guerre selon leur bon plaisir, levaient des impôts sur le peuple, accordaient des chartes de communes à leurs principales villes, battaient monnaie et s’intitulaient comtes, ducs ou barons par la grâce de Dieu.
Ces feudataires s’étant ainsi constitués indépendants contre la royauté, fondèrent, dans leurs domaines, une autorité qu’ils présentèrent aux peuples avec toutes les prérogatives de la souveraineté.
L’aristocratie féodale au dixième siècle, c’est, dit avec raison un écrivain judicieux, M. Minier (Histoire du droit français, page 141), l’aristocratie de la force, qui s’enracine dans la propriété nationale, l’hérédité et le droit d’aînesse.
La souveraineté s’enferme dans chaque grand fief; les droits de guerre et de justice, le privilége de battre monnaie, de donner des lois, d’imposer des tailles, des corvées, des coutumes, se concentrent, à des degrés inégaux, sur plusieurs points du royaume. La royauté a perdu sa suprématie; car, tant que l’autorité royale fut en vigueur, principalement sous la famille de Charlemagne, il n’y avait pas d’autre seigneur que le roi, et la justice ne se rendait publiquement qu’en son nom et par ceux à qui il en donnait le pouvoir.
On doit présumer que les premiers seigneurs qui donnèrent l’exemple des usurpations que nous venons de signaler, furent les comtes qui étaient les gouverneurs des bonnes villes, et qui avaient déjà, par le droit de leurs charges, l’exercice de la juridiction. Il fallait que les Francs, investis d’un bénéfice, observassent une fidélité inviolable envers le donataire; on ne donnait pas seulement en fief une propriété territoriale, mais toute espèce de concessions prenait la forme féodale.
On donnait en fief la gruerie, ou la juridiction des forêts, le droit d’y chasser; une part dans le péage ou dans le rouage d’un lieu; le conduct ou escorte des marchands venant aux foires; la justice dans le palais du prince ou haut seigneur; les places du change dans celles de ses villes où il faisait battre monnaie; les maisons et loges des foires; les maisons où étaient les étuves publiques, les fours banaux des villes; enfin, jusqu’aux essaims d’abeilles qui pouvaient être trouvés dans les forêts.
Cette multiplicité et cette variété d’inféodations étaient autant de moyens que les principaux seigneurs employaient pour augmenter le nombre de leurs guerriers. Enfin, lorsque les invasions des Normands, des Sarrasins, des Hongrois menacèrent la Gaule entière, les populations se pressèrent autour des grands, qui, à l’aide des forteresses qu’ils élevaient, pouvaient seuls les défendre efficacement. Ainsi, les Capétiens n’avaient guère que le titre de roi.
Le roi Robert II, qu’on peut regarder comme le premier fondateur du Palais, n’exerçait, en réalité, aucun droit hors de son domaine; il l’administrait comme les grands feudataires administraient les leurs.
Le clergé, de son côté, pesait sur les rois de France, et avait aussi augmenté son influence. Le roi Robert, en 995, avait épousé Berthe, veuve du comte de Blois, qui était sa cousine au quatrième degré. Quoique l’archevêque de Tours, Archambault, eût béni cette union, le pape Grégoire V la déclara incestueuse et somma le roi de la rompre; et, sur son refus, il le frappa d’excommunication (998). Le prince s’était déjà attiré le courroux du saint-siége pour n’avoir pas exécuté la décision du concile de Pavie, qui lui avait ordonné de mettre en liberté l’archevêque de Reims qu’il tenait dans les fers. Malgré la ferveur de sa foi et le respect qu’il témoignait pour l’autorité de l’Église, Robert hésita quelques années; mais, effrayé des suites de l’anathème sous lequel il vivait, il renvoya Berthe et épousa Constance, fille de Guillaume Taillefer, comte de Toulouse. Avant le second mariage, on le voyait errer dans son palais, seul et délaissé par ses parents, par ses serviteurs, et privé de tout service et de tout bon office.
La nouvelle reine Constance fut par dérision nommée Constance la volage, et elle abusa étrangement de la bonté de son époux. Elle corrompit la cour en amenant un grand nombre d’Aquitains et d’Auvergnats également méprisables par leurs mœurs et par leurs manières. Leurs armes et les harnais de leurs chevaux, nous dit Raoul Glober, dans sa Chronique, livre III, étaient également négligés. Leurs cheveux ne descendaient qu’à mi-tête: ils se rasaient la barbe comme les histrions, portaient des bottes et des chaussures indécentes; enfin, il n’en fallait attendre ni foi ni sûreté dans les alliances.
Le roi Robert, qui ne savait se maintenir que par des concessions, crut s’acquérir la bienveillance des grands du royaume, en leur conférant le titre magnifique de pairs, avec la prérogative de n’être jugés que par d’autres pairs; il ne leur assigna pas d’autres fonctions.
Ce fut à la porte de l’église Saint-Barthélemy, dont nous venons de parler plus haut, que Robert, que Grégoire V avait excommunié, fut abordé un matin par Abbon, abbé de Fleury, suivi de deux femmes du Palais, qui portaient un grand plat de vermeil, couvert d’un linge, ce qui lui annonçait l’accouchement de la reine Berthe, et lui dit en le découvrant: «Voyez les effets de votre désobéissance aux décrets de l’Eglise, et le sceau de l’anathème sur le fruit de vos amours.» Robert regarda et vit un monstre, disent Pierre Dammier et Romvold, qui avait le col et la tète d’un canard. «Croira-t-on, dit M. Sainte-Foix, t. I, page 76 de ses Essais sur Paris, que par le plus abominable complot, dans l’idée d’obliger le prince à se soumettre et pour fortifier en même temps parmi le peuple la terreur qu’inspiraient les excommunications, on substitua ce monstre à la place du véritable enfant?» M. de Sainte-Foix, en mentionnant ce fait qui serait bien odieux, s’il s’était passé ainsi, ne nous donne pas la moindre preuve historique pouvant lui servir d’appui, et c’est ce qui a fait dire au savant Hurtaut, auteur du Dictionnaire historique de la ville de Paris, «qu’il est plus naturel de penser qu’une masse de chair, d’une figure bizarre, avait pu se former au sein d’une femme dévorée de chagrin pendant sa grossesse, et dont l’imagination et la conscience étaient troublées par les menaces du pape.»
Le système féodal fut l’œuvre lente des temps; et chaque jour, à partir du règne de Hugues Capet, on s’achemina vers la maxime nulle terre sans seigneur, qui ne devança que de très-peu la consécration de cette autre maxime: la justice est patrimoniale.
La souveraineté et la noblesse tenant au sol, on devait en effet, comme conséquence, y attacher la justice. Elle fut divisée en haute, moyenne et basse justice. Au duc appartenait la haute justice, c’est-à-dire l’exercice du pouvoir judiciaire souverain sur les personnes et sur les biens.
Aux comtes, aux barons, tenant le second rang, relevant du duc, mais ayant au-dessous d’eux des fiefs inférieurs, appartenait la moyenne justice, c’est-à-dire la connaissance de simples querelles, les poursuites de meubles, héritages et larcins.
Aux simples chevaliers et seigneurs de fiefs de HAUBERT (haubert était le nom de la cotte de mailles dont se couvraient les chevaliers n’ayant au-dessous d’eux aucun autre fief) appartenait la basse justice, et celle-ci n’était que la décoration de la propriété d’un sujet: quelques auteurs l’appellent une justice domestique, une justice sous l’orme, parce qu’elle concernait uniquement les intérêts des seigneurs.
Les seigneurs mettaient une haute importance à rattacher la justice moyenne ou basse à leurs fiefs. C’était un moyen d’accroître leurs revenus ou leur influence.
C’est cet état de choses qui a inspiré à Loyseau les réflexions suivantes: «Il n’y a si petit gentilhomme qui ne prétende avoir la justice de son hameau ou village; tel même qui n’a ni village ni hameau, mais un moulin ou une basse-cour près de sa maison, veut avoir justice sur son meunier ou son fermier; tel encore qui n’a ni basse-cour ni moulin, mais le seul enclos de sa maison, veut avoir justice sur sa femme et sur son valet. Tel simplement qui n’a point de maison, prétend avoir justice en l’air sur les oiseaux du ciel, disant en avoir eu autrefois.»
La féodalité morcela donc la justice à l’infini, et ce ne fut pas là un de ses moindres vices.
Ce n’était point à main armée, par violence, que les seigneurs féodaux commettaient la plupart de leurs exactions, mais par l’abus des droits de leurs juridictions.
Voici les plaintes qu’adressaient à Richard II, quatrième duc de Normandie, vers la fin du dixième siècle (997), les paysans, laboureurs et artisans: «Les seigneurs ne nous font que du mal; chaque jour est pour nous jour de souffrance, de peine et de fatigue; chaque jour nous prend nos bêtes pour les corvées et les services. Puis ce sont les justices vieilles et nouvelles, des plaids et des procès sans fin: plaids de moulins et de routes, plaids de forêts, plaids de mouture, plaids d’hommes, etc.
«Il y a tant de prévôts et de justiciers, que nous n’avons pas une heure de paix. Tous les jours ils nous courent sus, prennent nos meubles et nous chassent de nos terres. Il n’y a nulle garantie pour nous contre les seigneurs et leurs sergents, et nul pacte ne tient avec eux.» (Fragment du Roman de Rou. Thierry, Hist. de la conquête, t. I, p. 198.)
La juridiction du comte, ainsi que nous l’avons vu, s’étendait sur toutes les personnes libres de son comté ; il ne connaissait que des causes vraiment importantes, celles d’une moindre importance étant décidées par les vicomtes, les centeniers, les châtelains. Le comte, nous dit Loyseau, représentait les hauts justiciers; les centeniers, vicomtes, châtelains, les moyens et bas justiciers.
Dans les causes où il s’agissait de la vie, de la restitution ou de la liberté, l’instruction seule appartenait au centenier, — mais la sentence définitive était réservée au comte Le comte, le centenier ne jugeait pas seul. Il fallait quand il rendait un jugement, qu’il fût assisté par sept notables ou scabins, d’où est venu le mot échevin; les vicaires ou centeniers n’avaient besoin pour les assister que de trois scabins. Ces scabins étaient élus, à ce qu’il paraît, par le peuple dans l’origine; mais sous la seconde race, ils devinrent des magistrats permanents.
Le comte devait être encore assisté d’un juge ou d’un officier fiscal, et il ne pouvait tenir son plaid sans avoir un livre de la loi.
Le placite se tenait tous les mois ou tous les quinze jours, à moins que des cas extraordinaires n’exigeassent des assemblées plus fréquentes. Il y avait même plusieurs fois l’an un placite général de tout le comté ou de tout le duché. Les vicaires s’y réunissaient avec leurs comtes, et les comtes avec leur duc.
Par suite de ces réunions générales, chaque personne, selon sa qualité, pouvait être jugée par ses pairs, et même conformément à la loi de laquelle elle relevait; car ce qu’il ne faut pas perdre de. vue, c’est que les Gaulois, longtemps après la conquête, continuèrent à être jugés selon leurs lois, tandis que les Francs s’appliquaient les leurs; enfin, pour faire comprendre comment on procédait, s’il s’agissait de la cause du vicaire d’un comte, elle était jugée par les autres vicaires du comte, ses pairs, assemblés dans le placite général. S’il était question de l’affaire d’un comte mineur, c’est-à-dire gouverneur seulement d’une ville, elle était jugée par les autres comtes réunis sous la présidence du comte ou gouverneur de la province. Pour les affaires des ducs et des comtes qui n’avaient ni comtes ni ducs sur eux, elles étaient portées à la cour du roi, qui était la seule cour des pairs relativement à eux.
La plupart des tribunaux des ducs et comtes n’avaient pas, on le pense bien, un extérieur bien imposant: on s’assemblait en plein air devant les portes des églises ou des villes, dans un cimetière, dans un champ, dans une rue, sur un rempart, toujours en un lieu public, où chacun pût avoir un accès facile. (Legendre, Mœurs des Français.) Quelquefois, l’incommodité des pluies ou de la chaleur obligeait les juges dé se réfugier dans les églises, ce qui interrompait le service divin. Pour prévenir ces inconvénients, Charlemagne ordonna de bâtir des auditoires de justice; mais son ordonnance n’était pas encore exécutée sous le règne de Charles le Chauve.
Les juges, dépourvus de lumières, ne suivaient guère d’autre loi que leur volonté propre; et la plus grande partie des contestations étaient abandonnées soit au sort des épreuves, soit au sort du combat judiciaire. Fallait-il juger un procès civil, un procès criminel, souvent on ordonnait le combat quand les preuves manquaient.
Un incident, un interlocutoire donnaient lieu également au combat. La victoire était considérée comme le jugement de Dieu.
Les combats judiciaires n’ensanglantaient pas seuls le territoire français; il était aussi déchiré par d’autres combats plus rudes et plus redoutables que se livraient entre eux les seigneurs rivaux, ou les communes voisines.
Ces combats, qui n’étaient en réalité qu’une forme judiciaire employée pour vider des différends nés sous le régime féodal, se nommaient guerres privées.
Leur origine se perd dans la nuit des temps. La royauté, réduite à n’être plus qu’une autorité méconnue, ne pouvait pas empêcher ces guerres désastreuses; mais ce que l’autorité royale ne put pas faire, fut tenté avec un peu plus de succès par l’autorité religieuse, et en l’année 1041, la trêve de Dieu fut proclamée. — Henri Ier régnait alors à Paris.
La trêve de Dieu sera corroborée plus tard par des édits royaux qu’on appellera quarantaine du roi.
Le droit de guerre privée se trouve consacré dans les lois des barbares, ainsi que le combat judiciaire: c’est le droit de vengeance, si vous voulez, ou de rachat du sang. Vous m’avez fait une offense, j’ai le droit de me venger de vous, d’appeler à mon aide ma famille, mes voisins; dans l’intérêt de la paix publique, ce droit pouvait se résoudre en une somme d’argent ou de choses évaluées payables par l’offenseur, ou les siens, à l’offensé et à ses ayants droits. — Dès qu’une offense avait été commise, la vengeance, ou feyda, s’élevait entre l’offenseur et l’offensé : feyda vient, selon les glossaires, du mot saxon fah qui signifie ennemi.
La loi salique, qui autorisait les guerres privées, défendait d’une manière expresse d’ôter les têtes de dessus les pieux, sans le consentement du juge, ou sans l’agrément de ceux qui les avaient exposées.
La qualité des peines que prononçaient les lois barbares est remarquable; pour la plupart des crimes, elles n’ordonnaient que des amendes pécuniaires, ou pour ceux qui n’avaient point de quoi payer, des coups de fouet, et il n’y en a presque point qui soient punis de mort, sinon les crimes d’Etat. Ces peines sont nommées compositions comme n’étant qu’une taxe de dommages et intérêts faite avec une exactitude surprenante. Il y en a 164 articles dans la seule loi des Frisons. C’est proprement un tarif de blessures avec l’énonciation de toutes les parties du corps humain, de toutes les manières dont chaque partie peut être offensée, et la mesure de chaque plaie.
Par exemple, on taxe en autant d’articles différents une main coupée, quatre doigts, trois doigts, un doigt, et on distingue si c’est le pouce, l’index, et ainssi des autres; même à chaque doigt, on distingue les jointures. On observe si la partie à été tout à fait coupée, ou si elle traîne encore, et si c’est seulement une plaie, on en exprime la longueur, la largeur et la profondeur.
On taxe en particulier le coup qui a fait tomber un os de la tête; mais cet os n’était pas une petite esquille du crâne, il fallait qu’il pût faire sonner un bouclier, dans lequel il serait jeté dans un chemin de douze pas. (Ripuaires, titre 70.)
Les injures de paroles sont taxées avec la même exactitude, et l’on peut voir celles qui passaient alors pour offenses.
Il y a des titres particuliers pour les larcins de toutes sortes de bêtes.
Sous les rois de la.première race, les Francs observaient la loi salique, les Bourguignons la loi Gombette; les Goths, restés en grand nombre dans les provinces d’outre-Loire, suivaient la loi gothique, et tous les autres la loi romaine.
Sous le règne de Chilpéric, il y avait de fréquentes guerres privées de ville à ville. Dans ces guerres, on mettait le feu aux maisons, on détruisait ce qu’on ne pouvait pas facilement transporter. Elles furent encore pratiquées pendant longtemps sous la troisième race. Des causes souvent futiles les faisaient naître: cependant l’usage voulait qu’elles n’eussent pas lieu hors certains cas prévus. —
«Guerre se meut de plusieurs manières,dit Beaumanoir, si
«comme par faits et par paroles quand l’un menace l’autre
«à faire vilenie ou ennuy de son corps et quand il le défie
«de lui ou des siens parfois, quand ces causes meslées
«sourdent entre gentils-hommes d’une part et d’autre.»
Les paroles par lesquelles les guerres naissaient devaient être claires et ouvertes.
«Qui autry veut mettre en guerre, nous dit encore Beaumanoir,
« par paroles, il ne lui doit pas dire troubles ni couvertes
«, mais si claires et si apparentes que celui à qui les
«paroles sont dites et envoyées, sache qu’il convient et qui
«autrement feroit trahison.»
Nous trouvons dans Clément Vaillant, Traité des guerres privées, des détails fort curieux, tant sur la discipline qu’il fallait suivre dans les guerres, que sur la composition des forces qui y étaient employées. «Il y avoit, dit-il, liv. II, p. 52, en la France deux sortes de gens, lorsque ces guerres privées étoient licentiées, comme de présent il y en a encore: les unes représentoient certains corps, les autres estoient singulières: de celles-ci, les unes estoient ecclésiastiques, les autres estoient séculières; et des laïcs aucunes estoient libres, austres serfs: et de ces libres auscuns estoient gentils-hommes, autres dicts aucunes fois gens de pole, qui est être en la puissance, aucunes fois dictes bourgeois; et de ces serfs il y en avoit de deux sortes, les uns en plus grande, les autres en moindre servitude. Ainsi qu’à présent il y ait des universités en corps représentées comme villes, nations, bailliages, collèges, gentilshommes et gens de pote.»
On voit par cette simple nomenclature quelles personnes pouvaient être engagées dans les guerres privées. Il n’y avait guère d’exemption, et à un titre ou à un autre il fallait y prendre part. Les gentilshommes seuls pouvaient être chefs des guerres privées. Elles ne pouvaient se faire entre frères germains, ni entre gentilshommes, et gens d pote ou bourgeois.
Le service dû par le vassal à son seigneur de fief, chef de guerre privée, n’était dû que pour la défense.
Le vassal, quand il s’agissait de porter la guerre au dehors, était libre de combattre, ou de se retirer.
«Si aucun, dit de Beaumanoir, est semond pour ayder
«son seigneur contre ses ennemis, il n’est pas tenu,
«s’il ne veut, issir hors du fief, ou de arrière-fief son
«seigneur; car il seroit claire chose que son seigneur
«assaudroit, ne il defendroit mye, puisqu’il isseroit hors
«de sa seigneurie, et n’est pas tenu à autruy assaillir hors
«de ses fiefs, si n’est pour l’ost du souverain.»
On pouvait s’exempter du service personnel par des prestations en argent; la durée de ce service était limitée à quarante jours; les dépenses suscitées par le service personnel était variable selon les coutumes: dans quelques-unes, elles se faisaient en partie par le vassal pour certain temps; l’autre partie était aux dépens du seigneur.
Les guerres privées étaient souvent interrompues par des trêves. La glose canonique définissait ainsi la trêve: «sûreté donnée aux personnes et aux choses, la discorde non finie.»
Il y avait des trêves de diverses sortes, les unes par justice, les autres légales: celles-ci étaient ordonnées par les constitutions ecclésiastiques, tandis que celles par justice résultaient d’ordonnances et d’arrêts.
Il y en avait aussi de coutumières.
Les guerres privées se multiplièrent d’une manière incroyable. Du neuvième au onzième siècle, on chercha pourtant à y porter obstacle. «Depuis le règne de Louis le
«Débonnaire, nous dit l’abbé Fleury, l’autorité souveraine
«était peu respectée partout l’empire français. Chaque seigneur
«prétendait avoir droit de se faire justice à main
«armée; et comme les seigneurs se multipliaient à l’infini,
«ce n’étaient que pillages et violences, elles avaient passé en
«coutume et n’étaient plus regardées comme des crimes.
«Ceux qui y étaient les plus exposés, étaient les marchands,
«les artisans, les laboureurs et le reste du menu peuple...
«et aussi les moines et les clercs.»
On cherchait depuis longtemps le remède à un mal si contraire, non-seulement à la religion chrétienne, mais à la société civile, dont il sapait les fondements. Ce remède, on doit le reconnaître, n’était pas facile à découvrir ou à appliquer dans une société abandonnée à l’anarchie féodale.
Nos féaux de ces temps malheureux ne ménageaient guère plus les gens d’Eglise que les vilains, les moines que les marchands; tout était bon à dévaliser quand ils chevauchaient par les champs, soit pour se battre, soit sous prétexte de se battre. Comme l’usage des guerres privées était enraciné dans les mœurs, il n’y avait pas possibilité de l’attaquer de front. Qui aurait d’ailleurs pu forcer les seigneurs à vivre en paix les uns avec les autres, alors qu’ils étaient de petits souverains chez eux? L’Église trouva une voie détournée pour adoucir le mal qui rongeait la société et qui l’atteignait elle-même, et elle prit l’initiative en cette occasion. Dès l’année 1027, nous voyons un premier règlement à ce sujet dans un synode tenu au diocèse d’Elue en Roussillon. Ce règlement défend, dans tout le comté, d’attaquer son ennemi, depuis none du samedi jusqu’à prime du lundi; d’attaquer moine ou clerc marchant sans armes, ni un homme allant à l’église ou en revenant, ou marchant avec des femmes, sous peine d’excommunication qui était convertie, au bout de trois avis, en anathème. Pareilles résolutions furent ensuite prises en Bourgogne.
L’évêque de Soissons et l’évêque de Beauvais, voyant que, par la faiblesse du roi Robert, le royaume se ruinait, les coutumes du pays étaient méprisées, et la justice abandonnée, crurent rendre service à l’État en établissant cette paix. Gérard, de Cambrai, sollicité par eux d’y consentir, le refusa, disant (et ceci est remarquable dans la bouche d’un évêque de ce temps-là) que c’était troubler l’Église en entreprenant sur l’autorité royale; car, ajoutait-il, «l’Église doit être gouvernée par deux sortes de personnes, par les rois et par les évêques. C’est au roi qu’il appartient de réprimer les séditions par la force, de terminer la guerre et faire la paix.»
Mais ce même évêque finit par donner son consentement, et, chose étrange, c’est qu’il arriva que plusieurs des évèques qui avaient proclamé cette paix, qu’on a appelée Trêve de Dieu, violèrent le serment qu’ils avaient fait de la respecter. Elle fut appelée Trêve de Dieu, parce qu’on croyait que Dieu l’avait approuvée par un grand nombre de punitions.
La menace des excommunications n’arrêta pas les guerres privées et particulières, et elles se continuèrent avec fureur. Alors on vit naître une nouvelle confédération, sous le nom de la Confrérie de Dieu, ou de l’Agneau de Dieu; et dans cette confédération entrèrent des évêques, des prélats, des gens riches, pauvres, de conditions diverses, qui s’engagèrent par serment à poursuivre ceux qui troubleraient le repos de l’État et de l’Église. Ils y furent excités par un bûcheron qui disait «que la sainte Vierge lui était apparue, et lui avait donné une médaille, où elle était représentée aux genoux de son Fils, avec cette légende: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.» (Voyez Histoire ecclésiastique de Fleury, livre XLIX et suivants. Voyez Velly, Histoire de France, tome II. Glossaire de Ducange.)