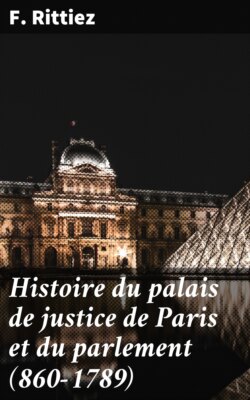Читать книгу Histoire du palais de justice de Paris et du parlement (860-1789) - F. Rittiez - Страница 6
CHAPITRE III.
ОглавлениеCombat judiciaire, ou jugement par gages de bataille. — Combat autorisé par les juges. — En quels oas il avait lieu. — Appels. — Règles établies dans les combats judiciaires. — Requête adressée au duc. — Sa teneur. — Du champ clos. — Combat judiciaire en Normandie. — Formalités qu’on y suivait. — Du serment. — Moyen de se purger d’une accusation. — Les sorts, ou sortes. — Odalies, ou épreuves par le fer chaud, par l’eau. — Jugement par la croix. — De l’épreuve en cas d’adultère chez les Gaulois. — Procès fait aux animaux.
Dans tous les duchés ou comtés, il y avait trois sortes de cours: l’une des ducs et comtes, avec les gens de leur hôtel; l’autre du bailli, avec gens de conseil ou sages; et enfin une cour des pers, ou pairs. La cour des pers se composait des vassaux du duc ou du comte, hommes ingénus, c’est-à-dire hommes libres, et de fidèles ou leudes. Leurs voix étaient d’égale puissance. — Le comte présidait les pairs.
En qualité de président, il surveillait l’exécution des jugements. Pour pouvoir remplir les fonctions de pair ou d’assesseur, il fallait s’être distingué par son mérite: le jugement par les pairs prévalait dans les Gaules comme étant saus doute le plus doux et le plus conforme à la liberté.
Les ajournements devant la cour des pairs étaient faits par l’un des pairs, et il y avait deux voies à suivre pour obtenir une solution judiciaire.
L’une par gages de bataille, l’autre par errements de cour, témoins et titres.
Quand on avait choisi l’une de ces voies, on ne pouvait pas revenir à l’autre.
La voie par gages de bataille était tout aussi bien pour les matières criminelles que pour les civiles, et tant en instance première et incidente que d’appel. En matière criminelle, quand on était défendeur, on était tenu de combattre, ou autrement on était réputé convaincu. «De tout cas de crime, dit Beaumanoir, on peut appeler et venir à gages de bataille, si l’accuseur veut faire l’accusation selon ce que l’appel se doit faire. Car il convient que celuy lequel est appelé se défende, ou qu’il demeure atteinct.»
On doit tenir pour certain qu’il n’y avait pas de combat, soit en matière civile, soit en matière criminelle, qui ne fût ordonné par le juge: et de là on peut conclure que le juge, avant de permettre le combat, épuisait tous les moyens de conciliation. Un capitulaire de Dagobert nous apprend certaines formalités relatives au combat judiciaire: «Si deux voisins, porte ce capitulaire, sont en dispute pour les bornes de leurs champs, qu’il soit levé un morceau de gazon dans l’endroit contesté ; que le juge le porte dans le malle, c’est-à-dire dans le lieu où il rend la justice, et que les deux parties, en le touchant avec la pointe de leur épée, prennent Dieu à témoin de la légitimité de leurs prétentions, qu’ils combattent après, et que la victoire décide du bon droit.»
Le combat judiciaire avait lieu dans les cas d’injures ou offenses, et paroles calomnieuses: les rois se réservaient ordinairement la connaissance de ces sortes d’affaires, et ils ne permettaient d’envoyer des cartels et des défis, de se donner champ et jour pour se battre que lorsqu’ils jugeaient l’offense assez grande pour mériter un combat. Les combats donnés sans tel octroi étaient punis comme crime de lèse-majesté. Il arrivait souvent que les rois les honoraient de leur présence.
Lorsque le plaideur qui avait succombé dans un procès par preuves testimoniales, était mécontent de la sentence, il avait deux moyens de la faire réformer: s’inscrire en faux contre elle (blasphemare), ou porter directement appel devant le roi. Dans le premier cas, le juge procédait à un supplément d’instruction, à moins que le condamné n’eût jeté le gant devant son juge, et alors c’était le combat judiciaire, jugement de Dieu lui-même qui décidait en dernier ressort. Si le plaideur succombait, il était condamné pour son fol appel, d’après la loi salique, à une amende de quinze sols au profit de chacun des premiers juges.
Les additions de Charlemagne lui offraient l’alternative de quinze coups de bâton. — Dans le second cas, l’affaire était portée au tribunal du roi.
L’usage de l’appel prouve clairement qu’on ne combattait pas toujours de prime abord pour vider un différend, et que certaines causes se décidaient par droit: du jugement de celles-là on pouvait appeler, puis l’appel se démenait par gages de bataille. C’était un défi aux juges; la partie condamnée leur disait: «Vous avez fet jugement faux et mauvés, comme mauvés que vous estes.»
Un appel de cette sorte était une injure grave, un démenti formel; on ne pouvait le faire directement au seigneur sans commettre félonie, ce qui aurait entraîné pour l’appelant l’obligation d’abandonner son fief avant d’offrir le combat.
La provocation s’adressait donc aux pairs: elle devait avoir lieu à l’instant même où le jugement venait d’être prononcé, car le moindre délai le faisait tenir pour bon.
Entrer en lice avec tous les membres d’un tribunal et n’avoir que cette alternative, ou de les vaincre tous l’un après l’autre, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, ou d’être pendu, c’était une manière d’appel horriblement chanceuse.
«Nul homme, disent les Assises de Jérusalem, chap. III, p. 88, qui aimoit son honor et sa vie, ne devoit emprendre à le faire, si Dieu ne faisoict opertes miracles pour lui: il moroit de vile mort et de honteuse et vergogneuse.» D’un autre côté, nous dit avec raison M. Boncenne (Théorie de la procédure civile, chap. XV, p. 427), «le combat judiciaire étant une sorte d’épreuve, dans laquelle nos pères admettaient l’intervention du ciel en faveur du bon droit, ils devaient être fort embarrassés pour expliquer comment cinq ou six juges, par exemple, étaient tombés sous les coups de l’appelant, avant que la victoire restât au septième, en manifestation de la justice et de la vérité d’une sentence qu’ils avaient rendue.»
On admit des modifications à cette dure loi, qui contraignait l’appelant à se mesurer avec tous ses juges, et on fit bien, car c’était frapper l’appel de forclusion et le rendre à peu près illusoire; voici comment on s’y prit:
La partie à laquelle il ne convenait pas de se mesurer avec un tribunal tout entier obtint la faculté de demander que chaque juge fût tenu de dire son avis à haute voix; quand le premier avait prononcé, si le second s’ensuivait, c’est-à-dire s’il opinait de même, c’était le moment d’appeler, en disant que le jugement auquel l’ensuivant s’accordait était faux, mauvais et déloyal, et que tel le ferait contre lui. Alors les gages de bataille étaient reçus; de telle façon, l’appelant n’eut plus qu’un combat à soutenir.
Toutefois, il n’en restait pas moins exposé à être pendu par son col en cas de défaite, ou à avoir le cheef cope, — s’il refusait de se battre après avoir faussé le jugement.
A cette rigueur extrême on substitua de fortes amendes. «Et pour che, il fut résou que l’appelant fist bonne seurté de poursuivre son appel.» (Beaumanoir, chap. LXI, p. 314.)
Lorsqu’il y avait déni de justice, défaute de droit, il était permis-d’attaquer directement le seigneur, de lui déclarer la guerre ou de le traduire par appel à la cour. «Cet appel se démenoit par raisons et faits tendant à prouver la défaute; » mais si des témoins étaient produits, celui contre lequel ils venaient déposer «leur mettoit sûr qu’ils étoient faux et parjures.» Beaumanoir. — Et il ajoute: «Ainsi peuvent bien naistre gages de l’appel, qui est faict sur défaut de droit.»
Les jugements par gages de bataille avaient leur procédure, qui est très-peu connue de nos jours, quoique bien faite pour piquer la curiosité. Ils n’étaient permis, en principe, qu’entre personnes de même condition. Cependant, il était accordé à un gentilhomme contre un roturier qui accusait celui-ci de vol, de meurtre, ou de quelque autre crime qui entraînait la mort du coupable. Dans ce cas, le gentilhomme pouvait combattre à cheval; mais si un gentilhomme se portait accusateur contre un roturier, pour un crime de même nature, il était tenu de combattre à pied. Dans les deux cas, la mort était infligée au vaincu.
Les bataillants, quand ils voulaient soutenir leur démêlé par gages de bataille ou bien faire appel par la voie des armes, d’un jugement rendu par la cour des pairs ou pers, adressaient une requête au duc ou au comte qui était ainsi conçue: «Sire, le jugement prononcé contre moi, et auquel Pierre s’accorda, est faux, et mauvais, et déloyal, et pour tel, je le feray contre ledit Pierre, qui s’est accordé au jugement, par moy ou par homme qui faire le peut, et doit pour moy, comme celui qui a essoine, laquelle je montrerai bien en lieu convenable à la cour ou en autre lieu où droit me menera par raison de cest appel. Le desfi de l’appellant est tel.» Quant au défié, il répondait par un acte dans lequel il soutenait que le jugement rendu en sa faveur était bon et loyal et qu’il était prêt à le soutenir, soit en la cour, soit où le droit mènerait.
Les défis des appelants et appelés étaient tels et s’adressaient au juge, qui recevait les gages de bataille et pouvait prendre bonne sûreté de celui qui appelait. — On n’arrivait pas, comme on voit, au champ de bataille sans remplir des formalités.
Quand elles avaient été remplies, commençait le devoir du juge: on faisait d’abord les serments; après qu’ils étaient faits, le juge devait regarder si le combat avait lieu par avoués, pour quelle cause on se battait, et si la partie vaincue devait recevoir la mort; quand la bataille se faisait par avoués, il faisait mettre en prison l’appelant et l’appelé en tel lieu qu’ils ne pouvaient voir la bataille et la corde à l’entour d’eux, corde avec laquelle on mettait à mort celui dont le tenant était vaincu: on leur mettait en outre entre les mains la bêche qui devait servir à creuser la fosse du supplice.
Ceci fait, les combattants étaient mis au champ de bataille et le juge faisait crier trois bans.
Le premier, afin qu’il ne restât personne autour du champ de bataille qui fût de la parenté des combattants; le second ban donnait avis que nul ne dît mot et que tous eussent à se taire et à se tenir paisibles; et enfin le troisième ban annonçait que nul ne devait en aucune manière donner aide à l’une ou à l’autre des parties par faits, gestes, signes ou paroles.
Ainsi que nous l’avons dit plus haut, les armes des combattants étaient les mêmes entre gentilshommes; il n’en était pas ainsi quand un chevalier combattait contre un roturier: le chevalier combattait à cheval et le roturier à pied. Cependant, il n’en était pas partout de même, ainsi que nous le verrons en parlant des combats judiciaires en Normandie.
La paix pouvait survenir au milieu même du combat, et s’il advenait que ceux qui se combattaient voulussent en entendre parler, le juge devait regarder l’état de chacune des parties et les faire immédiatement tenir en repos en cet état, et cela afin que l’une ou l’autre ne pût gagner de terrain, si le juge décidait que le combat devait recommencer.
Pour achever de donner une idée exacte des jugements par gages de bataille, nous allons rapporter les conditions dans lesquelles il avait lieu en Normandie, pays où il était singulièrement pratiqué.
Les belliqueux Normands (Organisation judiciaire en Basse-Normandie, Pezet, p. 64) aimaient à décider leurs querelles par le duel ou combat judiciaire, dont nous allons décrire les formalités telles qu’elles sont consignées dans le vieux coutumier.
Un assassinat a été commis; le fils de la victime accuse le meurtrier, il l’appelle devant le bailli, et là, il déclare que celui qu’il désigne comme l’assassin a féloneusement meurtri son père en la paix de Dieu, qu’il est prêt à le prouver ou à le faire connaître en une heure de jour. L’accusé nie, et pour défi contre l’accusation, jette le gage de bataille. L’accusateur répond en jetant le sien. Les gages sont relevés et remis au juge, qui en devient le dépositaire. Aussitôt, l’accusateur et l’accusé fournissent caution de mener la loi, c’est-à-dire de s’y conformer, et sont conduits en prison par un sergent d’épée, s’ils ne peuvent fournir à l’instant des répondants ou gardes qui prennent l’engagement de les représenter morts ou vifs au jour de la bataille et qui, à défaut de cette représentation, consentent à supporter eux-mêmes la peine qui serait infligée au coupable.
Le bailli fixe le jour du combat. Au jour ainsi fixé, et avant que l’heure de midi soit sonnée, les champions se présentent au bailli. Ils doivent être revêtus de leurs armes. Si ce sont des chevaliers, leur armure doit être la même que celle dont ils sont couverts en suivant le duc à l’armée. Si ce sont des non nobles, ils doivent avoir l’écu et le bâton cornu garni de cuir, de laine, de drap ou d’étoupes. Sont-ils de condition différente, le non noble combat avec une armure semblable à celle du chevalier, les parties doivent être égales en justice. Ils peuvent se frotter d’huile pour se donner plus de souplesse et d’agilité. Les deux combattants doivent avoir les cheveux coupés au-dessus des oreilles, pour que la longueur de la chevelure ne leur porte aucun obstacle.
Le bailli fait recorder ensuite les paroles de bataille, c’est-à dire l’exposé du motif pour lequel elle a lieu. Les lances ou les bâtons sont mesurés; les champions sont conduits au champ du combat, où ils trouvent quatre chevaliers, à qui la garde du camp est confiée. L’assistance se place autour; le sergent d’épée proclame, au nom du duc, qu’aucun de ceux qui sont présents ne soit si hardi qu’il fasse à nul des champions aide ni assistance par fait, ni par dit.
Il appelle ensuite à haute voix les combattants; ceux-ci se mettent à genoux en signe d’humilité et de dévotion, l’accusateur à droite et l’accusé à gauche. Ils placent leurs mains l’une dans l’autre en signe de la feauté qui doit être en humaine créature. Sur la demande qui leur est faite, tous deux déclarent leur nom de baptême, et affirment qu’ils croient au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et qu’ils tiennent la foi que la sainte Eglise garde. Cette déclaration, qui garantit leur respect pour la sainteté du serment, une fois reçue, l’accusé prend la parole et dit: A toi que je tiens par la main gauche et qui te fais appeler en baptême N. Je jure que je n’ai point meurtri ton père par félonie, ainsi m’aident Dieu et les saints. L’accusateur à son tour répond: A toi que je tiens par la main droite et qui te fais appeler en baptême N. Je jure que par les paroles que tu as jurées, tu t’es fait parjure, ainsi m’aident Dieu et les saints.
Tous deux ensuite et dans le même ordre jurent que par chacun ni par autre, il ne sera fait aucunes sorperies en champ, qui lui puissent ni doivent aider ni à son adversaire aussi. Ces formes solennelles remplies, les champions se retirent à l’écart pour prier Dieu de les appareiller à bien faire leur devoir. Les armes leur sont remises, la lice est vidée. Les quatre chevaliers se retirent aux quatre coins du champ. Le banc du duc est crié derechef, le signal est donné par ces mots: Champions, faites votre devoir. Ceux-ci s’avancent et le combat commence.
Tant que l’accusé n’est pas mis hors de combat, il a le droit de le prolonger jusqu’au moment où les étoiles paraissent au ciel; mais à ce moment, toute bataille doit cesser.
Si l’accusé a pu prolonger la lutte jusqu’à cet instant, la victoire est à lui; l’accusateur est vaincu, car il a failli à prouver par son corps ce qu’il devait prouver en une heure de jour.
L’un des champions est-il blessé pendant le combat ou forcé de se rendre, il doit être réputé vaincu, et puni comme atteint du cor. Est-il blessé mortellement, il n’en subit pas moins la peine, car il doit être traîné, mort ou vif, au gibet. Voilà le duel judiciaire tel qu’il se pratiquait dans toute sa simplicité chez nos ancêtres, et les formes suivies en Normandie, que nous trouvons relatées dans l’ancien coutumier de cette province, étaient à peu près les mêmes dans les autres provinces de France.
En l’an 820, le placite général s’assembla à Aix-la-Chapelle; plusieurs affaires importantes y furent mises en délibération, ce dont nous n’avons pas à nous occuper; mais il eu est une qui nous a frappé. Un gouverneur d’une province de l’empire, Bera, Goth, comte de Barcelone, et un autre seigneur goth, nommé Sunila; ce dernier l’accusa, devant le placite, d’avoir comploté contre l’Etat. Bera nia fortement ce crime, et fut condamné à prouver son innocence en présence de l’empereur et de tout le placite par le duel; mais il y eut une grande difficulté. L’usage des Français dans le duel était de se battre à pied; l’usage, au contraire, des Golhs était de se battre à cheval. Sunila consentait de se battre à la mode française, et l’empereur l’avait d’abord ordonné ainsi: mais le comte de Barcelone ayant protesté qu’on ne devait pas l’empêcher de suivre les lois de son pays, il fallut délibérer sur ce point, et il fut jugé que les champions, puisqu’ils étaient Goths tous les deux, se battraient à cheval. Ce duel se fit en grande cérémonie dans un champ voisin où se tenait le placite; l’empereur et toute sa cour y assistèrent. Avant que le combat commençât, l’empereur appela les deux champions, et exhorta celui des deux qui était coupable, ou de calomnie ou de félonie, d’avouer son crime; mais Sunila soutint son accusation, et Bera son innocence avec une égale fermeté. Ils retournèrent donc au lieu du combat, et Gondola les y suivit avec les gens qui portaient un brancard pour enlever celui qui serait renversé, et le délivrer de la mort s’il était possible. C’était ce qui se pratiquait alors pour adoucir la coutume barbare du duel.
Les deux combattants ayant attendu le signal du combat donné par l’empereur, se battirent avec acharnement. Bera fut vaincu. Selon les règles suivies en ces matières, le placite allait le condamner à mort comme convaincu du crime dont Sunila l’avait accusé, mais l’empereur s’y opposa. Il fut seulement condamné à perdre son comté et exilé à Rouen. Le comté de Barcelone fut donné à Bernard. Le récit de ce duel, que nous avons trouvé relaté dans un ancien manuscrit, nous prouve mieux que nous ne l’avons dit antérieurement, que l’on décidait les affaires les plus graves par les combats singuliers.
Tous les cas douteux pour le juge ne se décidaient pas par les armes et conjointement avec les combats; il y avait diverses épreuves, sorts ou sortes, au moyen desquels on les résolvait. Quand un crime avait été commis, et lorsque les preuves du crime ou de l’innocence se balançaient, on faisait usage des sorts et des épreuves.
Au dire de certains auteurs, il n’y avait pas de partie publique, en France, dans les premiers temps de la monarchie; mais c’est là une grave erreur; nous devons la rectifier dans l’intérêt de la science du droit.
Le duc, le comte, en acceptant un bénéfice, un duché, un comté, faisaient serment, suivant la huitième formule de Marculphe, liv. I, de protéger la veuve et l’orphelin, ainsi que de réprimer sévèrement les voleurs et les malfaiteurs; et s’il manquait à son serment, en relâchant un voleur qui avait étémis entre ses mains, il était puni de mort, suivant un décret de Childebert, de l’année 696. Le moyen âge a bien assez de méfaits certains, sans qu’on nous le représente plus chargé qu’il ne doit l’être.
On ne laissait donc pas les crimes impunis, ou livrés seulement à la répression individuelle; et c’est avec regret qu’on voit un professeur de droit, aussi éminent que l’était M. Poncelet, nous dire, dans son Précis de l’histoire du droit français, p. 41, «que la procédure de ce temps était très simple, qu’on ne connaissait pas l’institution d’une justice publique; que nos ancêtres étaient tous juges, et qu’ils ne connaissaient pas l’art d’interpréter la volonté législative et de débrouiller les textes.» Non, nos ancêtres n’étaient pas tous juges, et chacun ne se battait pas à son gré, et on ne se battait que dans des cas déterminés par le juge.
Les preuves employées en justice étaient le serment, le témoignage des tiers, la co-juratio et les odalies, et sorts, ou sortes.
Les Francs n’avaient pas l’usage des procureurs, ils pensaient que chacun devait paraître lui-même en justice, et oser affirmer ou nier de sa propre bouche.
Le serment se prêtait devant le juge, mais d’une manière plus solennelle, dans une église, la main sur l’autel, sur des reliques, sur l’Evangile. Le plaideur proposait le serment à son adversaire en lui présentant une paille. Si celui-ci prenait la paille, et acceptait le serment, on s’ajournait pour la prestation publiquement faite dans une église. La loi s’exprimait ainsi: «Qu’on ne permette pas facilement le serment; que le juge examine d’abord la cause et tâche d’y découvrir la vérité ; qu’on ne permette le serment que dans les causes où la vérité est impénétrable.»
Les parjures devaient avoir la main coupée, mais ils pouvaient racheter leur main moyennant une amende. Quant aux témoins qui assistaient les parties en justice, ils devaient être pris dans le voisinage de ceux qui les faisaient paraître; ils devaient être ingénus, c’est-à-dire libres, honnêtes, non souillés de parjure ou d’une condamnation infamante. Ils juraient de dire la vérité ; on faisait intervenir des co-jureurs dans maints procès; leur nombre variait excessivement, selon l’importance des personnes et la gravité des accusations.
Enfin, on arrivait à se purger d’une accusation, ou à décider des cas criminels douteux par l’emploi des sorts et odalies.
Les sortes, d’où les Français ont fait le mot sort, se pratiquaient souvent par de petites baguettes ou branches d’ar bre, auxquelles on mettait des marques distinctives. On les jetait au hasard sur une toile blanche, et, d’après leur position fortuite, le prêtre, ou le père de famille, prédisait l’avenir ou découvrait les secrets.
On tirait le sort sur l’autel (cas de crime), ou sur les reliques des saints, pour décider de l’innocence, qui dépendait del’événement, laquelle des deux baguettes était touchée par le prêtre, ou l’enfant qui suppléait à son office; celle marquée d’une croix était favorable à l’accusé.
Après le sort, les épreuves.
Il y avait plusieurs espèces d’odolies.
Les principales étaient celle du fer chaud, celle de l’eau bouillante et celle de l’eau froide. S’agissait-il du fer chaud, on faisait empoigner à l’accusé une barre de fer brûlante, du poids de deux ou trois livres, selon la nature du crime, ou bien, on lui ordonnait de marcher sur des lames de fer rouge, qui étaient souvent au nombre de neuf, et qu’on plaçait à différentes distances; ou bien on lui faisait mettre, quand il s’agissait de l’épreuve par l’eau, la main dans l’eau bouillante, ou bien on le jetait dans l’eau froide.
Si le fer ardent ou l’eau chaude ne brûlaient point l’accusé, on le tenait pour innocent. On le tenait-aussi pour tel s’il enfonçait dans l’eau froide quand on l’y précipitait. Mais si, au contraire, le fer le brûlait, ou s’il surnageait au-dessus de l’eau, on regardait ces accidents comme des preuves de son crime, et on l’exécutait sans délai.
Outre ces espèces d’épreuves, qui étaient le plus en usage, il y en avait plusieurs autres, comme: la purgation canonique par l’eucharistie, par la coupe judicielle, par le pain d’orge et le fromage, qu’on mangeait après qu’ils avaient été consacrés par des prières et des cérémonies établies pour cela; enfin, par le jugement de la croix. En 775, sous le règne de Charlemagne, il s’éleva une contestation entre l’évêque de Paris et l’abbé de Saint-Denis sur la possession d’une petite abbaye. Au lieu de vérifier l’authenticité des titres que les parties produisaient, on renvoya la décision du procès au jugement de la croix.
Les champions des parties se tinrent devant l’autel pendant la célébration de la messe, les bras tendus; le champion de l’évêque s’étant lassé le premier et ayant quitté son attitude, la question fut décidée en faveur de l’abbé.
Les épreuves judiciaires se sont perpétuées longtemps en France. Un arrêt du parlement de Paris, du 1er décembre 1601, nous en fournit la preuve. Il fut rendu contre les officiers de la châtellenie de Dinteville en Champagne, qui avaient condamné et fait exécuter à mort une prétendue sorcière qu’on avait convaincue en la jetant dans l’eau froide. L’arrêt condamna les juges à des dommages et intérêts envers les parents de la défunte.
Voici comment on faisait usage des épreuves dans le cas d’adultère:
«Une femme est accusée d’adultère par son mari, dit Grégoire de Tours; elle nie longtemps le fait devant son mari, et comme on ne peut la convaincre par son aveu, l’ordre est donné de la plonger dans l’eau.
«Le peuple accourt, on la mène sur le pont de la Saône, on lui attache avec une corde une pierre au col, on la précipite et le mari l’accompagne des injures: Va te laver, lui crie-t-il, dans les eaux profondes des souillures et de la débauche dont tu as sali ma couche... Mais le Seigneur qui, dans sa bonté, ne laisse pas souffrir les innocents, permit qu’il se trouvât sous les eaux une pointe (stilum) qui accrocha la corde, soutint la femme et l’empêcha de descendre au fond du fleuve.» (Greg. Tur. de Glor. mort. cap. 68, 69.)
Les épreuves à l’eau froide avaient lieu généralement dans un bassin qui avait douze pieds de dimension en profondeur et vingt pieds de largeur dans tous les sens, et on le remplissait d’eau jusqu’au bord. On plaçait sur le tiers de cette fosse de forts bâtons et une forte charpente pour porter le prêtre, les juges qui l’assistaient, l’homme qui devait entrer dans l’eau et les deux ou trois autres qui devaient l’y faire descendre.
En général, l’épreuve de l’eau froide n’était en usage que pour le petit peuple; on jetait l’accusé dans la pièce d’eau après lui avoir lié la main droite au pied gauche, et la main gauche au pied droit; s’il enfonçait, il était innocent, s’il surnageait, il était coupable.
En ce temps des odalies, où l’on était assez superstitieux pour croire que Dieu se déclarait toujours pour le bon droit et la vérité dans les épreuves de l’eau, du feu, du combat, il se trouvait quelquefois cependant des gens qui ne voulaient pas qu’on jugeât ainsi leur procès et qui n’étaient pas crédules sur le merveilleux des épreuves. Georges Lagothète parle d’un homme qui, dans le treizième siècle, refusa l’épreuve du feu, disant qu’il n’était point charlatan. L’archevêque ayant voulu lui faire quelques remontrances à ce sujet, il lui répondit qu’il prendrait le fer ardent, pourvu qu’il le reçût de sa main. Le prélat, trop prudent pour accepter la condition, convint qu’il ne fallait pas tenter Dieu.
M. Michelet nous assure que l’épreuve du feu et du fer rouge était connue des Grecs et qu’elle était aussi mise en pratique chez les Byzantins. A Cambrai, nous dit encore cet auteur, ville épiscopale, on a pris, en moins des cinq dernières années, plusieurs hérétiques qui, tous par la crainte de la mort, nièrent leur crime. Un clerc fut alors envoyé par l’évêque, lequel devait éprouver par le fer rouge ceux qui niaient ainsi et déclarer hérétiques ceux qui seraient brûlés; ils furent tous éprouvés et tous brûlés. (Cæsar heisterb. III, 16, année 1200.)
Le jeûne était une épreuve ecclésiastique. Si quelqu’un avait été pris pour vol et niait le fait, il se rendait le mardi soir à l’église en habit de laine et nu-pieds, et là, il demeurait jusqu’au samedi sous une garde loyale. — Il observait un jeûne de trois jours, ne se nourrissait que de pain azyme fait d’orge pur, d’eau, de sel et de cresson d’eau.
Nous trouvons dans les Éphémérides géographiques, t. XLVI, p. 375, un usage remarquable qui existait dans le village de Mandeuse, près Montbelliard. Lorsqu’un vol avait été commis, tous les habitants étaient invités, le dimanche après les vêpres, au lieu du jugement. Un des maires sommait le voleur de restituer et d’éviter la société des honnêtes gens pour six mois. Si le coupable ne se montrait pas, on en venait à ce qu’on appelait la décision du bâton. Les deux maires tenaient un bâton assez haut pour qu’un homme pût passer dessous. Tous devaient y passer. Il n’y avait pas d’exemple que le coupable l’eût osé : il restait seul et se trouvait découvert. S’il eût passé et qu’ensuite on l’eût reconnu coupable, personne ne lui aurait jamais parlé, tous l’auraient fui comme une bête sauvage.
Ce serait évidemment nous engager trop en dehors de notre sujet, que de nous arrêter sur tous les éléments de la législation du moyen âge; nous citerons seulement quelques peines applicables à certains cas spéciaux: «Si une fille était prise par force en ville, ou en champ clos, ou en bois (vieux coutumier de Normandie), il convient qu’elle crie si elle peut et que les voisins prennent le malfaiteur; dès que la fille le pourra, elle doit aller à la première justice du duc qu’elle trouvera, et le bailli fera voir sa blessure par prudes femmes qui sachent connaître si elle a été prise par force. Si ce malfaiteur veut épouser la fille et que celle-ci et ses parents y consentent, il n’y aura point de poursuites; au contraire, l’auteur de la violence sera puni par ses membres. Mais si une fille, voulant avoir son ami à mari, venait dire qu’elle a été prise par force, et si les prudes femmes qui l’auront visitée déclarent qu’elle ne porte point de traces de violence, elle ne sera point entendue en jugement: elle sera battue et chassée hors pays, et voici pourquoi on agissait: c’est parce que, disait naïvement la coutume normande, il y a moult femmes si pleines de maling esprit, qu’elles voudroient bien mettre leur vie en aventure pour faire occire les garçons qu’elles haïssent.»
Si quelqu’un était accusé d’avoir pris par force la femme de son voisin, le mari était tenu de le prouver par bataille, et s’il était victorieux, le coupable était puni par ses membres; mais si le mari était vaincu, il devait payer une amende de soixante francs et un denier, et la femme était battue et chassée hors du pays. Il perdait le droit d’être admis en témoignage, mais il pouvait défendre sa vie en cause criminelle. Lorsque le père tuait son fils par mésaventure (Etablissements et Coutumes, par Marnier, p. 34), il devait exécuter la pénitence que l’Eglise lui intligeait; si c’était par félonie, il était puni de l’exil; il n’y avait pas de peine de mort, parce que le fils est du sang et de la chair du père; s’il ne faisait que battre son fils, son neveu, sa tille ou quelqu’un de sa maison, il n’encourait aucune peine, parce qu’on supposait qu’il ne le faisait que pour les châtier.
Les mauvais traitements du mari sur la femme n’étaient punis que si elle était mehaigne, comme si, par exemple, il lui avait crevé les yeux ou brisé le bras. Le fils convaincu d’avoir tué son père était traîné sur une claie et pendu; si c’était une fille qui avait commis le crime, elle était brûlée.
Le frère qui tuait son frère était puni de mort.
Le vassal qui tuait son seigneur par mésaventure était puni de mort; si c’était par félonie, il était traîné sur la claie et était pendu; le seigneur qui tuait son vassal était puni de mort.
Les usuriers n’étaient pas punis pendant leur vie; mais s’il était prouvé après leur mort qu’ils avaient maintenu usure dedans l’an et jour avant leur mort, leurs maisons appartenaient au duc: leurs femmes et leurs enfants n’y pouvaient prétendre, ils n’avaient droit que sur les autres héritages.
Les seigneurs suzerains et hauts justiciers avaient le pouvoir d’amnistier certains crimes. Le vol, la trahison l’incendie n’étaient point susceptibles d’être amnistiés. L’homicide pouvait l’être, mais il fallait auparavant que le meurtrier se fût réconcilié avec les amis de la victime. L’amnistié, s’il était de la menue gent, devait porter scellées à son cou pendant un an et un jour les lettres délivrées par le suzerain et revêtues de son scel, quand il allait aux assises, aux foires, aux marchés du pays, afin que le public fût averti de la grâce accordée; on appelait cela porter la paix du duc.
S’il était baron ou de noble lignée, il était dispensé, mais il était obligé de les avoir sur lui secrètement.
Il fut un temps où, non-seulement en France, mais même en Europe, on faisait des procès aux animaux prévenus de certains méfaits. On pourrait s’étendre fort au long sur ces singuliers procès, mais cela ne servirait qu’à piquer une vaine curiosité ; non-seulement les tribunaux portaient des jugements contre les animaux malfaisants ayant commis des dégâts ou fait des blessures, mais l’autorité ecclésiastique venait en aide à la justice dans certains cas par ses excommunications.
En 1120, l’évêque de Laon excommunie mulots et chenilles de son diocèse. En 1314, les juges du comté de Valois firent le procès à un taureau qui avait tué un homme d’un coup de corne et le condamnèrent, sur la déposition des témoins, à être pendu; la sentence fut confirmée par arrêt du parlement, le 7 février 1314.
Nous voyons en 1497 qu’une truie fut condamnée à être assommée pour avoir mangé le menton d’un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre que les chairs seraient coupées et jetées aux chiens, que le propriétaire et sa femme feraient un pèlerinage à Notre-Dame-de-Pontoise, où étant, le jour de la Pentecôte, ils crieraient merci, de quoi ils rapportèrent certificat.
On faisait, comme on voit, des procès dans certains cas aux animaux, mais on trouve des traces de procès même faits à des objets inanimés. Ainsi en 1498, pendant l’assaut livré au couvent de Saint-Marc pour en arracher Jérôme, Savonavole, la cloche du prieuré fut accusée d’avoir sonné l’alarme et appelé au secours des assiégés; par une sentence des magistrats, cette cloche séditieuse fut condamnée à être promenée sur un âne par toute la ville en signe d’ignominie. (Curiosités judiciaires, p. 442.)