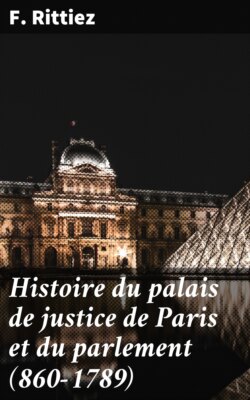Читать книгу Histoire du palais de justice de Paris et du parlement (860-1789) - F. Rittiez - Страница 7
CHAPITRE IV.
ОглавлениеÉtat des personnes sous Louis le Gros. — Serfs. — Vilains. — Serfs attachés à la glèbe. — Marquette. — Adoucissement au sort des serfs. — Les villes s’affranchissent. — Chartes concédées à prix d’argent. — Les grands, moyens et petits bourgeois. — Les cités ont le droit d’élire leurs magistrats. — Dernières paroles de Louis le Gros en mourant. — Le tribunal royal, ou plaid de la cour. — Sa composition. — Le grand sénéchal. — L’abbé Suger. — Belles qualités de ce grand ministre.
A l’avénement de Louis le Gros, quatrième successeur de Hugues Capet, le domaine de la couronne se trouvait réduit à Paris, à quelques villes et à trente seigneuries. Les habitants de la France étaient alors divisés en ingénus et en vilains et serfs.
Les vilains et les serfs languissaient dans une servitude à peu près identique; cependant le vilain avait quelques immunités qui le distinguaient du serf.
Les serfs étaient attachés à la glèbe, c’est-à-dire à l’héritage; on les vendait avec les fonds; ils ne pouvaient ni se marier, ni changer de profession sans la permission du seigneur; et, quoiqu’on ait cherché à le mettre en doute, il est certain que le seigneur, dans certaines contrées, s’était arrogé le droit de coucher avec la mariée la première nuit de ses noces. Ce droit finit par être converti en une redevance pécuniaire, mais il n’en a pas moins existé dans tout ce qu’il avait d’odieux et de dégradant.
«Les sieurs de Souloise, nous dit Laurière dans son Glossaire,
«au mot Culliage, avoient autrefois le droit de marquette;
« l’ayant obmis en l’aveu rendu au seigneur de
«Montlévrier, seigneur suzerain, le défaut donna ouverture
«de débat comme de défectuosité, et par acte du 15 décembre
«1607, il y renonça précisément.»
Au livre IX, chap. XVI, p. 598 de l’Histoire de Châtillon, on voit qu’un accord eut lieu entre Guy de Châtillon, seigneur de la Fère en Tardenois, et la communauté des habitants. Ceux-ci remontraient qu’ils étaient obligés à de grandes servitudes et devoirs, entre autres, pour le droit des mariages, et que chacun d’eux, en se mariant, était dans l’obligation de payer cent sols tournois, ce qui en empêchait bon nombre de se marier. Le seigneur les dégagea de cette obligation; toutefois, ce ne fut pas sans les astreindre à de nouvelles charges, mais moins honteuses.
Les serfs n’étaient en réalité que des esclaves, et leur servitude était complète.
«Il s’en fallait beaucoup, dit l’abbé Legendre, que les
«hommes de pote dépendissent autant du seigneur: il
«n’était point le maître ni de leur vie, ni de leurs biens;
«leur servitude se bornait à lui payer de certains droits et
«à faire des corvées: ni les uns ni les autres n’avaient ni
«juges ni lois; le seigneur était tout à la fois leur juge
«et leur loi, cela dura jusqu’à Louis le Gros.»
Ce roi, à son grand honneur, travailla efficacement à adoucir le sort des serfs.
A peine était-il monté sur le trône, nous dit Desfontaines dans sa véridique histoire de la ville de Paris, tome I, page 82, que, touché des plaintes qui arrivaient jusqu’à lui, il rendit un arrêt en faveur des serfs de l’Eglise de Paris, c’est-à-dire des serviteurs ou sujets des ecclésiastiques. Ces gens étaient entièrement soumis aux prêtres dont ils dépendaient, leur servitude était même un dur esclavage; leurs maîtres les échangeaient, les envoyaient à la guerre, se servaient d’eux pour les plus rudes travaux, et les mettaient en prison lorsque la misère où ils étaient réduits les empêchait de payer les tributs qu’on exigeait d’eux.
Un homme libre ne pouvait épouser une fille de corps (c’est ainsi qu’on appelait ces serfs) sans devenir serf lui-même, et les enfants qui provenaient d’un mariage formé dans les fers étaient esclaves en naissant.
Telle était la condition des serfs à quelque personne qu’ils appartinssent. Ceux de l’Eglise étaient de plus obligés de faire serment en justice, quand le cas l’exigeait, à la place des clercs ou des moines dont ils dépendaient, et si la partie adverse les traitait de parjures, il fallait qu’ils soutinssent par le duel la vérité du serment qu’on leur avait fait faire.
Cependant les hommes libres, méprisant peu à peu ceux qui ne l’étaient pas, se refusaient d’admettre leur témoignage et de se battre contre eux, ce qui autorisa les usurpateurs des biens ecclésiastiques.
L’Eglise de Paris s’en plaignit à Louis le Gros, qui rendit une ordonnance qui fut une concession faite à l’esprit du temps, portant que le témoignage des serfs de l’Eglise serait reçu en justice.
Louis le Gros, non-seulement travailla à l’affranchissement des serfs et à l’amélioration de leur condition, mais il fit mieux encore, il aida plusieurs villes à s’affranchir du joug de leurs seigneurs. Scrupuleux observateur des usages reçus, il distingua trois classes de bourgeois dans les villes auxquelles il concédait des chartes municipales.
Les ingénus, qui étaient des hommes libres au moment de l’affranchissement, prirent le titre de grands bourgeois, formèrent les grands conseils et jouirent des charges les plus importantes dans la cité. Les vilains, avec les serfs qui se rachetaient, furent appelés francs bourgeois, et se contentèrent des charges subalternes. Enfin, on appela petits bourgeois les vilains ou serfs qui manquaient de ressources pour se créer quelque indépendance et languissaient dans la misère.
Voici comment, dans la coutume d’Auxerre, on définissait la qualité des bourgeois: «Ce sont, y était-il dit, personnes affranchies et de libre condition, non nobles, non clercs, non bâtards, mais roturiers.» Les bourgeois de diverses communes payaient au roi une redevance annuelle, et, par suite, ils pouvaient décliner la cour et juridiction de tout seigneur subalterne.
Les seigneurs suzerains, entraînés par l’exemple de Louis le Gros, concédèrent aussi des chartes d’affranchissement aux habitants des bourgs et villes de leurs domaines. On vit renaître alors, dans le royaume des Francs, les franchises des villes, si longtemps violées et méconnues, avec leur juridiction particulière, l’élection de leurs magistrats et les formes de l’administration municipale, qui constituaient jadis les privilèges des cités gauloises.
Toutes les communes n’eurent pas la même indépendance et la même liberté de juger les citoyens, d’élire leurs magistrats, et d’administrer les biens communs de la cité ; les unes obtinrent la haute juridiction, les autres n’obtinrent que la moyenne et basse justice; dans quelques lieux on continua de juger avec les hommes de fief, tous les habitants étant assimilés aux hommes libres; dans d’autres, on jugeait avec les notables et les officiers municipaux; ici l’élection directe des magistrats appartenait aux habitants; là, cette élection devait être approuvée par le roi ou le seigneur haut justicier; mais, dans toutes les chartes qui contenaient et déterminaient les droits respectifs des seigneurs et des bourgeois, on trouvait écrit en première ligne ce privilège des habitants, de n’être jugés que par leurs pairs, même pour les délits commis hors de leur résidence. Les échevins ou jurés faisaient, comme les pairs des cours féodales, la double fonction de juges et de jurés, c’est-à-dire qu’ils étaient, comme eux, juges du fait et du droit, et juraient de rendre la justice selon l’inspiration de leur conscience. L’unanimité, en matière criminelle, était la règle de leurs décisions.
C’est à Louis le Gros, nous dit avec raison le président Hénault, que la couronne commença à reprendre l’autorité dont les vassaux s’étaient emparés. Il en vint à bout, soit par l’établissement des communes, soit par l’affranchissement des serfs, soit en diminuant la trop grande autorité des justices seigneuriales. Par rapport à la justice, on envoya des commissaires dans les provinces (missi dominici), pour recueillir les plaintes de ceux qui avaient été maltraités par les comtes ou les ducs; et, dans le cas où ils ne jugeaient pas eux-mêmes, ils renvoyaient aux assises du roi, c’est-à-dire à son plaid. C’est ainsi que s’introduisit l’usage des appels.
Les évêques et les abbés assistaient toujours aux plaids du roi; ils sont désignés avant tous les autres.
Louis le Gros mourut au Palais en l’année 1137. Voici les dernières paroles qu’il adressa à son fils en mourant: «Souvenez-vous que la royauté n’est qu’une charge publique dont vous rendrez un compte rigoureux à celui qui dispose des sceptres et des couronnes.»
Voyons maintenant quel était le tribunal du roi.
Le tribunal royal ou plaid de la cour était souvent présidé par le roi lui-même, ou, en son absence, par le comte du palais: il tenait sa séance toute l’année. Le comte du palais était le rapporteur né des causes qu’on y portait. Il surveillait aussi la rédaction des jugements et des lettres du roi qui les renfermaient. On voit ensuite les opimates, dont on ne connaît pas bien ni la dignité ni les fonctions. Ce n’était point, dit Bernardi (Histoire du droit public de la France, p. 45), un nom générique comme celui de grands, mais un titre spécial qu’on donnait aux grands d’un ordre supérieur. Après eux venaient les graffions et les comtes. Dans les plaids dont nous avons connaissance, il n’est pas fait mention des ducs.
Les grands qui portaient le nom de domestiques jouissaient de beaucoup de crédit et de considération. C’étaient eux qui prenaient soin des maisons royales et pourvoyaient aux dépenses de la cour. Ils assistaient aux plaids et y jugeaient. Il en était de même des référendaires, dont les fonctions étaient de désigner et de sceller le diplôme qui contenait le jugement. Le sceau dont on se servait n’était autre chose que l’anneau du roi qu’il remettait lui-même aux référendaires qu’il voulait charger du soin de l’apposer au jugement.
L’art d’écrire n’était pas fort répandu, et on scellait alors, au lieu de signer, les actes publics et privés.
Il y avait deux sénéchaux qui assistaient aux plaids. La charge de sénéchal répondait à celle de grand maître des derniers temps. Il y avait encore des espèces de conseillers appelés scabins du palais; dans une chronique citée par Ducange (Dissert. 14, sur Joinville), on leur donne le titre de docteurs ès lois.
Ils devaient connaître toutes les lois en usage dans le royaume.
Les comtes du palais ayant cessé, on ne sait trop à quelle époque, de présider la cour du roi, cet honneur fut confié au grand sénéchal, charge qui augmenta successivement en importance.
Le grand sénéchal est appelé dans les historiens et dans les chartes, tantôt maire, tantôt dapifère de la maison du roi, parce qu’il avait succédé aux maires et aux comtes du palais. Comme grand sénéchal, il prenait le principal étendard à la guerre; comme maire, il rendait la justice dans la cour domaniale du roi, et comme dapifère, il présidait au service de table, au festin royal du sacre. — Il avait inspection sur les prévôtés royales ou les juridictions inférieures des terres domaniales,
Sous le règne de Louis VI, dit le Gros, ainsi que sous celui de Louis VII, dit le Jeune, son fils, nous avons vu de grands progrès sociaux s’accomplir et d’importantes modifications légales se produire; mais en les rappelant, on est naturellement amené à songer à cette grande figure historique de cet abbé Suger, qui en fut en quelque sorte, sous les deux règnes, le principal promoteur: — cet homme qui était, au dire des historiens de son temps, d’une médiocre figure et d’une si basse naissance qu’on ne sait pas même au juste où il est né, n’en fut pas moins le plus grand homme d’Etat de son siècle; on peut avec raison, ainsi que l’a fait remarquer le président Hénault, dans son Abrégé chronologique, tome I, page 193, lui appliquer le mot de Tibère sur Curtius Rufus: «Curtius Rufus, mihi videtur, ex se natus (Tacite.) Curtius Rufus me paraît être né de lui-même.» Mais n’est-ce pas là un titre de plus à la recommandation de l’histoire? — celui-là qui est fils de ses œuvres, n’est-il point de tous points recommandable, lorsque, pour s’avancer, il n’a commis ni bassesse ni lâcheté, et lorsque, arrivé au sommet des honneurs et de la puissance, il ne songe qu’à la bonne gestion des affaires de on pays?
On a dit de l’abbé Suger, les uns qu’il était né à Saint-Denis, les autres à Saint-Omer. — Ce qu’il y a de certain c’est qu’il fut mis à l’âge de dix ans à l’abbaye de Saint-Denis, où Louis, fils de France, depuis Louis le Gros, était élevé.
C’est là sans doute qu’il se lia avec Louis, fils de France, et cette liaison devint la source de sa grandeur, car lorsque Louis fut devenu roi de France, il appela auprès de lui l’abbé Suger, qui fit partie de son conseil. L’abbé Adam étant mort en 1522, Suger le remplaça dans les fonctions d’intendant de la justice; les affaires de la guerre et les négociations étrangères lui furent en outre confiées: son esprit actif et laborieux suffisait à tout.
Louis VII, en partant pour la Palestine, le nomma régent du royaume.
Ses soins s’étendirent alors sur toutes les parties du gouvernement: il ménagea le trésor public avec tant d’économie que, sans charger les peuples, il trouva le moyen d’envoyer au roi de l’argent toutes les fois qu’il en demanda. Il mourut à Saint-Denis en 1152, entre les bras des évêques de Noyon, de Senlis et de Soissons. Le roi honora ses funérailles de sa présence et de ses larmes. C’est Suger qui, sans doute par reconnaissance pour ceux qui l’avaient élevé et par souvenir de son enfance, fit bâtir l’église de Saint-Denis; et ce qui honore encore sa mémoire, c’est qu’on croit, avec beaucoup de vraisemblance, que le projet de la compilation des grandes chroniques connues sous le nom de Chroniques de Saint-Denis, fut son ouvrage. (Mémoires de l’Académie des belles-lettres, tome XV, p. 591.)