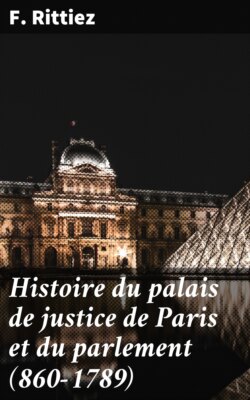Читать книгу Histoire du palais de justice de Paris et du parlement (860-1789) - F. Rittiez - Страница 8
CHAPITRE V.
ОглавлениеPhilippe Auguste habite le Palais. — Jean-sans-Terre. — Jugement rendu contre lui par la cour royale. — Chambres du Palais garnies de paille. — Création de quatre grands baillis. — Archives du roi. — Le sceau royal pillé par les Anglais. — La reine Blanche. — Elle est régente du royaume. — Les cours plénières. — Origine de la baillée aux roses. — Arrêt du parlement de 1541 concernant cet usage.
Le vainqueur de Bouvines, Philippe Auguste, fit du Palais sa résidence habituelle et il y épousa en secondes noces la reine Augelberg, sœur de Canut, roi de Danemark. En l’année 1201, il prit en main la cause du jeune Arthur, fils de Geoffroy, contre Jean dit sans Terre, de Bretagne, son oncle, qui l’avait violemment dépossédé de son duché. Jean-sans-Terre, dans un combat qui eut lieu dans le Poitou, fait Arthur son neveu prisonnier et le met à mort. Après cet odieux attentat, Philippe Auguste le cita à comparaître devant sa cour royale. Cette cour s’assembla au Palais, mais Jean ne comparut pas; un arrêt le déclare rebelle pour n’avoir pas comparu: en conséquence ses terres sont confisquées, et il est condamné à mort comme coupable du meurtre de son neveu, commis dans le ressort du royaume de France.
Philippe Auguste, aussitôt cette sentence rendue, se mit en devoir de l’exécuter; il s’empara incontinent de la Normandie et la réunit à la couronne; il en fit autant de la Touraine, de l’Anjou et du Maine, en sorte qu’il ne resta plus rien en France au roi Jean que la Guyenne.
La cour royale, ou, si l’on veut, la cour des pairs, sous le règne de Philippe Auguste, étendait sa juridiction sur tous les crimes qui pouvaient se commettre sur le territoire de France; et déjà les grands vassaux ne jouissaient plus de cette indépendance complète et absolue qui en faisait de petits souverains dans leurs duchés ou comtés.
Philippe Auguste, pour donner à sa cour royale une autorité incontestée, y introduisit autant de pairs ecclésiastiques qu’il y avait de pairs du roi, c’est-à-dire de grands vassaux, et quoique les pairs ecclésiastiques, relevant eux-mêmes de seigneurs laïques, eussent été choisis dans le duché de France, ils furent dès lors considérés comme grands vassaux, et leur compétence ne fut point déclinée.
On fait remonter au règne de Philippe Auguste l’institution des douze pairs de France; il paraît que dans le procès intenté au roi Jean, ils se formèrent en cour féodale pour le juger.
Les archevêques et évêques faisaient partie de la cour du roi, selon sa volonté ; on y voyait même siéger de simples chevaliers, miles, et des clercs ou simples ecclésiastiques: ceux-ci y étaient sans doute appelés par leurs lumières.
Sous Philippe Auguste, la cour du roi reçut une organisation, sinon nouvelle, du moins mieux appropriée aux besoins du temps et au service de la justice, et on commença à donner à la cour du roi le nom de parlement; on vit dès lors ce parlement s’appliquer à soutenir avec fermeté la politique royale.
Plus heureux que Louis le Gros, qui avait tenté vainement de renouveler les missi dominici de Charlemagne sous le nom de juges exempts, Philippe Auguste parvint à instituer et à maintenir des baillis dans les provinces, et y établit en même temps des sénéchaussées.
Ces justices, présidées par des officiers munis d’instructions royales et choisis parmi des jurisconsultes habiles, devinrent bientôt des centres de domination royale, qui absorbèrent les juridictions féodales. Dès le principe de cette institution, les baillis et sénéchaux ne jugèrent que les causes portées à la cour royale, et n’exerçaient leurs fonctions que dans le domaine du roi, mais bientôt ils étendirent à toutes les causes leur juridiction.
Il n’y eut dans l’origine que quatre baillis, ceux de Vermandois, de Sens, de Mâcon et de Saint-Pierre-le-Moustier; on les multiplia dans la suite à mesure que l’autorité royale gagnait du terrain.
Ils se prévalurent des défauctes de droit et des mauvais jugements rendus dans les cours des barons pour évoquer les causes et les juger eux-mêmes.
Les cas royaux réservés aux baillis s’étendirent peu à peu, et finirent avec le temps par resserrer beaucoup la juridiction des seigneurs.
Lorsque les barons de Champagne vinrent demander à Louis X quels étaient les cas royaux, il leur fit une réponse tant soit peu évasive et fort élastique; «c’est à savoir que
«la royale majesté est étendue ès cas qui de droit ou de
«ancienne coutume peant et doient appartenir à souverain
«prince et à nul autre.» Ordonn. des rois, tome I, p. 606.
C’est à partir du règne de Philippe Auguste qu’on fait aussi remonter l’usage des archives: c’est encore là un point historique qui pourrait soulever plus d’une objection, mais, comme nous l’avons déjà dit, nous évitons toute controverse sans utilité, et nous acceptons cette indication.
A en croire nos chroniqueurs, nos ancêtres tenaient peu de notes des actes les plus importants; ainsi faisait la cour du roi,et on assure, sans en fournir la preuve, que le jugement solennel rendu par cette cour contre le roi Jean-sans-Terre ne fut pas même rédigé. Cependant le roi avait des chartes écrites, des pièces, des titres, des contrats, et par un usage imprudent qui était pratiqué alors, on faisait marcher à la suite de nos rois tous les titres de leur couronne et toutes les chartes de leurs archives.
En 1194, Philippe Auguste ayant été surpris par les Anglais dans une marche près du village de Bellefoge dans le Blaisois, le chartier, le sceau royal, beaucoup d’autres effets devinrent la proie du soldat. La perte du chartier fut sans retour. Les titres se trouvèrent tellement anéantis qu’il n’a plus été possible de les recouvrer.
La Tour de Londres même ne les a point, ou du moins on n’en trouve aucune trace dans la belle collection de Wimer. Ce malheur donna naissance au dépôt des titres dans ce qu’on appelle le trésor des chartes et autres registres qu’on commença de faire en 1220. Quant aux jugements du parlement, on ne peut plus douter qu’il ne s’en soit trouvé dans les chartes qui périrent en 1194. Ils ne devaient pas cependant s’y trouver en grand nombre, puisqu’il arrivait souvent qu’on ne les écrivait pas.
Après cet événement, on commença à mettre quelque ordre dans les chartes de la couronne et dans les arrêts émanés de la cour des pairs, ainsi que nous aurons l’occasion de le constater ultérieurement.
Les chambres du Palais, sous Philippe Auguste, étaient garnies avec de la paille. Ce fait nous indique qu’on n’avait pas encore un grand luxe dans les appartements royaux. C’est dans une lettre, émanée de Philippe Auguste lui-même, que nous le trouvons mentionné. «Nous donnons, dit-il dans cette lettre, à la Maison de Dieu de Paris (aujourd’hui l’Hôtel-Dieu), située devant la grande église de la bienheureuse Marie, pour les pauvres qui s’y trouvent, toute la paille de notre chambre de notre maison de Paris, chaque fois que nous partirons de cette ville.»
— Le règne de Louis VIII (1223-1226) ne nous présente aucun fait notoire touchant l’administration de la justice.
A sa mort, son fils aîné n’était âgé que de douze ans; il fut placé sous la tutelle de sa mère, Blanche de Castille. Son père n’avait pas songé à former un conseil de régence. D’après les lois féodales, la régence et la tutelle du jeune prince revenaient à son oncle, Philippe le Hurepel, comte de Bourgogne. Mais cette régence n’était pas rassurante au point de vue de la nationalité ; le clergé ne la voyait pas de bon œil, et le cardinal Saint-Ange, légat du pape, l’archevêque de Sens et l’évêque de Beauvais attestèrent que le roi Louis VIII avait, sur son lit de mort, nommé régente Blanche de Castille, sa veuve.
C’était, depuis l’avènement des Capétiens, la première fois qu’une femme gouvernait le monde féodal. Cette femme aborda cette tâche avec fermeté ; elle était jeune et belle, et d’une grande piété. Cependant on la trouve mêlée aux épisodes de galanterie du temps; mais ceci n’est pas notre affaire, et ce qui nous importe à nous, c’est de constater le fait d’une régence déférée à une femme en dehors du droit féodal.
Une coalition redoutable de grands vassaux se forme contre elle; elle détache de cette coalition Thibaut, comte de Champagne, qui met son épée à son service avec un dévouement tout chevaleresque, et elle finit par triompher du mauvais vouloir de tous les barons français.
La régente assistait souvent aux cours plénières; elle les embellissait de sa présence et en faisait le plus bel ornement.
Les cours plénières ont tenu une grande place dans les mœurs féodales, et, à ce titre, elles doivent fixer notre attention.
On appelait cours plénières de magnifiques assemblées, présidées par les rois, qui se tenaient à Noël, ou à Pâques, ou à l’occasion d’un mariage, ou autre sujet de joie extraordinaire, tantôt dans un de leurs palais, tantôt dans quelque grande ville, quelquefois en pleine campagne, toujours en un lieu commode pour y loger les grands seigneurs. Ducange (Dissertation IV sur l’histoire de saint Louis) nous apprend que tous étaient invités à cette assemblée et obligés de s’y trouver; la plupart n’y assistaient qu’à regret, tant à cause de la dépense où le voyage les engageait, que parce que, plus ils affectaient de vivre chez eux en souverains, plus on s’étudiait à la cour à les humilier et à les tenir dans le respect.
La fête commençait par une messe solennelle pendant laquelle le célébrant, qui était toujours un évêque, assisté d’autres prélats, mettait au roi, avant l’épître, une couronne sur la tête. Le roi ne quittait cette couronne qu’en se couchant; il l’avait à table et au bal. Pendant la durée des cours plénières, le roi faisait des largesses au peuple, et pendant les entremets, des hérauts d’armes semaient de l’argent. Il y avait, l’après-dîner, pêche, jeu, chasse, danseurs de corde, plaisantins, jongleurs et pantomimes. Les plaisantins faisaient des contes, les jongleurs jouaient de la vielle et faisaient leurs tours d’adresse. C’était, dans ce temps-là, l’instrument le plus estimé ; les pantomimes, par leurs gestes, représentaient les comédies; la fête n’était bonne qu’autant qu’il y avait force jongleurs et baladins; c’était tellement l’usage que Louis le Débonnaire, quelque aversion qu’il eût pour les plaisirs ou les spectacles, n’était pas seulement obligé d’appeler à ces fêtes des acteurs de toutes sortes, mais encore de se trouver, par complaisance pour le peuple, aux pièces qu’ils représentaient.
«Pendant sept ou huit jours, dit Ducange, que durait une cour plénière, on n’y était pas si occupé de bonne chère qu’on n’y parlât aussi d’affaires, et le prince y rendait la justice au peuple; on ne savait, sous Clovis, sous Pepin, sous Hugues Capet, ni plus de trois cents ans après, ce que c’était que gens de justice. Chacun était jugé selon les lois de son état. A l’égard du peuple, il était jugé dans les bourgs et dans les villages, par des juges appelés centeniers, et par les comtes dans la ville. Les juges étaient tous d’épée; ils n’étaient juges que pour un temps; ils tenaient leurs assises dans un champ, dans un cimetière, aux portes des villes ou des églises, dans une rue, sur un rempart, toujours en un lieu public, où les parties pussent avoir un accès libre et facile. On conçoit, ajoute ensuite le même auteur, après avoir rappelé le désordre du temps, prouvé suffisamment par la trêve du Seigneur, stipulée depuis le mercredi jusqu’au lundi de chaque semaine, à quel degré les guerres de seigneurs à seigneurs étaient parvenues, et qu’au milieu de ce désordre, il devenait souvent impossible à nos barons de France de se réunir en parlement.»
Ce fut dans la tenue d’une de ces cours plénières que prit naissance un usage appelé la baillée aux roses, qui consistait à présenter, chaque année, le 6 mai, des bouquets de roses à chacun des membres du parlement.
Le 6 mai de l’année 1227, la reine Blanche se rendit à Poitiers, accompagnée du jeune roi, son fils, pour y tenir cour plénière.
Elle avait pour cortége plusieurs grands vassaux, des pairs de France et des conseillers de sa cour, car, tout en tenant cour plénière, elle se proposait d’expédier les affaires de justice, ainsi d’ailleurs que cela se pratiquait.
Son entrée à Poitiers fut pompeuse et magnifique, et l’on vit la régente s’avancer, pleine de grâces et souriante, au milieu des échevins et des bourgeois, couverts de leurs habits de cérémonie, sur un magnifique cheval, richement caparaçonné. A sa droite, était son jeune fils, et à sa gauche, Thibaut, comte de Champagne. Après les grands seigneurs et les pairs, venaient, montés sur des mules pacifiques, messieurs les conseillers de la cour, parmi lesquels on remarquait leur premier président, Pierre Dubuisson, âgé alors de 89 ans. Son grand âge ne l’empêchait pas de remplir les graves et austères fonctions de sa charge.
Le premier président, nous dit M. de Bast dans ses intéressantes Galeries du Palais de justice, et auquel nous empruntons une partie de ces détails, était accompagné de sa fille, jeune personne pleine de grâces et d’esprit, élevée dans les principes les plus purs.
Aussitôt après l’entrée solennelle, il y eut cérémonie religieuse. Quand elle fut terminée, la reine régente et le jeune roi se rendirent dans la maison du grand argentier de la couronne.
Cette maison touchait aux remparts de la ville et se trouvait entourée de tous côtés par des champs couverts de rosiers en fleurs.
La reine Blanche, en s’installant dans cette maison, voulut que ses conseillers fussent logés commodément auprès d’elle.
La jeune Marie, la fille du premier président, fit l’admiration de la cour plénière et fut grandement remarquée au milieu des fêtes et réjouissances qui se firent; mais elle, tout entière consacrée aux soins qu’elle prodiguait à son vieux père, ne songeait guère aux sentiments qu’elle avait pu inspirer à quelques jeunes seigneurs.
L’un d’eux, le comte de la Marche, jeune pair de France, était vivement épris d’elle; en sa qualité de pair de France, il siégeait avec les parlementaires.
Il fit, pour plaire à Marie, maintes démarches, et un soir il vint même jusque sous ses fenêtres chanter quelques romances.
Alors cette fenêtre s’entr’ouvrit, le comte de la Marche s’approcha, mais pour recevoir une verte remontrance. — La jeune Marie lui demanda si c’était ainsi qu’il se préparait à prononcer sur les affaires qui allaient être soumises à la cour.
Le comte de la Marche la comprit et se retira tout aussitôt.
Il avait à faire un rapport dès le lendemain devant la cour: il consacra les heures qui lui restaient à le préparer, et ce jour-là même, la reine vint en personne présider l’audience.
Le comte de la Marche, quand arriva son tour de faire le rapport de l’affaire dont il avait été chargé, prit la parole avec une admirable netteté, et exposa tous les faits d’une manière si claire et si lucide, que la cour et les assistants en furent frappés.
Les conclusions de son rapport furent adoptées. La reine, l’affaire jugée, le manda tout aussitôt: Comte de la Marche, lui dit-elle, vous venez de nous donner une belle preuve de votre éloquence, mais persisterez vous dans la voie dans laquelle vous venez d’entrer?
— Je ferai tous mes efforts pour persister, répondit-il.
— Très-bien, mais soyez sincère: a qui devons-nous ce changement?
Le comte de la Marche, tout ému, jette un regard vers Marie, qui se trouvait à côté de la reine; la jeune fille se mit à rougir.
Blanche de Castille se penche alors vers le jeune comte et lui dit à voix basse: «Je me promenais avec le comte Thibaut aux champs des rosiers, lorsque la parole celeste vous est venue.» Se tournant ensuite vers le premier président Dubuisson: «Messire, lui dit-elle, vous êtes dès ce moment chancelier de France; et vous, ma belle amie, ajouta-t-elle en tendant la main à Marie, demain, la cour vous saluera du nom de comtesse de la Marche.» Le premier président, la jeune Marie et le comte de la Marche s’inclinèrent avec respect. Puis la reine se levant et s’adressant aux jeunes pairs qui l’entouraient: «Messeigneurs, leur dit-elle, imitez l’exemple du comte de la Marche; quant à moi, afin de perpétuer à jamais le souvenir de Marie, je veux qu’en mémoire de l’union qui va se contracter, les jeunes pairs présentent à mon parlement un tribut annuel le 1er mai. — Et de quoi se composera ce tribut? dit le comte de Champagne. — De roses, répliqua la reine, et ce tribut sera certes payé exactement. Et c’est vous, comte de la Marche, qui rendrez le premier cet hommage à mou parlement.» Le comte de la Marche fit aussitôt cueillir des roses dans les champs voisins par les pages, qui les placèrent dans des corbeilles de jonc, et s’empressa de les offrir aux membres de la cour.
Depuis cette époque, chaque année, au 1er mai, le plus jeune des pairs de France présentait au nom de ses collègues des paniers de roses à messieurs du parlement: c’était là une naïve et touchante cérémonie, ayant tout à la fois un caractère sérieux et chevaleresque.
Cet usage était encore dans toute sa vigueur au seizième siècle.
Il donna lieu à un débat de préséance, en 1541, entre le jeune duc de Bourbon-Montpensier et le duc de Nevers, tous deux pairs de France. L’arrêt qui intervint sur cette contestation rapporte ainsi le sujet qui la provoqua. Me Marillac, pour le duc de Montpensier, a dit qu’il était question de bailler les roses a la cour, ainsi que les anciens pairs ont accoutumé de le faire, et que le duc de Montpensier se proposait de les bailler, attendu que par le roi, Montpensier avait été érigé en duché-pairie; mais que le duc du Nevers, tenant en pairie ledit duché, voulait, au bail des dites roses, précéder le duc de Montpensier et se référait a la cour pour décider qui premier les donnerait Le vendredi 17 juin, intervint un arrêt du parlement portant que, ayant égard à la qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairie, la cour ordonnait que le duc de Montpensier pourrait, le premier, bailler les roses. (Journal du parlement.)
C’est vers l’année 1589 qu’on cessa de pratiquer cet usage de la baillee aux roses. Alors le parlement de Paris, tout entier sous la domination des ligueurs n’était plus considéré comme la véritable cour des pairs.
Sauval (tome II, p. 446) nous donne quelques détails sur la baillée aux roses, sans en préciser l’origine. «Le roi, dit-il, paie tous les ans un droit de roses au parlement et a toutes les cours souveraines de Paris.» Puis il ajoute «que les pairs de France des derniers temps dévoient et présentoient eux-mêmes des roses au parlement en avril, mai et juin, lorsqu’on appeloit leurs rôles, et que les princes étrangers, les cardinaux, les princes du sang, les enfants de France, même les rois et les reines de Navarre en faisoient autant.»
Voici en quels termes il raconte l’incident qui s’éleva entre le jeune duc de Bourbon Montpensier et le duc de Nevers, incident dont nous venons de parler ci dessus:
«En 1541, dit-il, le parlement de Paris, au mois de juin, ordonna que Louis de Bourbon, prince du sang, duc de Montpensier, créé duc et pair en 1556, lui présenteroit des roses avant François de Clèves; duc de Nevers, pair de France vers l’an 1503, et n’eut point égard qu’a cette redevance il s’agissoit de patrie, non de sang et de naissance. Quarante-cinq ans après, son fils le porta bien plus haut, car il disputa le pas en parcide occasion, au roi de Navarre, créé lue de Vendôme en 1534. et de Beaumont.
«En 1575, Charles de Lorraine, duc de Guise et comte d’En, le disputa aussi au duc de Nevers, plus ancien pair que lui, et le 23 juin, ne laissa pas que d’emporter par arrêt; mais comme ils plaidoient en conseil pour la préséance, ce fut à condition que ce seroit sans préjudice. »
Sauval nous dit ensuite qu’on ne sait point ni la cause ni le temps où cet usage commença; mais Sauvai prouve sur ce point qu’il n’a pas suffisamment scruté nos annales judiciaires; on voit également qu’il ne s’est pas suffisamment renseigné, quand il avance qu’on ne sait pas davantage à quelle époque il a cessé.