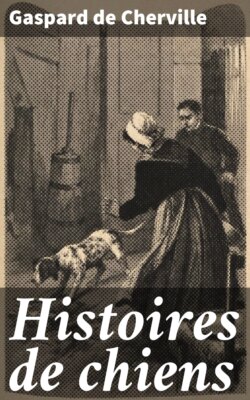Читать книгу Histoires de chiens - Gaspard de Cherville - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Une Chasse périlleuse.
ОглавлениеM. de Bourguebus tint parole.
Les quinze jours étaient loin de s’être écoulés que de notables mutations s’étaient opérées dans le personnel du château de Colleville, dont la physionomie se trouvait être considérablement modifiée.
Convaincu d’impénitence finale, le cuisinier avait été congédié ; le maître d’hôtel avait obtenu sa grâce mais à la condition expresse qu’il consentirait à ne plus se chausser de sabots, qu’il renoncerait au tricot, à ses pompes et à ses œuvres. Un cocher vif et alerte avait été adjoint au vieux serviteur qui, en raison de son âge et de ses services, devait être considéré comme un de ces meubles meublants dont on ne doit pas songer à se débarrasser. Un renfort de deux valets avait déchargé la domesticité des inconvénients du cumul et ne l’astreignait plus à mener de front les travaux agricoles et les soins de l’intérieur. Les meubles s’étaient trouvés époussetés; les tapisseries brossées; en même temps, on avait vu disparaître ce qu’il y avait de trop criard dans les contrastes de l’ameublement.
La sollicitude du chevalier s’était surtout exercée sur les instruments de son plaisir favori: dix-huit vigoureux chiens normands, bien créancés et parfaitement ensemble, non seulement par le pied, mais encore par la taille et par le poil, avaient pris la place des hourets de M. de Chastel-Chignon, lesquels avaient reçu leurs invalides au bout d’une corde. Cette meute satisfaisante avait été mise sous les ordres d’un piqueur expérimenté ; enfin, en attendant que M. de Chastel-Chignon pût aller à Paris renouveler ses équipages, M. de Bourguebus avait jugé convenable de faire acheter à sa nièce une charmante jument de selle, sur laquelle la jeune fille n’avait plus, comme devant, la tournure d’une fermière qui revenait du marché.
Les fermages arriérés, quelques fonds que le châtelain avait laissés à la disposition de sa fille avant son départ, pourvurent à toutes ces dépenses.
Cette révolution intime ne s’était pas opérée sans que Mlle Denise eût manifesté à plusieurs reprises une vive inquiétude, touchant la satisfaction qu’elle causerait à monsieur son père; mais les terreurs de la nièce n’eurent d’autre résultat que d’amener un sourire quelque peu sardonique sur les lèvres du chevalier.
Le vieux gentilhomme exagérait encore l’esprit profondément autoritaire de son époque,
Pour M. de Bourguebus, la conviction de la suprématie que son âge et sa parenté lui donnaient sur son neveu, atteignait aux proportions d’une foi. Ce titre de chef de la famille, que nous l’avons entendu revendiquer, n’était point à ses yeux un mot sonore et vide; il croyait fermement que ce mot faisait de lui un souverain, dont la volonté était une loi.
Une autre idée de ce temps-là contribuait à accentuer ce sentiment autocratique.
Cette idée était celle qu’un limon spécial et privilégié avait servi à pétrir les gentilshommes. Sous son empire, M. de Bourguebus avait pardonné la mésalliance de sa sœur, il ne l’avait point oubliée. En raison de l’infériorité de la naissance de son neveu, s’il ne le considérait plus comme taillable et corvéable à merci et miséricorde, il lui semblait du moins que la conscience de cette infériorité devait être un sûr garant de la soumission de celui-ci.
Aussi, lorsque sa petite-nièce le suppliait d’attendre le retour de M. de Chastel-Chignon pour compléter ce que le digne chevalier appelait ses «petites réformes», répondait-il invariablement que ce père devait être nécessairement enthousiasmé en retrouvant une véritable demeure de grand seigneur, au lieu et place du singulier logis dans lequel l’ignorance des usages du monde l’avait jusqu’alors condamné à vivre; il terminait en affirmant que si quelque chose l’inquiétait lui-même, c’était de trouver le moyen d’échapper à l’effusion de la reconnaissance que son neveu ne pouvait manquer de manifester.
Si Mlle Denise souscrivit un peu inconsidérément à toutes les volontés de son oncle, cependant il fut un point sur lequel le chevalier vit échouer la considérable influence qu’il avait conquise sur l’esprit de sa nièce, ce fut une antipathie que toute son éloquence fut impuissante à atténuer.
Cette antipathie était celle dont M. de Tancarville était l’objet.
M. de Bourguebus avait lutté avec une constance, avec une énergie dignes d’un meilleur résultat. Il s’y était pris de toutes les façons pour battre en brèche ce qu’il appelait les absurdes préventions d’une tète sans cervelle. D’abord, avec la conviction, avec la chaleur d’un véritable agent matrimonial, il avait longuement énuméré les mérites de son jeune ami, sa naissance, les agréments de sa physionomie, la distinction de sa tournure, la noblesse et l’élévation de ses sentiments. Mlle Denise acquiesçait volontiers à ce panégyrique; elle reconnaissait, sans se faire prier, que le cornette possédait des vertus qui le prédestinaient à devenir le modèle et l’exemple de tous les maris passés, présents et futurs; mais lorsque le, vieil oncle, convaincu qu’il avait forcé des yeux récalcitrants de s’ouvrir à la lumière, laissait sa physionomie s’épanouir dans l’expression d’une satisfaction orgueilleuse, la maligne fille ajoutait timidement que, par malheur, dans la nomenclature qu’il avait entreprise, le chevalier avait oublié un défaut, défaut fort léger, il est vrai, mais qui n’en suffisait pas moins à ternir tout le lustre des qualités de son client.
«Lequel? s’écriait M. de Bourguebus avec l’accent du défi.
— C’est que je ne l’aime pas,» répliquait humblement Mlle Denise.
Cet argument, dont il ne paraissait nullement apprécier la valeur, devenait pour le chevalier le signal d’un changement de tactique. L’impatience que cette resistance excitait en lui l’emportait sur la réserve diplomatique qui lui était indiquée par sa profonde connaissance du tempérament féminin; il oubliait complètement, ce qu’il savait de reste, que la violence, que les menaces devaient compromettre davantage la cause qu’il entendait servir: il en appellerait à son neveu Chastel-Chignon de l’injustifiable caprice de son enfant; — une fille bien née n’avait d’autre volonté que celle de ses parents; —il existait de bons couvents pour avoir raison de ces têtes rebelles, etc., car, une fois sur cette pente, le vieux gentilhomme ne s’arrêtait guère que lorsque sa voix étranglée par la colère ne lui fournissait plus que des sons gutturaux et inintelligibles.
Mlle Denise ne se targuait pas d’habileté, et pourtant elle trouvait tout de suite la plus adroite de toutes les défenses qu’elle eût à opposer au flux de cet emportement: elle renonçait à discuter, elle se taisait, courbait la tête, et le chevalier sentait sur ses mains, que la jeune fille tenait entre les siennes, tomber une à une de grosses larmes. Puis, ne tenant aucune espèce de compte des efforts du bonhomme pour se soustraire à ses caresses, les lui imposant par une douce violence, elle s’asseyait sur ses genoux, passait un bras autour de sa tête chenue, et appuyant son visage sur la poitrine du vieil oncle, elle s’abandonnait à ses sanglots, déplorant sa destinée, prenant le ciel à témoin que si le couvent lui faisait peur, c’était uniquement parce qu’il l’enlèverait à la tendresse d’un parent qu’elle ne chérissait pas moins que son père lui-même.
«Mais, par la morbleu!» s’écriait celui-ci d’une voix que l’émotion rendait tremblante, «pour que tu ne sois pas malheureuse, je croiserais l’épée contre tous les paladins de la Table ronde! Si ton bonheur était en péril, tout vieux, tout invalide que je suis, je me sens capable de bouleverser le monde! Comment peux-tu supposer que je te contraigne jamais à épouser un homme qui ne te plairait pas; je veux que celui-là te plaise, voilà tout.
— Moi, je ne demande pas mieux, mon bon oncle; seulement, vous l’avouerez, j’ai quelques raisons de prétendre que, sur ce point, ce n’est pas à moi que vos leçons devraient s’adresser.»
M. de Bourguebus était frappé de la justesse de ce raisonnement: il confessait qu’en effet tous les torts étaient du côté de M. de Tancarville et la trêve se scellait par un baiser sur le front de la jeune fille. Sans désemparer, le chevalier retournait à son donjon, où, immédiatement, il entamait une nouvelle campagne, dont son jeune ami devenait l’objectif.
Hélas! de ce côté également, il n’avait à enregistrer que des défaites.
La première impression que Mlle de Chastel-Chignon avait produite sur le jeune officier avait été défavorable. Cependant l’esprit de celui-ci était trop perspicace pour qu’il ne reconnût pas bien vite ce que ces dehors, un peu hautains, cachaient d’aimables et solides qualités. Malheureusement, il ne pouvait douter que son vieil ami n’eût communiqué les projets matrimoniaux à sa nièce, et la froideur significative avec laquelle elle l’avait traité, lors de sa première visite à Colleville, l’avait cruellement blessé. D’autant plus fier qu’il se sentait plus pauvre, il se refusait obstinément à toute démarche qui eût affirmé les intentions qui lui avaient été prêtées par son hôte; autant qu’il dépendait de lui, il s’efforçait de faire comprendre à la riche héritière que de telles ambitions n’avaient jamais été les siennes.
Longtemps, il s’était contenté de traiter comme une plaisanterie la négociation conjugale dont l’entretenait M. de Bourguebus; mais lorsque l’argument machiavélique de Mlle Denise eut rejeté sur le jeune officier la responsabilité de ses refus, ce qui n’avait été que la manifestation d’une amitié dévouée, d’une sollicitude affectueuse, prit le caractère d’une véritable persécution, et M. de Tancarville, obsédé par les objurgations de son vieux camarade, fut forcé de lui représenter que, si touché qu’il fût de l’excellence de ses intentions, s’il s’obstinait à le vouloir marier malgré vent et marée, il se verrait forcé d’abréger le séjour qu’il lui avait promis de faire dans sa maison.
Et pour témoigner plus fermement de ses intentions, il s’abstint de toute visite au château, il refusa énergiquement d’y suivre son hôte, que ses grandes réformes y appelaient chaque jour. Afin d’échapper à l’espèce de lutte qu’il avait à subir chaque fois que le chevalier se disposait à se rendre auprès de sa nièce, il consacra ses matinées à de longues promenades dans les bois des environs et sur les falaises qui bordent la mer de ce côté du littoral.
Je n’ai pas besoin d’ajouter que les petits succès que M. de Bourguebus obtenait d’un autre côté étaient loin de compenser à ses yeux le désastre de son projet capital; il enrageait et ne trouvait pas d’expressions assez dures pour qualifier comme il faut l’aveuglement obstiné de deux jeunes fous. Toutefois, il n’avait perdu ni l’espérance, ni le courage; bien souvent, il était donné à l’une et l’autre des parties contractantes de l’entendre, au milieu d’une causerie, parler de leur avenir, exactement comme s’il avait trouvé en eux de dociles instruments à ses volontés; de le voir escompter des résultats d’une union qu’ils étaient tous les deux également décidés à laisser dans le domaine des songes creux.
Un jour que M. de Bourguebus avait essayé la nouvelle meute dont il avait doté le chenil de son neveu, lorsqu’il fut de retour au donjon, il prit un malin plaisir à raconter à son jeune ami, qui s’était refusé de prendre part à la fête, tous les incidents qui l’avaient rendue charmante, et, comme celui-ci reconnaissait qu’effectivement une pareille chasse était de nature à passionner ceux qui avaient eu le bonheur d’y assister:
«Il ne tenait qu’à vous d’en jouir avec nous, mon cher,» répliqua le vétéran, avec une nuance d’aigreur; «ce n’est pas faute à moi de l’avoir sollicité comme une grâce. Il eût fallu probablement que ma nièce vînt se mettre aux genoux de Votre Grandeur pour la décider? Eh bien, soyez satisfait. Cette petite personne que vous accusez d’être fière et hautaine, s’est aperçue de votre absence; elle m’a chargé de vous dire qu’elle la regrettait et de vous proposer de monter un des chevaux de son père à notre prochain laisser-courre. Trouvez-vous la démarche assez flatteuse, et prétendez-vous toujours que mon amitié pour vous se repaît d’illusions touchant la bonne volonté de ma nièce à votre égard?»
M. de Tancarville interrompit son vieux camarade pour le rappeler à leurs conventions sur cette question délicate; il ajouta qu’il était extrêmement touché de l’aimable attention de Mlle de Chastel-Chignon; que, bien qu’il ne se fit aucune illusion sur sa valeur, et qu’il la tînt pour une politesse banale adressée à l’ami d’un oncle qu’elle aimait, il n’irait pas moins offrir ses remerciements à la jeune châtelaine; qu’il se considérait comme d’autant plus obligé à ce devoir, que sa santé le forçait de décliner la gracieuse proposition qui lui était faite.
L’inanité du prétexte sautait aux yeux de M. de Bourguebus. Les cinq à six lieues de promenade que le jeune homme accomplissait tous les jours témoignaient que jamais il ne s’était mieux porté ; d’un autre côté, il savait qu’excellent cavalier, M. de Tancarville aimait passionnément le cheval. Cette fin de non-recevoir, opposée à une invitation qui avait ravivé ses espérances, il la considéra comme une offense, et son dépit prit les proportions de l’indignation. Il souhaita le bonsoir à son jeune ami d’un ton très sec. Le lendemain, lorsque M. de Tancarville, auquel les dispositions de son hôte n’avaient point échappé, annonça à celui-ci qu’il désirait retourner à Paris, le chevalier n’essaya point de le retenir et, pour la première fois, il ne trouva aucune objection à opposer à cette résolution.
Mais le jour que le jeune officier avait fixé pour son départ se trouva être précisément celui de la seconde chasse de l’équipage; lorsqu’il quitta sa chambre, Jean-Louis lui annonça que, depuis longtemps déjà, M. de Bourguebus était monté à cheval et parti pour Colleville.
M. de Tancarville ne voulut pas quitter le donjon sans avoir embrassé son vieux camarade, sans lui avoir exprimé sa reconnaissance pour cette paternelle amitié, aux manifestations de laquelle il pouvait bien ne pas se prêter, mais dont il n’appréciait pas moins la valeur. D’un autre côté, et quels que fussent les sentiments que lui inspirait Mlle de Chastel-Chignon, il lui paraissait convenable de ne pas s’éloigner sans avoir été prendre congé d’elle; il ajourna donc son voyage, et suivant son habitude, après déjeuner, il s’en alla promener ses rêveries du côté de la mer.
De leur côté, M. de Bourguebus et sa nièce étaient déjà en chasse.
Le cerf, un daguet , avait été attaqué avec douze chiens, les six autres ayant été disposés en relais volant. Les conditions dans lesquelles on se trouvait faisaient de ce petit nombre de chiens un avantage; les bois n’étaient pas assez étendus pour qu’un animal, plus vivement mené, ne se décidât pas à en sortir et à essayer de quelques refuites , où les veneurs eussent eu peine à le suivre. Devant ce petit bruit, le daguet se contenta longtemps de tourner dans son enceinte d’attaque, se donnant plusieurs fois à vue et semblant, tant il paraissait peu effrayé, trouver quelque charme dans les fanfares qui éclataient derrière lui.
Cependant, il finit par soupçonner que ce joli tapage n’était pas précisément une aubade dont on avait entendu le régaler. Avec cet admirable instinct, qui touche de si près à l’intelligence, il avait compris que les bois de Colleville, situés sur les contreforts des falaises, rocheux et profondément découpés comme celles-ci, sillonnés de gorges marécageuses et abondamment garnis de fauves, étaient plus propices à ses défenses que le plateau à peine ondulé sur lequel il était. Une seconde fois, il débucha ; mais, au lieu de revenir dans ses premières voies, il prit la plaine dans la direction de Cany, suivit, pendant plus d’un quart de lieue, un chemin pierreux, sur lequel ni branches, ni broussailles ne devaient garder le sentiment de son passage, se jeta à gauche, et il avait réussi à distancer les chiens lorsqu’il se trouva dans son pays.
Admirablement gorgés , très collés à la voie, les recrues de M. de Bourguebus avaient les inconvénients de leurs qualités, ils étaient lents. A mesure qu’ils se trouvèrent plus loin du cerf, ils commencèrent à chasser plus froidement, et quand les veneurs arrivèrent en vue des masses grisâtres étagées sur un triple rang de collines qui étaient les bois de Colleville, la chasse avait pris le caractère d’un rapprocher . On alla ainsi en ânonnant Jusqu’à la bordure des taillis qui s’ouvraient sur une suite de coteaux dénudés, jalonnés çà et là de quelques touffes d’ajoncs rabougris et, à l’extrémité desquels, à une lieue de distance à peu près, on apercevait les sombres aspérités de la cime des falaises. Là, la meute se trouva tout à fait à bout de voie, et sur ce terrain desséché par le vent du nord, il devint impossible d’en revoir .
La journée s’avançait: dans la saison d’hiver la terre se refroidit rapidement aussitôt que le soleil décline; les moments devenaient de plus en plus précieux.
Même quand il chassait à courre, le chevalier ne se décidait pas à se séparer de Caporal: seulement alors il le tenait en laisse. Or, depuis que la meute était en défaut, il remarquait que son chien flairait la bruyère avec une expression voluptueuse, que les vives ondulations de sa queue rendaient encore plus caractéristique. Il pria sa nièce de tenir son cheval, et se disposa à mettre pied à terre.
Vainement celle-ci, lui représentant qu’avec son infirmité et sans aide une telle manœuvre n’était pas sans danger, lui proposa-t-elle d’appeler leurs gens, le vieux gentilhomme s’en défendit comme d’une offense.
«A mon âge, ma chère enfant,» lui répondit-il, «les victoires sont trop rares pour que, volontiers, on se résigne à les partager; laissez-moi donc tout l’honneur de la mienne. J’en suis sûr, Caporal empaume la bonne voie; regardez, il marque qu’une fois encore cette voie tourne à gauche, et vous avez assez d’expérience en vénerie pour ne pas ignorer qu’un cerf tourne toujours sur la même main. Il y a donc gros à parier qu’il est sur notre bête de meute.»
Les difficultés contre lesquelles le bon chevalier eut à lutter pour quitter la selle donnaient la mesure du sacrifice qu’il était disposé à faire au triomphe de son opinion. Enfin, il parvint à se laisser glisser sur le sol et détacha Caporal.
Aussitôt qu’il se sentit libre, le chien fit une pointe, revint sur ses pas, aspira largement, à plusieurs reprises, les émanations que la subtilité de son odorat lui faisait découvrir, et partit, le nez en terre, le plumet au vent, en jetant, de loin en loin, un aboi étouffé.
Il avait pris une direction parallèle à la lisière des bois, et M. de Bourguebus qui, à l’aide de son fouet, avait improvisé une béquille, le suivait clopin-clopant, quoique avec une agilité étonnante chez un invalide.
Caporal semblait partager l’animation de son maître, il s’échauffait de plus en plus; de plus en plus son allure devenait rapide et ses abois accentués. Il alla jusqu’ à un buisson de saules, de nerpruns et de genêts rabougris, qui, dans le bas-fond du coteau, couvrait à peine un arpent de terrain; il y pénétra. Il n’eut pas plutôt disparu, qu’on l’entendit donner à pleine voix et que le cerf bondit dans la lande.
«Tayaut! Rallie, ah! Rallie, ah!» cria le chevalier, dont l’ivresse est plus facile à deviner qu’à décrire.
Beaucoup plus curieux de jouir du succès de Caporal que d’aller retrouver son cheval, il s’assit sur un rocher, et sonna une vue que des poumons de vingt ans n’auraient certes pas soufflée aussi triomphante.
Le daguet tendait à rentrer en forêt, et cela d’autant plus franchement que Caporal le serrait de très près. Dans cet espace découvert, en vingt bonds il rejoignit le fuyard; il lui soufflait au poil; lorsque le cerf, éperdu, fit sa trouée dans le taillis, le chien semblait prêt à lui monter sur le cimier.
Le chevalier de Bourguebus avait dû cesser de sonner, il riait à se rompre les côtes.
Le daguet était destiné à tomber de Charybde en Scylla. Aux appels qu’il avait entendus, le piqueur s’était disposé à rallier; mais, comme il arrive souvent en pareil cas, il se préoccupa plutôt d’entraîner-rapidement la meute que de la maintenir en bon ordre; ses chiens s’éparpillèrent, et ce fut ainsi que l’un d’eux venant, pour ainsi dire, buter dans le cerf, le prit à vue. Celui-ci se jeta de côté par un écart; mais, dans sa nouvelle direction, il rencontra un nouvel ennemi, la meute l’entourait, la retraite de ce côté lui était coupée; il reprit la lande et vint débucher à cinq ou six pas de Mlle Denise.
Déjà très animé, le cheval de M. de Bourguebus, épouvanté par l’apparition subite du daguet, par le passage de ce tourbillon hurlant et criant, échappa à la faible main qui le retenait, et, avec l’instinct de son emploi, l’étrier lui battant au flanc, il s’élança derrière la meute. Pour lutter contre lui, Mlle Denise avait été forcée de lâcher la bride de la jument qu’elle montait; celle-ci partit également à fond de train dans la même direction. L’allure que cette bête avait prise était si précipitée que la jeune fille voulut la modérer; en essayant de la ramener, elle s’aperçut que sa jument ne répondait plus au mors.
M. de Bourguebus n’avait pu saisir tous les détails de cet incident; il avait trop l’habitude de ces sortes d’événements pour attacher une grande importance à la fugue de sa monture; il avait vu sa nièce prendre le galop, il était convaincu que c’était volontairement. Il était partagé entre l’enthousiasme qu’excitait en lui le curieux spectacle dont il venait d’être le témoin et l’orgueilleuse satisfaction avec laquelle il suivait du regard la hardie écuyère dans sa course furieuse à travers la lande; à chacun des obstacles qu’elle franchissait, il en faisait les honneurs à l’énergie, à l’intrépidité de sa nièce, il criait: bravo! comme si elle eût pu l’entendre, il applaudissait encore lorsqu’elle disparut avec la meute derrière une ondulation du terrain.
AUSSITÔT QU’IL SE SENTIT LIBRE, IL PARTIT LE NEZ EN TERRE (p. 70).
En ce moment, le piqueur débouchait du bois à de rapides allures. M. de Bourguebus le hêla.
«De grâce, ne m’arrêtez pas, monsieur le chevalier,» lui répondit cet homme; «je crains bien de ne pas arriver à temps pour empêcher un grand malheur.
— Quel malheur? Que veux-tu dire?
— Les falaises! monsieur le chevalier, et je tremble que mademoiselle ne soit plus maîtresse de sa jument.»
En jetant cette phrase sinistre au vieux gentilhomme, le brave garçon se lança à son tour à travers les bruyères, en fouillant de ses éperons les flancs de son cheval jusqu’ à en faire sortir le sang.
Le chevalier de Bourguebus fit un immense effort pour respirer; le souffle lui manquait; il venait de se rappeler un terrible drame de sa jeunesse. Sur cette même lande, il avait vu un cerf, poussé par les chiens, se précipiter du haut des falaises, une partie de la meute et un cavalier le suivre dans cette horrible chute.
Il jeta un regard plein d’angoisse dans la direction de la mer.
J’ai dit que les collines allaient s’étageant jusqu’à la dernière; après l’extrême pli de terrain que formait celle qui se reliait aux falaises, on découvrait une dentelure de rochers grisâtres, qui se détachaient sur l’horizon et au bas desquels, à deux cents pieds, mugissait l’Océan.
Sur cet espace crayeux, le pauvre chevalier vit d’abord apparaître un point noir, le cerf; derrière, un chien qu’il reconnut, Caporal; puis la meute se montra en peloton allongé ; enfin, à leur tour, du dernier bas-fond sortirent deux chevaux, sur l’un desquels il distingua les plis flottants de la robe de l’amazone.
Alors le courage du vieux soldat, qui dans vingt batailles avait bravé la mort, eut une défaillance: Broyé, brisé, tué, il essaya machinalement de se soustraire au spectacle de la scène horrible qui allait se passer; il se fit un masque de ses deux mains, et de sa poitrine s’échappa un rauque râlement, un sanglot doublé d’une imprécation.
Son anéantissement était si complet, il avait si absolument perdu le sentiment de ce qui se passait, qu’un homme s’approcha, le toucha à l’épaule sans qu’il l’entendît, sans qu’il s’aperçût du geste.
«Je vois avec plaisir, mon cher oncle,» lui dit le nouveau venu d’une voix vibrante et railleuse; «que Mlle de Chastel-Chignon vous a fait convenablement les honneurs de son château. Il me reste à vous demander de vouloir bien me présenter à elle, car je craindrais qu’elle ne me reconnût pas plus que je n’ai reconnu moi-même ma demeure tout à l’heure, en y rentrant.»
Le malheureux chevalier avait entendu, mais il n’avait pas compris; il avait reconnu son neveu Chastel-Chignon, mais son esprit était fermé à tout ce qui n’était pas le lugubre événement qui, à cet instant même, s’accomplissait. Denise, cette charmante petite Denise qu’il aimait tant, morte, et mourant d’une mort horrible, laissant des lambeaux de ses chairs à tous les rochers; cette pensée résumait pour lui le passé, le présent, l’avenir, le monde, tout.
Il s’affaissa lentement sur sa jambe valide; son corps se ploya comme si la vie allait l’abandonner. Ainsi prosterné devant le père de sa nièce infortunée, il joignit les mains, et de ses lèvres blêmies et tremblantes s’échappa ce seul mot:
«Pardon!»