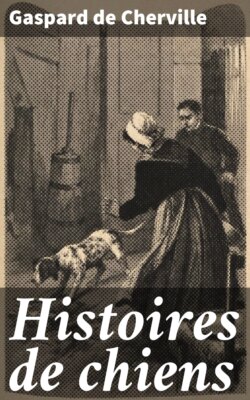Читать книгу Histoires de chiens - Gaspard de Cherville - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE PREMIER
Table des matières
Des origines du Maître de Colleville.
Dans la plantureuse Normandie, la fécondité du sol triomphe presque partout des vents âpres qui atrophient la végétation dans le voisinage immédiat de la mer. Lorsque l’on quitte la petite ville de Fécamp, en suivant la vallée, on n’a pas encore perdu de vue les falaises arides et crayeuses qui servent de ceinture à l’Océan, que cette végétation accuse sa puissance; à quelques centaines de mètres à peine de cette grève de galets, elle étale toutes ses magnificences.
Les coteaux se chargent de bois épais, où dominent les hêtres au feuillage glauque, dont les troncs blancs et lisses, se détachant sur ce fond d’un vert sombre, ressemblent aux fûts de colonnes de marbre; à droite et à gauche, les champs étagent leurs moissons bariolées, et dans le fond du vallon, des deux côtés d’un petit torrent qui roule ses ondes cristallines sur un fond de cailloux, s’allongent les nappes verdoyantes des prairies.
On fait ainsi deux lieues, découvrant, pour ainsi dire à chaque pas, un nouvel échantillon des splendeurs de cette terre généreuse; alors, sur le flanc de la colline de gauche, on aperçoit le clocher quadrangulaire et les maisons pittoresquement groupées du petit village de Colleville, dont chaque façade, construite en silex et en galets, se zèbre de dessins alternativement noirs et blancs.
A deux cents pas de la dernière maison, à cinquante de la route, derrière les cimes arrondies d’un régiment de pommiers, à l’ombre desquels pousse une herbe fine et drue, un vrai tapis, se dresse une grande tour carrée, dont l’architecture atteste quelques liens de parenté avec l’église du village et dont les murs grisâtres certifient l’antiquité.
De loin, cette haute et sombre silhouette fait croire à un château; mais l’illusion s’évanouit lorsqu’on en approche. La toiture moussue s’est affaissée dans plus d’une partie; çà et là, des sillons noirâtres indiquent des solutions de continuité dans l’alignement des tuiles qui la composent; les étroites fenêtres des étages supérieurs sont brisées, veuves de leurs carreaux, à la grande liesse des pigeons qui vont et viennent du dehors à l’intérieur et de l’intérieur au dehors; les ouvertures du rez-de-chaussée sont closes, mais avec des bottes de paille. D’ailleurs, un long bâtiment neuf, aux toits d’un rouge violent, qui flanque la vieille construction, accuse nettement que l’une et l’autre ont reçu une destination agricole et économique.
Par le volet supérieur, toujours ouvert, de la porte de la première, on aperçoit le bahut et l’armoire de chêne aux ferrures luisantes, le luxe du cultivateur, et les clayons où sèchent les fromages, une de ses industries; du seuil de cette porte jusqu’au verger, le sol est couvert d’une épaisse couche de litière mise en demeure de devenir fumier, égayée de quelques flaques d’une eau roussâtre dans laquelle barbotent les canards, tandis que leurs commères, les poules, grattent et picorent sur la terre ferme; de tous les côtés, des instruments d’agriculture qui se reposent complètent le tableau.
Si la qualité actuelle de cette habitation ne peut être mise en doute, les gloires de son passé n’en survivent pas moins à sa déchéance actuelle. Au-dessus du cintre de granit qui fut la poterne, on distingue encore un vestige d’écusson qui a résisté à la double rage du temps et des vandales de 1793; sur l’angle aigu du toit, on remarque un reste de girouette. Les murs effondrés n’ont jamais d’autres parchemins.
En effet, avant de devenir une humble ferme, cette tour avait été une demeure de gentilhomme, ni plus ni moins que le château de Colleville, qui a eu la chance de rester debout au milieu des orages révolutionnaires, et qui, bien que plus d’une fois il ait changé de maître, se dresse encore aujourd’hui au sommet de la colline.
En 1748, époque à laquelle s’ouvre ce récit, la tour et le château appartenaient à deux proches parents, à l’oncle et au neveu; mais, contre l’ordinaire, c’était l’oncle qui se trouvait pourvu de la plus modeste de ces deux propriétés.
Colleville et ses énormes dépendances, ses quatorze métairies, ses bois immenses qui allaient de Valmont aux falaises, avaient le neveu pour maître.
Commençons donc par faire connaître le plus riche de ces deux personnages à nos lecteurs; la richesse est le seul ordre hiérarchique qui soit légitime à l’époque où nous écrivons.
M. Tuvache de Chastel-Chignon , seigneur de Col-leville, des Mazures et autres lieux, avait été un des plus fameux maltôtiers de l’intendance de Normandie.
Bien qu’aussi largement pourvu en noms sonores qu’en espèces sonnantes, il était, bien entendu, dubiæ nobilitatis , une locution par laquelle la politesse du temps désignait ceux dont la roture n’était rien moins que douteuse. Son père, un plumitif affamé des environs de Lavaur, était arrivé à Rouen sans sou ni maille, mais avec une de ces facondes, une de ces outrecuidances gasconnes qui suffisent aux enfants de la Garonne pour pousser partout, comme disait le grand roi Henri. D’un poste infime des gabelles, M. Tuvache, — il n’était que Tuvache alors, — était rapidement arrivé à un emploi supérieur.
A force de râcler le plancher des greniers à sel, il avait ramassé quelques centaines de mille livres. Elles lui servirent à pénétrer dans l’intimité de Jean Duval de Bourguebus, alors seigneur de Colleville et conseiller au Parlement de Normandie, un robin qui s’était donné la tâche de faire fleurir à Rouen les mœurs de la cour; il prêta généreusement son argent à ce magistrat coureur de ruelles, mais sans oublier ses sûretés.
Lorsque le conseiller mourut, laissant des affaires un peu plus qu’embrouillées et deux enfants, un fils et une fille, le Tuvache daigna accepter le fief de Colleville en remboursement de ce qui lui était dû, et il fit mieux, il proposa au tuteur d’épouser Mlle de Bourguebus, afin que le bien ne sortit pas tout à fait de la famille; en face de la ruine des enfants du conseiller, cela pouvait passer pour de la générosité.
On lui livra la jeune personne, que l’on projetait de mettre en religion, et, du même coup, le maltôtier se trouva pourvu d’une seigneurie, d’un beau placement et d’une femme qui lui donnait tous les parlementaires normands pour alliés; sans compter que son action magnanime lui valait l’admiration de ses concitoyens.
Son fils, celui qui doit figurer dans cette histoire, lui succéda dans sa charge et dans ses ambitions. Peut-être modifia-t-il, comme la voix publique l’en accusait, les antiques procédés de ses devanciers par un trait de génie, en inventant le mélange d’une espèce de sable de roche au sel de Sa Majesté ; toujours est-il que son ascension vers la fortune fut encore plus rapide que ne l’avait été celle de son père.
En 1748, outre des biens meubles considérables, il avait acquis la terre de Chastel-Chignon, en Anjou, quelques maisons à Rouen, et il avait encore arrondi le domaine de Colleville par l’adjonction de plusieurs fermes qu’il avait successivement achetées de son oncle, M. de Bourguebus, lequel, de son côté, ne suivait pas moins pieusement que le fils de sa sœur les traditions bien différentes que lui avaient léguées l’auteur de ses jours.
Ce Tuvache, IIe du nom, était de bonne heure resté veuf avec une fille unique. Cette fille avait alors dix-sept ans, il songeait à l’établir; mais la fièvre de l’enrichissement le tenait d’une façon si absolue, que, s’il se préoccupait avec quelque anxiété des bénéfices matériels qu’il pouvait tirer de cette affaire, il ne songeait pas le moins du monde à consulter les petites idées que Mlle Denise, c’était le nom de son enfant, pouvait nourrir sur cette question intéressante.